



 | 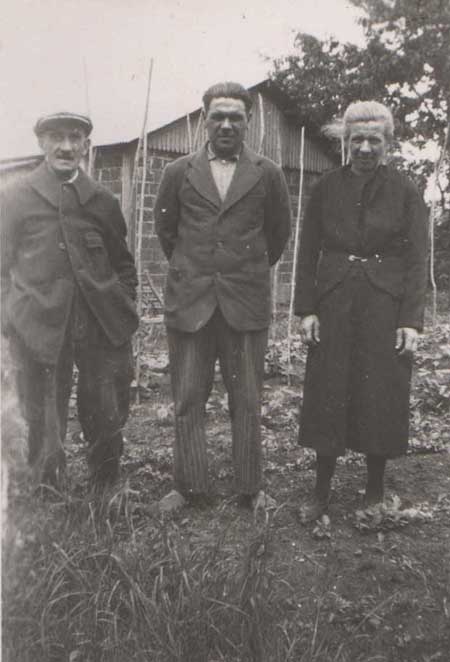 |
 |  |
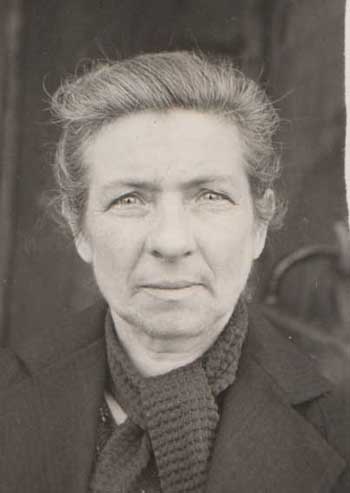 |
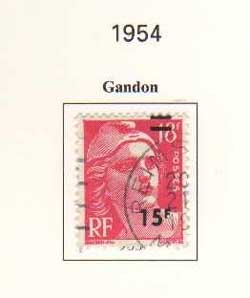 |
 |
| Carte postale de Charmont (années 50) : La Place et l'Hôtel du Lion d'Or (La maison des SAVART est indiquée par une croix bleue, en haut à gauche) |
 |
| Carte postale de Charmont (années 50) : La Colonie de Vacances et le Centre (Arrivée au village en venant de Vroïl) |
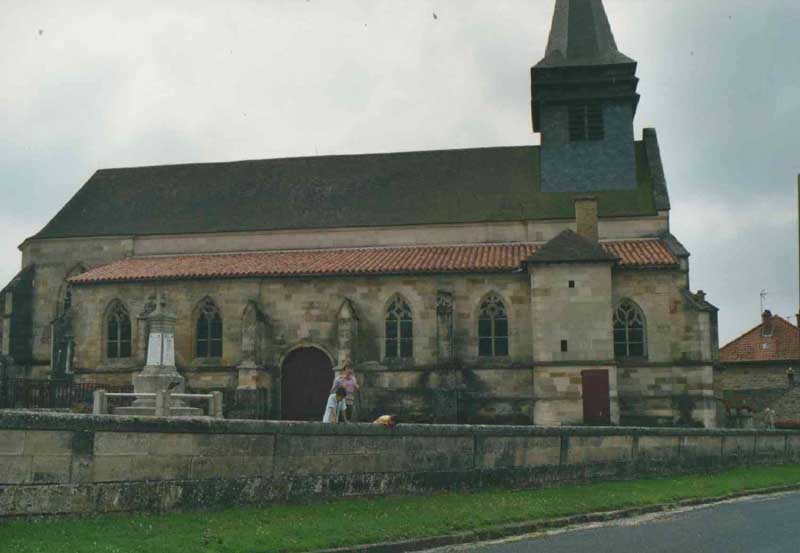 |
| Eglise et cimetière de Charmont (Marne) |
 |
| Tombe de la famille SAVART au cimetière de Charmont (Marne) - 23 Août 2002 |
 |
| La maison autrefois habitée par les SAVART, rue neuve |