|
|
|
|
|
|
LAMBERT Jean, Maurice, Jules.
Né le 22 novembre 1898
à Dijon (Côte d’Or), mort le 31 août 1961
à Saint-Pardoux-la-Croisille (Corrèze) ; ingénieur ; administrateur des Colonies
(1927-1945) ; militant communiste.
Jean Lambert naquit dans une famille d’intellectuels. Son père, Charles Lambert (Mouzon, Ardennes, 1866 - Nice, 1960), agrégé de grammaire à 24 ans, exerça comme professeur successivement au Puy-en-Velay (Haute-Loire), à Annecy (Haute-Savoie), puis à la Faculté des lettres de Dijon (Côte d’Or), où il devint Doyen, tout en étant par ailleurs très engagé dans la diffusion de l’espéranto. Son frère aîné, Paul, élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, mobilisé en 1914, fut tué au combat le 13 mars 1915. Sa sœur, Odette, était professeur d’histoire à Nice.
Très tôt, Lambert
développa des idées révolutionnaires que la mort
de son frère renforça encore. Après son
baccalauréat latin-sciences-philosophie, il entra à la
Faculté de médecine, mais ses études furent
interrompues par son engagement en 1918, comme médecin auxiliaire sur le front des Vosges, puis à Salonique. Après sa
démobilisation, il décida ne pas poursuivre en
médecine, ressentant une « aversion pour la
mentalité du corps médical… ». Admis
à l’Institut électrotechnique de Grenoble, il en
sortit avec un diplôme d’ingénieur
électricien et électro-métallurgiste.
D’abord militant à l’Association républicaine
des anciens combattants, secrétaire départemental
à la propagande en mars 1922, il adhéra bientôt au
Parti communiste (au plus tard, en 1922) et s’y distingua par la
violence de ses attaques contre le « centre » du Parti
représenté dans l’Isère par le docteur
Ricard. Quand ce dernier démissionna, il proposa, en
décembre 1922, une motion prononçant son exclusion. Il
était, à cette époque, secrétaire
fédéral adjoint du Parti communiste, aux
côtés de Guibbert, l’ancien secrétaire
départemental de l’ARAC. En mars 1923, Lambert
renonça à cette responsabilité pour « raison
de force majeure », mais demeura membre du comité
directeur de la Fédération. En mai 1923, il fut
inculpé de « provocation de militaires à la
désobéissance » pour deux articles publiés
dans Le Travailleur des Savoie et de l’Isère des 10 mars
et 21 avril, sous le pseudonyme de Louis Savoy. Il aurait alors
déclaré à la police, au cours de son
interrogatoire, le 13 mai 1923, qu’il approuvait les actes des
Vaillant, Bonnot, Caserio. En 1924, il défendit, dans la section
de Grenoble, une motion qui fut adoptée et qu’il
présenta ensuite au congrès fédéral de
l’Isère, demandant que le Parti communiste
considérant le « mauvais rendement » de la «
participation aux élections bourgeoises », décida
de ne présenter aux élections législatives que des
« candidats d’amnistie » là où ils
auraient « de grandes chances ». La motion ayant
été adoptée au congrès
fédéral, il fut délégué au
congrès du Parti à Lyon, avec Pierreton, pour la
défendre, mais elle n’obtint que leurs deux voix. Au
même congrès fédéral, il se prononça
contre l’adoption du rapport politique de la direction du parti,
critiquant vivement la politique du « front unique » et ce
qu’il considérait comme « l’étouffement
de l’opposition ».
Dans les années 1922-1925, il
fut licencié de plusieurs entreprises en raison de ses opinions
politiques. Malgré ses diplômes, il lui devint impossible
de trouver du travail. Il présenta alors le concours de
l’École coloniale où il fut admis major.
A partir de janvier 1927, il quitta la métropole pour
l’Afrique noire où il remplit des fonctions
d’administrateur des colonies (Moyen-Congo, Tchad,
Côte d’Ivoire, Mauritanie). Son habileté et sa
popularité parmi les populations noires furent reconnues par sa
hiérarchie : « M. Lambert a obtenu à Massakory
[Tchad] des résultats très remarquables […]. Il a
ramené la paix et rétabli l’ordre dans une
région mise en coupe réglée par les pillards et
les brigands […]. Cette transformation n’a
nécessité aucune rigueur inutile, elle a
été réalisée grâce […]
à une compréhension merveilleusement exacte des moyens
à employer. L’intelligence de M. Lambert, sa vaste
culture, ses talents administratifs, son admirable conscience
professionnelle […] sont dignes de la plus haute
considération » (Fort-Lamy, 16 janvier 1931).
Le 10 décembre 1941, alors
qu’il était chef de la Subdivision de Touba (Côte
d’Ivoire), il entra en dissidence vis-à-vis du
régime de Vichy. A la faveur d’une mission
d’inspection à la frontière du Liberia, il quitta
clandestinement la Côte d’Ivoire et rejoignit les
responsables du mouvement démocratique en A.O.F. à
Monrovia. Il se rallia à la France Libre, effectua diverses
missions secrètes, notamment à Accra et à Lagos,
et publia des articles extrêmement virulents anti-allemands et
anti-vichychistes dans la presse clandestine.
Lambert étant, par ses fonctions, « détenteur de secrets intéressant la Défense nationale et sur la situation militaire, politique et économique de la Colonie », le tribunal militaire de Dakar, le 5 septembre 1942, le condamna « à mort par contumace, avec confiscation de tous ses biens », pour « trahison ».
Réhabilité en 1944 par
le général de Gaulle, il reçut la médaille
de la Résistance. Lambert reprit alors ses fonctions en
Côte d’Ivoire comme chef de cabinet du Gouverneur Latrille,
puis chef du bureau des Affaires sociales et politiques. Il rencontra
et se lia d’amitié avec Félix Houphouët (alors
médecin). Lambert le conseilla lorsqu’il se
présenta aux élections d'octobre 1945 et l'aida à
être élu député de Côte d'Ivoire au
Parlement français [sous le nom de Houphouët-Boigny - boigny, signifiant le bélier], malgré des oppositions locales.
Au cours de sa carrière d’administrateur, Lambert fut
plusieurs fois sanctionné et relevé de son poste pour ses
opinions politiques, pour avoir souvent pris le parti des
Indigènes. En octobre 1942, il eut ainsi un grave
différend avec le Comité de l’Église de
Fort-Lamy. En avril 1946, il fit libérer 22 enfants et jeunes
gens prisonniers de Bonaké (Côte d’Ivoire),
condamnés selon lui à une trop lourde peine pour de menus
larcins. En juillet 1946, il s’opposa au secrétaire
général et au chef des Affaires économiques de
Côte d’Ivoire, voulant faire attribuer 25 % des parts
d’importations aux coopératives de planteurs locaux de
Côte d’Ivoire au détriment des
sociétés commerciales. Il fut alors muté en
Mauritanie, puis renvoyé en métropole (mai 1948) et
finalement révoqué (mars 1949). Il fit valoir ses droits
à la retraite, intenta un procès contre le gouvernement
qu’il gagna en Conseil d'État en juillet 1953 et obtint,
en réparation du préjudice subi, une indemnité
égale à cinq ans d’émoluments.
Établi successivement à
Menton (Alpes-Maritimes), à Marseille (Bouches-du-Rhône),
au Beausset (Var), il se retira à La Seyne-sur-mer en 1956. Il
poursuivit ses activités militantes, en suivant toujours avec
attention la situation de l’Afrique noire. Il fit aussi
bénéficier ses camarades ainsi que les élus
communistes de La Seyne, de son expérience et de son
érudition. Présent à toutes les réunions et
à toutes le manifestations (contre le réarmement de
l’Allemagne, pour la paix en Algérie, pour la
résolution pacifique du problème de Berlin, pour la
défense de l’école laïque, pour la
défense des ouvriers de la construction navale,…), il
accomplit tout seul un voyage en Union soviétique après
s’être lancé dans l’apprentissage de la langue
russe.
Lambert était marié et père d’une fille.
Au cimetière de Saint-Pardoux-la-Croisille, sur sa tombe, fut inscrit : « Jean Lambert, ami du peuple ».
ICONOGRAPHIE :
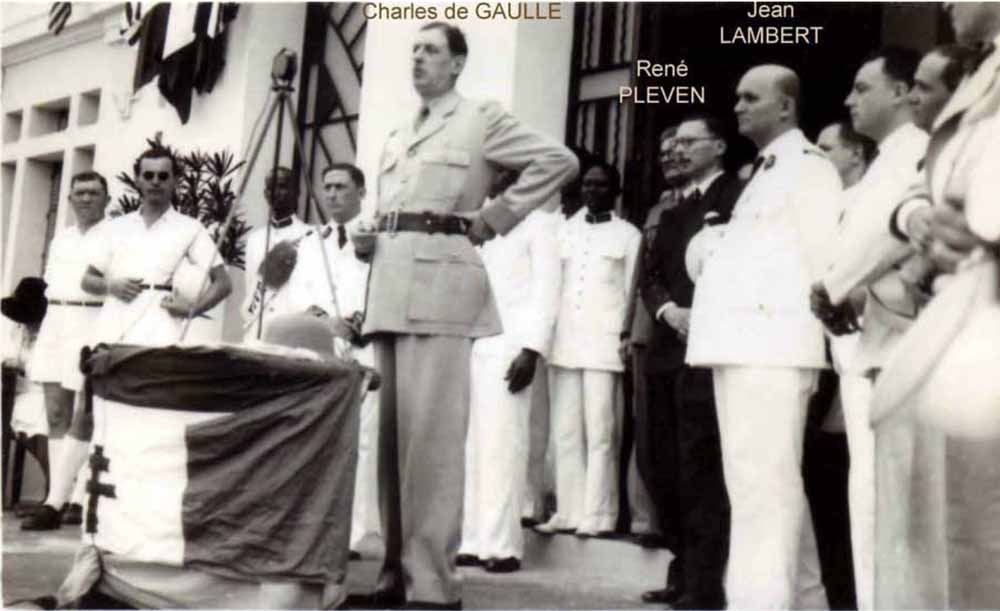 |
| Lambert à la gauche du général De Gaulle en 1944 |
 |
| Lambert dans les années 1950 |
SOURCES : Arch. Dép. Côte-d’Or, 2 E 239/402 —
Arch. Dép. Isère, 77 M 1. — Arch. Dép.
Haute-Loire, 6 E 178/236 — Arch. Dép. Haute Savoie, 4 E
3172 — DBMOF, notice par P. Broué. — Presse locale.
— Sources orales. — Renseignements fournis par
l’intéressé et documents officiels des
gouvernements français, tchadien et ivoirien (1936 à
1948) fournis par sa famille à J-C Autran.