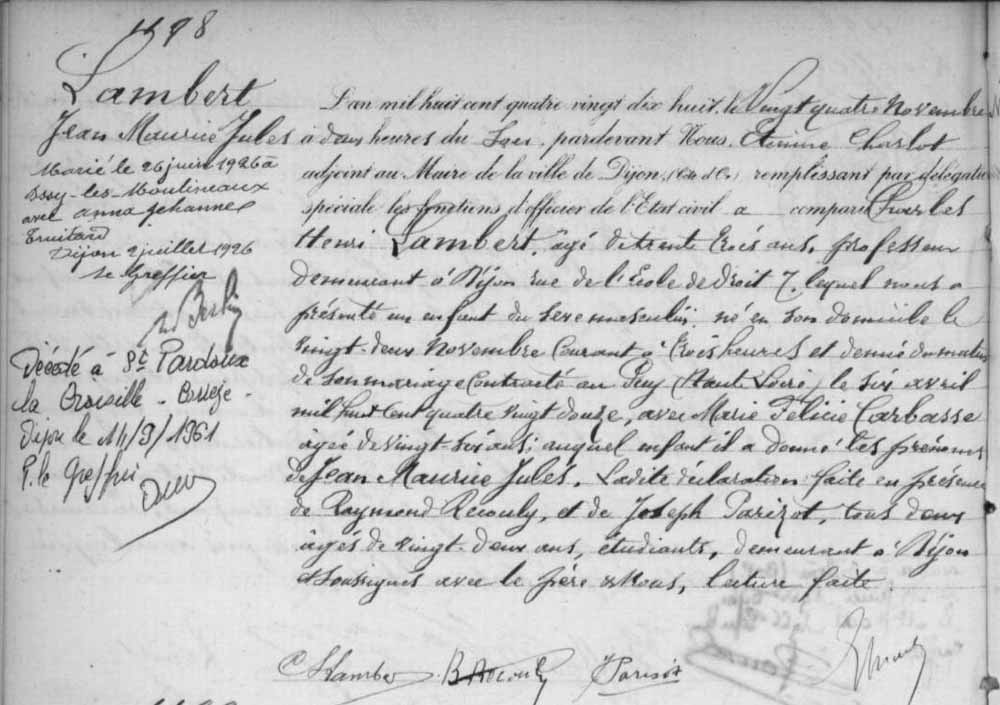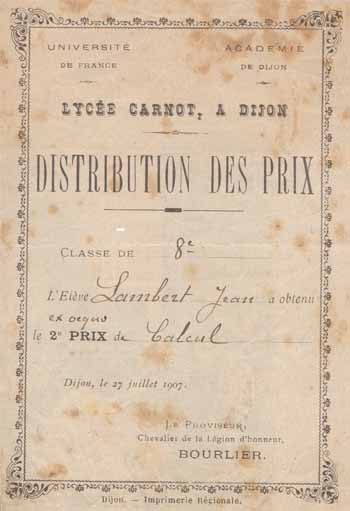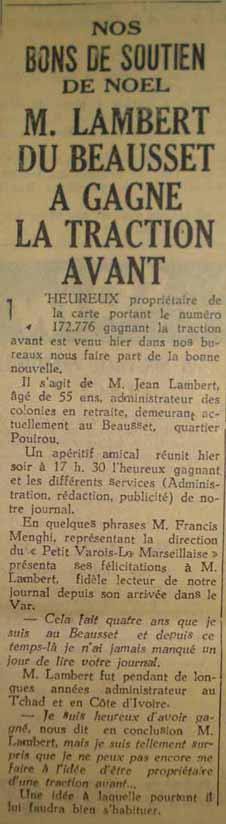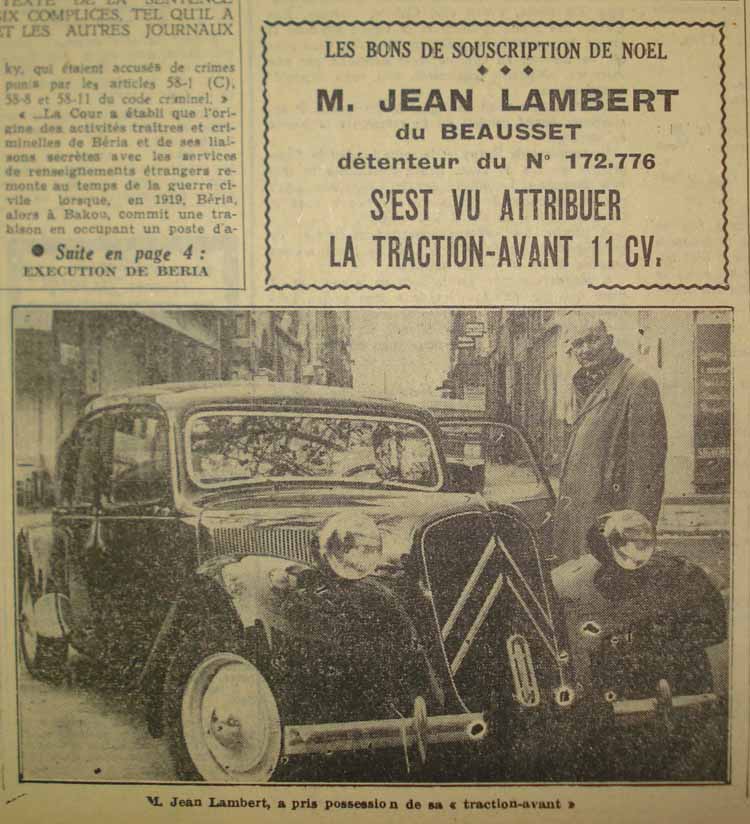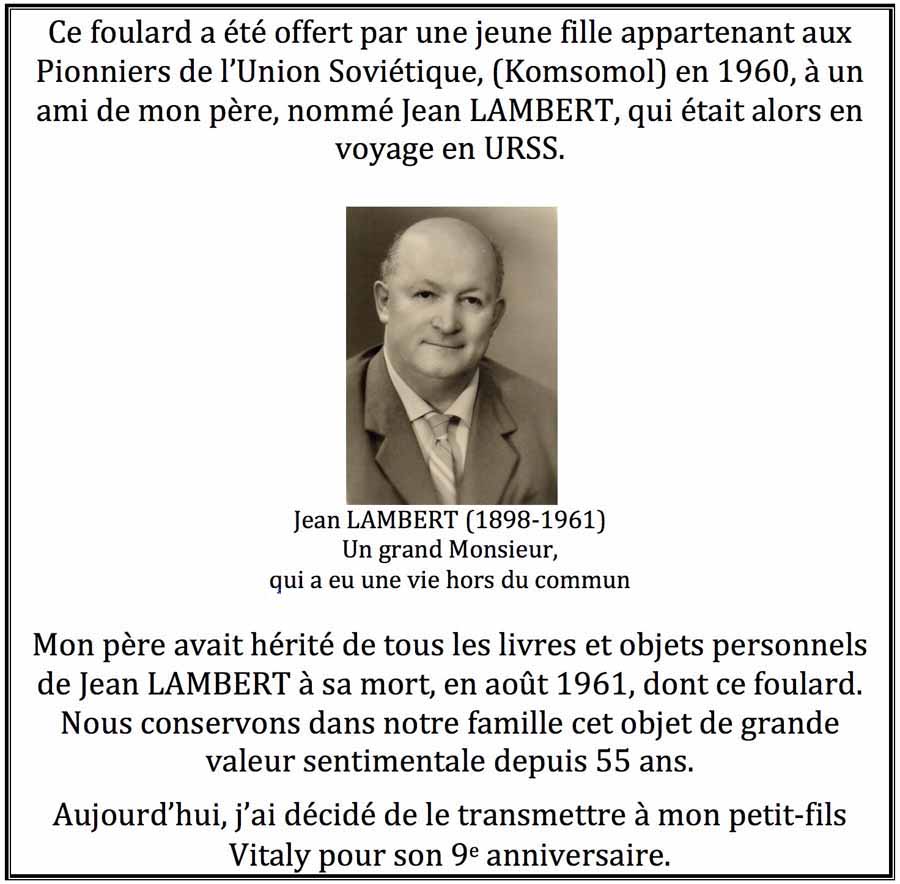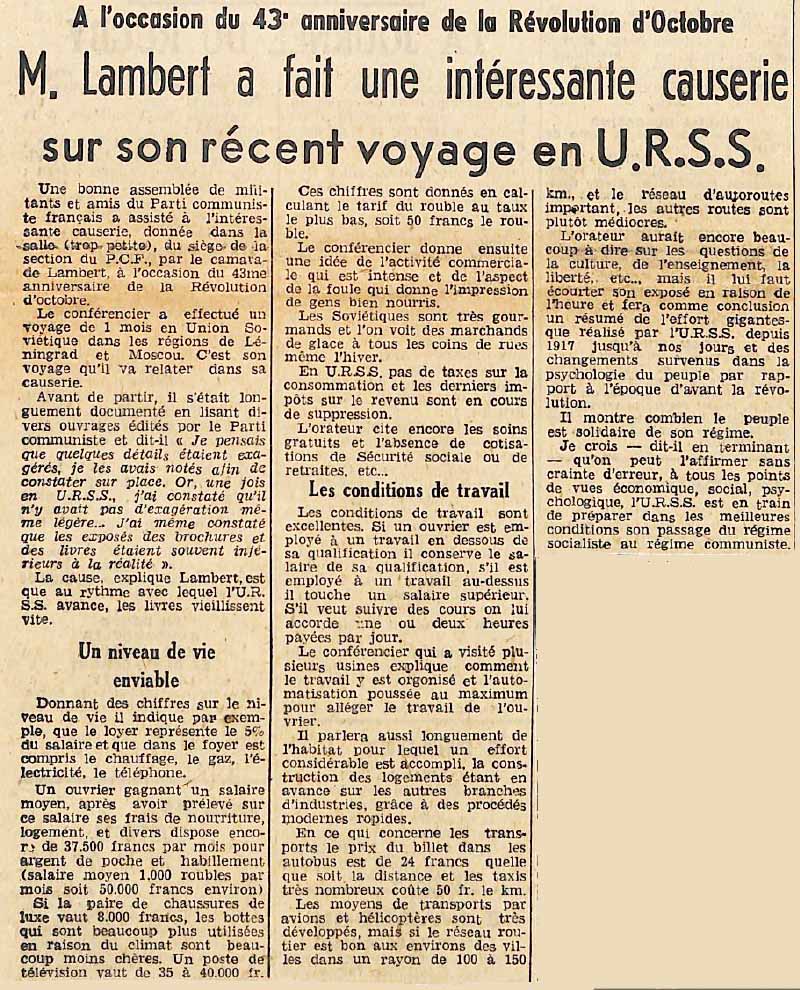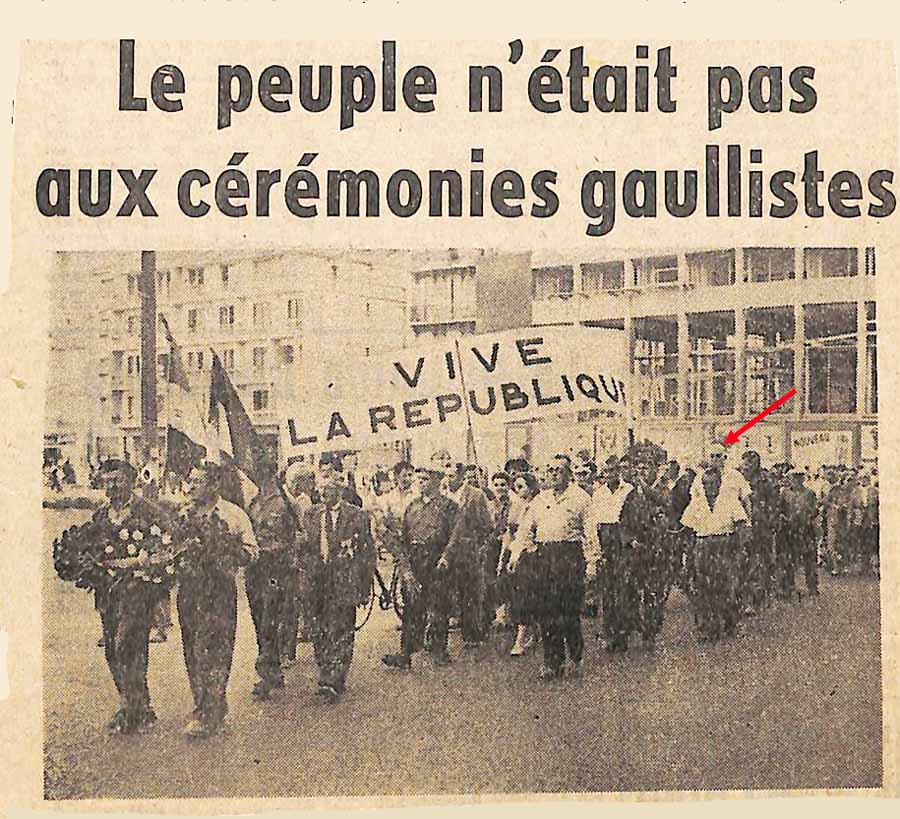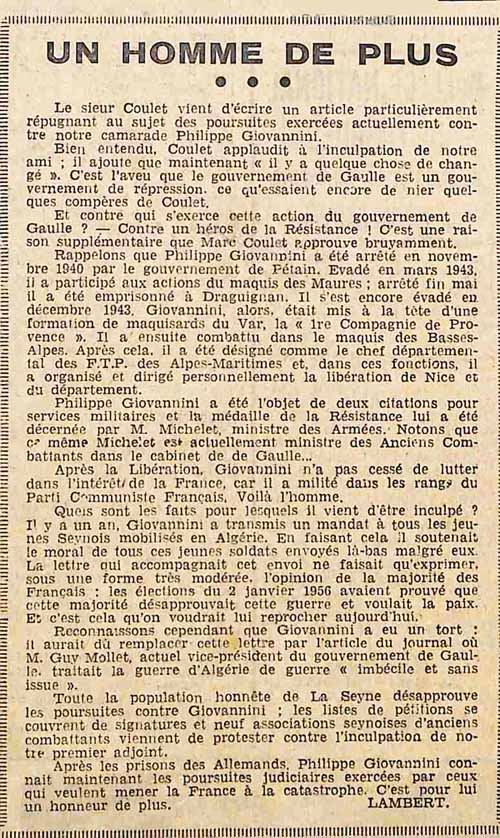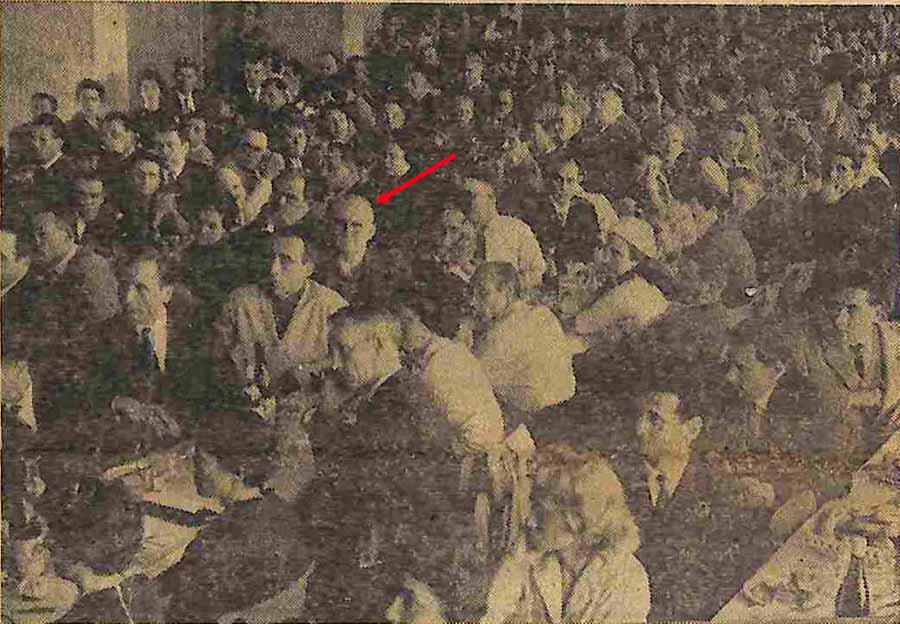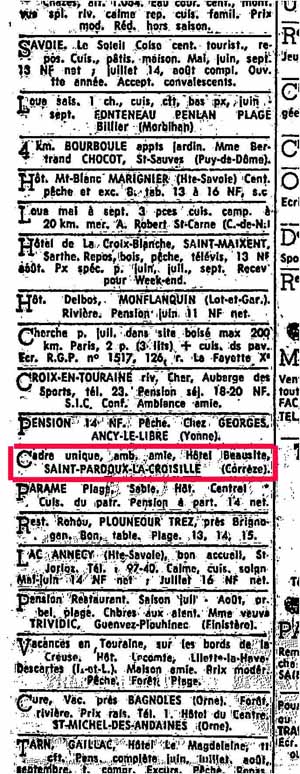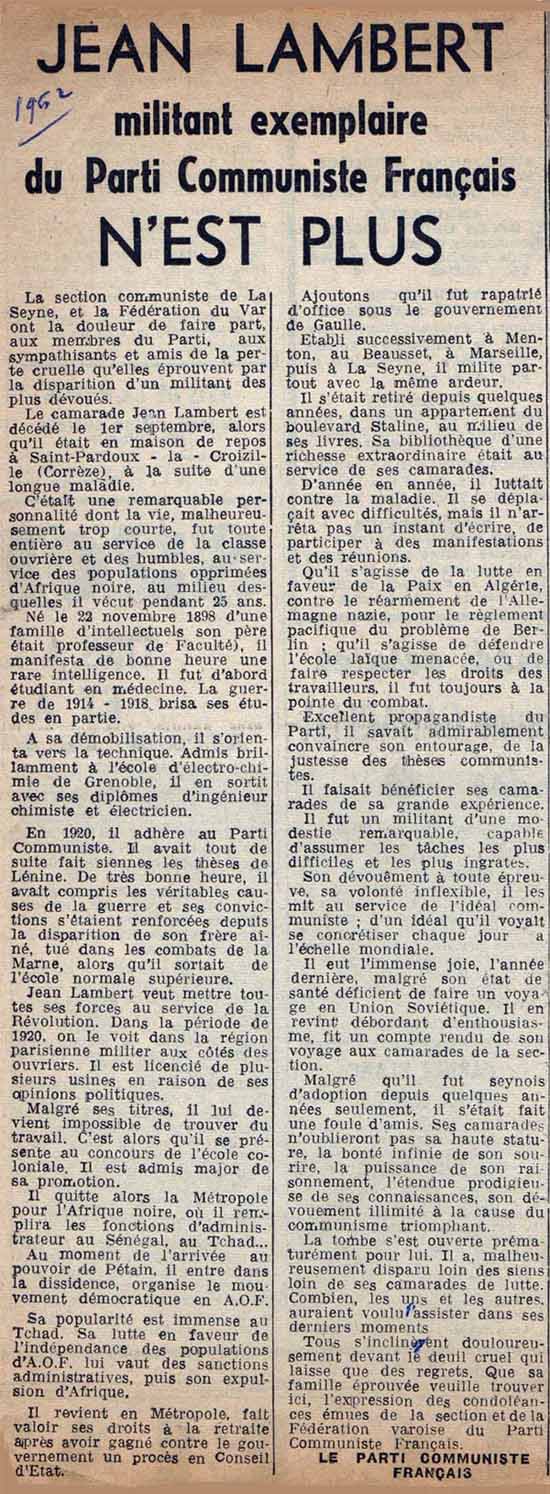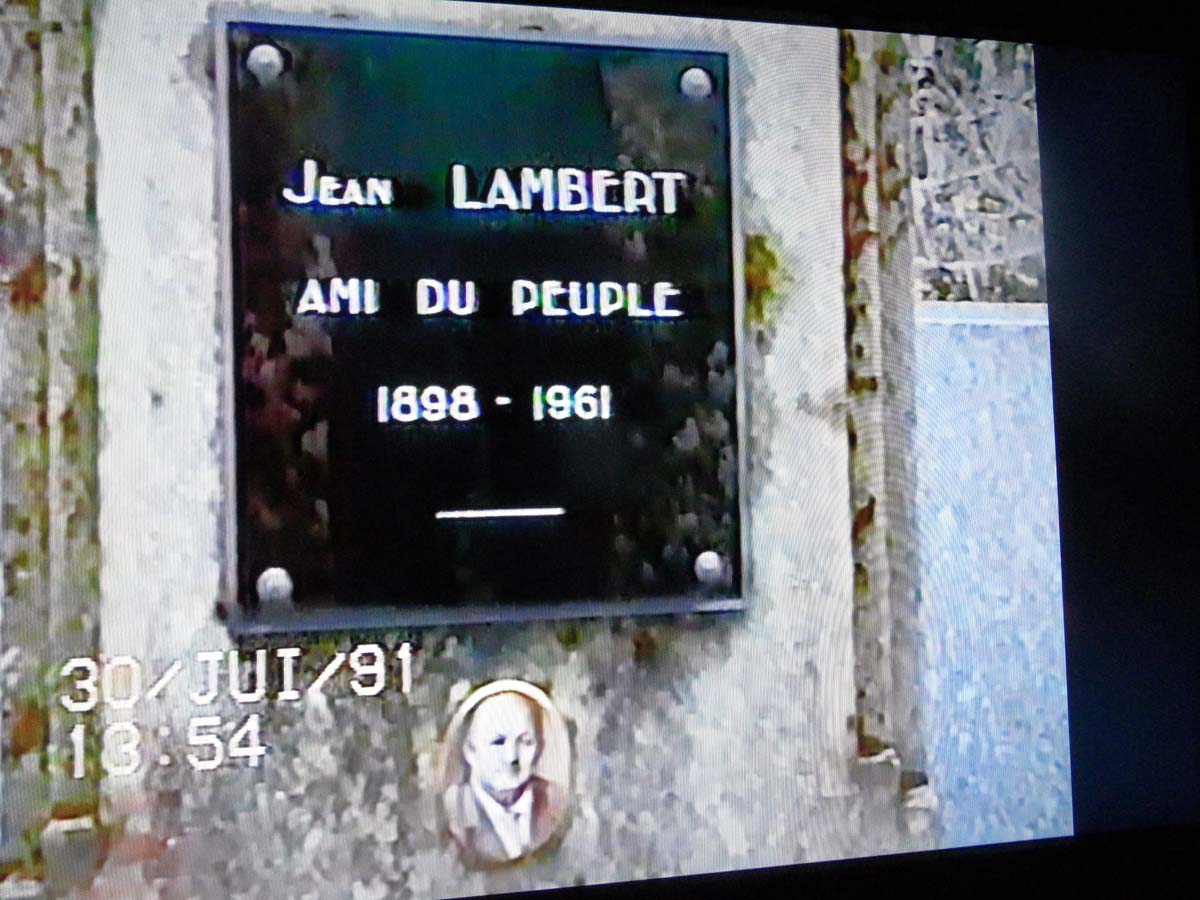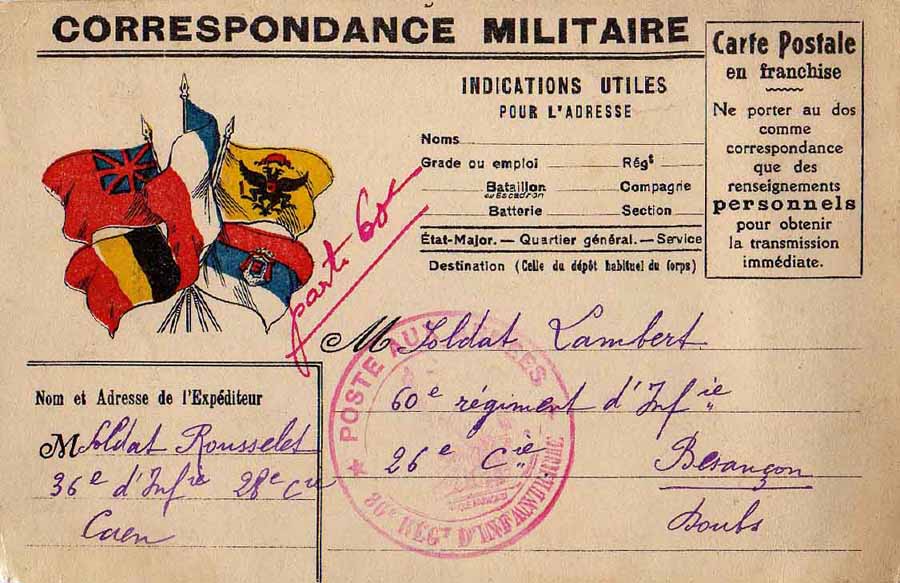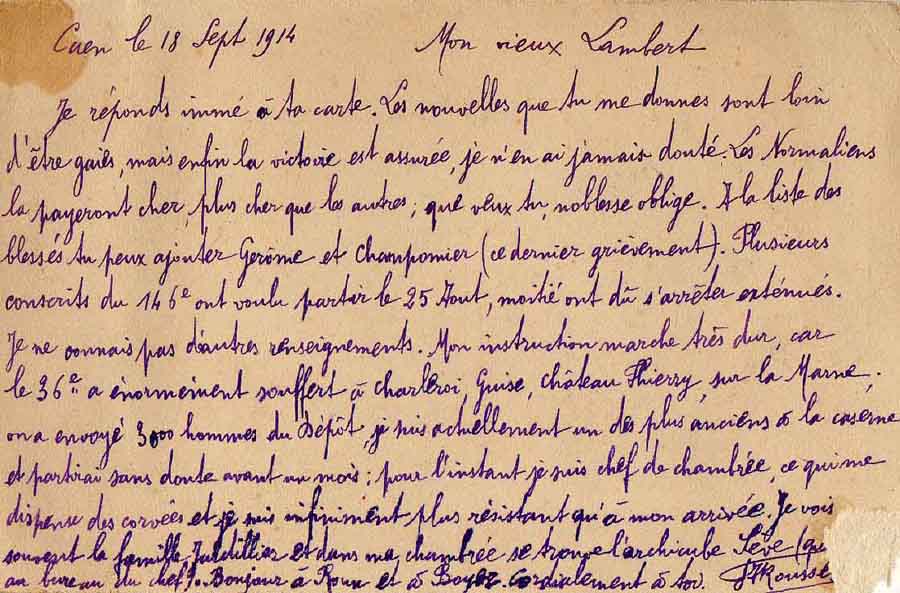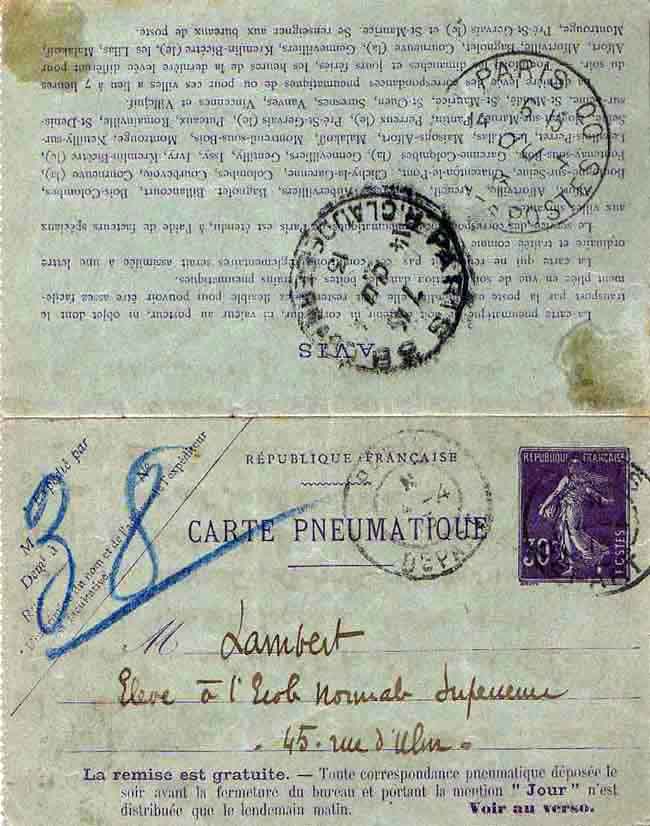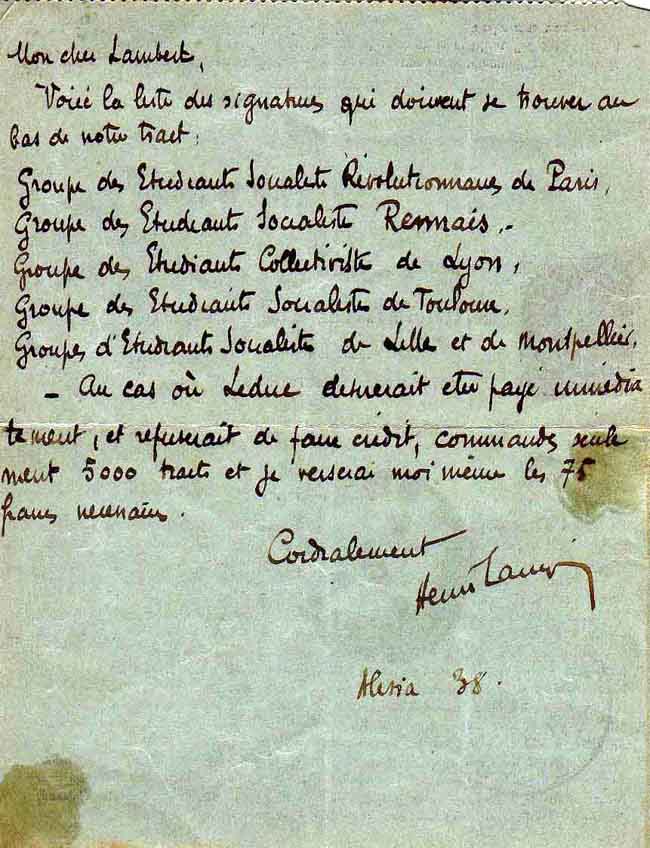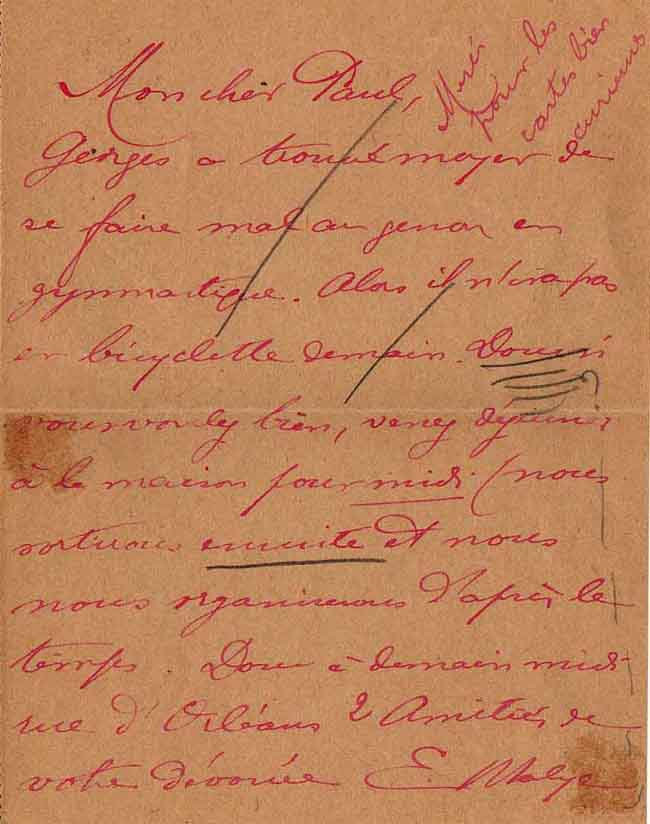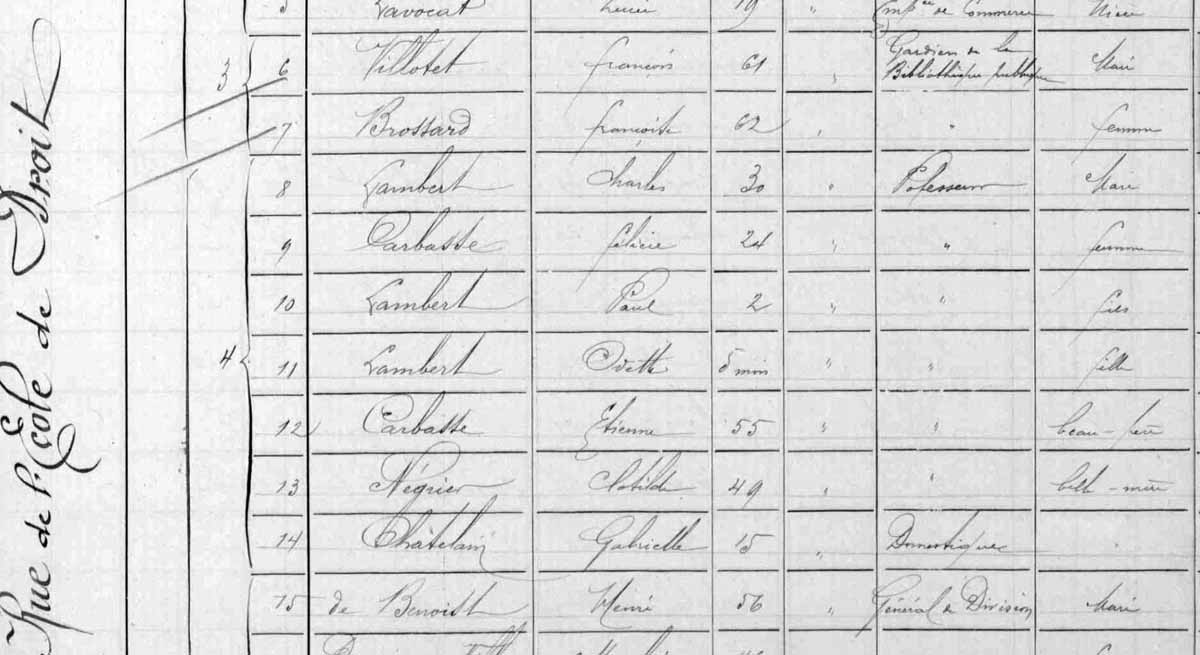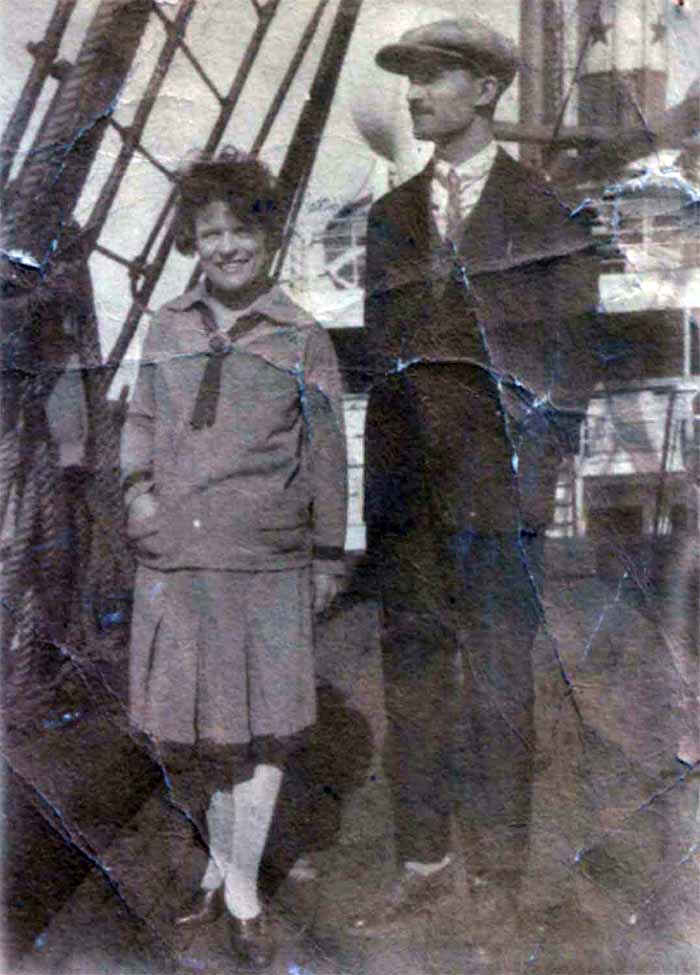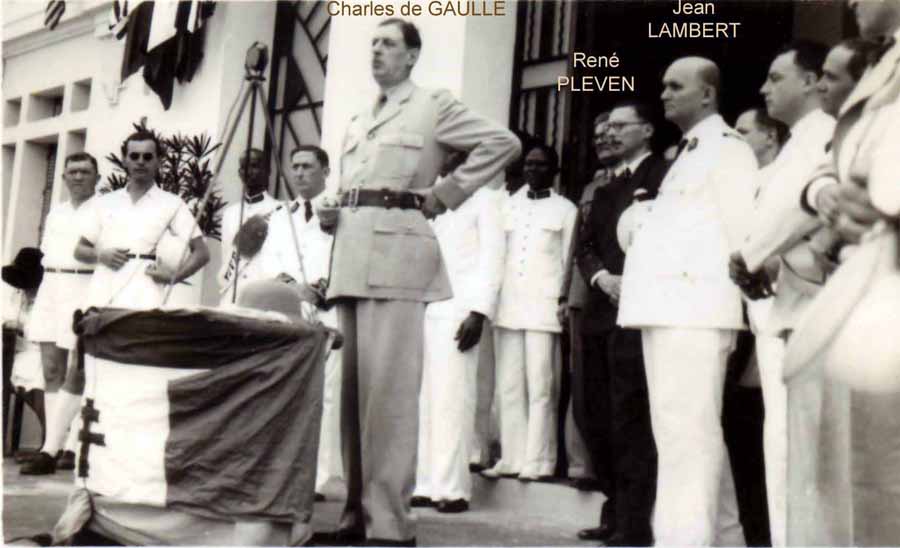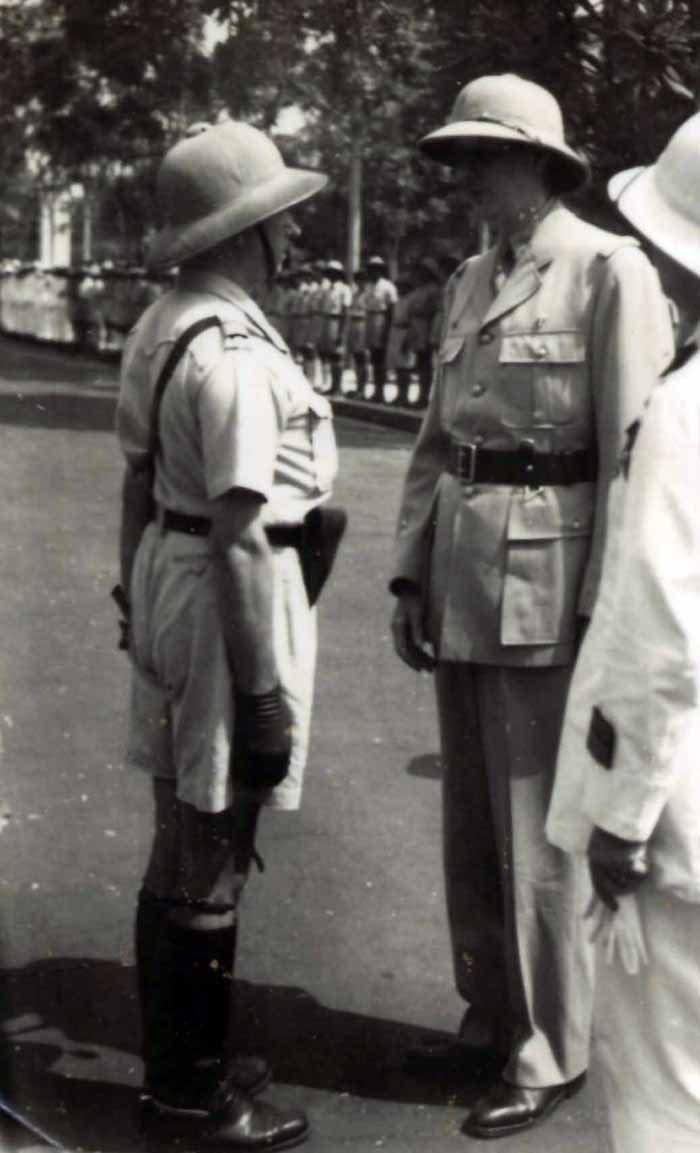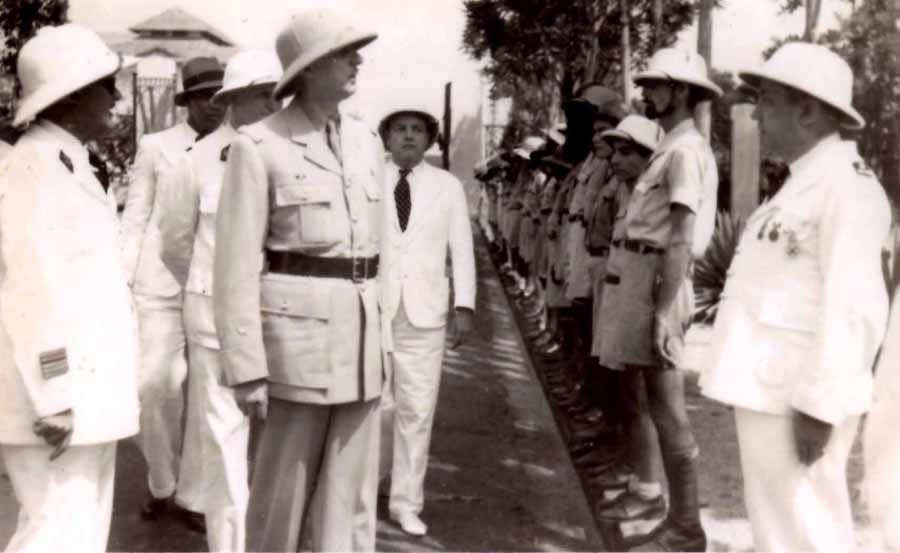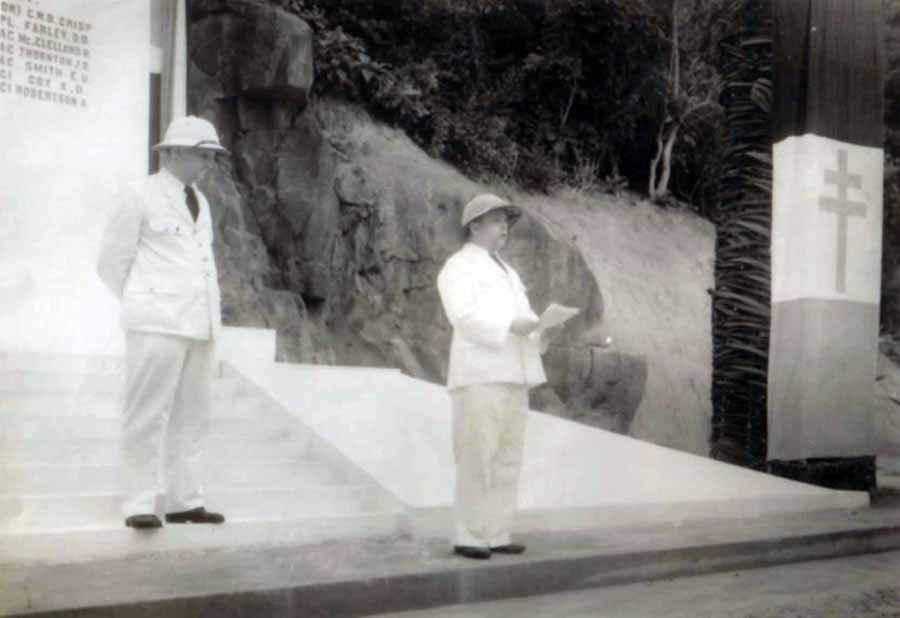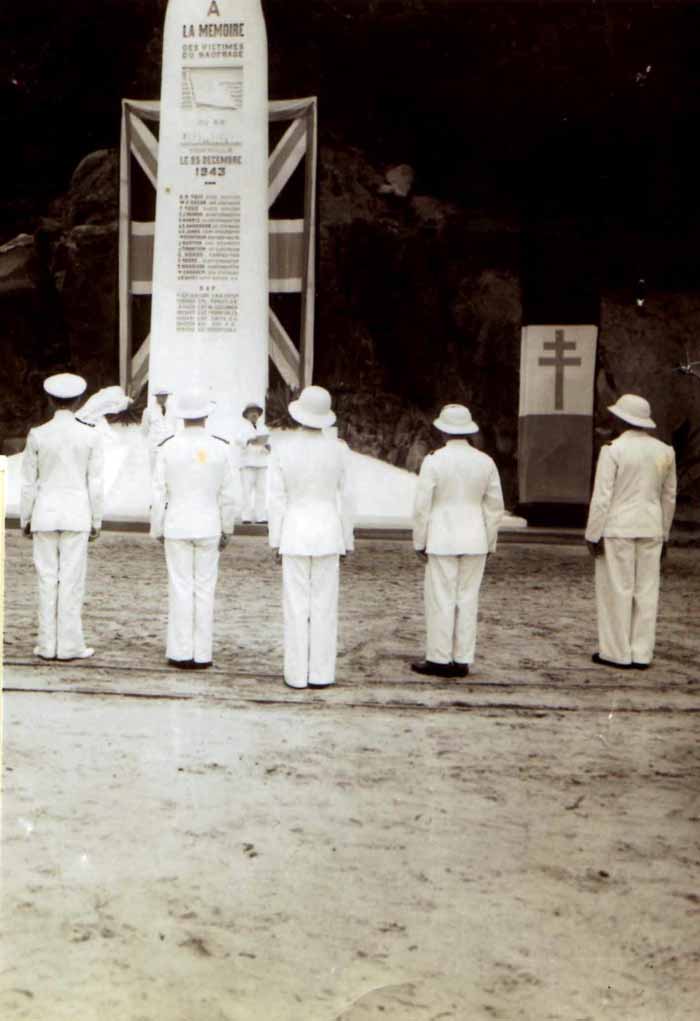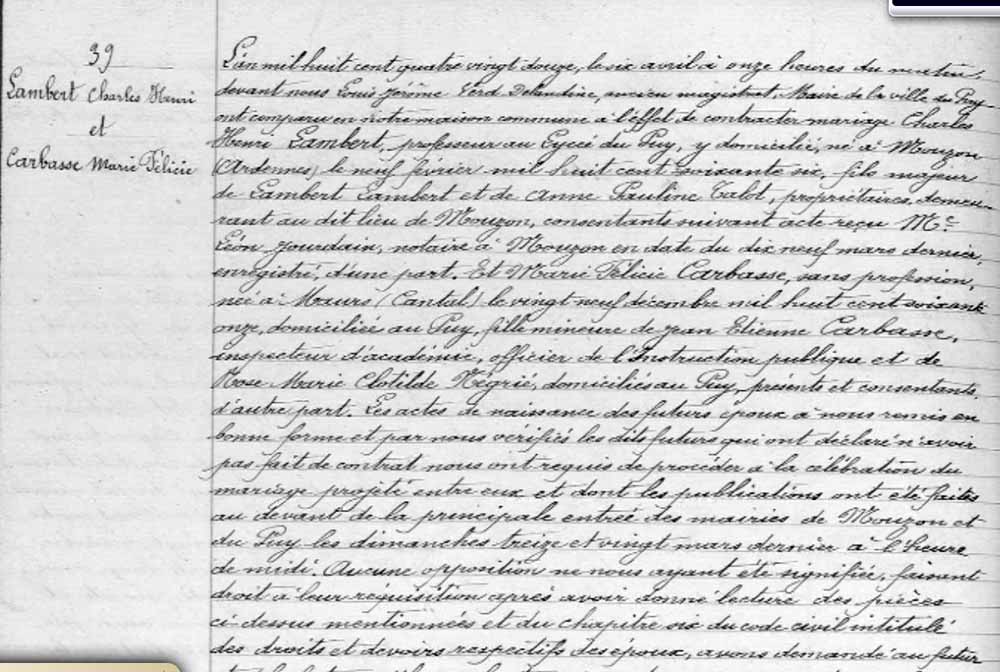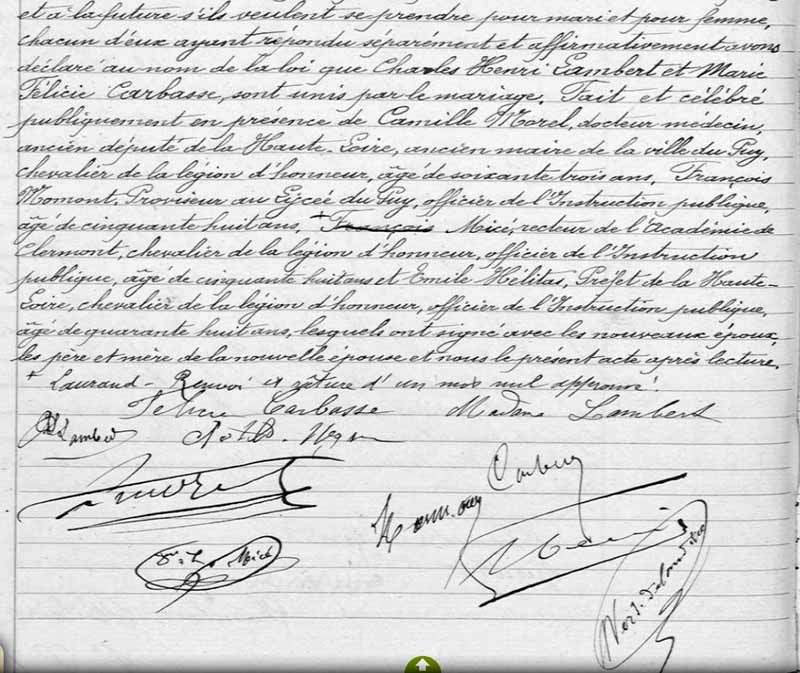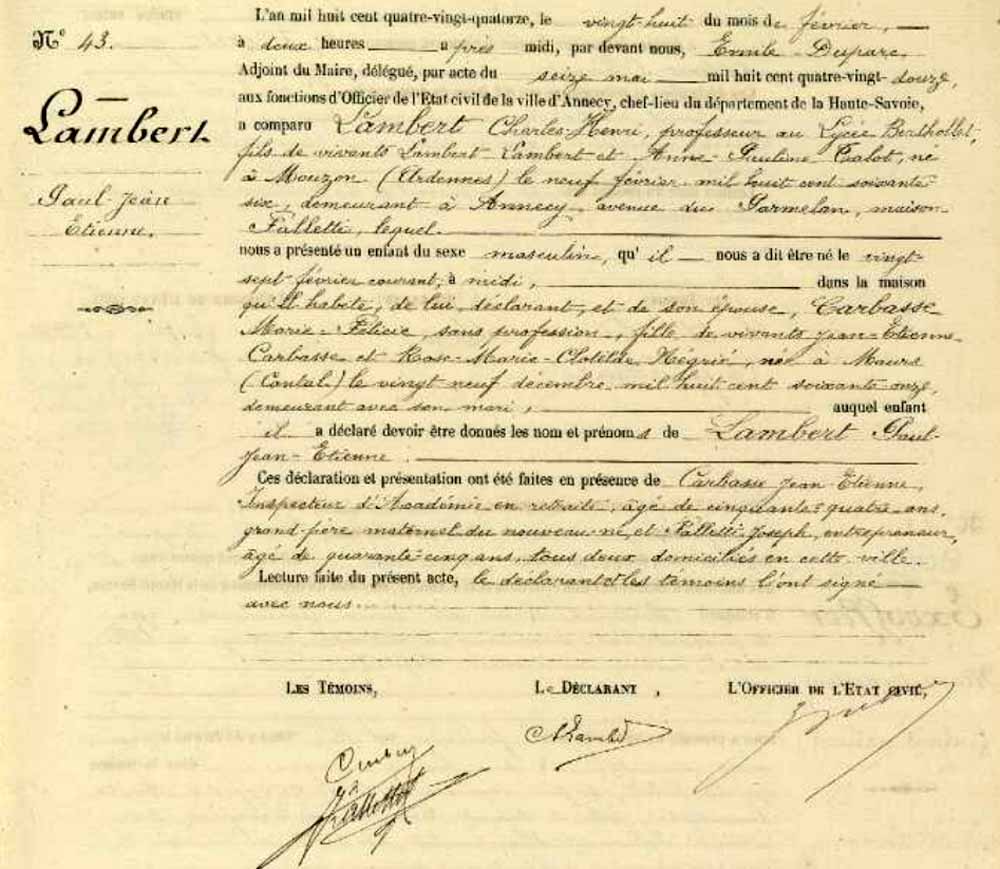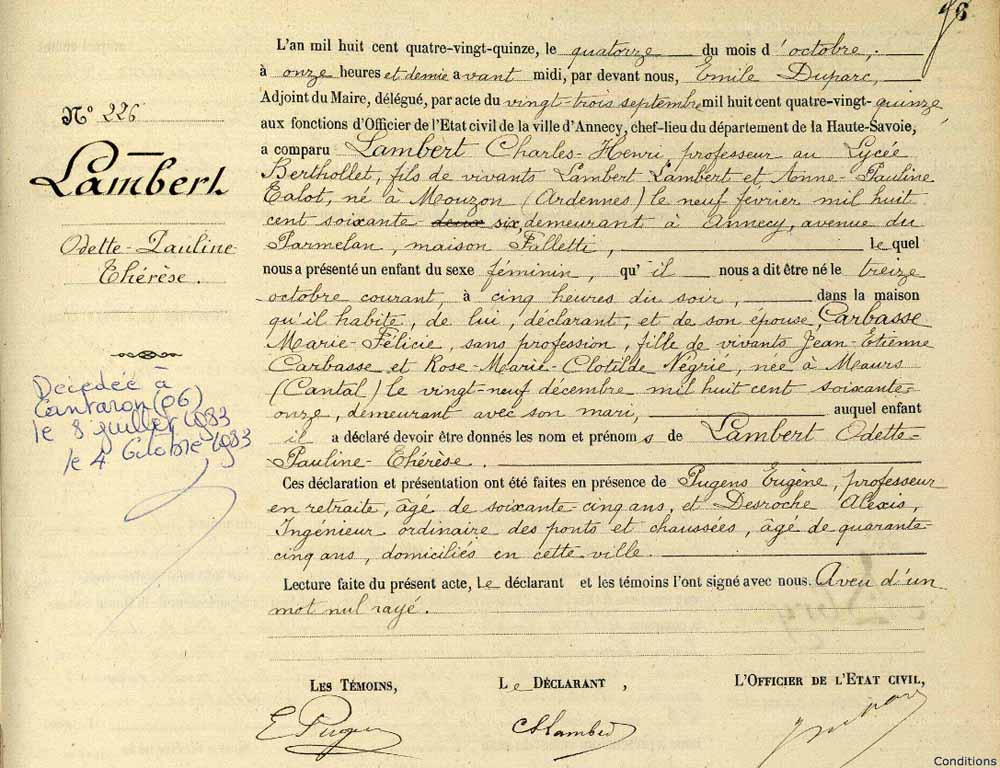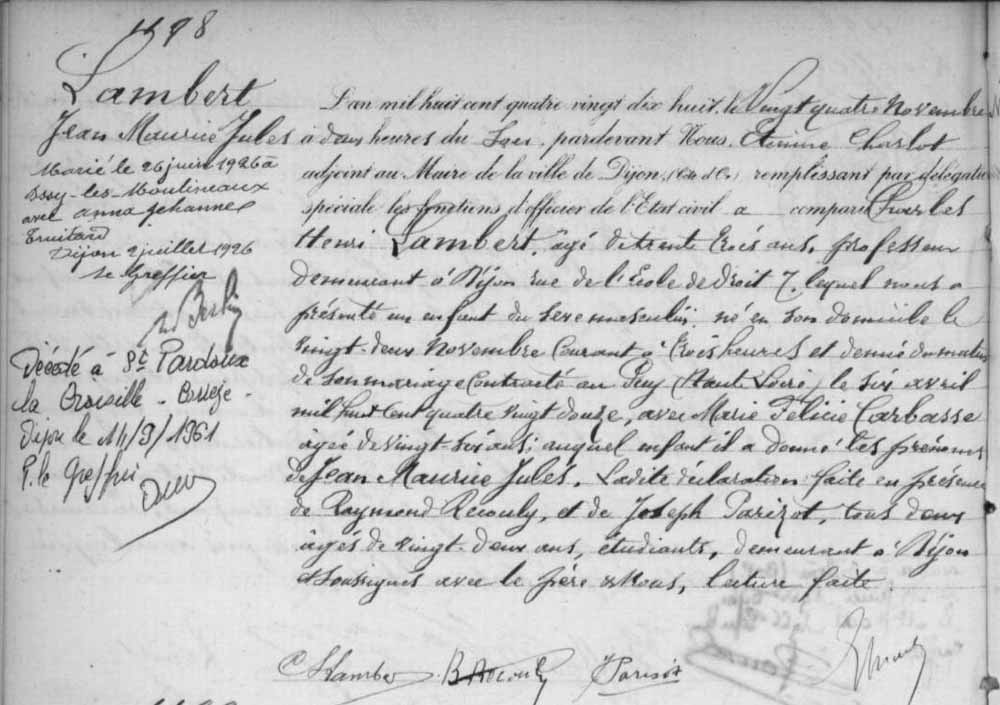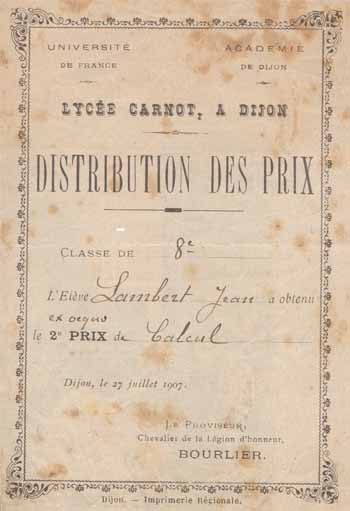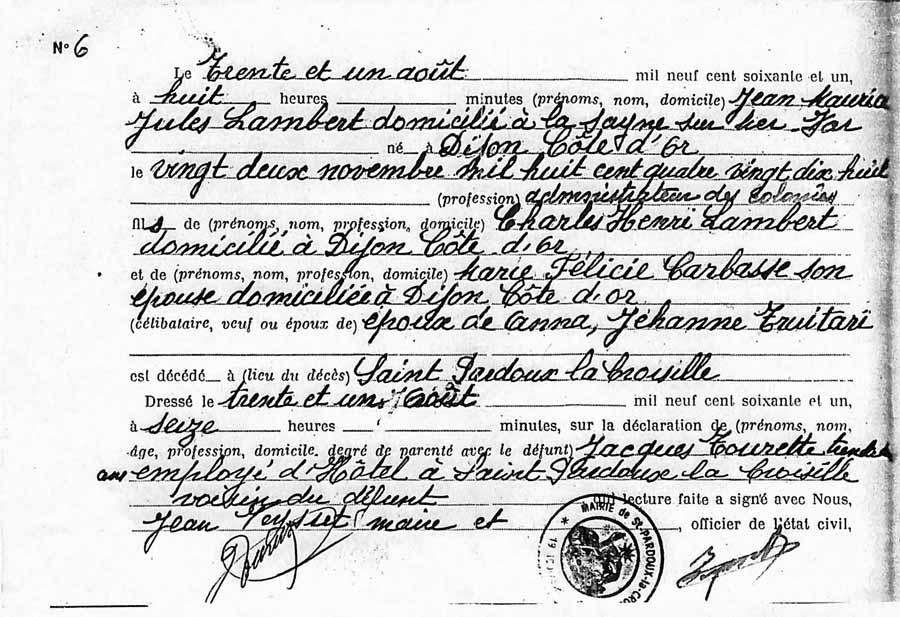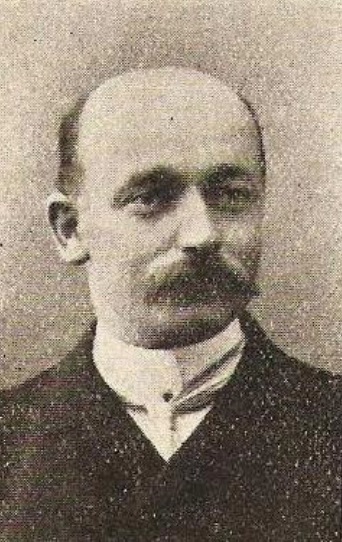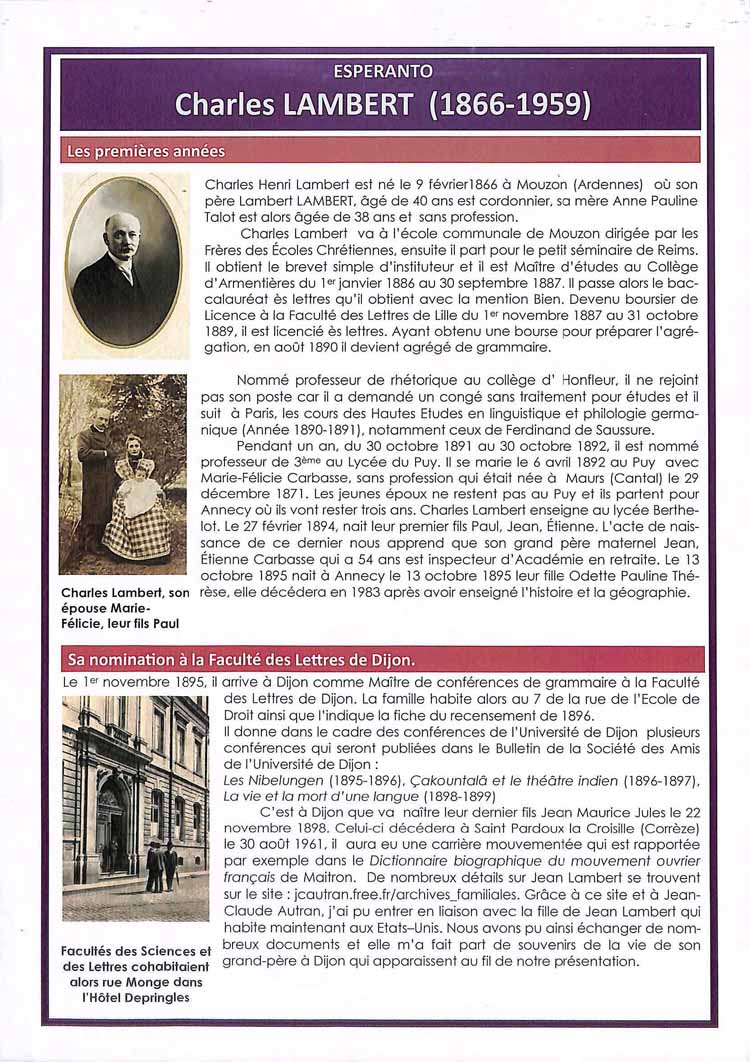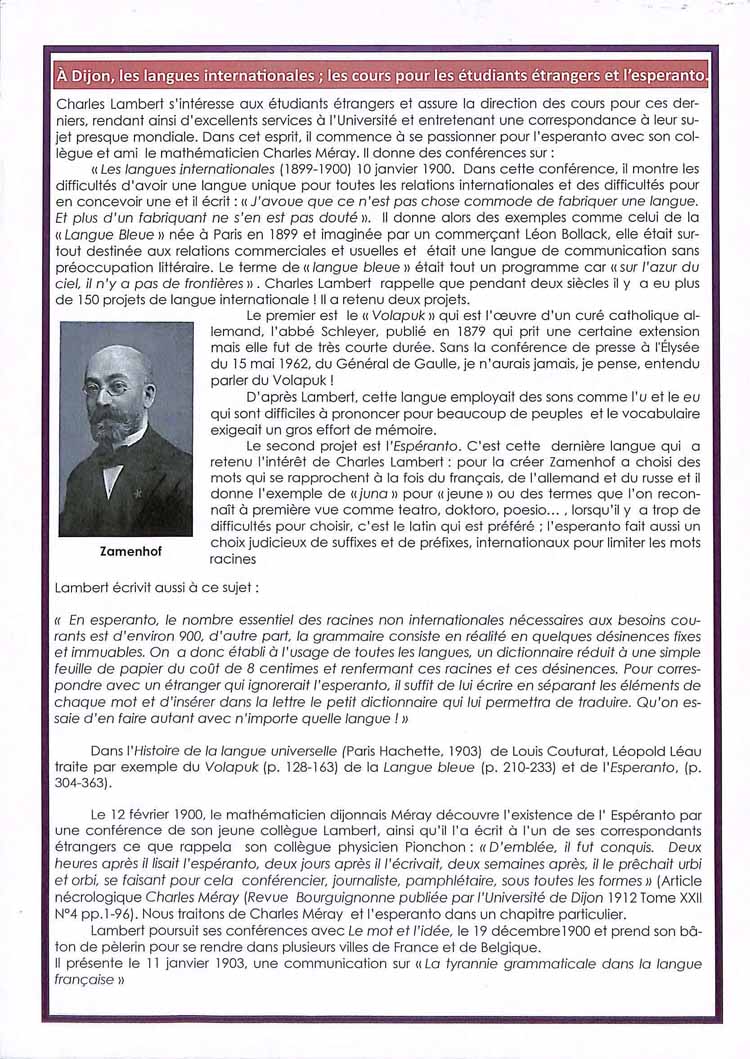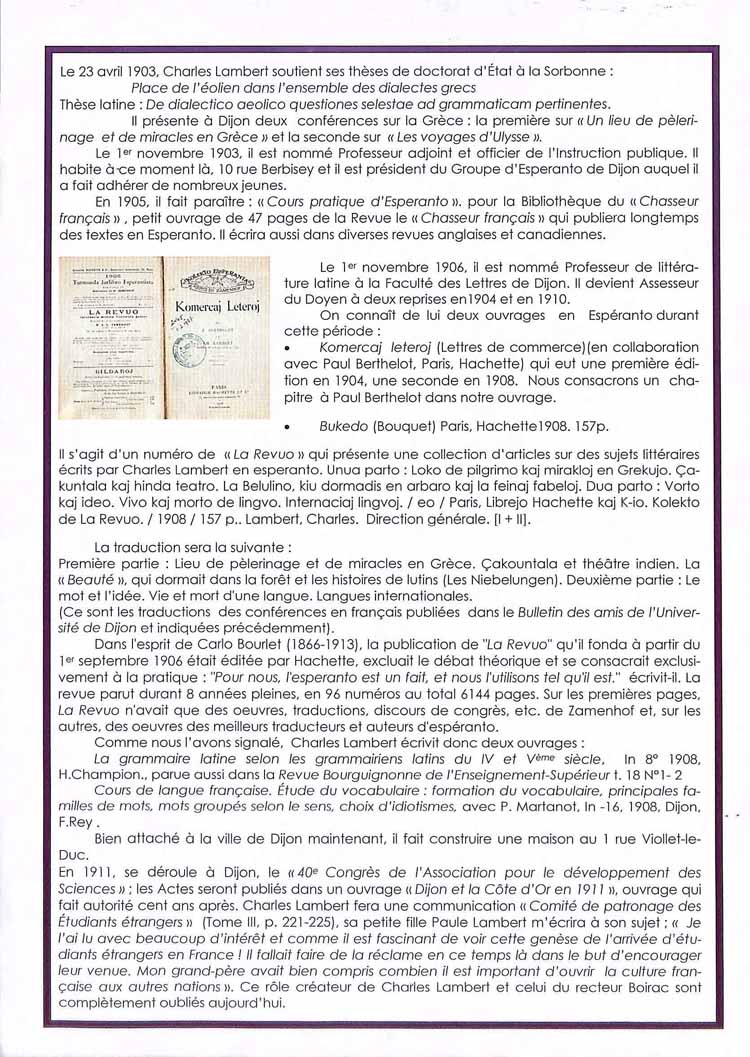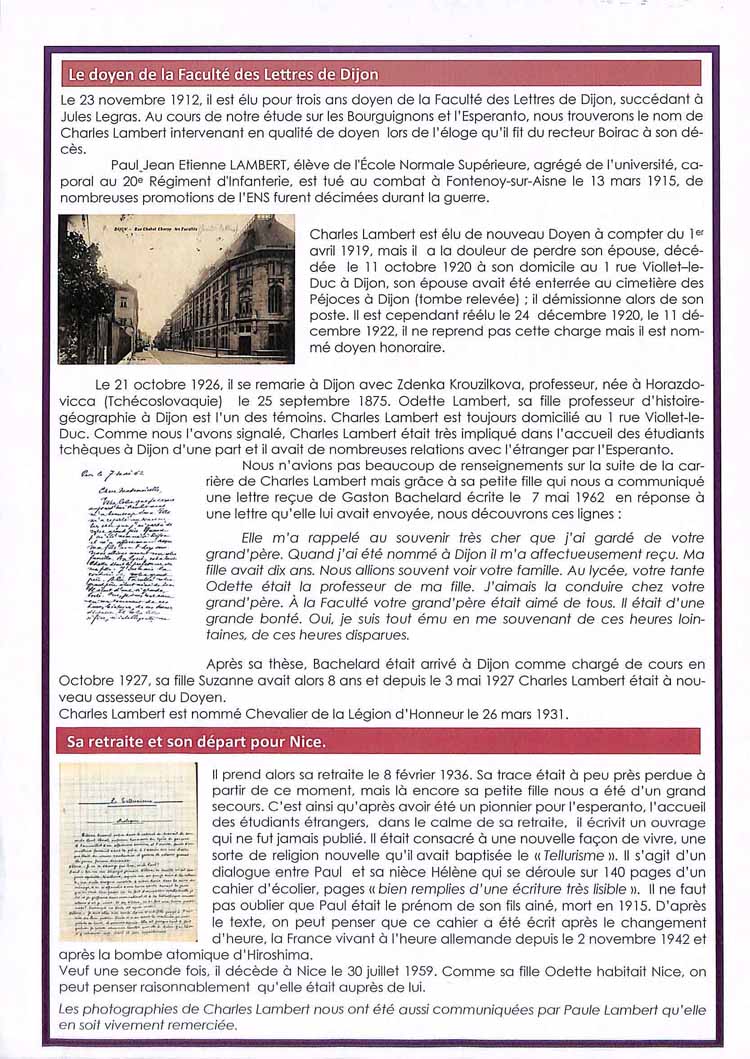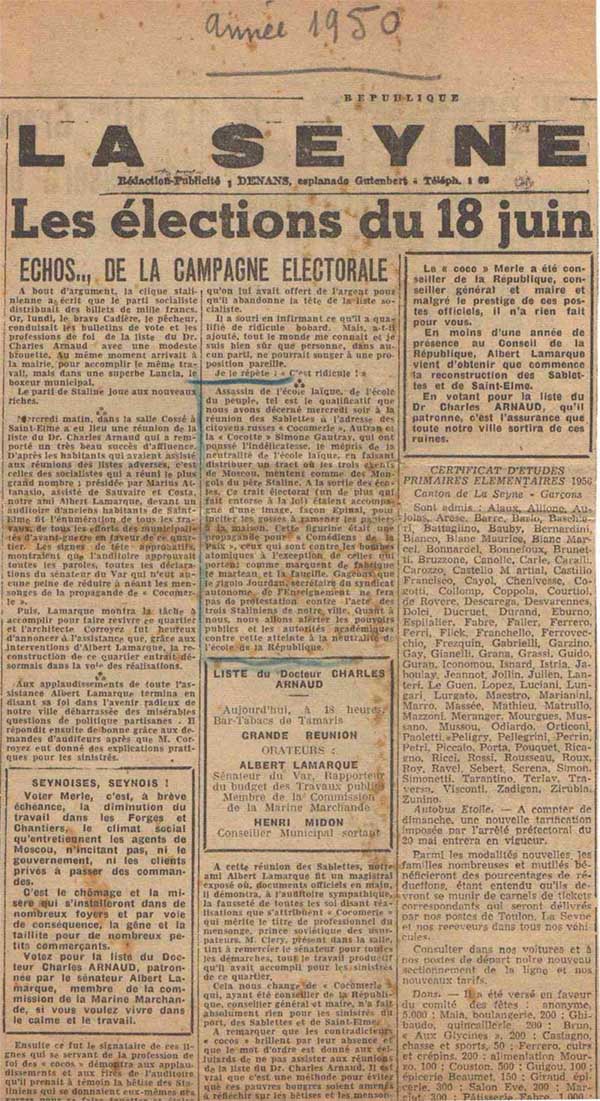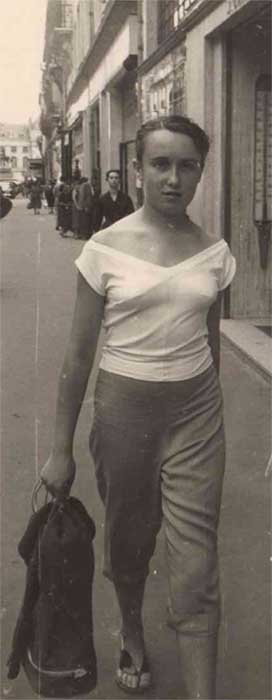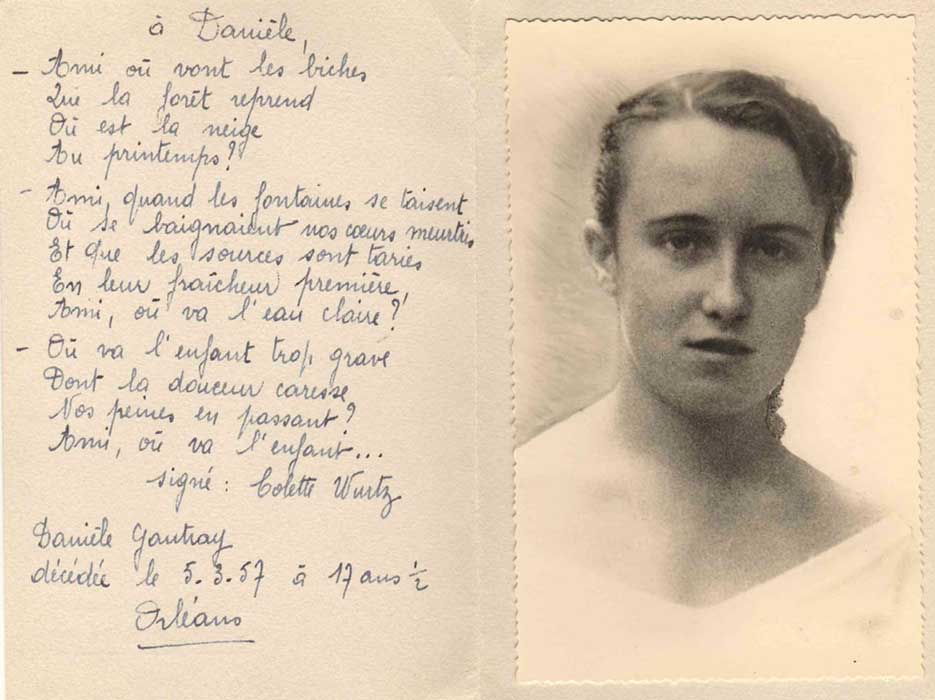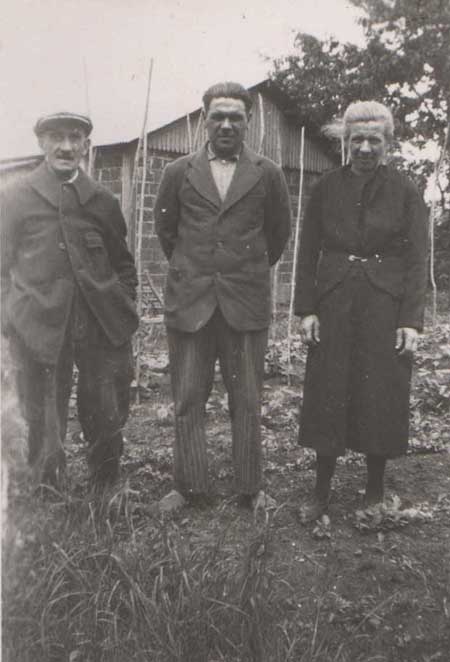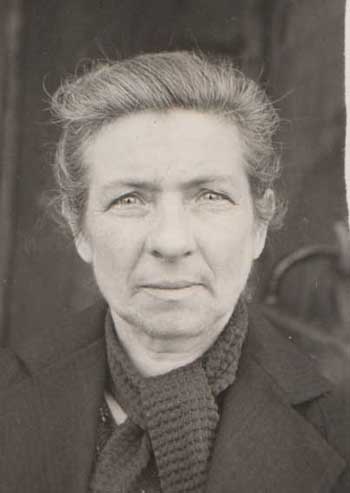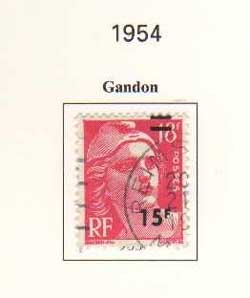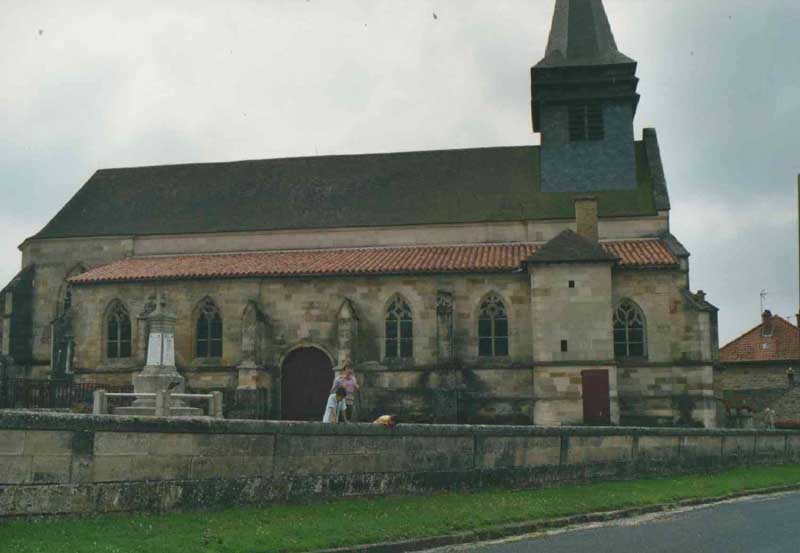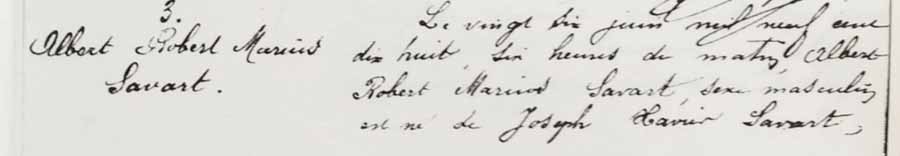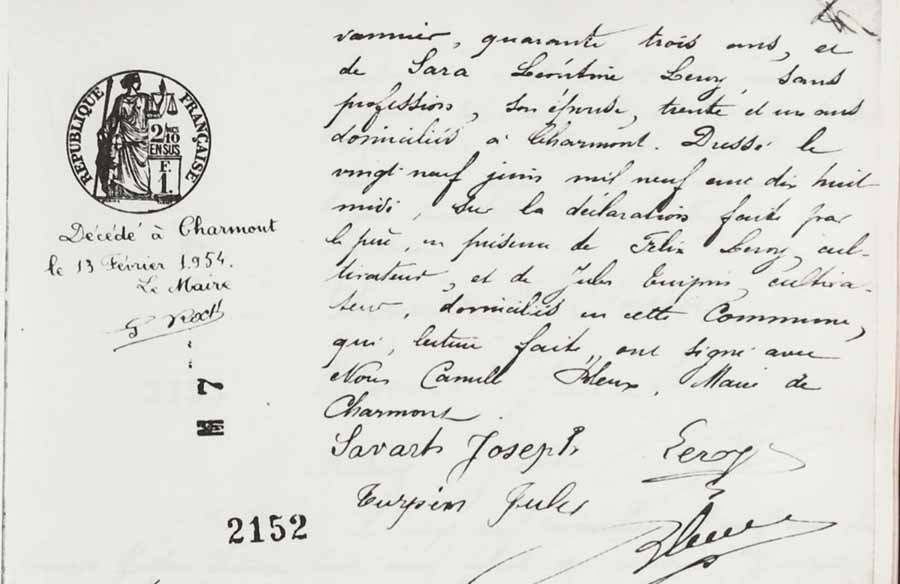A
suivre...
Page en
travaux 
- Jean LAMBERT
- 1898-1961
 | 
|
Je
ne l’ai connu que peu d’années, 3-4 ans environ, et
mon père guère
plus, mais il joua une place importante dans ma famille par sa forte
personnalité, sa grande culture, sa vie hors du commun, et sa
fin
tragique et prématurée.
C’est vers 1957, je crois, que mon père
commença à parler de lui, le « camarade LAMBERT
». Il était arrivé à La
Seyne depuis peu et avait emménagé dans un appartement
situé au
troisième et dernier étage d’un immeuble, au 14 bis
boulevard Staline,
presque en face du nôtre. [Les GAUTRAY - voir biographie plus bas
dans ce fichier - étaient au N°
16]. Nous étions
ainsi voisins, nous l’apercevions très
régulièrement, et mon père
devint son ami et entretint avec lui des conversations
fréquentes et
souvent approfondies.
 |
Appartement de Jean LAMBERT au
3e étage du 14 bis boulevard Staline à La Seyne-sur-Mer
|
Mon père l’avait croisé - et avait
rapidement mémorisé son nom et sa haute stature - lors de
petites
réunions locales du Parti auxquelles il participait souvent dans
l’un
ou l’autre des villages environnants. Avant de s’installer
à La Seyne,
Jean LAMBERT habitait (depuis 1949 ou 1951 ?) Le Beausset,
quartier Pouirou,
dans une petite maison isolée, sur la gauche de la route
départementale, au début de la montée du Camp. (Il
me semble qu’il
avait eu alors une motocyclette pour se déplacer jusqu’au
village).
Arrivé
à La Seyne vers 1956, il essaya (il était militant
communiste depuis de
longues années) de se rapprocher d’une cellule seynoise du
Parti. Une
réunion de cellule de notre quartier La Gatonne ayant lieu un
soir dans
un bistrot (celui de La Corderie, peut-être), il s’installa
discrètement à une table proche de celle où les
militants commençaient
à tenir leur réunion. C’est mon père qui
reconnut cet homme [pour l'avoir aperçu lors de
précédentes réunions du Parti dans l'un des
villages voisins], qui
semblait s’intéresser à la réunion, mais qui
gardait un comportement
timide. Mon père crut le reconnaître et lui dit : «
Mais vous êtes bien
le camarade LAMBERT ? ». C’était bien lui, et il se
joignit alors à la
réunion et, à partir de ce jour, il participa aux
activités de la
cellule, y joua un rôle croissant par le niveau de ses analyses
politiques et la puissance de son raisonnement - qui surpassait de
beaucoup le niveau moyen des militants du quartier. Il apparut comme un
homme peu ordinaire, d’une culture exceptionnelle et ayant eu
apparemment une vie riche en expériences.
Mon père le sentit
et se lia avec lui d’une profonde amitié. A la maison, mon
père parlait
très très souvent de ses conversations avec «
LAMBERT ». Mon père
cherchait à l’inviter à manger chez nous pour que
nous en fassions
aussi la connaissance, mais il refusait toujours, sauf une fois, pour
prendre simplement un café ou un dessert, vers 1959. Il ne
voulait pas
s’imposer, ne voulait pas déranger. Sa santé,
aussi, y était pour
quelque chose. Au fil des mois, cependant, après de nombreuses
discussions avec mon père, une partie du mystère qui
planait sur sa
vie, et surtout sur sa vie antérieure, fut levé. En
partie seulement.
Les
seuls détails qu’il confia un jour sur sa famille
étaient qu’il avait eu un frère aîné,
ancien élève de l'Ecole normale supérieure de la
rue d'Ulm, qui fut tué pendant la guerre de 1914-1918, et une
sœur, vivant à Nice, professeur, célibataire : Mlle LAMBERT,
qu’il ne voyait que
rarement.
Jean LAMBERT vivait donc seul à La Seyne, comme un
vieux célibataire, dans son appartement. Il avait une immense
collection de livres et lisait beaucoup. Il achetait 3 journaux chaque
jour : Le Petit Varois, L'Humanité et Le Monde. Mais on ne lui connaissait
pas de
relation féminine. Il n’en parlait pas. Mais il avait sans
doute une
vie privée car il prenait le car presque tous les
après-midi pour
Toulon, où personne ne savait ce qu’il faisait, ni qui il
rencontrait.
Pourtant,
il se déplaçait assez difficilement, il marchait toujours
avec une
canne, et devait éprouver beaucoup de difficulté à
faire ses courses et
à monter et descendre chaque jour les marches pour atteindre son
appartement du 3e étage. On apprit ainsi qu’il souffrait
du diabète,
qu’il était contraint de peser tous ses aliments notamment
glucidiques
et à se faire quotidiennement des piqûres
d’insuline. Il confia à mon
père que sa maladie ne pourrait que s’aggraver et que sa
vue baissait
peu à peu (il portait déjà des verres très
épais) et qu’il risquait de la
perdre complètement si jamais son diabète lui
entraînait un décollement
de la rétine. Et dans ce cas, le jour où il ne pourrait
plus lire, ce
qui était sa grande occupation et passion, il lui confia
qu’il mettrait
fin à ses jours. Il avait la volonté - et les moyens - de
le faire.
Ce que fut sa vie professionnelle antérieure, mon père
l’apprit peu à peu.
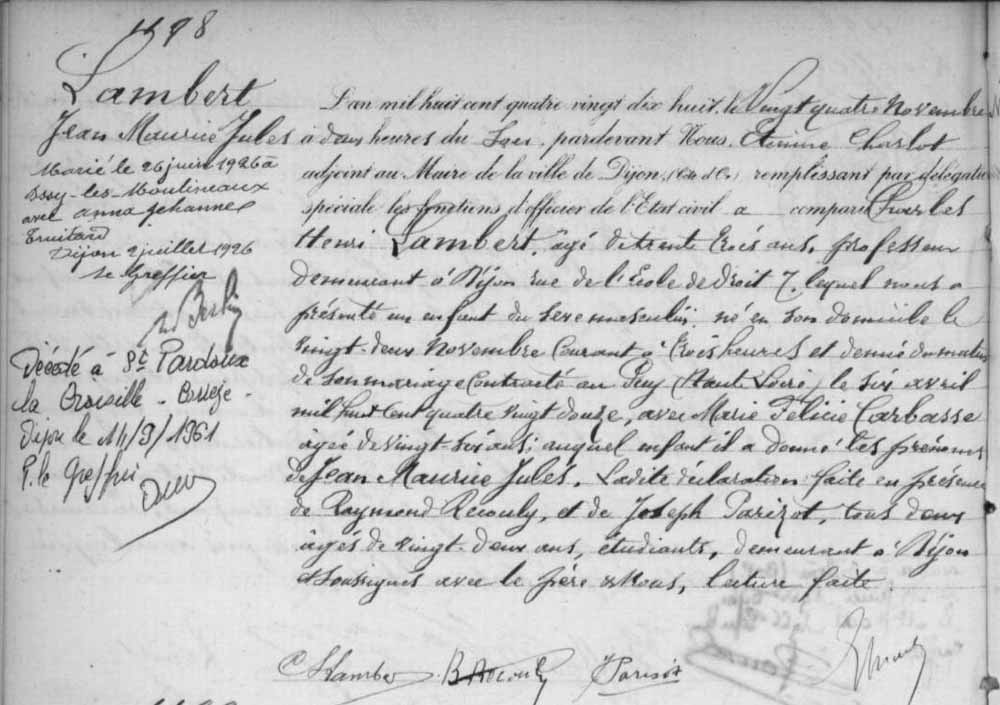 |
Acte de naissance de Jean LAMBERT à Dijon en 1898
«
Acte de naissance # 1198 du 24 Novembre 1898. LAMBERT Jean Maurice
Jules, fils de Charles Henri LAMBERT, 33 ans, professeur, demeurant
à
Dijon, Marié au Puy (43) le 6 Avril 1892 avec Marie
Félicie Carbasse, 26 ans. Marié le 26 Juin 1926 à
Issy-les-Moulineaux
(92) avec Anna Jehanne Truitard ». Décédé
à Saint-Pardoux-la-Croisille (Corrèze), Dijon [date de
transcription], le 14/9/1961. [Décédé en réalité le 31 août 1961]
|
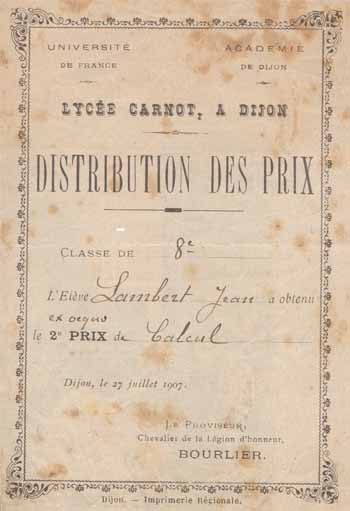 |
| Second prix de calcul obtenu en classe de 8e par Jean
LAMBERT
au Lycée Carnot à Dijon en 1907 |
Jean LAMBERT était né à Dijon, issu d’une
famille
de gens très cultivés. Son
père était recteur de l’Académie de Dijon et
possédait une riche
collection d’ouvrages, des ouvrages dont nous reparlerons
beaucoup
ci-dessous. Je crois qu’il avait eu (au moins) deux fils et une
fille.
L’un des fils, ancien élève
de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm fut
tué au cours des
combats de la guerre de 14-18. Je ne me souviens pas de ce qui se passa
pour Jean LAMBERT au cours de cette guerre. Il semble qu'il avait
été
mobilisé (il avait 20 ans en 1918), comme cela est
rapporté dans la
biographie qui sera publiée après sa mort (voir
ci-dessous). Ce dont je
me souviens c’est qu’il commença des études
de médecine. Il franchit
les premières années. Témoins, des récits
sordides de dissection de
cadavres qu’il faisait à mon père et des photos
qu’il lui avaient
montré où il posait avec un autre camarade, tous deux en
blouse
blanche, arborant un grand sourire, avec un « macchabée
» qu’ils
maintenaient debout entre eux, bras dessus - bras dessous. Mais il ne
termina pas sa médecine, s’apercevant que finalement il
n’appréciait
pas l’esprit et la mentalité du corps des médecins.
Après de nouvelles études à l'école
d'électrochimie de Grenoble, où il obtint le
diplôme d'ingénieur chimiste et électricien, il
présenta finalement le concours de l’école
coloniale et y
fut brillamment
admis. On le retrouva alors Administrateur des Colonies, en Côte
d'Ivoire, et au Tchad (Fort-Lamy). On le vit photographié aux
côtés de
René Pleven et de Charles de Gaulle lors de visites aux Colonies
françaises en 1945 ou 1946. Mais son esprit
généreux, humanitaire et
anticolonialiste entraîna la fin de sa carrière de
gouverneur. Il prit
en effet souvent le parti des peuples colonisés, contre le
pouvoir
français. Il se lia d’amitié avec beaucoup de
noirs, qui le portaient
dans leur cœur, ce qui ne satisfaisait pas nombre de colons. Il
eut une
grande affection pour les noirs, et mon père le suivait sur ce
point
(mon père ayant vécu plusieurs de ses jeunes
années en Tunisie et avait
aussi acquis un solide sentiment anticolonialistes). Il parlait des
noirs avec beaucoup de respect et d’amitié. « Les
noirs ont un cœur
d’or ». Beaucoup se seraient fait tuer pour lui,
étant reconnaissant du
soutien qu’il leur apportait. Un jour, en effet, dans un village,
il
fut pris d’une fièvre brutale et très grave et sans
soins rapides, ce
mal était en principe fatal. Un cercueil lui avait même
été commandé
[Ce cercueil inutilisé fut conservé, paraît-il, par
la suite, sous une
couverture et servait de banquette dans la maison. Aux gens qui y
étaient assis, on disait pour les effrayer : vous êtes
assis sur le
cercueil de Monsieur LAMBERT ! Et les gens se levaient et changeaient
de place]. Donc, ses jours étaient en danger et le
médecin le plus
proche se trouvait à deux jours de marche du village où
il se trouvait.
Et des noirs qui l’avaient en adoration décidèrent
de le porter sur un
brancard de fortune ; ils se relayèrent en marchant ou courant
jour et
nuit et arrivèrent à l’amener encore vivant chez le
médecin et Jean LAMBERT fut sauvé. Sa reconnaissance pour
ses amis noirs, et
pour tous
les noirs en général, ne fit que s’accroître.
A tel point que
cela fut fatal à sa carrière. Il racontait qu’un
jour, à Fort-Lamy (en
1945 sans doute), il reçut la visite de Charles de Gaulle, alors
Président du Conseil. De Gaulle lui dit : « Gouverneur, je
constate
qu’il n’y a pas d’église à Fort-Lamy
». Il osa répondre : « Mon
Général, il n’y a pratiquement pas de catholiques
à Fort-Lamy ». Et De
Gaulle répondit en substance : « Là n’est pas
la question, vous allez
faire construire une église. Je vous débloque un
crédit d’un million
pour cela ». Le même jour, ou à quelques jours de
là, le gouverneur LAMBERT reçut une
délégation de musulmans qui lui
dirent : « Monsieur
le Gouverneur, nous sommes nombreux et nous n’avons pas de
mosquée à
Fort-Lamy ! ». Que fit Jean LAMBERT ? Il brava le pouvoir
français et
utilisa le million de francs de De Gaulle pour faire construire une
mosquée à Fort-Lamy ! Un an après (1946), le
Général repassa à
Fort-Lamy et... trouva une mosquée au lieu de
l’église dont il avait
ordonné la construction ! Et le lendemain, Jean LAMBERT rentrait
en
France en avion « entre deux gendarmes », selon son
expression, mis
d’office à la retraite. Sa carrière de gouverneur
était terminée. Il ne
retourna plus en Afrique et se retrouva désormais habiter (pour
quelle
raison ?) le sud-est de la France, successivement à Menton, au
Beausset
(1949), à Marseille, puis à La Seyne (vers 1956).
Retraité à
48 ans. Il avait de quoi vivre et n’était pas sans
fortune. Il me
semble qu’il parlait de quelques lingots d’or (??) et de
gains en bourse
qu’il aurait fait, ce qui lui aurait payé le voyage en
URSS qu’il fit
par la suite et dont on reparlera.
Je ne sais à peu près rien de
ses activités au cours des 10 premières années qui
suivirent sa
retraite anticipée. Sinon qu’il lisait beaucoup,
qu’il se cultivait
énormément et pouvait aborder en connaissance de cause
à peu près tous
les sujets scientifiques, techniques, économiques,
géographiques
(surtout l’Afrique), historiques, politiques, etc. Et qu’il
avait
adopté les thèses communistes et marxistes. Nombre
d'ouvrages qu'il
avait lus étaient annotés, parfois de manière
humoristique, parfois
corrigés pour des erreurs qu'il avait relevées. C'est le
cas d'ouvrages
sur l'Afrique, et aussi d'ouvrages scientifiques. On a même
retrouvé dans sa bibliothèque un ouvrage de
mathématiques écrit par
Emile Borrel (Académie de Mathématiques) dans lequel Jean
LAMBERT avec
corrigé une équation !
Une anecdote de cette époque, que j’avais
oubliée, mais dont j’eus la preuve bien plus tard à
la lecture de vieux
journaux des années 50, c’était le « service
» qu’il rendit un jour au
journal « Le Petit Varois ». Ce journal qui était
alors, comme il le sera
plusieurs fois dans son histoire, en grave difficulté
financière, avait
imaginé la vente de « bons de soutien de Noël
», dont le gros lot était
une voiture (mon père racontait cette histoire en parlant
d’une 4 CV
Renault, mais c’est d’une « traction »
Citroën qu’il s’agissait !). Le
Journal n’avait évidemment pas les moyens d’acheter
une voiture pour la
mettre en lot de tombola ! Il s’agissait donc d’une
arnaque, pour la
bonne cause, évidemment : il fallait sauver le journal. Les bons
de
soutien furent vendus et il s’agissait alors de trouver un
lecteur
complaisant et de confiance qui aurait « gagné » la
traction. Et c’est
Jean LAMBERT, « un lecteur du Beausset », discret et peu
connu, qui fut
photographié et interviewé devant une « traction
» anonyme (on ne voit
pas son immatriculation) qu’il avait soi-disant gagnée
grâce à son
billet N° 172.776. Mais Jean LAMBERT ne fut jamais possesseur de la
moindre voiture !
 |
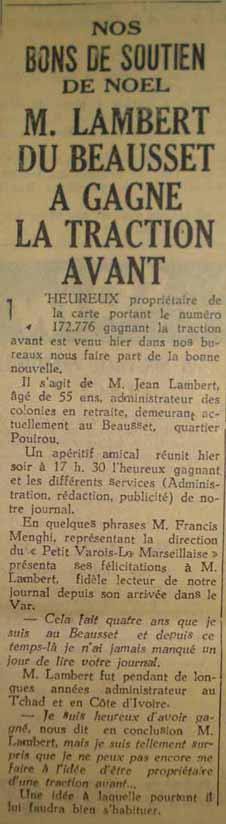 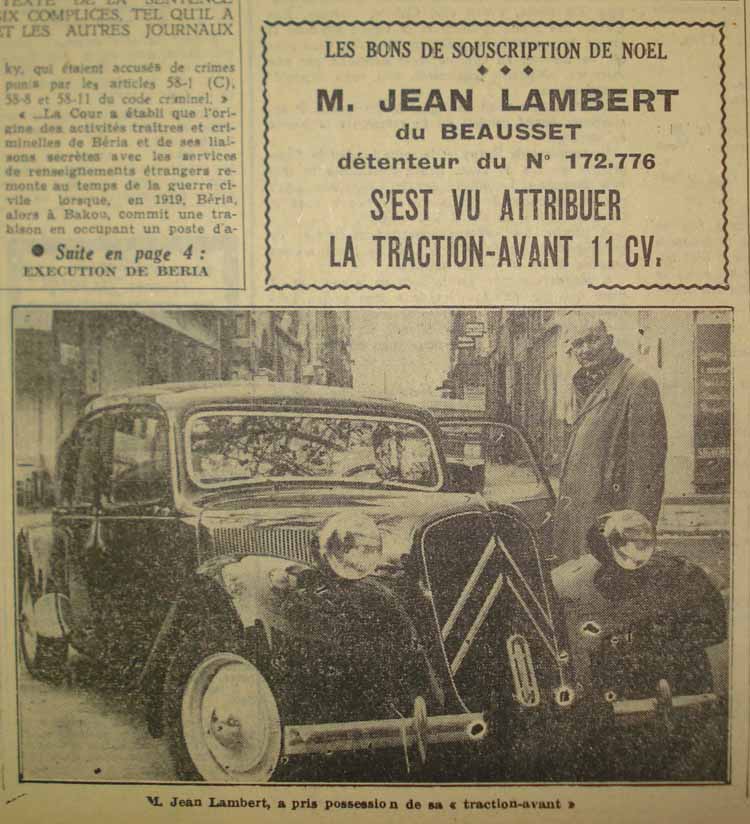 |
| Le Petit Varois, 23
et 25
décembre 1953 |
Un
jour de 1957 ou 1958, mon père lui rend visite et le trouve au
milieu de
livres
et de cahiers écrits en caractères cyrilliques. Il lui
demande : «
qu’est ce que tu fais ? ». « Ben, je suis en train
d’apprendre le russe
! ».
Son projet était de se rendre en URSS l’année
suivante, au
moment de l’anniversaire (43e) de la Révolution d’Octobre.
Et, voulant se
débrouiller tout seul un minimum, il avait décidé,
à près de 60 ans,
d’assimiler les bases de la langue russe. Et il avait en effet
accompli
ce voyage, était revenu enchanté, malgré la
difficulté qu’il avait à se
déplacer, et avait ramené des souvenirs essentiellement
positifs. Ce
fut après ce voyage qu’il accepta de venir un soir chez
nous et, avec
quelques petits cadeaux, qu'il nous conta quelques faits marquants de
son
voyage. Il m’en reste deux en souvenir. L’un était
une invitation au
domicile d’amis russes qui avaient insisté pour lui faire
goûter à un
gros et riche gâteau au miel et qui ne comprenaient pas son refus
dû au
diabète. Pour ne pas les vexer, il avait dû accepter
d’en avaler une
grosse part, mais le soir il avait dû se faire une «
énorme piqûre
d’insuline ». L’autre souvenir est sa rencontre, un
jour dans la
campagne avec un groupe de jeunes filles pionnières ou «
komsomolsk ».
Voyant se déplacer ce « pauvre vieux » avec sa
canne, l’une
voulut l’aider
à marcher et, ne voulant pas le quitter sans lui faire cadeau de
quelque chose,
elle dénoua le
foulard rouge qu’elle portait et le lui noua autour du cou.
Revenu en
France, ce foulard, il le montrait toujours avec beaucoup
d’émotion. Il porte l'insigne d'origine « Vsegda
gotov »
(Toujours prêts). Ce foulard, c’est mon père qui en
hérita par la
suite. Il le garda très
précieusement pendant plus de 45 ans. J'en ai hérité à sa mort, en
2007, et j'ai décidé en occtobre 2016, de le transmettre à mon
petit-fils Vitaly pour son 9e anniversaire.
 |
 |
 |
A mon petit-fils Vitaly pour son 9e anniversaire :
|
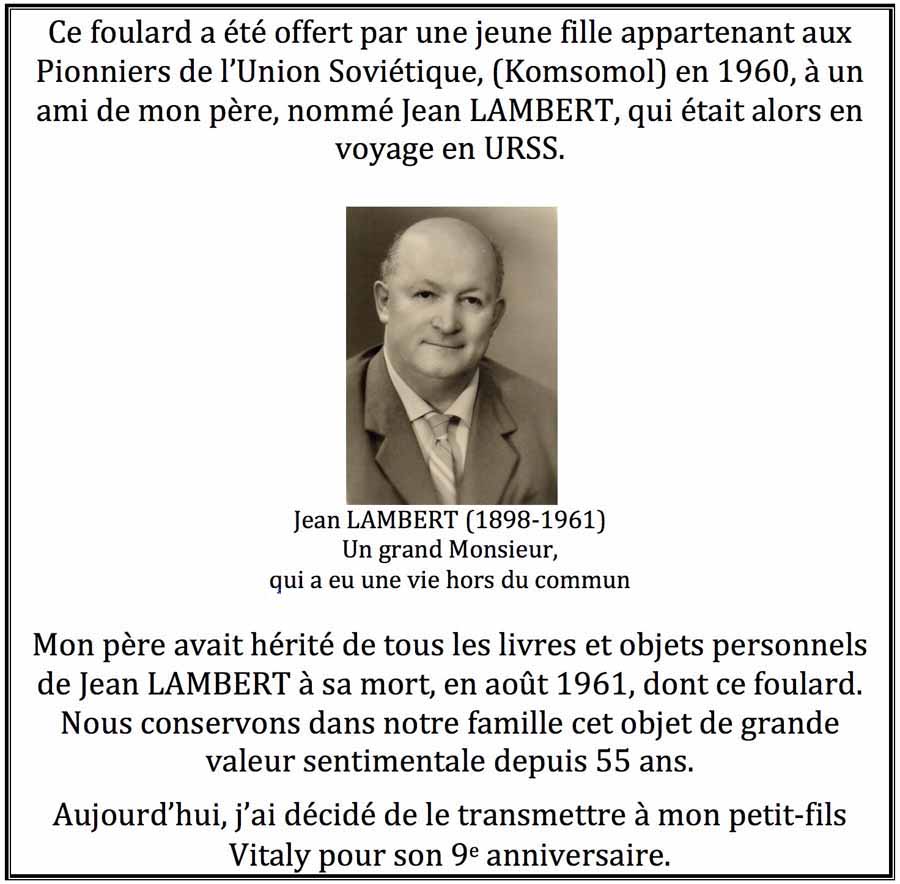 |
A son retour d'URSS, il fit une conférence sur son voyage dans
la salle de la section de La Seyne du Parti communiste,
conférence relatée dans l'article ci-après du Le Petit Varois - La Marseillaise :
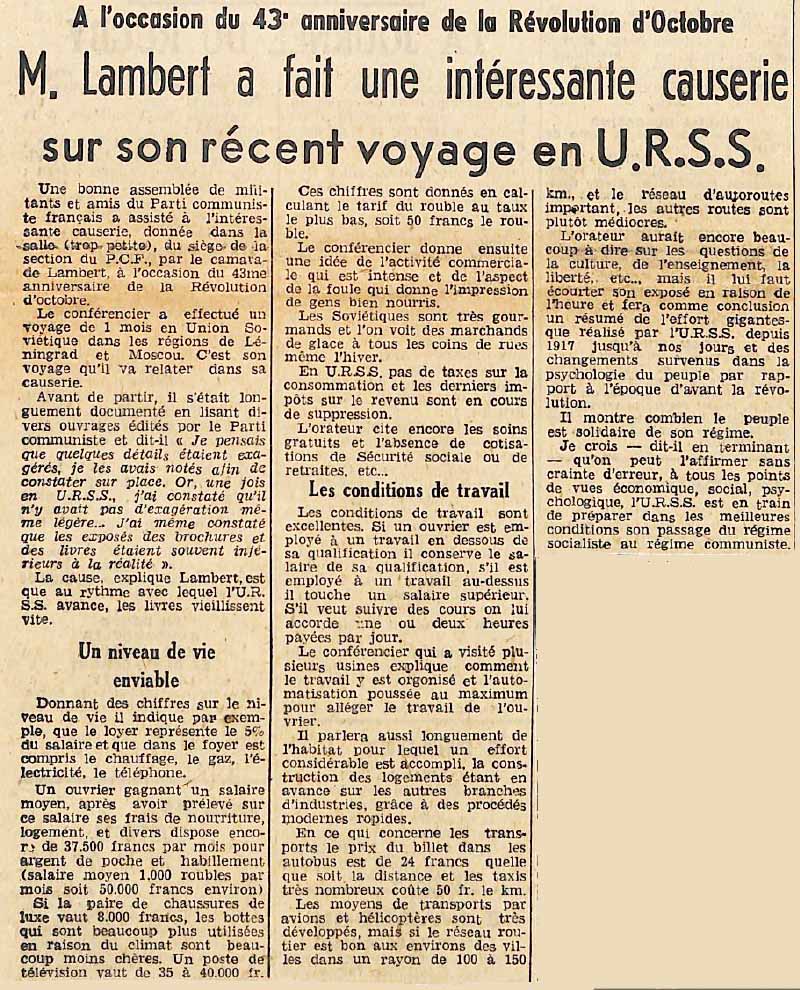 |
Le Petit Varois - La Marseillaise, 27 novembre 1960
|
Il avait encore le projet de
retourner en URSS, en 1967, pour le 50e anniversaire de la
Révolution,
mais il ajoutait : « si j’suis pas crevé !...
».
Dans les années 1958-60, on
le vit souvent à La Seyne, dans de nombreuses
commémorations ou
manifestations. Sa haute stature le faisait facilement
reconnaître
sur les
photos. Mais sa santé ne s’améliorait pas.
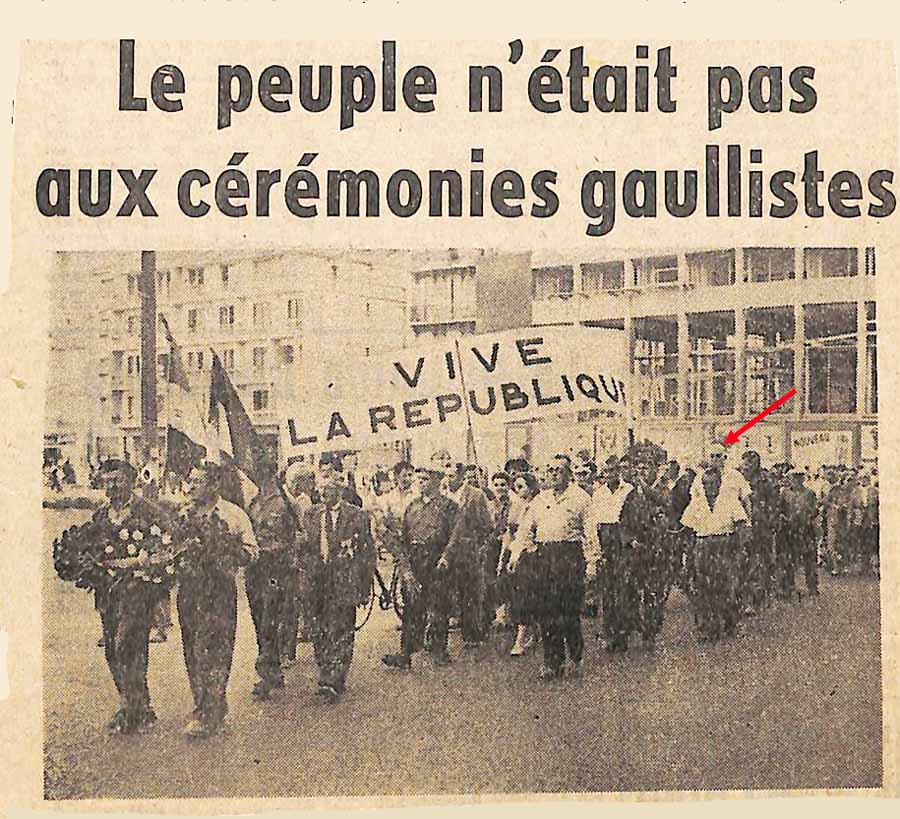 |
Le Petit Varois - La Marseillaise, juin 1958
|
En juillet 1958, il publie une tribune dans le Le Petit Varois - La Marseillaise pour
défendre le 1er adjoint Philippe Giovannini poursuivi en justice
pour avoir adressé une lettre « désapprouvant la
guerre » aux soldats seynois appelés en Algérie :
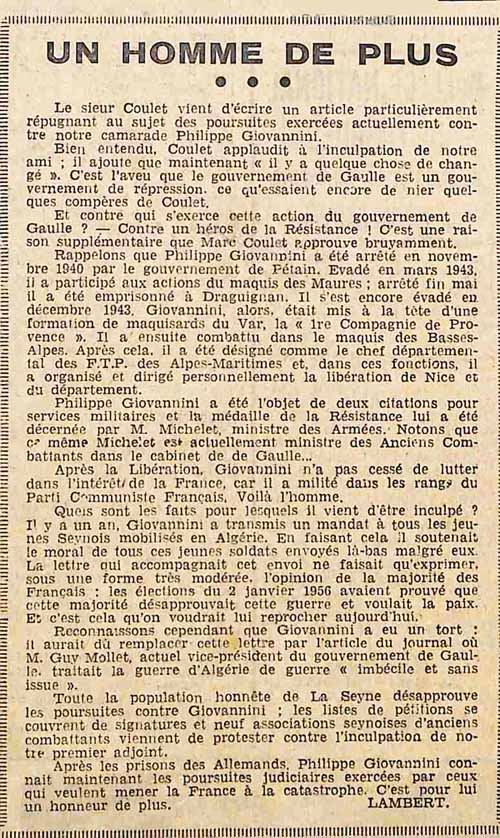 |
| Le Petit Varois - La Marseillaise, 7 juillet 1958 |
Le 13 février 1961, il est présent au
déjeuner servi dans la salle des fêtes de
l'hôtel-de-ville de La Seyne en présence de Maurice
Thorez, secrétaire général du P.C.F., venu le
matin à Toulon inaugurer la nouvelle maison du Parti.
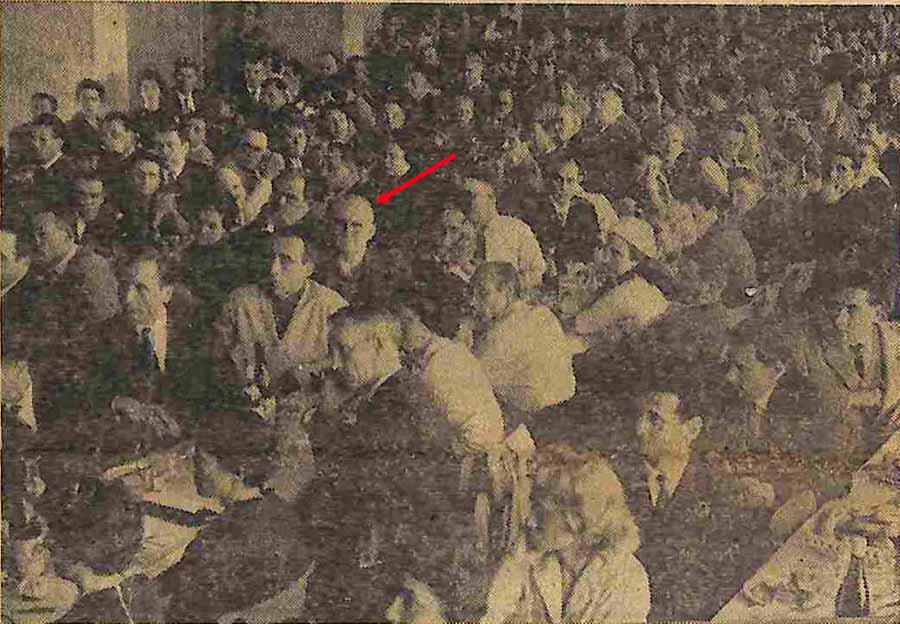 |
Le Petit Varois - La Marseillaise, 13 février 1961
|
Au printemps 1961, je me souviens qu'il avait encore une fois rendu
visite à sa sœur, à Nice, une sœur ne
partageait pas les idées révolutionnaires de Jean. Peu de
jours auparavant, il y avait eu le premier envoi dans l'espace, par les
Soviétiques, d'un vaisseau habité avec le
célèbre Youri Gagarine. Jean était présent
un jour où sa sœur avait invité chez elle l'une de
ces amies à prendre la café ou le thé et les deux
femmes saisissaient toutes les occasions pour critiquer la Russie
soviétique, ce à quoi Jean ne manquait pas de
répliquer avec fermeté ou avec humour. Aussi, dit l'amie
: « Ils auraient pu choisir quelqu'un avec un nom moins ridicule
pour l'envoyer dans l'espace. Car Gagarine, en français
ça commence par gaga... ». Et Jean, devant le niveau
primaire de cette argumentation, avait répliqué en
disant à l'amie [qui s'appelait Mme ou Mlle Clusel] : «
Mais vous, en dialecte bantou (ou bambara ?), si l'on prend le
début de votre nom (cluse), savez-vous ce que ça signifie
? Ça désigne l'endroit où l'on place les
suppositoires... Alors, je vous en prie, réfléchissez
avant de vous moquer d'un nom qui commence par Gaga... ».
Pendant deux ou
trois étés successifs il était parti se reposer et
changer d’air dans
une pension (Hôtel Beau Site) tenue par un camarade (je crois que la publicité en
était
faite dans le journal L’Humanité Dimanche),
dans la Corrèze, à
Saint-Pardoux-La-Croisille
exactement.
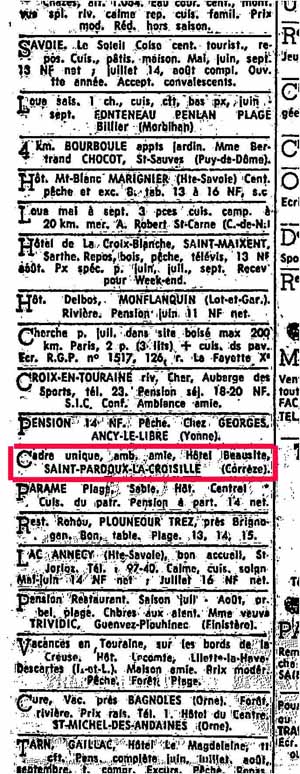 |
| Annonce de l'Hôtel Beau Site à Saint-Pardoux-la-Croisille, dans L'Humanité Dimanche |
L’été 1961, il y alla aussi, mais les semaines
précédentes, il apparaissait inquiet de sa santé
et de sa vue qui
baissait. Arriva le début du mois de septembre, on se disait :
il
devrait bientôt rentrer. Mais les jours passèrent. Vers la
mi-septembre, un ami et voisin du boulevard Staline, M. Cabras, passe
chez
le marchand de journaux, qu’il voyait tous les jours, et ce
jour-là ce
bonhomme, pas très futé, lui dit : « vous le
connaissiez vous, ce M. LAMBERT ? ». Et il lui
révèle un fait datant de
plus de 10 jours, le
passage d’enquêteurs de la police auprès de divers
voisins, chargés de
rechercher une éventuelle famille à M. LAMBERT, qui
était décédé à son
lieu de vacances !
Ainsi, « LAMBERT » était mort ! Depuis le 1er septembre 1961, à l’âge de 63 ans. Nous ne
l’avions pas su. Cet
abruti de marchand de journaux avait laissé repartir les
policiers sans
même leur indiquer que Jean LAMBERT comptait bien des amis
à proximité,
qui eux, auraient pu leur fournir des renseignements utiles sur lui et
la famille qui lui restait.
Que s’était-il passé ? Je ne sais
plus comment on l’apprit, peu à peu. LAMBERT avait
dû perdre espoir en
voyant sa vue diminuer et il décida de disparaître dans sa
chambre de
la pension de Saint-Pardoux. D’après le directeur de la
pension, il
avait laissé un billet sur sa table de nuit disant, je crois :
«
J’en ai marre. Enterrement civil. Ni fleurs ni couronnes ».
Je ne crois
pas qu’on ait su les causes exactes de la mort.
S’était-il injecté
quelque produit mortel, comme il l’avait vaguement
évoqué auparavant,
lorsqu’il rappelait qu’il avait fait des études de
médecine ? Ou
avait-il simplement interrompu ses piqûres d’insuline, ce
qui avait dû
le faire rapidement tomber dans le coma et entraîner ensuite sa
mort ?
Il fut enterré au cimetière de
Saint-Pardoux-la-Croisille. On apprit
par la suite que sa mort, dans la pension, avait créé
bien des soucis
au directeur et au personnel, d’autant que le corps avait
été découvert
au moment où un repas de mariage était
célébré dans l'établissement, et
où il avait fallu
beaucoup de sang-froid pour faire face simultanément à
l’affluence de
clients en liesse, la présence d’un cadavre dans une
chambre et
l’enquête de police...
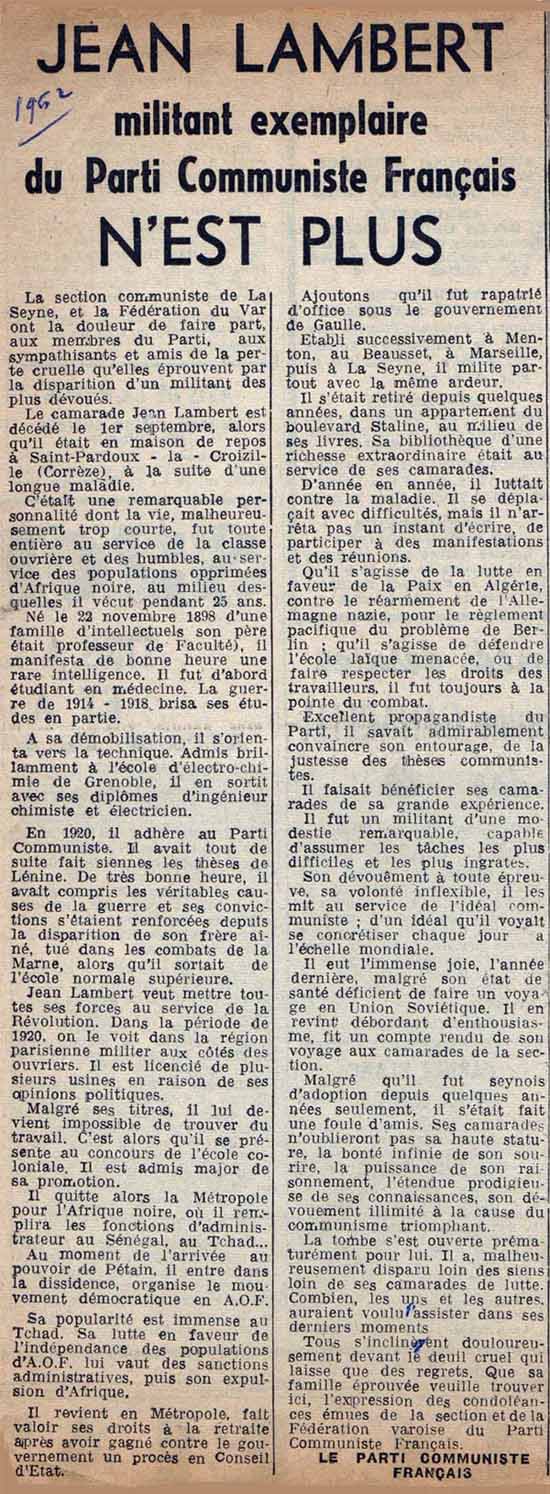
|
Le Petit Varois - La
Marseillaise, 18 septembre 1961
(Article signé LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, mais
écrit en très grande partie par Marius AUTRAN)
|
Ce fut évidemment la consternation pour
mon père et notre famille, ainsi que pour tous ses anciens amis
et
camarades du quartier.
Il revenait alors à l’ami le plus proche,
mon père, évidemment, de prévenir l’unique
membre de la famille
de Jean LAMBERT dont il avait connaissance (sa sœur) de son
décès. Mais il
fallait agir le plus
délicatement possible. Je crois qu’il obtint son adresse
et lui écrivit
que son frère était au plus mal et que sa présence
était requise. (Il
n’était en effet pas convenable d’annoncer
brutalement le décès d’un
frère par courrier ou par téléphone). Mlle LAMBERT
répondit qu’elle
avait des problèmes de santé, des difficultés
à se déplacer et qu’elle
hésitait à entreprendre ce voyage. Mon père reprit
alors contact et lui
dit que si elle tardait trop, elle risquait de ne plus revoir son
frère
vivant. Et Mlle LAMBERT vint donc à La Seyne, chez nous,
où mon père
devait lui annoncer la nouvelle. Nous fûmes surpris en la voyant
arriver : cette vieille demoiselle avait exactement la même
stature que
son frère et se déplaçait aussi difficilement que
lui, avec une canne.
Elle monta avec peine les deux étages et une fois assise, elle
demanda
évidemment : « Alors, où est-il ? ». Et
je souffrais pour mon
père et admirais sa délicatesse puisqu’il trouva
les mots difficiles,
appropriés pour ce genre de situation. « Je n’ai pas
de bonnes
nouvelles à vous annoncer. Et même de très
mauvaises... Eh oui, il est
décédé ». Et je me souviens de Mlle LAMBERT
disant : « Ah mon
Dieu ! » en tirant son mouchoir pour essuyer des larmes. Mon
père lui
expliqua le lieu du décès de son frère, et le fait
qu'il reposait déjà
au cimetière de Saint-Pardoux. Je ne me souviens pas s'il
évoqua le
fait que Jean LAMBERT avait probablement mis volontairement fin
à ses
jours. La suite de la conversation, je ne m’en souviens plus.
Sauf un
point capital. Lorsqu’il fut question de la famille de Jean
LAMBERT,
Mlle LAMBERT dit : « Mais il faut prévenir ma
belle-sœur » (!!!). «
Mais Jean était marié ! Il n’en avait jamais
parlé ! ». Ainsi, il
existait une Madame LAMBERT !
Je ne sais plus comment il fut
possible de pénétrer dans l'appartement de Jean LAMBERT.
Ses effets
personnels avaient-ils été rapatriés depuis
Saint-Pardoux ? Mon père
était présent lors de l'ouverture de l'appartement. Il
fut rapidement
trouvé sur son bureau une enveloppe « Ceci est mon
testament ». Je ne
me souviens plus de tous les détails qui y étaient
mentionnés, sauf la
phrase « Au camarade Autran, je lègue ma collection de
livres ». Une
phrase importante car, les livres, c'est à peu près tout
ce qu'il
possédait. Les murs de son appartement, séjour, chambre,
couloirs,
étaient recouverts d'étagères en bois remplies
d'ouvrages de toutes
sortes. Des milliers d'ouvrages.
Je
ne sais plus comment Madame LAMBERT fut contactée, sans doute
par sa belle-sœur
qui avait
certainement ses coordonnées. Elle résidait à
Paris, et elle était je
crois aide-maternelle (ou un emploi similaire) dans une école.
Nous la
vîmes arriver un jour. Elle héritait de l'appartement de
Jean et
pouvait s'y installer lors de ses visites. C'était une femme
d'assez
petite taille, qui contrastait avec Jean LAMBERT. C'était donc
elle,
Anna Truitard, que Jean LAMBERT avait épousée le 26 Juin
1926 à
Issy-les-Moulineaux (cf. les mentions marginales de l'acte de naissance
de Jean LAMBERT ci-dessus, ainsi qu'un relevé de son acte de
naissance retrouvé depuis sur Geneanet, et qui indique : Anna
Jehanne Truitard, née le 14 octobre 1898 à Bois-Colombes
(92)). Des conversations avec elles, nous eûmes
davantage de détails sur ce qu'avait été la
personnalité de Jean LAMBERT, que ce dernier n'avait jamais
confiés. En particulier,
ils
avaient eu une fille ! Et c'est à partir de là, pour des
raisons très
personnelles dans lesquelles nous n'avons pas à entrer, qu'ils
se
seraient
séparés. Cela devait
se situer à l'époque où Jean était en poste
en Afrique, et nous ne savons pas s'il connut ou non sa fille.
On en apprit
aussi davantage sur la vie qu'ils avaient menée aux Colonies.
Ils
avaient souvent fait la fête entre blancs. Ils avaient aussi,
tous
les 3-4 ans, de longues périodes de congé (6 mois), mais
il fallait
parfois plusieurs semaines de déplacement en bateau sur les
rivières
africaines pour atteindre la côte et s'embarquer pour la
métropole. Sur
ces bateaux, on buvait aussi beaucoup. Et Madame LAMBERT racontait que
son mari, ivre à ne plus tenir debout après avoir
consommé une forte
quantité de pippermint, avait réussi à ne pas
perdre la face lors de l'arrêt à un point de
contrôle.
C'est vers octobre ou novembre 1961 que nous avions reçu Mme
LAMBERT, accompagnée
de sa fille, à déjeuner dans notre appartement du
boulevard Staline
[Nous ne devions quitter cet appartement pour habiter notre nouvelle
maison du quartier Châteaubanne qu'aux vacances
de Noël 1961]. Je revois encore la fille de Jean LAMBERT, de
quelques
années plus âgée que moi, de stature comparable
à clle de son père. Je
ne sais plus ce qu'elle faisait, quelles avaient été ses
études. Je me
souviens qu'elle m'avait interrogée sur mes propres
études et mon
avenir alors que je m'apprêtais à entrer en classes
préparatoires aux grandes écoles, un domaine qu'elle
semblait bien
connaître. Mais la discussion au cours du repas avait
été assez tendue
avec mon père sur les aspects politiques.
La
mère et la fille ne partageaient pas du tout les idées de
Jean LAMBERT
et avaient vivement critiqué l'idéologie communiste et le
régime
soviétique
- « la fin justifie
les moyens » avait dit la fille de Jean. Il semblait y avoir eu
aussi
surprise et incompréhension de la part de l'épouse et de
la fille de
Jean, qui gardaient surtout de lui l'image négative d'un homme
qui
avait quitté sa famille pour mener sa vie ailleurs, tandis que
les amis
seynois de Jean - qui ignoraient tout de sa vie antérieure - le
considéraient comme un être hors du commun pour son
calibre
intellectuel, son immense culture et la puissance de son raisonnement.
Mme
LAMBERT avait souhaité que le maximum soit
enlevé rapidement pour rendre l'appartement habitable. Un
travail de déménagement important et mon père (qui
devait aussi aider
Mme LAMBERT pour diverses formalités) n'avait guère le
temps avec son
travail, la mairie, la maison que nous étions en train de faire
construire au quartier Châteaubanne, plus, à la même
époque, mon
grand-père qui était en fin de vie et qui exigeait des
soins et de la
présence. Ce que je n'avais pas réalisé
moi-même. Je le savais malade
et je savais qu'il souffrait beaucoup, mais ce n'est
précisément que
lors d'une conversation entre mon père et Mme LAMBERT que mon
père,
disant qu'il était débordé, prononça,
devant moi, la phrase « ... et en
plus, j'ai mon père qui meurt d'un cancer du poumon ! ».
On ne me
l'avait jamais dit ainsi. Et Mme LAMBERT qui rajouta « C'est
terrible,
il doit s'étouffer ». Et effectivement, mon
grand-père mourut le 30
mars 1962, sans avoir d'ailleurs jamais vu la maison de
Châteaubanne
terminée, alors que nous y habitions depuis 3 mois.
Nous
avions donc déménagé (depuis le 3e étage de
l'appartement de Jean) un grand nombre d'ouvrages, ainsi que la plupart
des rayonnages en bois sur lesquels les ouvrages se trouvaient et nous
en avions conservé une partie (les plus précieux dans
notre appartement du boulevard Staline), une autre partie ayant
été directement transportés dans notre maison,
alors en fin de construction, au quartier Châteaubanne, où
mon père avait déjà commencé à
installer son petit bureau dans une pièce du
rez-de-chaussée.Certes, nous
avions déjà pas mal de livres, scolaires, politiques,
romans, etc. Mais
avec cet héritage, notre fonds tripla ou quadrupla, pour le
moins.
Mais
nous n'avions pas pu tout récupérer et même pas pu
tout trier car cela nous aurait demandé des jours et des jours.
Nous avions donc rapidement mis de côté ce qui paraissait
le plus utile, le plus précieux, le plus intéressant (le
Larousse du XIXe siècle en 17 volumes - qui avait dû
appartenir au père de Jean, à Dijon, le Larousse du XXe
en 6
volumes, le Littré de 1875 en 4 volumes, de nombreux romans et
autres ouvrages tras du russe, de nombreux dictionnaires, de
nombreux ouvrages scientifiques,... Et surtout de nombreux ouvrages ou
plaquettes à caractère politique, notamment les
principaux classiques du marxisme. Ce qui m'avait permis, alors que
j'étudiais la philo à
Beaussier avec un prof éminemment marxiste, de me plonger et de
passer un temps excessif dans la lecture du
Capital, de l'anti-Dühring, et de bien d'autres œuvres de
Marx, Engels ou
Lénine.
D'ailleurs au détriment de mes études scientifiques, qui
n'avaient pas
été extraordinaires au cours de ce premier trimestre de
terminale.
Le
reste des ouvrages que nous n'avions pas pu conserver (car il y avait
aussi nombre de romans policiers ainsi que quelques ouvrages
érotiques) avait été déménagé
par les cantonniers de la mairie jusqu'au local provisoire de la
rue Messine où se trouvaient à l'époque les
collections de livres scolaires, et une partie avait été
transportés
à la bibliothèque municipale de la ville.
Au
fil des années, mon père élimina un certain nombre
d'ouvrages qui étaient soit endommagés, soit de peu
d'intérêt pour la famille. Mais, ayant
hérité des biens de mon père en 2007, je
possède encore un bon nombre de ces ouvrages de Jean, entre 400
et 500, que je conserve précieusement après les avoir
répertoriés dans le fichier informatique de ma
bibliothèque.
Grâce
aux annotations que l'on trouve dans nombre de ses livres, notamment de
la datation qu’il inscrivait quelquefois au début des
livres qu’il avait acquis, avec une mention du type « Le
Beausset, 18-2-53 », ou « La Seyne, 29-1-58 »,
quelquefois précédée de ses initiales (JL)
entrecroisées, on peut tenter de reconstituer le parcours de
Jean LAMBERT entre 1948 et 1958. Certes, il n’est pas certain que
tous les lieux écrits correspondent à une adresse
qu’il ait eue (car on ne peut pas exclure que ce puisse
être parfois la ville où il a acquis l’ouvrage et
où il ait été simplement été de
passage). Mais la répétition de certaines villes donne
cependant des indices sur son parcours. Ainsi, je suis certain
qu’il a habité Le Beausset (Var), apparemment entre 1951
et 1953, et La Seyne de 1955 environ jusqu’à sa mort. En
ce qui concerne les autres lieux, il est intéressant de noter
Saint-Louis en 1948 et plusieurs fois Nice (où résidaient
sa sœur et son père).
- Saint-Louis, 8-6-48
- Nice, 7-3-49
- Le Beausset, 12-2-51
- Toulon, 27-2-1951
- Marseille, 15-6-1951
- Le Beausset, 2-2-52
- Nice, 20-5-52
- Toulon, 6-4-52
- Toulon, 7-8-52
- Le Beausset, 18-2-53
- Nice, 16-6-53
- Beausset, 6-7-53
- Toulon 8-8-53
- Paris, 25-5-56
- La Seyne, 29-1-58
- La Seyne, 8-6-58
Jean
LAMBERT avait aussi conservé une assez grande quantité de
timbres, peut-être 10
000, de tous les pays, notamment des planches de timbres neufs des
colonies françaises. Je passai alors beaucoup de temps à
reclasser tous
ces timbres qui étaient en vrac pour la plupart. J'en
échangeai aussi
quelques-uns chez un marchand philatéliste de la rue
Franchipani. Cet
échange m'avait permis d'obtenir sans rien dépenser
quelques séries
intéressantes de timbres de France des années 1960-62 et
ce fut un
nouveau départ pour ma petite collection de timbres de France
que je
repris
alors systématiquement avec un nouvel album, et que je n'ai
jamais cessé d'enrichir depuis (52 ans déjà !).
Jean
LAMBERT possédait aussi quelques autres objets dont la fonction
ne nous était pas connue.
Mon
père n'étant censé hériter que des ouvrages
de la bibliothèque, nous n'avions pas souhaité
récupérer grand-chose d'autre, sauf s'il s'agissait
d'objets dont Mme veuve LAMBERT souhaitait se débarrasser (parmi
le bric-à-brac qu'elle avait trouvé dans l'appartement de
Jean). Mon père avait dû récupérer quelques
objets divers, mais qui se sont plus ou moins dispersés au fil
des années. Je possède encore des accessoires
d’optique, lentilles, miroirs, une « alidade nivelatrice du
Colonel Goulier », une boîte contenant des griffes de lion
ou de panthère et des dents d’animaux, ainsi que le
foulard de Pionnier ramené de son voyage en URSS.
Mais
d'autres anciens camarades de Jean rendaient parfois des visites
intéressées à Mme LAMBERT et en profitaient pour
subtiliser quelque objet qu'ils convoitaient...
Je
me souviens que la fille de Jean avait heureusement emporté la
machine à écrire portable de son père et sans
doute les principaux souvenirs de sa famille. Jean possédait une
série de photos de 1944-1945 où il apparaissait en
uniforme d'Administrateur (sans doute à Fort-Lamy), notamment
aux
côtés de Charles de Gaulle et de René Pleven.
J'espère que ces documents rares et précieux pour la
famille de Jean avaient bien été conservés et
qu'ils existent encore quelque part.
Quelques
années passèrent où Mme LAMBERT revint
régulièrement, notamment
l'été, séjourner quelques semaines à La
Seyne en occupant l'appartement de Jean. Un jour, vers 1965 ou 1966
(?), il nous sembla qu'elle avait cessé de venir à
l'appartement et nous n'avons jamais plus eu de nouvelles
d'elle, pas plus que de sa fille que je n'avais donc rencontrée
qu'une seule fois, en octobre ou novembre 1961.
En
septembre 1964, mon père mit à exécution le projet
qu'il avait depuis la disparition de Jean LAMBERT : se rendre sur sa
tombe à Saint-Pardoux-la-Croisille, en Corrèze. J'avais
accompagné mon père à cette occasion et nous
avions pu nous relayer au volant de la 403. Nous avions logé 2
nuits à l'hôtel même où Jean avait l'habitude
de séjourner et nous nous étions présenté
au patron qui nous avait alors évidemment conté le drame
de la disparition de Jean dans son établissement, un
évènement qui l'avait beaucoup marqué et qu'il
n'était pas près d'oublier. Nous avions alors
recherché la tombe dans le cimetière, l'avions
trouvée et y avions déposé un souvenir
funéraire portant l'inscription « Un ami de La Seyne
». Mais, je ne sais pas pourquoi, aucune photo n'avait
été prise de la tombe ce jour-là.
 |
Carte postale ancienne de
l'hôtel Beau Site, à Saint-Pardoux-la-Croisille
(Corrèze), où Jean LAMBERT avait plusieurs fois
séjourné et où il est mort le 31 août 1961
|
Près
de 30 ans se sont encore écoulés avant que je ne repasse
dans la région. C'est le 30 juillet 1991, alors que nous
étions à notre maison de campagne de l'Aveyron et que
nous avions, je crois, visité Rocamadour, que j'eus
l'idée de pousser une pointe un peu plus loin vers le nord
jusqu'en Corrèze et m'incliner ainsi, une seconde fois, sur la
tombe de Jean LAMBERT. Il n'y eut pas de photo non plus, mais une
séquence video du cimetière avec quelques zooms sur la
tombe et la photo de Jean. Voici ci-dessous un arrêt sur image
montrant la pierre tombale, telle qu'elle était il y a plus de
20 ans déjà. Je n'y suis jamais retourné depuis
mais le souvenir de Jean LAMBERT ne s'est jamais effacé en moi.
Pour
terminer, quelques autres documents émouvants retrouvés
parmi les ouvrages de la bibliothèque de Jean, notamment des
correspondances destinées à son frère Paul,
élève de l'Ecole normale supérieure de la rue
d'Ulm, mobilisé en 1914 et tué au combat en 1915.
Je
termine ici cet hommage à Jean LAMBERT, un personnage hors du
commun qui a tenu une place importante dans la vie de ma famille. Il
n'est pas dans mes habitudes de divulguer sur mon site internet des
détails d'ordre personnel ou familial. Mais peut-être
que
cette « bouteille jetée à la mer », qui
contient volontairement beaucoup (peut-être trop ?) de
détails d'ordre privé permettra-t-elle justement de
rétablir un contact avec la fille de Jean ou ses descendants, ou
d'autres membres de sa famille qui ignorent vraisemblablement nombre
d'informations que je détiens sur leur illustre ancêtre.
- Jean-Claude AUTRAN
- 8 décembre 2009, complété le 2 août
2013
Jean LAMBERT (suite)
La « bouteille jetée à
la mer » a été retrouvée !
En
effet, le 31 octobre 2012, je reçus un premier message
électronique provenant de Montréal, Canada, de la part de
Monsieur GL, petit cousin de Jean LAMBERT, qui « cherchait depuis
des années à retrouver cette branche de la famille
LAMBERT totalement perdue de vue ». Il ne connaissait que son
prénom, celui de sa sœur et de son frère,
effectivement disparu à la guerre de 14. Monsieur GL me remercia
de ce partage d’informations qui constituait pour lui « un
cadeau inappréciable, celui d’une vie sortie de
l’oubli ». Car, intéressé par la
généalogie, ce qu'il cherchait,
c'était « pas simplement des noms mais
des témoignages de vie, c’était de pouvoir enrichir
le coté humain des personnages que l’on rencontre et de
pouvoir redonner vie aux branches disparues ».
A
partir de jour, pendant environ 15 mois, nous avons eu plusieurs
échanges qui ont permis à chacun de nous de progresser -
bien au-delà de nos espérances - sur la connaissance de
Jean LAMBERT, ses origines, ses convictions, sa vie personnelle,
familiale et professionnelle. Une vie encore plus riche et plus
complexe que ce que mon père n'aurait pu l'imaginer. Le
détail de ces échanges ne sera pas divulgué car GL
ne souhaitait pas les voir publiés sur internet. Mais quelques
précisions d'ordre généalogique ont
été relevées et ont été
rajoutées pour compléter la biographie de Jean LAMBERT.
J'appris
ainsi que la famille LAMBERT était originaire des
Ardennes, de Villemontry. Le père de Jean (Charles), né
dans les Ardennes, avait eu plusieurs postes d’enseignant : au
Puy en Velay où il s’était marié, à
Annecy où il avait eu ses deux premiers enfants, puis à
Dijon (où Jean était né) et où il avait
fini sa carrière. Il
s’était ensuite retiré à Nice où il
était décédé en 1960. Il était donc
à
Nice quand Jean était à La Seyne. Sa mère
était
décédée longtemps auparavant, en 1922.
J’ai pu ainsi retrouver, dans le recensement de Dijon
(sur le
site internet des Archives départementales de la Côte
d'Or) la page du recensement de Dijon de 1896 où figure la
famille LAMBERT ), la composition de la famille LAMBERT de
l’époque au n°
2 de la rue de l’Ecole de Droit (l’adresse qui figure sur
l’acte de
Naissance de Jean LAMBERT en 1898). Voir le document ci-dessous.
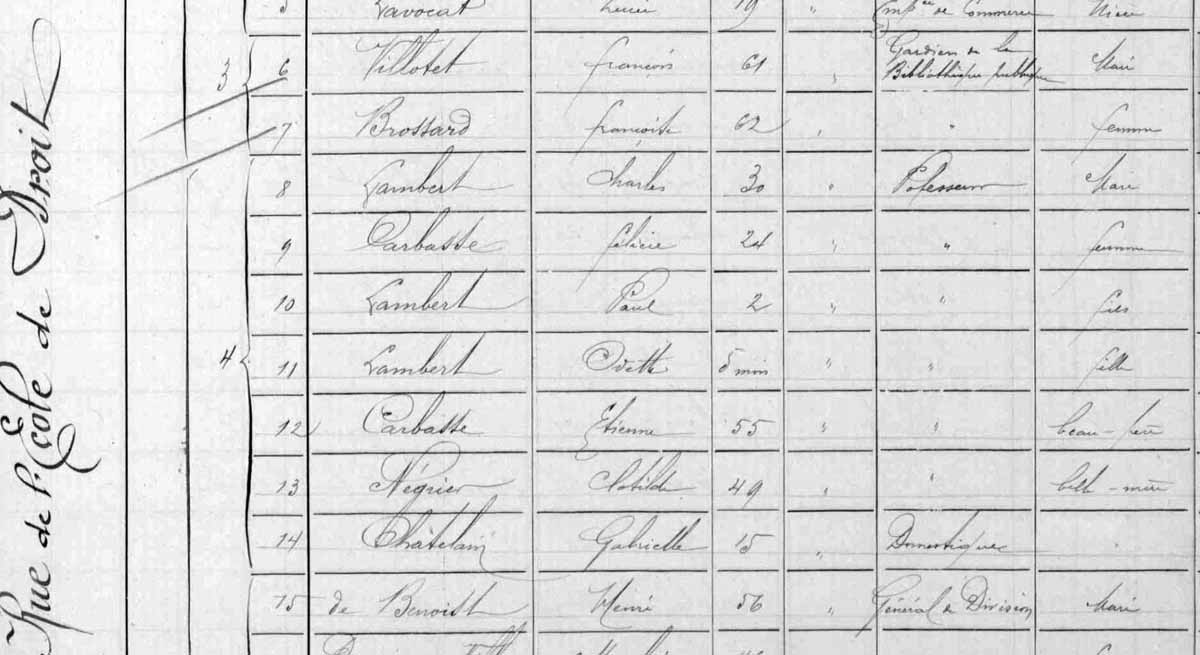
|
Extrait
du recensement de
Dijon de 1896, au 4 rue de l'Ecole de Droit. On y trouve Charles
LAMBERT, professeur, 30 ans, Félicie Carbasse, 24 ans, son
épouse, leurs deux premiers enfants : Paul, 2 ans et Odette, 5
mois [sans doute les deux enfants nés à Annecy], ainsi
que le beau-père et la belle-mère de Charles LAMBERT.
Jean LAMBERT n'était pas né à cette date. Il
naîtra à Dijon en 1898.
|
On y trouve effectivement :
LAMBERT Charles, 30
ans, professseur
CARBASSE Félicie, 24 ans, femme
LAMBERT Paul, 2 ans, fils
LAMBERT Odette, 5 mois, fille
CARBASSE Etienne, 55 ans, beau-père
NÉGRIER Clotilde, 49 ans, belle-mère
CHÂTELAIN Gabrielle, 15 ans, domestique
Paul était donc l’aîné de 4 ans environ, de
Jean. Odette, née vers 1895, était sans doute la
sœur aînée de Jean, qui était venue à
La Seyne en 1961.
Je n’avais cependant pas retrouvé les actes de naissances
de
Paul ni d'Odette à Dijon. Ni l’acte de mariage de leurs
parents. Peut-être étaient-ils récemment
arrivés à Dijon en 1896 et, si Jean y est bien né
en 1898, ses deux aînés étaient apparemment
nés ailleurs, mais je n’avais aucun idée du lieu,
ni
de l’origine géographique de leurs parents.
Enfin, j’avais retrouvé aussi dans des notes
généalogiques du site Geneanet, quelques informations sur
l’épouse de Jean LAMBERT :
« Anna Jehanne Truitard, née le 14 octobre 1898 à
Bois-Colombes (Hauts de Seine) ».
Mais nous n'avions encore aucune trace de leur fille. Je ne me
souvenais pas de son prénom. Je ne l’avais vue
qu’une fois en 1961. Elle avait alors quelques années de
plus que moi, peut-être 23-25 ans à l’époque.
Elle serait donc née vers 1936-1938. Mais
qu’était-elle
devenue ? Je me souviens qu’elle avait été
très surprise qu’à La Seyne, on avait son
père en grande estime, et qu’on le considérait
comme une personnalité d’exception – car, elle, ne
l’avait pas connu, et sa mère ne lui avait en
peut-être jamais dit grand chose, et peut-être pas en bien
? Donc, si elle a eu des enfants et des petits-enfants il est à
craindre qu’ils n’aient jamais beaucoup entendu parler de
leur grand-père et arrière grand-père Jean et
qu’ils n’aient pas cherché jusqu’ici à
savoir qui il était ?? Nous trouvions dommage que la fille de
Jean Lmabert ne connaisse peut-être jamais son histoire
familiale, mais sait-on jamais…
Dans les échanges qui ont suivi, je fis parvenir à
Monsieur GL le maximum de détails que j'avais pu retenir ou
retrouver, notamment des feuilles ou des lettres intercalées
dans les livres ayant appartenu à Jean LAMBERT.
Mais nous n'avions toujours pas d'information objective sur le parcours
de Jean pendant la guerre de 1914-1918, sur les entreprises dans
lesquelles Jean LAMBERT avait travaillé comme ingénieur
avant de faire l’École coloniale, et dans quels pays il
avait travaillé comme administrateur colonial ? Quelques dates
relevées dans ses ouvrages pouvaient seulement laisser imaginer
son parcours après la seconde guerre mondiale (Abidjan,
1947 ; Saint-Louis, 1948 ; Nice, 1949 ; Le Beausset et Toulon,
1951-1953 ; Paris, 1956 ; La Seyne, 1958). La découverte de la
mention d’Abidjan en 1947 m'apparut cependant importante car elle
semblait confirmer le souvenir que j’avais d'une conversation de
Jean avec mon père sur la Côte d’Ivoire et sur sa
rencontre avec Houphouët-Boigny. Ceci se passait donc
après qu’il dût quitter son poste à
Fort-Lamy, sanctionné par de Gaulle. (Il disait qu’il
avait été ramené en France par avion « entre
deux gendarmes »). Ces dates de 1947 et 1948 montrent qu’il
serait retourné dans plusieurs pays africains après ces
évènements (de Gaulle ayant quitté le pouvoir en
janvier 1946).
Comme élément nouveau, j’avais retrouvé un
échange de courriers de 1958 entre Jean LAMBERT et
l’auteur du livre “Le poids de l’Afrique”
(Charles-Henri Favrod), qui rapportait de manière critique
l’action de Jean LAMBERT au Tchad. Courrier dans lequel Jean
LAMBERT avait relevé des “erreurs flagrantes”, suivi
par la réponse de l’auteur du livre qui reconnaît
avoir été de bonne foi mais abusé par des
informations inexactes venant de la part d'une personne qui lui avait
paru être une caustion suffisante... Egalement, on rencontrait
dans plusieurs ouvrages de Jean LAMBERT des annotations de sa main
qu’il portait parfois en marge au cours de ses lectures.
C’étaient souvent des critiques, parfois acerbes, souvent
avec humour. Et l’on trouve de ces annotations dans tous les
types d’ouvrages, qu’il s’agisse de politique, de
philosophie, de romans, de mathématiques, etc., preuves de son
immense culture et de ses convictions. Il est notamment très dur
avec Simenon : « (...) ce n'est qu'un aspect de son racisme, si
bien partagé entre la presque totalité de la bourgeoisie
française ». Cela renseigne aussi sur son écriture,
très caractéristique et toujours très fine.
Un autre élément à prendre en compte était
la tombe de Jean LAMBERT à Saint-Pardoux-la-Croisille que
j'avais sur laquelle j'avais remarqué, en 1991,
l’inscription “Jean LAMBERT – Ami du peuple” et
sa photo - qui ne figuraient pas lors de ma première visite en
1963. Elles avaient été rajoutées (mais par qui ?).
Précisément, en juin 2013, Monsieur GL envisagea de se
rendre en France et de passer notamment à
Saint-Pardoux-la-Croisille pour savoir si
la tombe de Jean LAMBERT n'était pas en
déshérence. Et il eut la surprise de découvrir que
la femme de Jean LAMBERT avait été inhumée avec
lui et que la tombe était parfaitement entretenue. Un
extraordinaire hasard a fait qu'ils aient pu parler aussi avec Monsieur
TOURETTE, qui était le propriétaire de
l’hôtel au moment du décès de Jean LAMBERT et
qui était précisément de passage à
Saint-Pardoux où il ne réside plus depuis longtemps
(l'hôtel ayant maintenant fermé). Monsieur TOURETTE se
souvenait (52 ans après !) des derniers jours de Jean LAMBERT
qui, la veille de sa mort « avait rencontré un
médecin à Tulle qui lui avait annoncé qu’il
allait devenir aveugle dans les six mois ». Il se souvenait aussi
« de la femme et de la fille de Jean LAMBERT qui étaient
venues au moment du décès ainsi que de personnes de la
Seyne-sur-Mer venues après le décès.
 |

|
Tombe de Jean LAMBERT et de
son épouse à Saint-Pardoux-la-Croisille en 2013
(Photos GL)
|
A ce moment-là (juin 2013), voici comment je pouvais
résumer les informations en ma possession :
- - Un fait nouveau, c’est tout d’abord le
fait que la femme de Jean LAMBERT ait été inhumée
auprès de lui. Je n’avais d’ailleurs jamais su la
date de décès exacte de Jeanne LAMBERT (Anna Jehanne
TRUITARD, d’après l’état-civil). Lors de mon
dernier passage à Saint Pardoux la Croisille, le 30 juillet
1991, il n’y avait aucune plaque mentionnant Jeanne LAMBERT,
décédée pourtant 2 ans auparavant. Le corps de
cette dernière a donc dû être
transféré auprès de celui de son mari après
1991. La tombe est en effet parfaitement entretenue, la pierre tombale,
qui apparaissait déjà dégradée en 1991, a
été remise à neuf, sans doute à une date
récente. Ce qui indique que des descendants s’en occupent.
Sa fille ? Des petits-enfants ??
- -
Il est extraordinaire que l’ancien
propriétaire de l’hôtel après autant
d’années et qu’il ait conservé de Jean
LAMBERT et de son décès des souvenirs aussi vivaces. Ce
décès brutal dans son établissement (et, je crois,
pendant des festivités locales - ce qui avait compliqué
les choses car il avait fallu mettre de la discrétion dans la
venue de gendarmes à l’hôtel et
l’enlèvement du corps).
- - Ce que j’ignorais aussi (ou que j’avais
peut-être oublié), c’est que Jean avait
rencontré la veille un médecin à Tulle. Certes, il
avait dit à mon père au cours des mois
précédents que, comme conséquence de son
diabète, il risquait d'avoir progressivement un
décollement de la rétine et que, si cela se produisait et
qu’il devenait aveugle, vu que sa grande passion était la
lecture, il mettrait fin à ses jours. Et quand nous avons appris
son décès (et qu’il avait laissé un mot sur
sa table de nuit, dont je crois me souvenir que c’était :
« J’en ai marre. Obsèques civiles. Ni fleurs ni
couronnes », nous avions compris que son mal avait
progressé. Mais cette visite à un médecin de Tulle
la veille de son décès ne nous avait jamais
été rapportée, du moins je ne m'en souviens pas.
- - Ce qui me surprend dans le souvenir du directeur de
l’hôtel, c’est la venue de la femme et de la fille de
Jean « au moment du décès ». Car il me semble
que le décès fut ignoré de ses amis et de sa
famille pendant une certaine période. Ignoré de sa
famille, car c’est mon père qui, le premier, avait
réussi à joindre la sœur de Jean à Nice,
qu’il lui avait demandé de venir au plus vite en
prétendant que Jean était au plus mal. La sœur, qui
se déplaçait difficilement, avait hésité
à entreprendre le voyage. Mon père avait dû la
rappeler et insister pour qu’elle vienne chez nous, et
c’est seulement là qu’elle avait appris le
décès et qu’elle avait dit qu’il fallait
prévenir « ma belle-sœur ». Nous ne savions
pas alors que Jean avait été marié et avait une
fille. Sachant que le décès ne fut connu de mon
père que 1-2 semaines après (vu que la police
était venue à l’appartement de Jean sans
succès et avait ensuite interrogé des voisins dont le
marchand de journaux d’en face qui n’avait pu renseigner la
police sur le moindre membre de la famille qui aurait pu être
retrouvé, et qui n’avait signalé le
décès de Jean à un ami de mon père
qu’incidemment, je crois 1-2 semaines après le 1er
septembre. Ceci pour dire que le décès ne fut connu de la
sœur de Jean, puis de sa femme et de sa fille que vers la fin
septembre. Elles n’avaient donc pu aller à Saint-Pardoux
au moment du décès. Elles ont dû évidemment
s’y rendre ensuite, peut-être en octobre, et ont dû
s’occuper de la tombe à ce moment-là.
- - La tombe, je l’ai vue, avec mon père, 3 ans
plus tard, fin août ou tout début septembre 1964. (Et non
1963 comme j’avais dû l’écrire initialement).
Et nous avions logé chez M. Tourrette et parlé
naturellement avec lui de Jean LAMBERT. S’il se rappelle de
personnes venues de La Seyne-sur-Mer, c’est peut-être de
nous. Mais il n’est pas impossible que d’autres amis de
Jean soient venus sur sa tombe dans les mois ou les années qui
ont suivi son décès.
Voilà ce que je pouvais dire en me replongeant dans mes
souvenirs (d’il y a plus de cinquante ans !) et en indiquant les
points qui me paraissaient correspondre exactement à mes
souvenirs
et ceux que j’ignorais ou dont je n’avais pas le même
souvenir. Restait à ce moment-là (juin 2013) à
retrouver ceux ou celles qui avaient continué à
entretenir la tombe de Saint-Pardoux, ce qui
aurait pu amener à rétablir le contact avec la fille de
Jean LAMBERT ou ses descendants, car d’autres documents originaux
sur Jean LAMBERT (je pensais aux photos de Jean, en uniforme
d'Administrateur, à Fort-Lamy, avec Charles GAULLE et
René PLEVEN, photos que sa fille avait précieusement
recueillies) étaient certainement en leur possession.
Or, quelques semaines plus tard, le 30 juillet, Monsieur GL m'informa
que
les choses avaient beaucoup avancé : c'était bien la
fille de Jean LAMBERT, Paule LAMBERT [un prénom qui rappelle
bien sûr Paul LAMBERT, frère aîné
de Jean, normalien tué à la guerre en 1915], qui
avait fait rajouter sur la tombe une plaque au nom de sa mère et
qui chargeait quelqu’un de l’entretien de la tombe. Paule
LAMBERT l'avait contacté. Elle était
maintenant âgée de 80 ans et vivait aux États-Unis
depuis une trentaine d’années. Elle n’avait pas de
descendants. Paule s'était montrée très
désireuse de pouvoir parler avec quelqu’un qui avait connu
son père, et j'acceptai naturellement de lui communiquer mes
coordonnées téléphoniques. Mais je n'arrivai pas
à réaliser que la fille de Jean pouvait avoir
aujourd’hui 80 ans ! Il est vrai que, lorsque je l’ai
rencontrée, une seule fois, en 1961, j’avais 17 ans et
elle avait quelques années de plus que moi, entre 25 et 28 ans,
me semblait-il.
Fin août 2013, je fus en effet appelé pour la
première fois au téléphone par Paule LAMBERT.
Ce fut une grande joie et une grande émotion. Nous
avions parlé plus de 45 minutes et elle m’avait
conté les
principaux épisodes de sa vie, de celle de sa mère et de
celle de son
père, telle qu’elle avait pu la reconstituer
d’après tout ce qu’avait
pu lui dire sa mère, son grand-père ou d’autres
membres de la famille.
J’ai essayé d’écrire rapidement, au fur
à mesure, ce qu’elle me disait,
mais je n’ai évidemment pas pu tout noter tant elle avait
de détails à
me livrer. Je n’ai pas pu, non plus, faute de temps, lui demander
un
certain nombre de choses sur elle, notamment pourquoi elle était
partie
un jour pour les États-Unis et y était restée.
Finalement, elle savait beaucoup plus de choses que je ne le
pensais
sur son père, et elle m’en a aussi beaucoup appris.
Parfois, l’histoire
coïncidait très bien avec ce que j’en savais par mon
père. Mais,
concernant de nombreux aspects de sa vie, au contraire, bien
qu’il ait
passé de très nombreuses heures à bavarder avec
mon père, Jean ne les
avait jamais évoqués. A commencer bien sûr par le
fait qu’il était
marié, qu’il avait une fille, qu’il avait revu sa
femme à plusieurs
reprises, ou que son père était
décédé en 1960, à Nice. Ce que j’ai
découvert aussi, c’est que Mme LAMBERT et sa fille
étaient revenues
régulièrement, et pendant de nombreuses années,
à La Seyne, à
l’appartement de Jean. Et que ce n’était que
récemment que Paule avait
mis l’appartement en location et l’avait vendu.
J’étais persuadé, aux
dires de mes parents, comme je vous l’avais écrit, que Mme
LAMBERT y
était venue seulement quelques années et qu’ils ne
l’avaient plus vue après 1965 ou 1966. Paule me dit au
contraire qu’elles avaient essayé de retrouver
la trace de mon père mais que, dans le quartier, on lui avait
dit que
nous étions partis, sans autre précision. Il est vrai que
nous avions
déménagé entre temps, mais ce n’était
qu’à quelques centaines de
mètres, et il est regrettable que le contact ait
été ainsi rompu alors
que Paule et sa mère étaient revenues tout près de
chez nous pendant
encore une vingtaine d’années, jusque dans les
années 1980.
J’ai toujours pensé que Jean LAMBERT était un
personnage d’exception,
tel qu’on en rencontre très peu dans une vie (pour les
modestes
habitants d’une petite ville de province que nous étions),
qu’il avait
eu une existence et une carrière hors du commun (début
d’études médicales, qu'il abandonne ;
mobilisé en 1918 comme médecin-auxiliaire ; études
d’ingénieur (chimie, électronique) à
Grenoble ; il ne peut jamais garder longtemps ses emplois de cadre car
il soutient toujours
les pauvres et les faibles, il défend toujours les ouvriers et
les incite à se révolter ; il est donc renvoyé de
partout ; il entre à l'École coloniale et fait
carrière en Afrique ; mais, là aussi, il soutient
toujours les Indigènes contre les Européens et il est
finalement limogé par de Gaulle ; il gagne plus tard son
procès en Conseil d'État et obtient en réparation
le versement de 5 ans de salaire). Bien qu'ayant eu une
éducation bourgeoise, raffinée (grand
père
inspecteur d’académie, père doyen
d’université), rapidement, sa nature
révoltée prend le dessus, surtout
après la mort de son frère (1915) et de
sa mère (1922), et il quitte très vite sa
famille. Mais c’était aussi
apparemment une nature complexe, et, il me semble, difficile à
décrypter. Quelqu'un d’une curiosité et
d’une culture encyclopédique, et qui devait être
fascinant, mais peut-être à l’étroit dans la
vie quotidienne.Je ne crois pas que sa fille soit parvenue
à comprendre ou
expliquer de manière rationnelle les raisons du comportement de
son
père avec elle et avec sa mère. Un certain nombre de
choses nous
échappent peut-être, pour lesquelles Jean, homme
particulièrement
intelligent, avait sans doute ses raisons, que nous ne
connaîtrons
jamais. J’ai parlé à Paule LAMBERT des photos (avec
Charles de Gaulle et René
Pleven, entre autres) que Jean avait montrées à mon
père. Elle les
avait conservées, effectivement, et m’en a envoyé
des copies que j’ai
reçues il y a quelques jours. Dans un courrier du 3 septembre,
elle m’a envoyé aussi de nombreuses
photocopies de la carrière professionnelle de Jean et de ses
activités
dans la Résistance au régime de Vichy, qui lui avaient
valu saisie de
tous ses biens et même condamnation à mort.
3
septembre 2013 : Premier courrier de Paule LAMBERT
Chers
amis,
Voici
enfin les documents promis. J'ai eu beaucoup de plaisir à parler
avec vous au téléphone et j'aime revivre tous les
souvenirs attachés à mon père que vous avez mieux
connu que moi. Je ne sais plus très bien ce que je vous ai dit
car, en même temps, j'ai parlé à GL plus ou moins
des mêmes choses. Donc, si vous avez des questions, quelles
qu'elles soient, je serai heureuse d'y répondre.
L'histoire
de la traction avant m'a bien amusée.
Très
amicalement
PL
 |
Jean LAMBERT à
l'École Coloniale (année 1926/1927) : le 4e assis en
partant de la droite
|
Photos
d'identité et de famille
 |
Photo de la
carte de la Bibliothèque Nationale 1929/1930
|
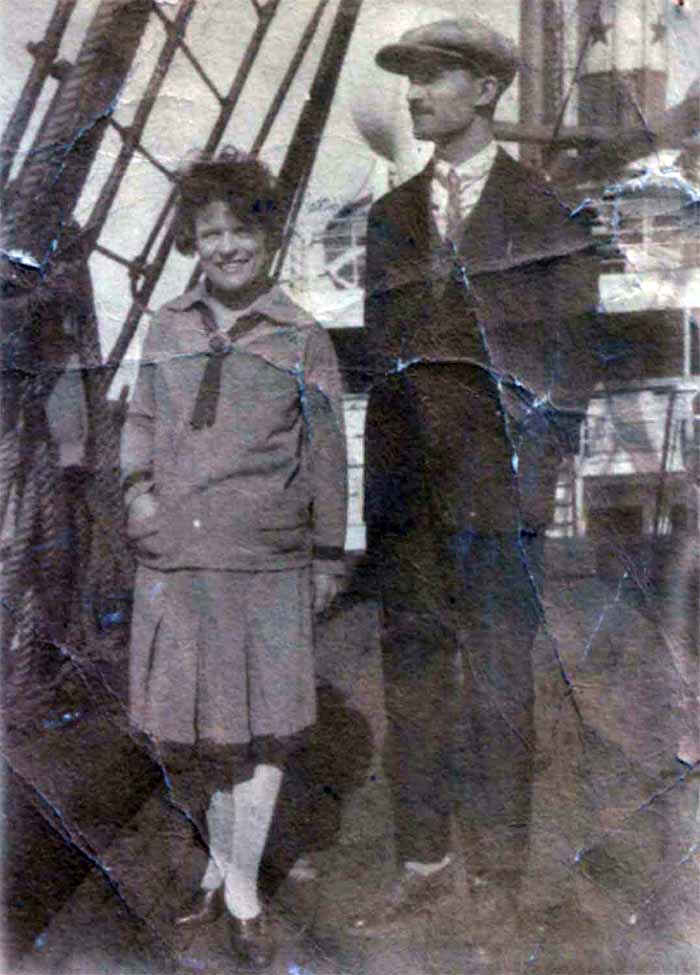 |
Jean LAMBERT
et son épouse, en route pour l'Afrique
|
 |
Photo
d'identité, non datée
|
 |
Photo
d'identité, non datée
|
Photos
d'Afrique
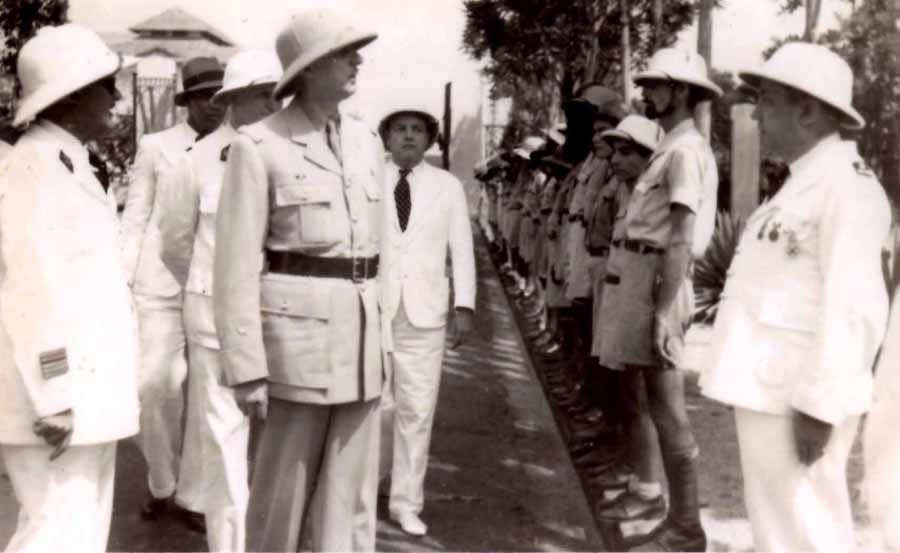 |
1943
|
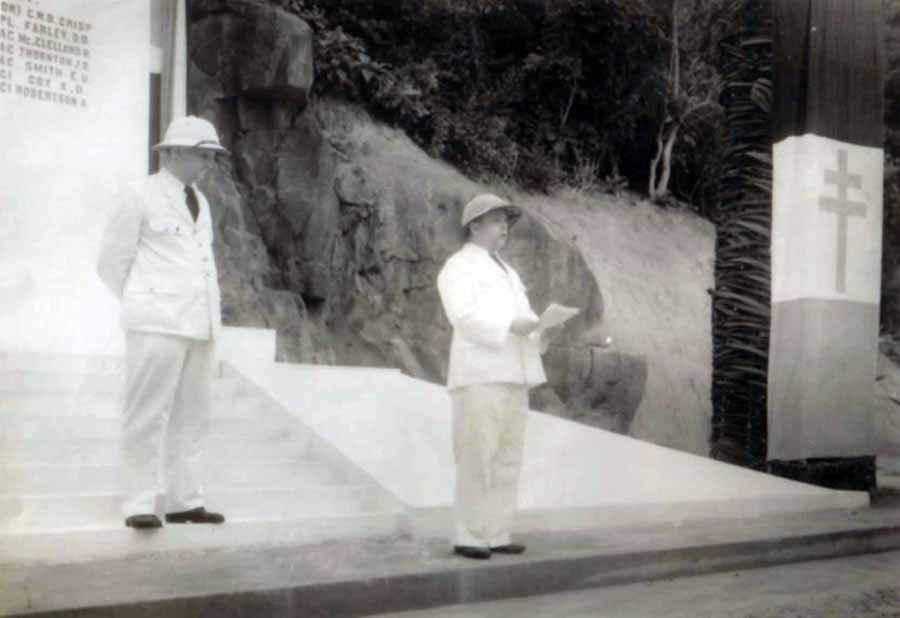 |
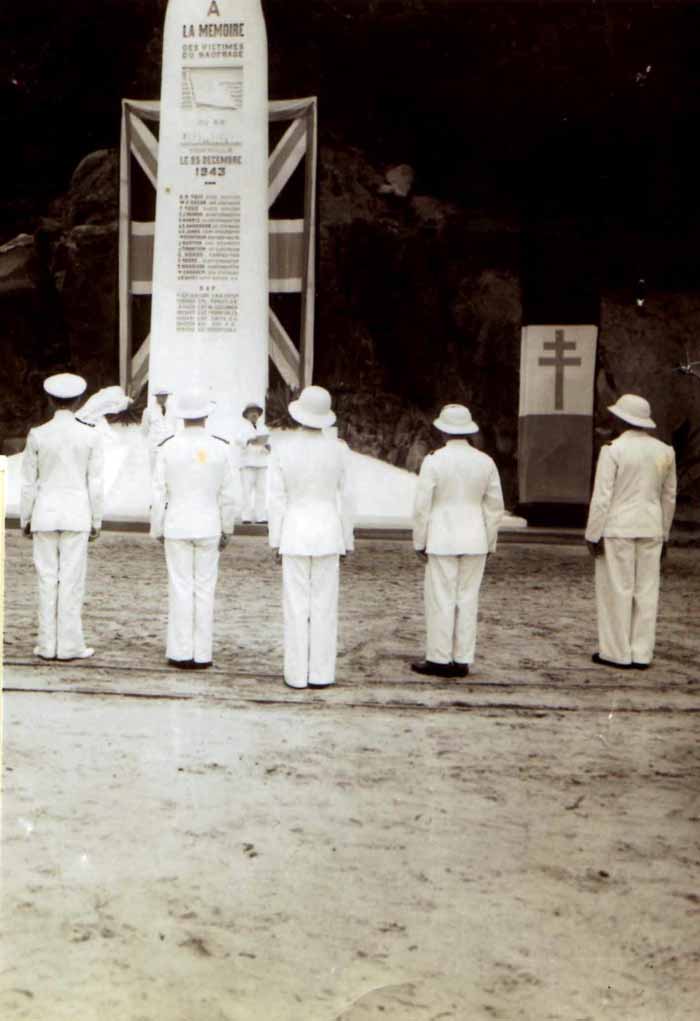 |
 |
| Cérémonie autour
du monument funéraire (Sassandra, Côte d’Ivoire) qui rend hommage aux victimes du
torpillage du
s.s. Dumana le 24 décembre 1943. La photo du bas représente le monument aujourd'hui
|
Photos
d'un lieu inconnu (à identifier)
 |
|
J’ai
été très ému de découvrir ces photos
de Jean, beaucoup plus jeune,
avec encore des cheveux ! dans sa tenue blanche d’Administrateur
en
Afrique. Si mon père (décédé il y a 6 ans),
qui avait une estime
infinie pour Jean, était encore de ce monde, il aurait
été extrêmement
intéressé de revoir ces photos et de découvrir
aussi tous ces aspects de la
vie de Jean, qu’il a ignorés. Et il aurait admiré
comment, grâce à
internet, il était devenu possible de renouer des contacts avec
des
familles amies, aussi éloignées et si longtemps
après !
Jean LAMBERT
est mort, il y a maintenant 52 ans, et pourtant, à La
Seyne-sur-Mer, plusieurs responsables politiques de
l’époque (à qui
j’ai parlé de Jean récemment), tous
octogénaires, se rappellent
parfaitement de lui, de son visage et de sa stature, bien qu’ils
ne se
souviennent plus très bien de son parcours (administrateur ?
Afrique ?
écrivain ?). Ils m’ont rappelé qu’au
début des années 1960, peu après
la disparition de Jean, une Cellule du Parti communiste du quartier
Berthe (un quartier populaire de La Seyne), avait été
dénommée «
Cellule Jean LAMBERT ».
Il y eut par la suite deux autres conversations
téléphoniques et deux autres courriers de Paule LAMBERT
avec, à chaque fois, de nouvelles précisions et l'envoi
de nouvelles photocopies de documents retrouvés sur la vie et la
carrière de Jean LAMBERT.
Mais la date et le lieu des photos prises en Afrique, notamment lors
d'une visite de Charles de GAULLE n'ont toujours pas pu être
déterminés avec certitude. Certaines photos auraient pu
être prises à Fort-Lamy, à l'époque ou Jean
LAMBERT y fut Administrateur-Maire et de GAULLE et PLEVEN se sont
rendus plusieurs fois, ce pays s'étant, le premier d'Afrique,
à s'être rallié à la France Libre (PLEVEN
dès 1941). J'ai en effet le souvenir que Jean LAMBERT fut
limogé par de GAULLE après l'affaire de la mosquée
de Fort-Lamy. Il y a pourtant, dans la série de photos, celle d'une
cérémonie autour
du monument funéraire qui rend hommage aux victimes du
torpillage du
s.s. Dumana le 24 décembre 1943, monument qui se trouve,
aujourd’hui
encore, à Sassandra, en Côte d’Ivoire. Alors, ces
photos (si elles sont vraiment
toutes de la même série) pourraient plutôt dater de
la période en
Côte d’Ivoire, après septembre 1943. A partir de
cette époque, Jean LAMBERT est en effet affecté au poste
d'Administrateur, Chef de cabinet de M. le Gouverneur de Côte
d'Ivoire. Mais pourtant de Gaulle ne semble être venu pour la
première fois à Abidjan que le 15 janvier 1944. Jean
LAMBERT n'aurait alors pas été limogé par de
GAULLE à Fort-Lamy, mais il l'aurait été plus tard, en
1947 (et ce n'était plus par de GAULLE lui même, qui
n'était plus au pouvoir), et pour ses idées politiques,
au
moins autant que pour cette affaire de mosquée.
28 novembre 2014 : Courrier
à Paule LAMBERT
Bonjour Paule,
J’avais promis de vous faire parvenir de nouveaux textes
biographiques de votre père. (...) Vous trouverez donc ci-joint
deux textes biographiques destinés au Dictionnaire Biographique
du Mouvement Ouvrier et Social Français (dont il existe une
version imprimée et une version en ligne) :
- L’un qui avait été écrit par un
historien
de la région de Grenoble (Pierre Broué) et qui
s’arrête en 1924, l’auteur ayant alors perdu la trace
de Jean LAMBERT dans les archives locales.
- L’autre qui prend en compte la suite de la vie de votre
père à partir des informations en ma possession,
complétées par les échanges que j’ai eus
avec Gérard LAMBERT et avec vous, le tout remis en forme dans le
style standardisé de ces notices biographiques (écriture
au passé, ton neutre, état civil contrôlé,
sources) par mon ami historien Jacques Girault (qui habitait autrefois
le même immeuble que ma famille et qui avait donc aussi connu
votre père à la fin des années 50).
Pendant de nombreuses années, seule la première
version
de la biographie de votre père avait figuré, sans que
nous nous en doutions, dans le Dictionnaire. Jacques Girault a
maintenant adressé la version complétée à
l’Éditeur pour qu’elle remplace l’ancienne.
Je pense que la première version retiendra
particulièrement votre intérêt car elle
témoigne des opinions et des actions extrémistes voire
anarchistes de votre père à cette époque, sans
doute, comme vous me l’avez expliqué, en réaction
à la disparition tragique de son frère, puis de sa
mère.
La dernière version de la biographie, qui a
été
mise sur internet, peut toujours faire l’objet de
compléments ou de rectifications. Donc, si vous constatez des
anomalies ou des oublis, vous pouvez m’en informer pour que nous
opérions les corrections que vous souhaiteriez voir
apparaître.
Dans cette attente, recevez toute mon amitié.
Jean-Claude Autran
4 décembre 2013 : Courrier de Paule LAMBERT
Bonjour Jean-Claude,
Merci infiniment de m'avoir envoyé ces deux biographies qui
me sont
très précieuses. Comme vous l'avez deviné, cela
m'a beaucoup interessée
de découvrir ce que faisait mon père avant d'entrer dans
la vie de ma
mère. Ces informations sont nouvelles pour moi mais
correspondent bien à l'état d'esprit qui dut être
celui de mon père, esprit de révolte
après la mort de son frère dans les tranchées et
toutes les
pertes de vie qui ont marqué la guerre de 1914. GL me
disait aujourd'hui que la moitié de la promotion de Paul a l'ENS
y a
perdu la vie : 9 élèves sur 18. N'est-ce pas affreux ?
N'est-ce pas un
gachis abominable et une perte de cerveaux remarquables qui auraient pu
apporter beaucoup à la société ?
Merci aussi de la photo de votre famille que je viens d'imprimer.
Je
peux ainsi mieux vous imaginer. Quelle belle famille ? Vous avez l'air
très heureux tous les cinq sous le beau ciel de Provence.
Merci encore, cher Jean-Claude.
Toutes mes amitiés, à vous, à Yolande et
à vos trois fils.
PL
21 janvier 2014 : Courrier de
Paule LAMBERT
Cher Jean-Claude,
J'ai retrouvé des papiers relatifs à mon
père, qui
sont susceptibles de vous intéresser. Ci-joint les copies :
1) Récapitalatif des activités de
Jean LAMBERT jusqu'en 1945.
2) Affectations successives en Afrique.
3) Rapport officiel (par l'administration de
Vichy) du passage clandestin de mon père au Libéria.
4) Jugement par contumace prononcé par
le tribunal militaire de Dakar.
5) Appel lancé à la radio d'Accra.
6) Demande d'affectation au corps
expéditionnaire indochinois (Je n'avais jamais eu connaissance
de cette démarche qui semble ne pas avoir abouti).
Il apparaît que mon père s'est aussi engagé
volontaire pour combattre dans l'armée française en mai
1940 (il devait avoir une idée derrière la tête),
que, dans ce but, il s'est rendu à Sète, mais que cette
affectation lui a été refusée et qu'il a
été estimé plus utile de lui redonner un poste en
Afrique après son congé en France (c'est la
période où nous avons vécu ensemble, tous les
trois, à Dijon). Il a été alors affecté en
Côte d'Ivoire, d'où il s'est enfui pour se rendre au
Libéria et rejoindre les Forces Françaises Libres.
En février 1942, il est affecté au Tchad, à
Fort-Lamy, et c'est là que les photos ont dû être
prises avec de Gaulle.
Les pièces du puzzle se mettent peu à peu en place
et,
grâce à vous, je commence à avoir une vision
d'ensemble et j'en suis ravie.
J'espère que vous n'avez pas été
touchés
par les inondations qui affectent tout le Var. Ici, nous entrons encore
dans une tempête de neige et il fait très froid.
A vous et à Yolande, j'envoie toutes mes amitiés les
plus sincères.
PL
Jean Lambert : activités jusqu'en
1945
- Né à Dijon le 22 novembre 1898.
- Baccalauréat en 1914 et 1915.
- Étudiant en médecine en 1915-1916-1917.
- Mobilisé en avril 1917.
- Infirmier de 2e classe, puis médecin-auxiliaire.
- Front des Vosges, puis Macédoine.
- Démobilisé en février 1920.
- Adhère à la section de Dijon du Parti en mars 1920.
- Participe à la lutte pour le rattachement à la
3ème Internationale.
- Arrêté lors de la manifestation vontre l'inauguration du
monument de Bossuet et condamné par le tribunal de simple police
à 5 francs d'amende.
- Licencié ès-sciences en juillet 1921.
- Étudiant à l'Institut Électrotechnique de
Grenoble d'octobre 1921 à juillet 1923. Fait partie de la
section de Grenoble.
- Secrétaire-adjoint de la Fédération Communiste
de l'Isère.
- Condamné en mai 1923 par le Tribunal correctionnel d'Annecy
à 800 francs d'amende pour un article paru dans le journal local
du Parti, "Le Travailleur de l'Isère".
- Diplômé Ingénieur électricien en juillet
1923.
- En juillet 1923, à sa sortie de l'Institut Électrotechnique, le
directeur de l'Institut refuse de le placer à cause de ses
opinions politiques.
- S'embauche comme manœuvre dans une usine de pros chimiques de Saint-Fons (banlieue de Lyon).
- Milite à la section de Saint-Fons.
- Secrétaire du syndicat (C.G.T.U.) des Pros Chimiques de
Lyon.
- Participe en janvier 1924 au congrès de Lyon du Parti.
- Désigné par le congrès comme membre de la
délégation qui devait assister aux obsèques de
Lénine. (La délégation n'est d'ailleurs pas
partie, les obsèques ayant eu lieu sans délai).
- Mars 1924 : Ingénieur électricien aux "Exploitations
électriques à Langres". Milite à la section de
Langres.
- Octobre 1924 : Ingénieur chimiste aux usines du
"Bi-Métal" à Alfortville.
- Secrétaire-adjoint du rayon d'Alfortville.
- Secrétaire-adjoint de la Fédération des Pros
Chimiques (C.G.T.U.).
- Octobre 1925 : Ayant porté la contradiction au nom du Parti
à une réunion publique à Alfortville, est
renvoyé des usines du "Bi-Métal".
- Ingénieur aux usines de la S.E.V. (Issy-les-Moulineaux).
- Milite à la cellule de l'usine.
- Ayant fait grève le 1er mai 1926, est renvoyé de la
S.E.V. le 2 mai.
- Ingénieur-chimiste au Comptoir des Alcaloïdes à
Noisy-le-Sec.
- Janvier 1927 : Entre dans l'administration coloniale comme Adjoint
des Services Civils de l'A.E.F.
- Affecté aux chantiers du chemin de fer Congo-Océan, a
fourni les éléments de la campagne menée par le
Parti en 1929 et 1930 contre les abus commis au Congo-Océan.
- A cessé de cotiser au Parti en 1927 car il n'existait pas de
section en A.E.F.
- 1930 : Nommé Administrateur-Adjoint des Colonies.
Affecté au Tchad.
- 1937 : Affecté au Moyen-Congo. Dénonce officiellement
les abus commis par la mission catholique de Franceville et par
l'évêque de Libreville, TARDY.
- Mai 1939 : Nommé Administrateur
des Colonies.
- Mai 1940 : Rapatrié en France, malade.
- Novembre 1940 : Affecté en A.O.F., en Côte d'Ivoire.
- Août 1941 : Muté de Gagnoa (Côte d'Ivoire)
à Touba (Côte d'Ivoire) pour avoir « saboté les
cérémonies de la Semaine impériale de
Pétain ».
- Décembre 1941 : Abandonne son poste de Touba et gagne le
Liberia pour rejoindre les F.F.L. Après un emprisonnement de 15
jours au Liberia, traverse à pied tout le Liberia et s'embarque
à Monrovia.
- Février 1942 : Affecté à la mission des Forces
Françaises Libres d'Accra (Côte de l'Or) où il est
chargé du bulletin d'information de la station de radio.
- Avril 1942 : demande à partir à l'armée Leclerc.
Affectation refusée. Est affecté au Tchad [dont le gouverneur Félix
Éboué proclame le 26 août 1942 le ralliement
à la France Libre]. Administrateur-Maire de Fort-Lamy,
puis chef du département de Batha (Tchad).
- 5 septembre 1942 : Condamné à mort pour "trahison" et
à la confiscation des biens par le Tribunal militaire de Dakar.
- Septembre 1943 : Affecté en Côte d'Ivoire par le
Gouvernement provisoire d'Alger. Chef du Cabinet du Gouverneur de la
Côte d'Ivoire, puis Chef du Bureau des Affaires politiques de la
Côte d'Ivoire.
- Août 1945 : Rentre en France en permission de détente.
Reprend sa carte du Parti à Dijon. Médaillé de la
Résistance Française.
|
Affectations successives de Jean
LAMBERT en Afrique (de 1927 à 1940) :
I° séjour
|
Février 1927
Janvier 1929
Novembre 1929
|
Chargé des cultures
vivrières des chantiers du chemin de fer Congo-Océan
Congé de convalescence de six mois
Stagiaire à l'Ecole Coloniale
|
2° séjour
|
26-5-1930
Juin 1930
Juin 1932
|
Affectation à l'A.E.F.
Chef de subdivision de Massakory
Congé administratif de 6 mois
|
3° séjour
|
Mars 1933
Août 1933
Juin 1934
Décembre 1934
Mars 1936
|
Chef de subdivision de Ngouri
Adjoint au chef de circonscription du Kanem
Adjoint au chef de circonscription du Mayo-Kebbi
Chef de subdivision de Fianga
Congé administratif de 9 mois
|
4° séjour
|
Février 1937
Septembre 1937
Février 1938
Juillet 1938
Avril 1939
Décembre 1939
|
Chef de subdivision de
Franceville
Chef de subdivision d'Okondja
Évacué sur l'hôpital de Brazzaville
Chef de subdivision d'Aboudéia
Chef de département intérimaire du Salamat
Chef de subdivision d'Aboudéia
Évacué sur l'hôpital de Fort-Archambault :
hospitalisé le 5-2-1940
|
6 février 2014 : Courrier à Paule LAMBERT
Chère Paule,
Encore un
grand merci pour tous les précieux documents que vous venez de
m’adresser.
La vie et le
parcours chronologique de votre père nous sont ainsi connus avec
encore
plus de précisions. Et tous les détails nouveaux que
j’ai découverts me
confortent dans l’idée qu’il fut vraiment un
personnage hors du commun
et animé d’un courage, d’une conviction, et
d’un patriotisme
extraordinaires.
Vos documents
nous font découvrir des choix importants qu’il avait faits
(demande
d’engagement volontaire en 1940, demande à partir dans
l’armée Leclerc
en 1942, demande à d’affectation au corps
expéditionnaire indochinois
en mars 1945), et qui n’apparaissaient pas dans les documents
biographiques rassemblés jusqu’ici. Ils nous permettent
aussi de bien
compléter certaines périodes de sa vie qui étaient
encore obscures, à
la fois au niveau de ses affectations professionnelles en France (et
son activité constante de militant communiste qui dut être
classé parmi
les « durs » de l’époque), et surtout en ce
qui concerne la chronologie
de ses affectations en Afrique.
Cela va nous
amener à déjà corriger certains points de la
notice biographique qui
avait été rédigée il y a quelques mois sur
votre père en vue du
Dictionnaire du Mouvement Ouvrier et Social Seynois. En particulier,
pour ce qui concerne ses affectations en 1917-1918 sur le Front des
Vosges, puis en Macédoine (la notice faisait état
d’une affectation au
Moyen-Congo, ce qui ne sera le cas qu’en 1937 - car le Fascicule
de
Mobilisation - classe 1918 - sur lequel je m’étais
appuyé est en fait
un document de mobilisation pour la Seconde guerre mondiale et non de
1918).
Je n’ai
peut-être pas encore étudié avec suffisamment de
soin toutes les dates
et tous les lieux de missions en Afrique, mais j’ai encore
quelques
doutes sur l’épisode de la fameuse mosquée
qu’il avait fait construire
avec les crédits attribués par de Gaulle. Dans les
souvenirs transmis
par mon père, il me semble que cela se situait à
Fort-Lamy et je me
souviens qu’il avait alors des fonctions de « Maire
», ce qui est
confirmé par vos documents (« Administrateur-Maire »
en avril 1942). Et
pourtant je ne suis pas certain que les photos avec de Gaulle soient de
Fort-Lamy, car il y dans la même série de photos une
cérémonie autour
du monument funéraire qui rend hommage aux victimes du
torpillage du
s.s. Dumana le 24 décembre 1943, monument qui se trouve,
aujourd’hui
encore, à Sassandra, en Côte d’Ivoire. Ces photos
(si elles sont
toutes de la même série) pourraient donc plutôt
dater de la période en
Côte d’Ivoire, après septembre 1943.
Je vais voir
si l’on peut retrouver le parcours exact de de Gaulle dans cette
période. Le gouverneur Félix Eboué avait
proclamé le ralliement du
Tchad à la France Libre le 26 août 1942. Je ne sais pas si
de Gaulle
s’est vraiment rendu au Tchad entre août 1942 et septembre
1943, date à
laquelle votre père était affecté en Côte
d’Ivoire. Et si l’épisode de
la mosquée s’était effectivement
déroulé à Fort-Lamy, il aurait fallu
que de Gaulle y soit passé une première fois pour donner
ses directives
et une seconde fois pour constater que votre père avait
désobéi. Or, il
me semble que c’est lors du second passage que votre père
avait été
limogé et qu’il avait été aussitôt
renvoyé en métropole « entre deux
gendarmes », comme il le racontait. Ce qui n’a pas pu se
produire en
1942 ni en 1943 puisque sa carrière en Afrique s’est
poursuivie
jusqu’en août 1945.
Peut-être
avez
vous davantage d’idées sur la question. J’essayerai
de vous téléphoner
un de ces prochains jours pour bavarder un peu avec vous sur ce
point
et sur tous les autres sujets.
Merci de
prendre de nos nouvelles au sujet des inondations qui ont, encore une
fois, touché certaines parties du département du Var.
Mais
personnellement, nous ne risquons rien car nous habitons sur une zone
un peu élevée. Ce sont surtout les plaines alluviales des
rivières du
Var et des zones littorales plates qui sont, de plus en plus
régulièrement, victimes d’inondations. Mais le
phénomène des vagues de
submersion est tout de même bien moins importants que sur toute
la côte
atlantique. Mais ce n’est pas terminé car hier encore le
Var a été
classé en « alerte orange inondations » et que de
fortes pluies sont
encore attendues demain. Mais, contrairement à votre
région, aucune
neige n’est ici prévue et l’hiver pourrait bien se
terminer sans qu’il
y ait eu la moindre température négative.
Avec toutes
nos amitiés.
Jean-Claude
Autran
25 février 2014 :
Courrier de Paule LAMBERT
Cher Jean-Claude,
Voici quelques documents qui pourront vous intéresser.
N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un
plaisir d'y répondre et je suis heureuse que vous vous
intéressiez à la vie de mon père. En fait, vous
m'avez appris beaucoup de choses sur lui et j'en suis ravie. Je vous en
remercie profondément.
Toutes mes amitiés à vous et à Yolande.
PL
9 juillet 2014 : Courrier
à Paule LAMBERT
Bonjour Paule,
Veuillez me pardonner d'avoir tant tardé à reprendre
contact avec vous après l'envoi de vos derniers documents sur
votre père, il y a déjà plusieurs mois. (...).
J'ai enfin trouvé le temps de me repencher sur
l'ensemble des documents, copies de courriers et photos, que vous
m'aviez adressés en plusieurs envois. Je les ai reclassés
par ordre chronologique et je les ai résumés dans une
liste qui, bien que comportant encore quelques périodes
incertaines, permet d’effecteur un maillage plus précis de
la vie de votre père et de mieux suivre, année par
année, les péripéties de son parcours
professionnel et politique. (Je n'y ai pas fait figurer les questions
qui sont d'un ordre familial plus intime). Je vous adresse ci-joint ce
résumé. (Naturellement, vous pourriez y relever des
oublis ou des erreurs d’interprétation de ma part, que
vous remercie par avance de bien vouloir me signaler).
Les deux périodes que je n'arrive pas encore à bien
comprendre sont :
1) L'année 1942-1943
où votre père est nommé Administrateur-Maire de
Fort-Lamy (sous le régime des Forces Françaises Libres)
(*). Mais en octobre 1942, un courrier fait état d'un grave
différend entre l'Administrateur-Maire et le Comité de
l'Eglise de Fort-Lamy. Des souvenirs que j'avais, il me semblait que
l'épisode de la mosquée se situait à Fort-Lamy et
que votre père avait alors été limogé par
de Gaulle « renvoyé en France entre deux gendarmes
». Je pensais que sa carrière aux Colonies avait pris fin
après ce limogeage [mais après tant d'années,
peut-être les souvenirs se sont mélangés dans ma
mémoire, d'autant que j'avais reçu ce souvenir par
l'intermédiaire de mon père qui l'avait peut-être
lui aussi inconsciemment transformé ou édulcoré].
Or, bien qu'il n'ait pas été retrouvé de document
écrit sur la période octobre 1942 - septembre 1943, il
est certain qu'en septembre 1943, votre père est bien « de
retour en Côte d'Ivoire et affecté au poste
d'Administrateur, Chef de cabinet de M. le Gouverneur de Côte
d'Ivoire ». Même s'il avait peut-être
été sanctionné pour sa « raideur excessive
dans ses rapports quotidiens avec les Européens » [ce
télégramme du 29 juillet 1944 n'est pas très
explicite : « Solution proposée me paraît bonne...
?], sa carrière a néanmoins continué à un
niveau élevé de responsabilités, jusqu'en mars
1947. Peut-être avait-il été muté de
Fort-Lamy à Abidjan après cet incident autour de
l'église et de la mosquée ? Mais de Gaulle ne devait pas
alors lui garder trop de rancune puisqu'il avait accepté de le
voir Chef de cabinet du Gouverneur de Côte d'Ivoire et avait
aussi signé l'attribution de sa Médaille de la
Résistance en 1945.
(*) Il est possible que les photos avec de Gaulle soient de cette
époque car j'ai vérifié que de Gaulle (et Pleven)
sont venus plus d'une fois au Tchad, premier territoire africain
à s'être rallié à la France Libre. Mais il y
a probablement certaines autres photos qui sont de Côte
d’Ivoire, notamment celles du monument qui rend hommage aux
victimes du torpillage du s.s. Dumana, qui se trouve à
Sassandra, en Côte d’Ivoire.
2) La période 1947-1949. Que s'est-il passé en 1947
avant cette passation de pouvoirs à M. Charles Claverie ? Est-ce
là qu'il a été véritablement limogé
? Sans doute pour ses idées politiques en général,
mais y a-t-il eu une cause précise à ce moment-là
? Si je comprends bien, il quitte la Côte d'Ivoire
définitivement en mars 1947. Il est présent à
Saint-Louis (Sénégal) en 1948 [Il avait dû y
récupérer les copies certifiées conformes de sa
condamnation à mort - qui portent un cachet de Saint-Louis].
Mais les décrets portant sa révocation ne sont
datés que des 28 mars et 21 novembre 1949. Sait-on quelles
raisons précises sont invoquées pour qu'il ait
été révoqué ? Il avait dû
vraisemblablement continuer à percevoir son salaire entre 1947
et 1949 car l'indemnité en réparation du préjudice
subi prend en compte une période commençant le 1er avril
1949.
Voilà quelles sont les questions que je me pose
encore sur le parcours riche et complexe de votre père.
Peut-être avez vous de votre côté
quelques éléments de réflexion ou autres documents
qui permettraient de mieux m'éclairer sur les points qui
demeurent encore obscurs pour moi. Je serais heureux de poursuivre les
échanges avec vous.
Ayant rassemblé tous les éléments
disponibles sur la carrière de votre père, je serai alors
amené à rectifier sa fiche dans le « Dictionnaire
du Mouvement Ouvrier et Social Seynois », celle-ci ayant
été rédigée avant réception des
derniers documents détaillant ses affectations successives en
Afrique et comportant donc des omissions (Congo, Moyen-Congo) et des
erreurs dans la chronologie.
Avec toutes mes amitiés. J’espère que tout va
bien pour vous.
Jean-Claude
Voici la liste des différents documents
rassemblés sur Jean LAMBERT, reclassés par ordre
chronologique, avec le
détail des principaux éléments de leur contenu :
(rajoutés en bleu, les documents reçus lors de l'envoi d'octobre 2014, et en violet, ceux reçus lors de l'envoi de janvier 2015)
- Acte de naissance de Jean
LAMBERT à Dijon en 1898 : «
Acte de naissance # 1198 du 24 Novembre 1898. LAMBERT Jean Maurice
Jules, fils de Charles Henri LAMBERT, 33 ans, professeur, demeurant
à Dijon, Marié au Puy (Haute-Loire) le 6 Avril 1892 avec
Marie Félicie Carbasse, 26 ans ». Mentions marginales :
« Marié le 26 Juin 1926 à Issy-les-Moulineaux (92)
avec Anna Jehanne Truitard » et «
Décédé à St-Pardoux-la-Croisllle
Corrèze - Dijon le 14/9/1961 ».
- Second prix de calcul obtenu en classe de 8e par Jean LAMBERT au
Lycée Carnot à Dijon en 1907.
- Document du Secrétariat de l'École de
Médecine et de
Pharmacie de l'Université de Dijon, daté du 16
février 1918, certifiant que LAMBERT Jean, Maurice, Jules,
« est actuellement pourvu de six inscriptions en vue d'obtenir le
diplôme de Docteur en médecine ».
- Courrier du 11 mars 1929 du Service Colonial de Bordeaux qui l'avise qu'il est autorisé
à présenter le concours d'admission au stage à l'École Coloniale, les
2_3 avril au centre de Paris, courrier qui est adressé à Monsieur LAMBERT « adjoint des Services Civils », 110 rue
des Boulets, Paris 11e.
- Appréciation et notation de M. LAMBERT, daté de
Fort-Lamy, 15 janvier 1931 : « M. LAMBERT a obtenu à
Massakory des résultats très remarquables. En cinq mois,
il a ramené la paix et rétabli l'ordre dans une
région mise en coupe réglée depuis des
années par les pillards et les brigands de grand chemin qui
l'habitaient. Cette transformation n'a nécessité aucune
rigueur inutile, elle a été réalisée par la
seule mise en œuvre de sanctions judiciaires et d'une incessante
activité, grâce à une compréhension
merveilleusement exacte des moyens à employer. L'intelligence de
M. LAMBERT, sa vaste culture, ses talents administratifs, son admirable
conscience professionnelle, la parfaite dignité de sa vie sont
dignes de la plus haute considération et le désignent
particulièrement pour un avancement qui n'aura jamais
été mieux mérité. M. LAMBERT a droit
à un avancement. Je le propose pour le grade d'Administrateur
Adjoint de 1° classe ». Code numérique: 20/20.
- Poème intitulé « SANS ELLE »
écrit
dans la nuit du 11 au 12 avril 1933 par Jean LAMBERT «
après son retour en Afrique lorsqu'il eut laissé ma
mère en France pour me donner naissance » (PL).
- 1939 ? Fascicule de mobilisation,
classe 1918, profession : administrateur-adjoint, grade :
médecin auxiliaire, domicilié à Franceville,
département du Haut Ogooué (Moyen Congo), affecté
au Bataillon de Réserve du Moyen Congo stationné à
Brazzaville.
- Formulaire de déclaration pour les personnes
pénétrant en territoire français - du lieu de
délivrance dans une colonie française (Bangui, A.E.F.).
Jean LAMBERT, administrateur de 3ème classe des Colonies. Motif
: congé de convalescence (fin avril 1940, 3 mois sauf
prolongation, Bordeaux ou Marseille). Fait à Bangui (territoire
de l'Oubangui-Chari, A.E.F.) le 9 mars 1940 : «
L’intéressé a droit au rapatriement. Une
réquisition de passage en 1ère classe lui sera
délivrée sur le paquebot de la Compagnie des Chargeurs
Réunis qui quittera Pointe-Noire le ( ?) à destination de
Bordeaux. A l’expiration de son congé, il aura droit au
transport gratuit de sa famille à destination de la Colonie
» (Bangui, le 9 mars 1940) ».
- Note confidentielle de 2 pages du Gouverneur de la Côte
d'Ivoire (signée H. Deschamps, Abidjan, 7 janvier 1942) à
M. le Gouverneur Général, Haut Commissaire de l'Afrique
Française, Direction du Personnel, Dakar, relatant en
détail « les circonstances dans lesquelles M. LAMBERT,
Administrateur-adjoint des Colonies, Chef de Subdivision de Touba, est
passé au Libéria », avec notamment le paragraphe
suivant : « Il est incontestable - ainsi que je le signalais dans
les dernières notes - que M. LAMBERT avait une nette tendance au
déséquilibre mental. Provenant du Tchad, il
été hanté périodiquement par l'idée
de ses camarades demeurés là-bas. Le sort de sa famille
demeurée en France paraissait lui importer assez peu. D'un
caractère sombre, sujet à des colères brusques,
cet Administrateur, qui ne fréquentait personne, n'avait su se
créer aucune sympathie. Ses fantaisies dans l'Administration de
la Subdivision de Gagnoa m'avaient amené à le muter
à Touba, poste moins important, et à lui adresser des
observations sévères ». « J'ai l'honneur de
vous demander de bien vouloir proposer au Département la
révocation de M. LAMBERT, à compter du 8 décembre
[1941], date à laquelle il a quitté son poste sans
autorisation pour se rendre dans une colonie étrangère
». « D'autre, part, M. LAMBERT étant
détenteur, par ses fonctions de Chef de Subdivision, de secrets
intéressant la Défense Nationale, et sur la situation
militaire, politique et économique de la colonie, il est
à présumer qu'il les communiquera aux dissidents qui
demandent, à chaque transfuge, un rapport sur ce qu'il a vu, et
entendu en territoire français. Il y a donc présomption
de trahison ».
- Transcription d'un message radio du 19 janvier 1942 à
Monrovia, Libéria : « JEAN LAMBERT CHEZ ARRIVETS MONROVIA
LIBL NO 46/CC VOUS ADRESSE MES FELICITATIONS LES PLUS VIVES STOP
PRESENTEZ VOUS CAPITAINE DE VILMORIN LIBERIA QUI VOUS DIRIGERA SUR
POINTE NOIRE OU ETES ATTENDU ». Signé : SICE
- Appel prononcé à Radio Accra le 26 février
1942
: « L'Administrateur LAMBERT parle à la Côte
d'Ivoire » (extrait du Bulletin d'informations de l'Afrique
Française Libre - N° 45 du 12 Mars 1942) « (...) La
raison de mon départ peut se résumer en quelques mots :
je ne voulais pas travailler pour les boches. Ce projet de rejoindre la
France Libre, je l'avais formé dès la capitulation de
juin 1940. Envoyé de France à Gagnoa en décembre
1940, j'ai tout fait pour me faire enlever de ce poste, situé
à mon goût beaucoup trop au milieu de la colonie.
Dès mon arrivée à Touba, je préparai mon
évasion (...). Je m'avoue impuissant à vous
décrire l'émotion qui m'a saisi plus tard lorsque j'ai
revu enfin le drapeau français flottant librement, ses soldats
et des officiers ayant dans le regard leur fierté d'hommes qui
savent pourquoi ils se battent, qui ont foi dans un chef
n'obéissant qu'à sa conscience de Français (...).
Je fais appel à tous mes camarades administrateurs de la
Côte d'Ivoire pour qu'ils viennent à leur tour rejoindre
les Forces Françaises Libres (...). Le beau café de la
Côte d'Ivoire est allé réchauffer les soldats nazis
qui essaient en vain d'asservir le peuple russe (...). Quant au coton
et aux corps gras, j'espère qu'aucun d'entre vous n'a jamais eu
de doute sur leur véritable destination. Ces pros se
transforment en explosifs qui tuent les Français Libres en Lybie
et les soldats alliés luttant partout contre l'Allemagne (...).
Vous avez pu constater l'accueil respectueux réservé
à ces boches en Côte d'Ivoire... N'est-ce pas M.
l'Administrateur C alors Commandant du Cercle de Sassandra, qui avez
trouvé dans cette boue la promotion que vous n'espériez
plus ? (...). Depuis que j'ai rejoint les Forces Françaises
Libres, j'ai eu bien des occasions de constater que les "
collaborationnistes " étaient tombés plus bas que je ne
le croyais. Les colonies anglaises d'A.O.F. reçoivent par petits
paquets des tracts annonçant la victoire de Hitler et vantant le
régime nazi. Ces ordures portent le nom de " French Bulletin ",
imprimées à Dakar, elles passent la frontière par
les soins des autorités françaises. N'est-ce pas M.
l'Administrateur maire de Lomé et M. le Chef de la Subdivision
d'Assinie ? (...). Mes camarades de la Côte d'Ivoire, la France
vous le demande, ne continuez plus cette besogne dégradante qui
répugne à la plupart d'entre vous et que les
indigènes ont déjà jugée (...). Venez
rejoindre les Forces Françaises Libres, vous aurez la joie de
préparer ce jour dont actuellement vous n'osez même pas
prononcer le nom : Le jour de la délivrance. Vive le
général de GAULLE, vivent nos courageux alliés.
Vive la France ».
- Ordre de mission des Forces Françaises Libres (Lagos, 28
février 1942) : « Monsieur Jean LAMBERT, Administrateur
des Colonies, rallié à la France Libre, se rendra en Gold
Coast par les voies les plus rapides pour une mission de courte
durée. Dès son arrivée à Accra, il se
présentera au Chef de la Mission Française Libre de Gold
Coast, et se mettra à sa disposition pour lui fournir tous les
renseignements utiles » (Signé : pour le Colonel Adam,
absent, le capitaine Tourot, chargé de l'expédition des
affaires courantes) - Vu au passage à Accra, du 29
février au 4 mars 1942, le Chef de Bataillon Ponton.
- Autre appel à Radio Accra : « Lâcheté
allemande » : « Comme ils se sont servis des
réfugiés pour couvrir leur avance en mai et juin 40.
(...) Comme ils se sont servis des petits enfants de France
affamés pour détendre le blocus britannique et voler pour
nourrir leurs soudards ce que nos alliés destinaient à
nos mioches (...). Avec une cruauté toute germanique le
général von Stupnagel informé de l'arrivée
des avions britanniques a interdit que l'alerte fut donnée. Avec
toute sa férocité de boche, il a voulu mettre à
profit l'émotion créée par le bombardement des
usines Renault pour assassiner quand même au petit jour les vingt
otages innocents dont l'agonie morale révoltait le cœur
des Parisiens. (...). Réfléchissez à leur
stupidité de bêtes à nuque plate (...). Mais ils ne
sont pas capables; ces brutes, ces scientifiques du crime, ces
organisateurs de massacres en série d'un sentiment
d'humanité, même calculé, même
intéressé (...). Aujourd'hui, les de Brinon, les Darlan
et la pauvre vieillard lui-même qui avait dit " Je reste pour
vous protéger " tremblent devant la France et les
Français ».
- Jugement par contumace par le Tribunal Militaire de Dakar : " Au
nom
du peuple français " a rendu le jugement suivant : «
Aujourd'hui cinq septembre 1942, le Tribunal Militaire de Dakar,
ouï le Commissaire du Gouvernement dans ses réquisitions et
conclusions, a déclaré le nommé LAMBERT Jean
Maurice Jules, de nationalité française, Administrateur
adjoint de 3e Classe des Colonies, Commandant de la Subdivision de
Touba, Cercle d'Odienné (Côte d'Ivoire), absent et
contumax, à la majorité, coupable de TRAHISON pour avoir,
le 11 décembre 1941, en temps de guerre, entretenu des
intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses
agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la
France, en quittant sans autorisation le territoire français
(Guinée française) pour se rallier aux troupes
dissidentes de l'ex-général de Gaulle en Libéria.
En conséquence, le dit Tribunal l'a condamné par
contumace, à la peine de MORT, aux frais envers l'État et
a, en
outre, ordonné la confiscation au profit de la Nation, de tous
les biens présents et à venir du condamné, de
quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, le
tout par application des articles (...) du Code de Justice militaire et
de la loi du 5 février 1941. (...) à rembourser sur ses
biens présents et à venir, le montant des frais du
procès (...). Signalement du nommé LAMBERT Jean Maurice
Jules ». En marge figure la mention suivante : " Jugement
annulé par arrêt du 8 novembre 1943 de la chambre de
révision en A.O.F. (application de l'ordonnance du 6 juillet
1943 portant légitimation des actes accomplis en faveur de la
libération de la France"). [Copie certifiée conforme,
Saint-Louis, le 14 février 1948].
- Document du Haut-Commissariat de l'Afrique Française -
Cabinet
Militaire - Bureau M.A. - N° 1900/MA.80, 8 septembre 1942 : Audience
du Tribunal Militaire Permanent de Dakar du 5 septembre 1942 : «
LAMBERT Jean Maurice Jules, ex-Administrateur adjoint des Colonies,
ex-Chef de la Subdivision de Touba (Côte d'Ivoire) - CONTUMAX -
MORT - CONFISCATION DES BIENS, pour "TRAHISON". A quitté le
territoire français pour se rallier aux troupes dissidentes
»
- Lettre dactylographiée de Paul-Zahé DOMORO,
Commis-Expéditionnaire, de Touba, le 25 septembre 1943 : «
Bien cher Monsieur LAMBERT, C'est avec une joie indescriptible que
j'apprends l'heureuse nouvelle relative à votre retour à
la Colonie et avec le titre d'Administrateur, Chef de cabinet de M. le
Gouverneur. Jamais joie n'a été aussi immense dans la
profondeur de mon humble cœur que cette nouvelle d'apaisement et
de sérénité, qui vient enfin, après tant de
soucis, de regrets amers et d'inquiétude qui me furent
causés par votre brusque et cruelle disparition en
Décembre 1941. Je ne suis pas étonné par votre
réussite glorieuse, connaissant la bonté, la droiture et
l'intégrité sans pareilles qui vous caractérisent
dans le Service, ces nobles qualités qui ne peuvent que vous
conduire à une ascension ininterrompue, et mieux encore, le
public l'affirmant et Dieu sait, votre disparition ne pouvait
être qu'éphémère et donner, comme elle l'a
fait, un résultat probant, brillant et bien
mérité. Je vous en félicite vivement ! (...)
Puisse le Ciel vous bénir dans vos nouvelles fonctions et vous
préserver de toutes maladies dans ce séjour colonial.
Longue vie et bonne santé ! Voilà des vœux que
forme mon cœur pour vous, Bien Cher Monsieur LAMBERT, celui qui
reste votre attaché dévoué et pour toujours
».
- Lettre dactylographiée de Jean LAMBERT («
Administrateur
de 2ème classe des Colonies, Chef du département du
Bas-Chari, Administrateur-maire de Fort-Lamy ») au Comité
de l'Église de Fort-Lamy (23 octobre 1942) : « Messieurs,
J'ai
l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 21
octobre 1942. Je regrette profondément que vous ayez cru devoir
signer un pareil document. De cette lettre, il résulte : I°
Que votre désir de collaboration avec l'Administration que
vous confirmez les termes d'une lettre adressée par vos
représentants à l'Administrateur-Maire, lettre qui
contenait deux passages inadmissibles pour un fonctionnaire
français. 2° Que votre hâte d'avancer les travaux de
l'Église - hâte tant de fois exprimée de toutes les
manières telles que vous remettez la solution des questions
pendantes après ma passation de service à mon successeur.
Cette attitude est vraiment curieuse. J'ai, en particulier, peine
à croire que tous vos membres auraient accepté de
recevoir des lettres écrites sur un pareil ton. Laissez-moi
admirer votre action de Haute Propagande en faveur de l'Œuvre qui
vous a été confiée. Je ne peux que vous rappeler
le dernier paragraphe de ma lettre N° 553 du 15 Octobre 1942.
Veuillez agréer, messieurs, l'assurance de mon entière
considération ».
- Lettre manuscrite de Mouassi KOUAKOU, Moniteur Auxiliaire de
l'École
Régionale d'Agboville, d'Agboville, le 22 Octobre 1943 : «
Monsieur LAMBERT, je vous souhaite bon retour, bonne arrivée
dans notre Colonie. Ce matin, en fouillant le J.O., j'ai
été surpris d'apprendre votre arrivée. Il y a
surtout du changement dans votre situation ! Je vous félicite
pour l'important poste que vous occupez (...).
- Lettre manuscrite de Mory Gadiga, de Touba, le 8 mai 1944 :
«
Monsieur l'administrateur LAMBERT, je viens respectueusement vous
apprendre que je suis arrivé en bonne santé à
Touba. L'oncle Gamoussa et toute la famille Gadiga se joignent à
moi pour vous remercier de la gentillesse que vous avez subi à
mon égard pendant mon séjour à Abidjan. Je vous
remercie surtout d'avoir bu de la limonade avec un grand chef, dans vos
propres verres, dans lesquels un petit noir comme moi, ne songerait
à y boire. Je ne puis faire que vous souhaiter un bon
séjour en Côte d'Ivoire. Dieu seul vous
récompensera de votre bonté irréprochable. Comme
il a le devoir de récompenser tous les bienfaiteurs de
l'humanité. Monsieur l'administrateur, nous vous souhaitons une
longue et heureuse vie et la réussite de votre bonheur ».
Signé de « Votre dévoué Mory Gadiga,
demeurant à Touba ».
- Télégramme N° 593/C du 5 juillet 1944 de
LATRILLE à GOUGAL, Dakar : « Ai communiqué LAMBERT
essentiel de votre 722 le concernant - STOP - Intéressé
estime relève poste dans de telles conditions constituerait
sanction qui aurait conséquence toute sa carrière - STOP
- LAMBERT demande qu’avant toute décision dossier affaire
lui soit communiqué pour qu’il puisse au moins
connaître les faits qui lui sont reprochés et
présenter défense avant d’être jugé -
STOP - demande LAMBERT est logique - STOP - Je ne peux croire que votre
722 ait pu être provoqué suite cabale menée par
éléments douteux Côte d’Ivoire lors votre
dernière tournée ». Signé LATRILLE.
- Télégramme de « Colonies Alger à
Gougal Dakar », du 29 juillet 1944. N° 1549 : «
Solution proposée me paraît bonne stop Ce qu'on reproche
essentiellement à LAMBERT est raideur excessive dans ses
rapports quotidiens avec Européens stop D'autre part je
n'entends pas que sa mutation paraisse être un désaveu de
la politique suivie par LATRILLE qui est celle voulue par gouvernement.
Dans ces conditions je n'ai pas objections au retour de LATRILLE
à Abidjan directement stop veuillez bien montrer ce
télégramme à LATRILLE.
- Lettre dactylographiée de Félix HOUPHOUET (Syndicat Agricole Africain de la Côte d'Ivoire - Korhogo, 4 janvier 1945) :
«
Cher Monsieur LAMBERT, Malgré la recommandation parue dans la
presse du 29 dernier, je me serais rendu à Abidjan tant en mon
nom qu'au nom de mes camarades, la bonne et heuresue année
à Monsieur le Gouverneur LATRILLE et à vous, son digne
collaborateur, si l'embauchage des manœuvres volontaires ne
m'avait point éloigné de la Capitale. En rentrant en
France, en cette France que vosu avez dû quitter afin de la mieux
servir, je souhaite de tout mon cœur que vous retrouviez tous les
vôtres en bonne santé.
Il faut parcourir la Colonie comme je le fais depuis quatre mois pour
comprendre l'affection vraie que la masse laborieuse de ce Pays
témoigne à ce grand chef, à ce chef si juste, si
humain. En très peu de temps, Monsieur le Gouverneur LATRILLE a
pu faire la conquête si difficile de nos cœurs. Il
était temps..... Depuis la guerre surtout par une politique
indigne de Français, ses prédecesseurs et les Colons qui
les soutenaient afin de les détourner de leur noble mission,
allaient nous détacher de la France à qui nous devons
cependant tout : la paix, la liberté, la joie de vivre.
Tous les Indigènes souhaitent la suppression radicale de cette
autre forme de l'eclavage ; le travail forcé qui rend si
inhumain ceux qui en tirent de si gros et honteux
bénéfices.
Nous planteurs africains avons compris le côté humain de
cette question de main d'œuvre. Les sacrifices en argent que nous
avons librement consentis et que nos collègues européens
ne veulent point accepter nus paraissent légers, très
légers devant le but à atteindre : une production accrue
avec une main d'œuvre heureuse de travailler, de concourir
largement au ravitaillement de notre malheureuse France qui
sortira victorieuse de cette guerre, mais combien ruinée,
combien meurtrie par quatre années de la plus barbare occupation
que l'histoire ait enregistrée.
Ma tâche n'est nullement facilitée par Messieurs les
Administrateurs complices apeurés de Colons fanfarons et cupides.
Partout c'est le même refrain chaque fois que je me
présente : "les Indigènes ne veulent rien entendre du
volontariat". Calmement, je leur demande l'autorisation de m'adresser
directement à ces Indigènes (en leur présence), de
leur expliquer ce qu'ils peuvent attendre de nous et ce que nous
attendons d'eux, l'intérêt pour eux comme pour nous de
travailler courageusement, librement. Partout les Administrateurs ont
été déçus. J’ai eu, j'aurai partout
de volontaires. J’en aurai beaucoup à Korhogo. Il se peut
même que j'en trouve plus qu'il n'y en ait de disponibles
d'après les estimations de l'inspection de travail. Dans ce cas
je vous demanderai de prier Monsieur l'inspecteur de Travail de
réduire d'autant le nombre de recrutés forcés que
d'autres régions où je ne pourrai me rendre fourniront.
Messieurs les Administrateurs de Ferké et Korhogo
déclarent que malgré qu'il ait distribué ici des
cartouches et de l'argent Mr. LAGAROSSE n'a réussi à
embaucher un seul volontaire sénoufo. Mr. LAGAROSSE a offert 4
francs de salaire journalier !.... C'est regrettable que pas un des
quelque dix mille manœuvres qui ont passé depuis dix ans
sur les chantiers ne se soit souvenu de bons traitements reçus
pour répondre à son appel. Sans distribution de
cartouches ou d'argent, avec la seule promesse formelle de reconnaitre
les droits du travailleur, droit de vivre, bien vivre à l'ombre
du drapeau français, promesses qui seront tenues, tout le monde
en est persuadé malgré la honteuse campagne de nos
détracteurs par trop intéressés, j'ai
réussi là où un des "pontifes" du Pays a
échoué.
J'ai appris que Mr. le Gouverneur LAURENTIE passera à Abidjan
dans la première quinzaine de Janvier. Je serais très
heureux si je pouvais faire entendre à ce grand chef la voix des
Africains travaillant en Côte d'Ivoire. Il saura de quel
côté se trouve la bonne volonté d'œuvrer pour
la grandeur et l'honneur de la France.
Veuillez recevoir, cher Monsieur LAMBERT, avec mes vœux les
meilleurs du nouvel an, l'assurance de mon bien sincère
attachement.
Signé : F. HOUPHOUET
- Lettre manuscrite de M. Albert Balibié (Bouaké, 5
mars
1945) à M. l'Administrateur : « C'est avec enthousiasme
que je viens de savoir que vous êtes dans la Capitale de notre
colonie (...) ». Je me presse de vous adresser un bonjour
respectueux. C'est un fait que votre haute personnalité voudrait
bien admettre puisque, moniteur vétérinaire, je servais
sous vos ordres en 1941 à Gagnoa. Vous éprouviez
même une certaine satisfaction pour le zèle et le
dévouement que je déployais à exécuter vos
ordres auprès des planteurs-éleveurs européens et
indigènes de cette région. Je me souviens avec plaisir de
la poignée de mains toute paternelle que vous m'accordiez pour
me dire « au revoir » et de continuer à bien
travailler, lors de votre départ pour Toulon. Ce départ,
que tous les fonctionnaires noirs regrettaient à cause de votre
bonté et de votre savoir commander. Lorsque poussé par
votre parfaite clairvoyance des choses, vous entrepreniez le
périlleux voyage à travers les mers pour aller collaborer
aux côtés du général de Gaulle, le sauveur
providentiel de la France qui désespérait, un frisson de
peur nous avait traversé ; nous nous demandions si vous n'alliez
pas rencontrer malheur ou accident au cours de cette traversée.
Soyez sûr, monsieur l'administrateur, que tous mes anciens
collaborateurs de Gagnoa et moi, nous bénissons vivement les
circonstances qui vous ont fait revenir en Côte d'Ivoire parmi
nous. Parti de Gagnoa en septembre 1943, je suis actuellement à
Bouaké, nouveau poste d'affectation. Pour finir, je voudrais
vous parler de ma situation qui ne s'améliore jamais. J'ai
souvent été lésé dans les avancements aux
grades élevés de mon cadre. Je ne sais à quoi cela
est dû. Cette année, je m'attendais à être
moniteur-vétérinaire adjoint de 2e classe pour la
promotion de juillet 1945. Je viens d'être encore
déçu ; mon nom ne figurait pas au tableau d'avancement.
Monsieur l'administrateur, j'ai l'honneur d'avoir recours à
votre haute intervention pour ma nomination de juillet prochain. Si vos
souvenirs ne sont plus exacts sur moi, veuillez demander des
renseignements à Paul Taucogue et à Kouakou qui sont
auprès de vous à Abidjan. Je vous adresse une fois de
plus, mes souhaits de bonne santé et de bon courage pour les
hautes responsabilités du gouvernement ».
- Lettre dactylographiée de l'Administrateur de Ière
Classe des Colonies LAMBERT Jean en service à Abidjan
(Côte d'Ivoire) à Monsieur le MINISTRE des Colonies
à PARIS (Sous le couvert de Monsieur le GOUVERNEUR de la
Côte d'Ivoire) : « Monsieur le MINISTRE; J'ai l'honneur de
solliciter de votre haute bienveillance mon affectation au Corps
expéditionnaire indochinois dont la constitution vient
d'être annoncée par la radio-diffusion française.
J'appartiens à la classe 1918. J'ai servi en Macédoine au
10ème Bataillon Indochinois. J'ai le grade de
Médecin-auxiliaire de réserve mais je suis volontaire
pour servir dans n'importe quelle arme avec n'importe quel grade. Je me
permets de rappeler respectueusement les faits suivants : Le 10 Mai
1940, me trouvant en congé en France, j'ai adressé une
demande de mobilisation dans une unité combattante de la
Métropole. Cette demande a reçu une réponse
favorable sous le N° 3997 I/D.S.M. du 31 Mai 1940 dont copie
ci-jointe. La réponse m'est parvenue à Dijon au moment
des évènements de Juin 1940. Je suis allé me
mettre à Sète à la disposition des
Autorités Militaires le 19 Juin 1940 pour être
incorporé dans une unité combattante. L'annotation
portée sur la lettre 3997 en fait foi. N'ayant pu arriver
à mes fins, j'ai été envoyé en Côte
d'Ivoire (A.O.F.) en tant qu'Administrateur. Le 8 Décembre 1941,
j'ai quitté mon poste et j'ai rejoint les Forces
Françaises Libres en traversant le Libéria. Pour ce fait,
j'ai été condamné à mort par contumax par
le Tribunal Militaire de Dakar le 5 Septembre 1942. En 1942 j'ai
été affecté à la Mission Française
Libre d'Accra puis au Tchad. Je suis revenu en Côte d'Ivoire en
Septembre 1943 où j'ai servi comme Chef de Cabinet du Gouverneur
puis comme Chef du Bureau des Affaires Politiques et Sociales de la
Côte d'Ivoire. Je serais heureux si je pouvais participer
à la libération de l'Indochine. J'ajoute qu'étant
inscrit en tête de la deuxième liste de la relève
en A.O.F., je devrais quitter la Côte d'Ivoire dans quelques
semaines ; mon affectation au Corps expéditionnaire d'Indochine
ne diminuerait donc pas le nombre des Administrateurs en service en
Côte d'Ivoire. Veuillez agréer, Monsieur le MINISTRE,
l'assurance de mon profond respect et de mon entier dévouement
». (Vu et transmis à Monsieur le GOUVERNEUR GENERAL de
l'A.O.F. pour suite à donner. Cette demande est une preuve
supplémentaire de patriotisme fervent et agissant qu'a toujours
manifesté l'Administrateur LAMBERT. Je ne puis que m'associer
à des sentiments aussi élevés et je
transmets cette demande avec un avis très favorable. Abidjan, le
26 Mars 1945. LE GOUVERNEUR. Signé A. LATRILLE).
- Lettre dactylographiée de Antoine H. ZINSOU,
commerçant
en pros coloniaux à Abidjan (Côte d'Ivoire), du 12
avril 1945, à Monsieur LAMBERT, Administrateur des Colonies,
CHEF DU BUREAU DES AFFAIRES SOCIALES et POLITIQUES à ABIDJAN :
« Monsieur et cher PROTECTEUR, Je mets du temps pour vous
écrire parce que fou de joie depuis je ne sais exactement pas
quoi vous écrire. En me confiant à vous, je ne
m'étais pas trompé, car je n'ignore pas votre sollicitude
envers vos administrés, plus que jamais, tous ici, en Côte
d'Ivoire ont su apprécier votre promptitude à trouver
l'heureuse solution à tous les problèmes d'une
administration difficile, à la satisfaction de tous les hommes
qui sentent et dont la bonne foi n'est pas en doute. C'est dans cet
esprit, qu'une fois de plus, je me fais un devoir impérieux de
vous adresser l'expression de ma gratitude infinie pour votre efficace
et salutaire intervention ayant abouti à maintenir votre
auxiliaire Madame ZINSOU sage-femme à son poste de Treichville.
Ce faisant, je ne puis cacher, que vous avez contribué à
sauvegarder les intérêts supérieurs d'une famille
nombreuse dont le CHEF n'entend que servir loyalement la cause
française. Comme COLONISATEUR, vous en êtes digne, car les
éminents services que vous rendez et dont vous n'avez
cessé de rendre jusqu'ici à des malheureux noirs qui
s'adressent toujours à vous, seront connus des
générations futures. Ma grande joie serait de vous voir
un jour en personne afin de pouvoir vous adresser de vive voix mes
remerciements. PUISSENT MES VŒUX, faire que dans les temps
à venir, je vous revois, soit à la tête de la
Côte d'Ivoire, soit à celle de ma colonie d'origine, le
Dahomey, afin que je puisse rester éternellement votre
protégé. Je vous prie d'agréer, Monsieur et bien
Cher PROTECTEUR l'expression respectueuse de mes sincères
sentiments ».
- Lettre manuscrite des Elèves Instituteurs, Dabou, 25
Avril
1945 : « Cher Monsieur, Nous venons d'apprendre votre
départ en congés et nous tenons à vous remercier
de tout cœur. Vous nous avez fait un bien inoubliable et c'est
grâce à votre générosité, à
celle de Monsieur le Gouverneur, que nous serons désormais
instruits en vrais Français et possèderons les plus
nobles sentiments patriotiques. Il nous manque des phrases pour vous
témoigner cette reconnaissance car elle demeure grande. Nous
vous promettons de travailler, d'aimer toute notre vie la
Mère-Patrie dont vous êtes les plus nobles
représentants. "Courage ! Effort ! Confiance !" ces trois
célèbres mots du grand Chef français, le
Général De Gaulle, resteront toujours gravés dans
nos cœurs. Vous nous avez déjà montré la
voie du Courage et de la Confiance. L'Effort seul dépendra de
nous. De nos âmes débiles, vous avez fait des âmes
justes, des âmes de vrais Français. Grâce à
vous et au chef de la Colonie, nous avons le courage total de
perpétuer dans les cœurs de nos futurs
élèves l'amour de la France, de cette France qui a
compris, la première, la valeur de notre race et l'obligation
sacrée de respecter et d'accroître cette valeur. Nous
avons confiance en vous et nous vous laissons en souvenir la photo de
la promotion. Bonne traversée, heureux séjour et prompt
retour parmi nous ».
- Décret du 17 juillet 1945 du GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE
LA
REPUBLIQUE FRANÇAISE portant attribution de la Médaille
de la Résistance Française à M. LAMBERT Jean,
Administrateur des Colonies (...). Le présent décret sera
publié au journal officiel de la République
Française. Signé C. DE GAULLE (Par le Gouvernement
Provisoire de la République Française, Le Ministre des
Colonies P. GIACOBBI).
-
Note du 5 août 1945 du Gouverneur A. LATRILLE (Abidjan, 5
août 1945) : « Depuis 23 mois, M. LAMBERT est mon
collaborateur immédiat. Il a pris sa très large part,
sans aucun répit, dans la tâche lourde et délicate
que j'ai entreprise pour redresser la situation en Côte d'Ivoire
tant sur le plan politique et économique que sur le plan social.
L'Administrateur LAMBERT a l'étoffe d'un chef. L'Administration
se doit de le pousser aux emplois élevés : il y sera
à sa place car il n'a d'autre souci que de bien servir
l'intérêt général Je regrette infiniment que
mes deux propositions antérieures au grand choix pour le grade
d'Administrateur en Chef n'aient pas été retenues. Je le
propose à nouveau et très instamment pour le grade
d'Administrateur en chef avec la cote maximum et me fais un devoir
d'insister pour qu'il soit promu au très grand choix ».
- Ordre de Mission du
Gouvernement Général de l’Afrique Occidentale
Française - Colonie de la Côte d’Ivoire du 7 août 1945 :« Rejoindre Dijon, 1 rue Viollet-le-Duc, seul, par voie aérienne et terrestre ».
- Ordre de Mission du Gouvernement Provisoire de la
République
Française, Ministère des Colonies, du 14 août 1945
: « Le Ministre des Colonies ordonne à M. LAMBERT Jean,
Administrateur des Colonies, 1 rue Viollet-le-Duc, Dijon (...) de se
rendre en mission à Dijon pour RAPATRIE sanitaire de la COLONIE
REJOINT SA RESIDENCE. Moyens de transport : Voie ferrée - Train
57 à 19h05-Ière classe. Date de départ 18
août 1945. Les Frais de mission seront imputés sur le
budget colonial Côte d'Ivoire. N° du Passeport 436
délivré à Abidjan le 7-8-1945.
- Lettre manuscrite de 8 pages de Félix Houphouët
(Abidjan, 19 août 1945) : « Cher Monsieur Lambert, Je suis
malade depuis hier. Il est 15 heures. A 16 h 30, je dois remettre cette
lettre à M. Cherineau (?). Malgré mon état de
santé et le peu de temps dont je dispose, je ne puis manquer
l'heureuse occasion qui m'est offerte de vous donner directement et
brièvement de mes nouvelles.
Votre départ. —
Inutile de vous dire que M. le Gouverneur Latrille et vous êtes
regrettés par tous les Africains de la Côte d'Ivoire
Française. Nos vœux les plus chers, c'est de vous voir
revenir frais et dispos après ce repos bien
mérité. Vous avez fait du beau travail pour nous, pour la
Côte d'Ivoire, pour la France éternelle. Nous ne
l'oublierons jamais.
Nouvelles locales.
— Tous vos détracteurs, ceux qui veulent sacrifier
l'intérêt supérieur de l'Empire à leurs
intérêts particuliers sont désemparés. Nous
tenons bon. Ils craignent l'union qu'ils sont venus nous prêcher
et l'évolution de la masse, évolution pour laquelle tant
des leurs ont versé sur cette terre de l'Afrique le plus noble
de leur sang, consenti les plus durs sacrifices. Ils traitent
d'anti-Français ceux qui veulent l'union sincère de tous
les enfants de l'Empire. Nous travaillons contre ce qui divise. L'union
est impossible sans une justice sociale. Pour le moment nous faisons de
la politique économique : la politique du ventre, des muscles.
En voulant me persécuter, ils ont, sans le vouloir,
contribué à l'union des Africains autour de ma
chétive personne. Je représente pour eux l'ennemi public
n° 1. Mais que me reprochent-ils ? Ils sont très
embarrassés de le dire : je veux que tout le monde travaille, je
veux que le travail soit payé. Petit-fils de tyran, je connais
la tyrannie. Est-ce un mal à qui je dois cette heureuse
évolution ? A la France. Je le reconnais. Tous ceux qui me
suivent le reconnaissent également. Mais les Colons veulent
à tout prix me combattre? C'est un crime d'aimer son pays et de
travailler avec désintéressement pour ce pays. Mais ce
pays, celui pour lequel nous nous sommes activement mis au travail dans
la paix et l'ordre retrouvé grâce à Mr le
Gouverneur Latrille, fait partie de l'Empire Français.
Qu'importe. Les Colons ont décrété que je suis
dangereux et il faut qu'ils me fassent disparaître ou qu'ils
dressent un Africain contre moi. Ils n'ont pas pu en trouver en
Côte d'Ivoire. Ils sont allés en chercher en France. C'est
Mr Coffi Pierre. Celui-ci même qui, sans notre consentement,
s'est fait le délégué africain de la
Confédération Générale de l'Agriculture.
C'est un jeune afnis(?) qui est parti de la Côte d'Ivoire en 1939
avant la guerre. Il a débarqué à Miara--(?) avec
13 frs en poche ayant voyagé clandestinement à bord d'un
paquebot. En 1944, nous apprenons qu'il est membre fondateur d'une
société UCA (Union Commerciale Africaine)
représentée en Côte d'Ivoire par M. Vilasco. Les
membres français connus de nous sont messieurs Colligu(?) et
Cohué(?). Pour qui connaît les antécédents
de M. Vilasco, cette société ne ppeut inspirer confiance.
M. Vilasco a tenté d'entrer en contact avec nous. Il a
échoué.
Pierre Coffi arrive le 9 août chargé de mission en Afrique
par le ministère de l'Agriculture. Coffi, qui n'avait que le
certificat d'études primaires supérieures à son
départ d'Abbidjan, nous revient avec ces titres très
flatteurs : Membre de l'Institut de Recherches de Caoutchouc et de la
Société Botanique de France. Délégué
de l'A.O.F. pour la Confédération Générale
de l'Agriculture. La France traverse toujours une triste
période. Le ministère des Finances a dû être
trompé par ce jeune homme dont vous lirez ci-joint la prose.
Celui que je plains bien sincèrement, c'est l'ami Lamine
Guège(?) dont Coffi Pierre a une piètre opinion.
Nous avons pu saisir sur Coffi Pierre des brouillons de lettre dont Mr
Chevineau (qui demande aujourd'hui des renseignements plus
précis à Dakar) peut attester l'authenticité. Le
ministère des Colonies doit ignorer la mission de Coffi Pierre.
Mais messieurs Jourdain, Bordarier et les Colons ont vu en
l'arrivée de Coffi l'aubaine attendue. Ce jeune escroc s'est
présenté à M. Bordarier comme un
radical-socialiste. Il prétend venir de France pour combattre ce
qu'il appelle ma politique. Ce courtier de l'UCA, de financiers
très probablement véreux, a osé me demander de lui
communiquer nos documents. Il est reparti confus. Sa propagande, bien
que soutenue par vos détracteurs, sera sans effet. Le pays m'a
jugé.
J'ai contrattaqué. Par des documents dont ci-joint copie, j'ai
demandé à Mr Jourdain de faire la lumière sur
cette mission. Coffi tremble...
Les élections.
— Cette attaque brusquée et ma vigoureuse riposte
coïncide avec les élections au conseil municipal. Je
patronne la liste des Africains contre celle des Colons et contre celle
que veut présenter M. Brochorion(?) qui a eu le tort de me taxer
d'anti-Français devant des camarades qu'il croit de mes ennemis.
La lutte est dure. Toute la liste a été sabotée.
Devant nos véhémentes réclamations, M. Faignel(?)
s'est fait porter malade. La Côte d'Ivoire, grâce à
Mr le Gouverneur Latrille, s'est réveillée de sa torpeur.
Nous ferons de cette Colonie aux possibilités infinies une des
plus belles provinces de l'Empire français. La liste que je
patronne passera malgré les millions pris sur notre dos qui
seront distribués. Cette première victoire sera suivie
d'une autre, celle que craignent tous les Colons.
Les élections à la Constituante.
— Hélas, bien que candidat sollicité par le pays,
je ne suis pas certain de pouvoir me présenter devant les
électeurs. Je ne suis pas citoyen français. Et je ne sais
si les citoyens à statut de (dont je serai) sollicités
par les Etats Généraux de la Renaissance Française
prendront part au vote. Si les seuls citoyens et citoyennes sont
appelés à élire un ou deux députés,
je soutiendrai la candidature de Marcel Auguste Denise et celle
d'Alphonse Boni, le magistrat baoulé actuellement à
Kayes. Je sais que Sénégalais et citoyens autochtones
reportent sur tous ceux que je patronnerai l'affection qu'ils ont pour
moi. Ce qui compte pour moi, c'est l'intérêt
supérieur du pays.
Je prépare également les élections à la
Chambre d'agriculture. Soyez tranquille, c'est une majorité
africaine que recevra cette année cette chambre qui a toujours
travaillé contre les intérêts des planteurs
africains.
Le Moro, Cybo(?) Coulibaly avec leurs propriétaire de 50
bœufs sont avec moi. Le Moro sera sur ma liste s'il ne se
désiste en faveur de son frère. J'ai reçu un
télégramme qui a dû faire trembler ceux qui
s'intéressent à ma correspondance. Aboufourou(?) et
Dimbokro seuls m'assurent la majorité.
Mr Maniglier a écrit à M. Jourdain pour lui annoncer la
grève à Aboufourou. En fait de grève, c'est le
nettoyage des routes de l'Indénis(?) effectué dans
l'enthousiasme par tous les Indigènes. Mr Modeste continue ses
attaques contre vous.
Vous recevrez bientôt copie de nos pétitions en faveur du
retour de Mr le Gouverneur Latrille en Côte d'Ivoire.
Je serais heureux de recevoir de vous et de vos de bonnes nouvelles et
des précisions sur la Représentation nationale..
Veuilles présenter mes hommages à Mr le gouverneur
Latrille et recevoir vous-même avec mes sincères
remerciements l'expression de mon respectueux dévouement.
Signé : F. Houphouët
- Décision n° 198 du Gouverneur des Colonies, chef du
Service Colonial de Bordeaux (Ministère de la France
d'Outre-Mer) (daté du 21.3.1946, vu l'avis du 24.1.1946 du
Conseil Supérieur de Santé des Colonies). Décide :
« Un congé de convalescence de 3 mois est accordé
à M. LAMBERT Jean, Administrateur des Colonies de la Côte
d'Ivoire, 18 avenue des Gobelins, Paris, avec effet du 21.11.1945 au
20.3.1946 ».
- Avril 1946 : Retour en
Côte d’Ivoire comme Chef du Bureau des Affaires Politiques.
Il fait libérer 22 détenus. Cela donnera lieu (voir
ci-dessous, en 1948) à un courrier (non daté, non
signé) : « Questions posées à M.
L’Administrateur des Colonies LAMBERT concernant les conditions
dans lesquelles ont été effectuées les
libérations conditionnelles de BOUAKÉ en avril 1946 ».
- Lettre manuscrite de John Kunaké Creppy, notable,
secrétaire de la Commune Indigène d'Anécho (Togo)
à Monsieur LAMBERT, Administrateur des Colonies, Chef du Cabinet
du Gouverneur, Abidjan, Côte d'Ivoire. Anécho, le 7 juin
1946 : « Mon Administrateur et Cher Ami, Votre retour en
Côte d'Ivoire, toujours en compagnie de notre cher Gouverneur M.
LATRILLE, a provoqué ici une joie sans borne. Les Togolais ont,
une fois de plus, souvenance de votre bienveillance à leur
égard (...). Le "Bon Apôtre" de la France, en votre haute
qualité, ne fait que serrer davantage notre ardent amour
à la Patrie et notre loyalisme sans aucune
arrière-pensée envers la France, la noble et digne
civilisation de la race attardée (...). Je vous souhaite une
complète réussite dans vos gestions, surtout une
santé de fer qui vous permettra de continuer qui vous permettra
de continuer inlassablement la défense des gens de bonne foi et
des faibles. Daignez agréer, mon Administrateur et Cher Ami,
l'assurance de ma vive gratitude et de mes affectueuses
cordialités ».
- 11 juillet 1946 : Lettre
dactylographiée de 5 pages de l’Administrateur de 2°
classe LAMBERT Jean, Chef du Bureau des Affaires Politiques et Sociales
de la Côte d’Ivoire, à Monsieur le Gouverneur de la
Côte d’Ivoire à Abidjan, rendant compte de la
conférence qui s’était tenue la veille dans son
bureau :
« J’ai l’honneur de vous rendre compte des faits suivants :
J’ai appris de
source personnelle que le récit de la conférence qui
s’est tenue hier 10 juillet au matin dans votre bureau
s’était répandu dans Abidjan sous les formes les
plus diverses.
Les Services de la Sûreté ont dû ou peuvent vous renseigner officiellement à ce sujet.
Comme ces récits
plus ou moins fantaisistes dépasseront certainement le cadre de
la Côte d’Ivoire, j’ai tenu à rappeler
ci-dessous les faits exacts alors qu’ils sont encore
récents et présents à la mémoire de tous.
Depuis plusieurs jours une
lettre relative aux attributions d’importation à faire aux
coopératives était soumise à votre signature.
Vous aviez bien voulu me demander, en tant que Chef des Affaires Politiques et Sociales, mon avis sur cette lettre.
L’opinion que je vous ai exposée était la suivante :
En mai 1946 vous aviez
remis une note à Monsieur le Haut Commissaire demandant par
quelle procédure pouvait être incluse la
Coopérative des Planteurs Africains parmi les importateurs
quoique cet organisme ne possédait pas
d’antériorité d’importateur.
Par lettre N° 3976 en
date du 3 juin 1946 Monsieur le Haut Commissaire a répondu que
l’arrêté n° 276 du 23-1-1946 laissait à
votre attribution 25 % des importations à des non
antérioritaires et que vous pouviez en attribuer une part
à la Coopérative des Planteurs Africains.
Je vous ai alors proposé de répartir ces 25 % de la manière suivante :
17 % à la Coopérative des Planteurs Africains
2 % à la Coopérative “Les Planteurs du Sassandra”
6% à la Coopérative des Fonctionnaires
Ce projet rencontra
l’opposition absolue du Secrétaire Général
et du Chef des Affaires Économiques. Vous avez alors
résolu de réunir en votre présence et dans votre
bureau le 10 juillet à 9 heures du matin une conférence
à laquelle participeraient : Le Secrétaire
Général, le Président de la Coopérative des
Planteurs Africains, Le Chef de Cabinet, le Chef des Affaires
Économiques et le Chef des Affaires Politiques et Sociales.
Je me suis
présenté dans votre bureau à 8 h 55.
Étaient déjà arrivés le Président de
la Coopérative des Planteurs Africains, Le Chef de Cabinet et le
Chef des Affaires Économiques. Après avoir salué
tout le monde, je suis allé m’asseoir à
côté du Chef des Affaires Économiques.
Peu après, arriva
le Secrétaire Général qui vous salua ainsi que
votre Chef de Cabinet et d’assit.
Le Chef de Cabinet fit un exposé de la question et un échange de vues s’engagea.
Le Secrétaire
Général et le Chef des Affaires Économiques
déclarèrent qu’ils s’opposaient formellement
à l’attribution d’une part quelconque aux 3
coopératives pour les raisons suivantes :
1°- Les statuts de ces
coopératives n’avaient pas été
modifiés pour en faire des coopératives de consommation.
2°- Ces coopératives n’avaient pas de patente d’importateur.
3°- Les importations
devaient, selon eux, être réservées aux maisons de
commerce, c’est-à-dire aux organismes achetant ou
revendant pour faire un bénéfice, ce qui n’est pas
le cas des coopératives (sic).
4°-
L’attribution d’un pourcentage quelconque des importations
à une coopérative était contraire à la
lettre de l’arrêté général n° 270
du 23-1-46.
5°- Que les délais fixés par cet arrêté n° 270 pour les importations des
6°- Que les 25 %
réservés aux non antérioritaires avaient
déjà été répartis par vous quelques
jours auparavant entre 75 commerçants.
Sur le premier point, je
répondis qu’il était inutile de modifier les
statuts de ces 3 coopératives puisque ces statuts en faisaient
déjà des coopératives de consommation.
Le Chef des Affaires
Économiques déclara que lui, Chef des Affaires
Économiques, avait été tenu dans l’ignorance
des statuts de la Coopérative des Planteurs Africains.
Je lui fis observer que
les statuts des 3 coopératives en question avaient paru au
Journal Officiel de la Côte d’Ivoire ainsi que cela est
réglementaire.
Sur le deuxième
point, je répondis que la lettre n° 3979 du 3 juin 1946 du
Haut Commissaire avait prévu l’octroi d’une patente
“pro forma” aux coopératives.
Le Chef de Cabinet demanda
alors au Secrétaire Général et au Chef des
Affaires Économiques s’ils étaient d’accord
pour l’octroi d’une pareille patente aux
Coopératives.
Le Chef des Affaires
Économiques déclara que cela n’avait pas
d’importance et que la délivrance d’une patente ne
donnait aucun droit à l’intéressé.
Sur les troisième
et quatrième points je fis remarquer que la lettre n° 3979
du 3 juin 1946 du Haut Commissaire était très claire et
que cette lettre exposait nettement que l’attribution d’une
part des importations pouvait être faite au profit de la
Coopérative des Planteurs Africains.
Le Secrétaire
Général et le Chef des Affaires Économiques
déclarèrent qu’une lettre ne pouvait modifier un
arrêté.
Je répondis que
cette lettre était un commentaire de l’arrêté
n° 270 sur un point particulier, que cette lettre émanait de
l’autorité même qui avait signé
l’arrêté et que dans ces conditions nous devions
nous en tenir aux instructions contenues dans la lettre n° 3979 du
3 juin 1946.
Le Secrétaire
Général et le Chef des Affaires Économiques dirent
qu’ils maintenaient leur point de vue.
Le Chef des Affaires Économiques ajouta alors que je voulais faire une “Révolution”.
Je lui ai répondu
que ce mot ne m’inquiétait pas. J’ai
précisé qu’en tant que Chef des Affaires Politiques
et Sociales je désirais le développement des
coopératives, conformément à la ligne politique
actuelle du Gouvernement.
Sur le cinquième
point, j’ai répondu que les délais étaient
effectivement dépassés pour les importations relatives
aux 1er et 2ème semestre 1946 puisque le dernier délai
relatif au 2ème semestre était fixé au 1er juin.
Mais considérant
que la lettre n° 3979 du Haut-Commissaire était datée
du 3 juin 1946 et que le report du droit d’importation pour les
coopératives au 1er semestre 1947 ne jouerait, en pratique, que
pour les arrivages des derniers mois de 1947, on pouvait demander au
Haut Commissaire de prolonger le délai fixé par
l’arrêté pour les attributions de 1946.
Je vous avais,
d’ailleurs, remis au début de la séance, un projet
de télégramme au Haut Commissaire annonçant la
répartition que j’avais proposée (17 % à la
Coopérative des Planteurs Africains - 2 % à la
Coopérative “Les Planteurs du Sassandra” - 6%
à la Coopérative des Fonctionnaires) et demandant que
cette répartition soit appliquée immédiatement
malgré l’expiration des délais. Le projet signalait
par ailleurs que vous aviez été saisi de demandes
verbales de la part de la Coopérative des Planteurs Africains en
janvier et en mai 1946, de demandes verbales de part de la
Coopérative “Les Planteurs du Sassandra” et de la
Coopérative des Fonctionnaires en mai 1946.
Continuant
l’échange de vues, j’ai précisé que
l’autorité ayant signé un arrêté
pouvait fort bien proroger des délais inclus dans ce même
texte. J’ai rappelé que cela s’était
déjà pro dans un autres cas en faveur d’une
maison de commerce.
Le Secrétaire
Général et le Chef des Affaires Économiques
maintinrent qu’ils s’opposaient à ce que soit faite
une pareille demande de prorogation de délai.
L’échange de
vue s’engagea ensuite sur le 6ème point de vue. Le
Secrétaire Général et le Chef des Affaires
Économiques déclarèrent que le retrait du
pourcentage de 25 % aux 75 commerçants non
antérioritaires allait provoquer chez les
intéressés un violent mécontentement et que
d’ailleurs les coopératives n’étaient pas en
état d’absorber la totalité des importations qui
leur était attribuée.
J’ai répondu
qu’il fallait d’abord mettre les coopératives en
état d’importer et que tout autre procédé
remettrait indéfiniment la question sans jamais rien faire de
réel.
Vous avez alors
estimé qu’il serait impolitique de mécontenter trop
violemment les 75 non antérioritaires, vous avez consulté
le Président de la Coopérative des Planteurs Africains.
Vous avez pris ensuite mon projet de télégramme
précité et vous l’avez modifié de votre
main. Vous proposiez ainsi au Haut Commissaire de faire la
répartition suivante des 25 % réservés aux non
antérioritaires :
6 % à la Coopérative des Planteurs Africains
1 % à la Coopérative “Les Planteurs du Sassandra”
3 % à la Coopérative des Fonctionnaires
les 15 % restant
étant réservés aux 75 commerçants figurant
sur la liste déjà établie. Vous demandiez en outre
que les attributions aux coopérateurs commencent
immédiatement malgré l’expiration des délais
fixés par l’arrêté n_ 270 du 23 janvier 1946.
En somme le
télégramme ainsi conçu ne contenait rein de
définitif et soumettait la question au Haut Commissaire.
Dans un but de
conciliation le Président de la Coopérative Africaine et
moi-même avons déclaré nous rallier au projet de
télégramme ainsi modifié.
Le Secrétaire
Général et le Chef des Affaires Économiques
déclarèrent alors s’opposer à l’envoi
du télégramme et maintenir intégralement leur
point de vue exposé au début de la conférence. Ils
ajoutèrent que votre télégramme allait amener une
violente réaction de la part des milieux du commerce et se
permirent de déclarer que leur insistance était due
à leur souci de “votre situation personnelle”.
J’ai objecté
que le mécontentement ne pouvait pas être
extrêmement vif. Les 75 commerçants visés
figuraient sur une liste datant de 8 jours, ils n’avaient encore
rien apporté jusqu’à présent ; de plus la
nouvelle rédaction du télégramme ne proposait pas
l’élimination des 75 intéressés ; elle se
contentait de proposer la diminution du total de leurs attributions de
25 % à 15 %.
Finalement, vous avez
tendu une feuille blanche au Chef des Affaires Économiques en
lui demandant de rédiger suivant son point de vue le
télégramme destiné au Haut Commissaire.
J’ai alors
déclaré que les coopératives allaient être
ainsi sacrifiées aux maisons de commerce. Le Chef des Affaires
Économiques se tourna alors vers moi et me déclara
d’un ton furieux que je l’accusais d’être au
service d’une maison de commerce.
Simultanément, le
Secrétaire Général se leva et se retira. Vous
l’avez rappelé ; le Secrétaire
Général continua à s’éloigner. Vous
avez ensuite envoyé le Chef de Cabinet à sa recherche.
Pendant ce temps, le Chef
des Affaires Économiques continua à manifester bruyamment
sa colère. Je lui répétai à plusieurs
reprises qu’il défendait les intérêts des
maisons de commerce. Vous m’avez interpellé violemment en
criant à plusieurs reprises “Non, Lambert”. Devant
l’aspect que prenait la scène, j’ai
déclaré que je préférais me retirer. Je
suis sorti au milieu du silence de tous.
Dans l’escalier
j’ai rencontré le Secrétaire Général
qui remontait à votre bureau en compagnie du Chef de Cabinet. je
lui ai dit “Vous pouvez rentrer, c’est moi qui me
retire”. Il est passé sans répondre.
J’ignore ce qui s’est passé ensuite dans votre bureau.
x
x x
Pour
les raisons exposées au début de cette lettre, j’ai
tenu à faire le présent rappel des faits exacts dans une
pièce officielle.
J. LAMBERT
Administrateur des Colonies
- Courrier
classé CONFIDENTIEL, Abidjan, le 27 juillet 1946 de
l'Administrateur de 1° Classe Pierre DELTEIL, Secrétaire
Général de la Côte d'Ivoire à Monsieur le
Ministre de la France d'Outre-Mer s/c de Monsieur le Gouverneur de la
Côte d'Ivoire et de Monsieur le Haut-Commissaire de la
République, Gouverneur Général de l'A.O.F. :
« Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous demander de bien
vouloir me remplacer dans les fonctions de Secrétaire
Général de la Côte d'Ivoire. L'impossibilité
dans laquelle je me trouve de travailler en liaison avec
l'Administrateur LAMBERT, Chef du Bureau des Affaires Politiques,
même quand, en l'absence du Chef de la Colonie, je suis
chargé de l'expédition des affaires courantes, ne me
permet pas d'assurer mon service dans des conditions satisfaisantes et
efficaces. Je vous demande en outre de considérer que, depuis
juin 1937 je n'ai bénéficié que detrois mois de
congé. Durant les dix mois que je viens de passer à la
Côte d'Ivoire, j'ai dû assumer de lourdes charges et
j'éprouve un réel besoin de détente.
Je vous serais donc
particulièrement reconnaissant 'autoriser mon retour
anticipé sur la Métropole, ainsi que celui de ma famille.
Signé : DELTEIL ».
- Procès-verbal de passation de service : « L'an mil
neuf
cent quarante sept et le dix huit Mars, Nous LAMBERT, Administrateur
des Colonies, cessant à la date de ce jour nos fonctions de Chef
du Bureau des Affaires Politiques & Sociales avons
procédé à la passation de service et la
transmission de toutes les archives appartenant au Bureau des Affaires
Politiques & Sociales à M. CLAVERIE Charles, Administrateur
des Colonies, Chef du Bureau des Affaires Politiques & Sociales
nommé par décision N° 1365 CP du 18 Mars 1947 et qui
prend à la date de ce jour ses fonctions. M. CLAVERIE
reconnaît avoir reçu toutes les archives et dossiers. La
présente passation de service n'a donné lieu à
aucune remarque particulière et il il n'a été fait
aucune réserve de part et d'autre ». Signé : LE
CHEF DU BUREAU RENTRANT / LE CHEF DU BUREAU SORTANT.
- Ordre de Mission du Gouvernement Général de
l’Afrique Occidentale Française - Colonie de la Mauritanie
- Bureau du Personnel su 14 août 1947 :
« En exécution des prescriptions du
Télégramme Officiel n° 125 du 14 août 1946,
Monsieur l’Administrateur LAMBERT se rendra à Dakar en
mission. Départ le 16 août 1947 par la Micheline. M.
LAMBERT aura droit aux indemnités prévues par les
réglements en vigueur ».
- Décision du 30 mai 1947 : « Le Haut Commissaire de
la République du Gouvernement Général de
l’Afrique Occidentale Française (…) décide :
M. LAMBERT Jean, Administrateur de 2° classe en service en
Côte d’Ivoire est mis à la disposition du Gouverneur
de la Mauritanie ». Signé R. BARTHES. Visé par le
contrôle financier, cachet daté du 23 mai 1947.
- Décision du 14 juin 1947 (de Saint-Louis) : Le Gouverneur de
la Mauritanie, Officier de la Légion d’Honneur, (…)
décide (…) : « M. LAMBERT Jean, Administrateur de
2° classe des colonies, nouvellement affecté en Mauritanie,
est nommé Chef du Bureau du Personnel et de
l’Administration Générale en remplacement de M.
PERHIRIN François, Administrateur-adjoint de 2° classe,
appelé à d’autres fonctions ».
- Courrier du 17 mai 1948
[mention SECRET] du Haut-Commissaire de la République, Gouverneur
Général de l’A.O.F., à Monsieur le Gouverneur de la Mauritanie -
Saint-Louis : « Conformément aux instructions que je viens de recevoir
du Département, je vous serais obligé de bien vouloir inviter M.
l’Administrateur des Colonies LAMBERT à répondre au questionnaire
ci-joint » concernant
les conditions dans lesquelles ont été effectuées
les libérations conditionnelles de BOUAKÉ en avril 1946 en
Côte d'Ivoire » (Copie conforme transmise à M.
LAMBERT « pour notification ». Visé par le Cabinet
de la Colonie de Mauritanie le 22 mai 1948) :
1°/
Quelles sont les raisons qui ont poussé M. LAMBERT, alors Chef
du Bureau Politique de la Côte d’Ivoire à proposer
la libération immédiate de 22 détenus, alors que
les dossiers n’avaient pas été examinés et
que les pièces nécessaires n’avaient pas
été établies ?
2°/ M. LAMBERT
ignorait-il que toute libération conditionnelle doit être
précédée d’une enquête approfondie ?
3°/ M. LAMBERT
ignorait-il que certains intéressés ne remplissaient pas
les conditions nécessaires à une libération
conditionnelle ?
4°/ M. LAMBERT est-il
intervenu de façon pressante auprès du Gouverneur pour
que les intéressés soient immédiatement
libérés ? Quel a été son rôle et le
sens de ses interventions ?
5°/ Quelle part M.
LAMBERT a-t-il prise à la régularisation “à
postériori” de ces libérations conditionnelles ?
- Certificat de
déménagement : « Inventaire des bagages de M.
LAMBERT (Jean), Administrateur de 2° classe des Colonies, en
déplacement définitif ». Suivent le détail
du contenu de chacune de 19 cantines métalliques. Visé
par M. le Cdt de [illisible]. Daté du 19 mai 1948 (de Saint-Louis du Sénégal) avec le Cachet de l’Administrateur de la Colonie du Sénégal.
- Réponse manuscrite du 24
mai 1948, depuis Saint-Louis, de l’Administrateur de 2° classe des
Colonies LAMBERT (Jean) « à un questionnaire sans références ni date qui
lui a été notifié sous transmission n° 404/c du 22 mai 1948 par
Monsieur le Gouverneur de la Mauritanie » :
«
Avant de répondre séparément aux 5 questions qui
me sont posées, je tiens à signaler qu’elles
concernent des faits datant de plus de 2 ans et que mes réponses
ne sont basées que sur des souvenirs. Il est donc possible que
dans ces réponses, je commette involontairement des erreurs
partielles dues à l’éloignement des faits ».
Question n° 1. Réponse : « En 1942 ( ?), plus de vingt
enfants et tout jeunes gens furent condamnés par le Tribunal de
Bonaké (Justice Indigène) pour une série de
larcins commis principalement sur le marché de cette
localité. Ils furent condamnés en bloc à 7 ans de
prison pour “Association de malfaiteurs”.
Vers le temps où
ils eurent accompli la moitié de leur peine, quelques-uns des
condamnés (2 ou 3) établirent des demandes de
libération conditionnelle qui suivirent la procédure
régulière. Les dossiers parvinrent au Bureau Politique de
la Côte d’Ivoire. Leur examen attira
particulièrement mon attention car il en ressortait deux points
frappants : d’une part, la sévérité apparente
dont il avait été fait preuve à
l’égard de jeunes délinquants primaires
n’ayant commis que des larcins, d’autre part, le fait que
les requérants déclaraient n’avoir pas atteint la
majorité pénale au moment de leur condamnation.
Ce fut donc, pour moi,
l’occasion d’étudier à fond cette affaire.
Les premiers requérants furent mis en liberté
conditionnelle après qu’eurent été
accomplies toutes les étapes de la procédure habituelle.
Dès ces mises en
liberté, plus de quinze familles d’autres
emprisonnés de la même affaire écrivirent
directement au Chef du Territoire pour demander la même mesure
à l’égard de leurs enfants. Toutes ces lettres
insistaient sur le jeune âge des délinquants et sur la
dureté de la peine infligée.
Le Gouverneur devait,
précisément, se rendre en tournée à
Bonaké et il fut décidé de constater sur place
l’âge apparent des détenus.
Dès son
arrivée à Bonaké, le Gouverneur reçut de
nombreuses demandes d’audience de parents des jeunes
condamnés. Les détenus furent convoqués. Je ne me
souviens plus de leur nombre précis. La moitié, au moins,
d’entre eux avaient un âge apparent de 17 à 19 ans ;
aucun ne dépassait 22 ou 23 ans.
Si l’on tient compte
du fait qu’ils avaient été jugés près
de 4 ans auparavant et qu’ils venaient de subir près de 4
ans de prison (cause de vieillissement prématuré), on
pouvait en déduire qu’ils avaient tous été
condamnés très jeunes et que beaucoup d’entre eux
n’avaient pas, alors, atteint l’âge de la
majorité pénale.
Je fis la constatation
qu’il n’existait au dossier aucune pièce
d’état-civil établissant l’âge des
délinquants. Les pièces d’interrogatoire leur
donnaient 17 ans ou plus, sans la moindre preuve de cette affirmation.
L’affaire se présentait donc ainsi :
- Plus de 20 enfants et
jeunes gens avaient été condamnés à une
peine de 7 ans de prison à la suite de larcins divers.
- La condamnation avait
été prononcée en bloc, par un même jugement,
retenant un délit collectif d’“Association de
malfaiteurs”.
- Deux (ou trois) de ces
condamnés avaient déjà été remis en
liberté conditionnelle, après la procédure
habituelle. A cette occasion, les différentes consultations
normales avaient été faites ; toutes avaient conclu en
faveur de la libération.
- Si l’on avait
voulu reprendre toute la procédure pour les jeunes
détenus qui restaient en prison, cela aurait demandé
plusieurs semaines, pour une formalité superflue puisque tous
les avis à recueillir avaient déjà
été donnés sur cette affaire. La
conséquence aurait été de maintenir en prison
pendant tout ce temps ces jeunes condamnés qui avaient
déjà accompli une peine bien dure.
- Le dossier avait été examiné à fond.
J’ai donc
proposé à Monsieur les Gouverneur de la Côte
d’Ivoire de signer sans plus tarder leur mise en
libération conditionnelle afin que ces enfants et jeunes gens
soient remis immédiatement à leurs familles.
Ce faisant, j’ai agi
par un sentiment d’humanité élémentaire ;
j’ai été également poussé par le
point de vue social de l’affaire : il était de
l’intérêt général que ces jeunes gens,
tous délinquants primaires, soient enlevés le plus
rapidement possible à la promiscuité des prisons
qu’ils subissaient déjà depuis trop longtemps
J’ajoute
qu’aujourd’hui, au souvenir de cette affaire,
j’éprouve toujours les mêmes sentiments ».
Question n° 2.
Réponse : « Je ne crois pas ignorer la procédure
employée pour les libérations conditionnelles ».
Question n° 3. Réponse : « Je ne me souviens pas d’un fait pareil ».
Question n° 4.
Réponse : « Je n’ai pas eu à intervenir de
“façon pressante” auprès de Monsieur le
Gouverneur qui venait de recevoir les familles. Mon rôle
s’est borné à lui expliquer à nouveau
l’affaire qu’il connaissait déjà, en y
ajoutant le résultat de mes derniers examens des dossiers. En
conclusion, j’ai proposé la mise en liberté
conditionnelle sans plus tarder des condamnés encore
détenus ».
Question n° 5.
Réponse : « Je n’ai aucun souvenir à ce sujet
et ne vois pas ce dont il peut être question ».
- Bulletin individuel de notes (document "très
confidentiel" du
Ministère des Colonies - Gouvernement Général de
l'A.O.F. - Colonie de la Mauritanie), avec : Nom, prénoms,
grade, fonctions (chef des bureaux du Personnel et de l'Administration
Générale, Saint-Louis), date d'entrée en service
(24 janvier 1927) (...), langues étrangères (allemand,
arabe, tchadien), distinctions honorifiques (Condamné à
mort (Tribunal Militaire de Dakar 7-9-1942), Médaille de la
Résistance), durée des services calculés jusqu'au
30 juin 1948 (en France : 7 ans, 3 mois, 14 jours ; à la mer ou
aux colonies : 17 ans, 8 mois; 18 jours ; total : 25 ans, 0 mois, 2
jours).
- Lettre recommandée du MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER
à Monsieur Jean LAMBERT, Administrateur 3° échelon de
la France d'Outre-Mer, Route de Marseille, LE BEAUSSET (VAR). Paris, le
15 octobre 1954 : « A la suite de la suppression de 53 emplois
d'Administrateurs de la France d'Outre-Mer par voie budgétaire,
je me suis vu contraint de procéder à des admissions
à la retraite en application des dispositions de l'article 6 du
décret du 9 août 1953 relatif au régime des
retraites du personnel de l'État et des Services publics. Cette
mesure
a été appliquée aux administrateurs qui ont
déjà attient leur ancienne limite d'âge personnelle
ou qui l'atteindront prochainement et qui ont droit à pension
d'ancienneté. Seul un critère automatique de date est
intervenu dans l'établissement de la liste de ces
administrateurs. Né le 22 novembre 1898, vous avez
été atteint par cette limite d'âge le 22 novembre
1953. En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir
ci-joint, pour valoir notification, copie du décret du 4
août 1954 vous admettant à faire valoir vos droits
à une pension de retraite pour ancienneté de services
». Pour le Ministre et p.o. Le Directeur du Personnel L. PECHOUX.
- Décision de la Direction du Personnel, 2° bureau -
I°
Section, 4 février 1955, Paris : Portant attribution d'une
indemnité à un Administrateur de la France d'Outre-Mer
réintégré. LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ;
VU le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur le
solde et les allocations accessoires des fonctionnaires coloniaux et
les textes qui l'ont modifié et complété ; VU la
décision du Conseil d'État en date du 29 juillet 1953
annulant
les décrets du 28 mars 1949 et du 21 novembre 1949 portant
révocation de M. LAMBERT Jean, Administrateur de 2° classe
des Colonies, pour compter du Ier avril 1949 ; VU l'arrêt du
Conseil d'État, en date du 26 mars 1947, au terme duquel un
Gouverneur
des Colonies (M. GIACOBBI) dont l'admission à la retraite est
annulée ne peut prétendre, en l'absence de service fait,
à un rappel de traitement mais doit recevoir une
indemnité en réparation du préjudice subi ; DECIDE
: ARTICLE I - « Il est attribué à M. LAMBERT Jean,
Administrateur 3° échelon de la France d'Outre-Mer, une
indemnité égale au montant des émoluments qu'il
aurait perçu s'il était resté en service dans la
Métropole, du Ier avril 1949 au 4 août 1954 ».
ARTICLE 2 - « De l'indemnité allouée à M.
LAMBERT seront dés : I°/ Les retenues
réglementaires pour pension qui auraient été
normalement précomptées sur sa solde de grade du Ier
avril 1949 au 4 août 1954. 2°/ Les arrérages de
pension et les rémunérations publiques et privées
dont M. LAMBERT a bénéficié du Ier avril 1949 au 4
août 1954 ». ARTICLE 3 - « Le montant de
l'indemnité revenant à M. LAMBERT, liquidée
à la somme de (...), selon décomptes
joints,
sera imputable au chapitre 031-01 du Budget de l'État
(Ministère
de la France d'Outre-Mer) ». (Fait à Paris le 4
février 1955. Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur du Cabinet A. GRIMALD).
Ce qui permet de faire un maillage
aussi exhaustif que possible de la vie de Jean LAMBERT, reconstituer
son parcours et
ses activités avec aujourd'hui davantage de précisions
- 9 février 1866 : Naissance
à
Mouzon (Ardennes) de Charles Henri LAMBERT, père de Jean
LAMBERT. Il
sera professeur d'Université, ami de Gaston BACHELARD, exercera
successivement au Puy-en-Velay (Haute-Loire), à Annecy
(Haute-Savoie),
puis à la Faculté des lettres de Dijon (Côte
d’Or), où il devint Doyen,
tout en étant par ailleurs très engagé dans la
diffusion de l’espéranto.
- 29 décembre 1871
: Naissance à Maurs (Cantal) de Marie Félicie
CARBASSE, mère de Jean LAMBERT.
- 6 avril 1892 : Mariage des parents de
Jean LAMBERT au Puy-en-Velay (Haute-Loire).
- 27 février 1894 : Naissance de Paul Jean Etienne LAMBERT,
frère aîné de Jean LAMBERT, à Annecy
(Haute-Savoie).
- 13 octobre 1895 : Naissance
d'Odette Pauline Thérèse LAMBERT, sœur
aînée de Jean LAMBERT, à Annecy (Haute-Savoie).
Elle sera plus tard (dès les années 1930) professeur d'histoire et géographie à
Nice.
- 22 novembre 1898 : Naissance
de Jean LAMBERT à Dijon en 1898 : « Acte de naissance #
1198 du 24
Novembre 1898. LAMBERT Jean Maurice Jules, fils de Charles Henri
LAMBERT, 33 ans, professeur, demeurant à Dijon, Marié au
Puy
(Haute-Loire) le 6 Avril 1892 avec Marie Félicie CARBASSE, 26
ans ».
Mentions marginales : « Marié le 26 Juin 1926 à
Issy-les-Moulineaux
(92) avec Anna Jehanne (Jeanne) TRUITARD » et «
Décédé à St-Pardoux-la-Croisllle
Corrèze - Dijon le 14 septembre 1961 ».
- 1907 : Jean LAMBERT est en classe
de 8e au Lycée Carnot à Dijon et obtient un second prix de calcul.
-
1914 et 1915 : Baccalauréat.
- 13
mars 1915 : Paul Jean Etienne LAMBERT, frère aîné
de Jean LAMBERT, 21 ans, élève de l'École normale
supérieure de la rue d'Ulm à Paris, caporal au 20e
Régiment d'Infanterie, est tué au combat à
Fontenoy-sur-Aisne.
-
1915-1916-1917 : Jean LAMBERT est étudiant en médecine
[Un document du Secrétariat de l'École de Médecine
et de Pharmacie de l'Université de Dijon, daté du 16
février 1918, certifie que LAMBERT Jean, Maurice, Jules, «
est actuellement pourvu de six inscriptions en vue d'obtenir le
diplôme de Docteur en médecine »].
-
Avril 1917 : Mobilisation comme Infirmier de 2e classe, puis
Médecin-auxiliaire.
-
Affecté sur le Front des Vosges, puis en Macédoine dans
le 10e Bataillon Indochinois.
-
1920 : Démobilisé avec le grade de
Médecin-auxiliaire de réserve.
-
Mars 1920 : Adhère à la section de Dijon du Parti
(socialiste) et participe à la lutte pour le rattachement
à la IIIème Internationale.
-
Arrêté lors de la manifestation contre l'inauguration du
monument de Bossuet et condamné par le tribunal de simple police
à 5 francs d'amende.
- Ne
poursuit pas ses études de médecine et semble
s'être inscrit à la Faculté des sciences car il
obtient une licence ès-sciences en juillet 1921.
-
Octobre 1921 à juillet 1923 : Étudiant à
l'Institut Électrotechnique de Grenoble. Fait partie de la
Section de Grenoble du Parti communiste. Devient
secrétaire-adjoint de la Fédération communiste de
l'Isère.
-
1922 : Décès (vraisemblablement à Dijon) de sa mère. Son
père se remariera par la suite et continuera de vivre à
Dijon.
- Mai
1923 : Condamné par le Tribunal correctionnel d'Annecy à
800 francs d'amende pour un article paru dans le journal local du
Parti, "Le Travailleur de l'Isère".
-
Juillet 1923 : Obtient le diplôme d'Ingénieur
Électricien. Mais, à sa sortie de l'Institut
Électrotechnique, le directeur de l'Institut refuse de le placer
à cause de ses opinions politiques.
-
S'embauche comme manœuvre dans une usine de pros chimiques de
Saint-Fons (banlieue de Lyon), devient Secrétaire du syndicat
(C.G.T.U.) des pros chimiques de Lyon et milite
simultanément à la Section de Saint-Fons du P.C.F.
-
Janvier 1924 : Participe au congrès de Lyon du Parti. Il est
désigné par le congrès comme membre de la
délégation qui devra assister aux obsèques de
LÉNINE. (Mais la délégation ne part pas, les
obsèques ayant eu lieu sans délai).
-
Mars 1924 : Recruté comme Ingénieur électricien
aux "Exploitations Électriques" à Langres. Il milite
à la Section de Langres du P.C.F.
-
Octobre 1924 : Recruté comme Ingénieur chimiste aux
usines du "Bi-Métal" à Alfortville. Il devient
Secrétaire-adjoint du rayon d'Alfortville et
Secrétaire-adjoint de la Fédération des Pros
Chimiques (C.G.T.U.).
-
Octobre 1925 : Ayant porté la contradiction au nom du Parti
à une réunion publique à Alfortville, est
renvoyé des usines du "Bi-Métal".
-
Recruté comme Ingénieur aux usines de la S.E.V.
(Issy-les-Moulineaux) et milite à la cellule du P.C.F. de
l'usine.
-
Ayant fait grève le 1er mai 1926, est renvoyé de la
S.E.V. le 2 mai.
-
Recruté comme Ingénieur chimiste au "Comptoir des
Alcaloïdes" à Noisy-le-Sec.
-
Dans ces années 1920, il est parfois « médecin
marron » : il soigne les plus pauvres sans être
médecin diplômé. C’est ainsi qu’il
rencontre sa future épouse, alors infirmière, au chevet
d’un malade.
- 26
Juin 1926 : Mariage avec Anna Jehanne (Jeanne) TRUITARD à
Issy-les-Moulineaux (née le 14 octobre 1898 à
Bois-Colombes).
-
1926/1927 : Présente le concours de l'École Coloniale
où il est reçu major.
-
Janvier 1927 : Entre dans l'administration coloniale comme adjoint des
Services Civils de l'A.E.F. Il cesse, à cette date, de cotiser
au Parti car il n'existait pas de section en A.E.F.
-
Février 1927 : Affecté au Congo, aux chantiers du chemin de
fer Congo-Océan (C.F.C.O.) [ligne ferroviaire longue de 510 km
environ, à l'écartement de 1,067 m, située dans la
République du Congo qui relie le port de Pointe-Noire sur
l'océan Atlantique à Brazzaville sur le fleuve Congo. Il
fut construit sous l'administration coloniale française entre
1921 et 1934 au prix de nombreuses pertes humaines - 17 000 personnes
en raison du travail forcé]. Il y est chargé des cultures
vivrières et fournit les éléments de la campagne
menée par le Parti communiste en 1929 et 1930 contre les abus
commis au Congo-Océan.
-
Janvier 1929 : En congé de convalescence de six mois.
- Mars 1929 : Se trouve à Paris « adjoint des Services Civils », 110 rue des Boulets.
-
Novembre 1929 : Stagiaire à l'École Coloniale.
-
1930 : Nommé Administrateur-Adjoint des Colonies et
affecté au Tchad (26
mai 1930) où il part avec son épouse.
-
Juin 1930 : Nommé Chef de subdivision de Massakory où, en
cinq mois, il « ramène la paix et rétablit l'ordre
dans une région mise en coupe réglée depuis des
années par les pillards et les brigands de grand chemin qui
l'habitaient » (appréciation élogieuse de son
supérieur, 15 janvier 1931).
-
Juin 1932 : En congé administratif de 6 mois : rentre en France
avec son épouse.
-
Mars 1933 : Retourne en Afrique, laissant son épouse en France.
Nommé Chef de subdivision de Ngouri, petite ville du Tchad,
chef-lieu du département du Wayi, dans la région du Lac.
-
Mars 1933 : Jean LAMBERT, malade, n'est prévenu que tardivement
des « faits affreux » qui se sont déroulés
à la prison de N'Gouri. Prévenu à 6 heures du
matin, il se « traîne jusqu'à la prison » et
« prend les mesures qui s'imosaient ».
-
Juin 1933 : André LATRILLE est administrateur et chef de
circonscription du Kenm lorsqu'a lieu une bataille rangée entre
deux tribus antagonistes, faisant plus de 200 morts identifiés,
y compris les chefs des deux tribus. Désaccord entre le
gouverneur LATRILLE et un gouverneur BRUNOT au sujet de cette bataille,
LATRILLE ayant demandé aux officiers chefs de subdivisions
qu'une enquête fût ouverte et qu'il soit
procédé par la force aux arrestations nécessaires,
ce qui ne fut pas fait.
- 7
juillet 1933 : Naissance de Paule LAMBERT en France.
-
Août 1933 : Nommé adjoint au Chef de circonscription du
Kanem (nord-est du lac Tchad).
-
Juin 1934 : Nommé adjoint au chef de circonscription du
Mayo-Kebbi (sud-ouest du Tchad, près de la frontière avec
le Gabon).
-
Décembre 1934 : Nommé Chef de subdivision de Fianga,
petite ville du sud-ouest du Tchad, chef-lieu du département du
Mont d'Illi (région du Mayo-Kebbi Est).
-
Mars 1936 : Obtient un congé administratif de 9 mois.
- Non
daté : Un fascicule de mobilisation « classe 1918,
profession : Administrateur-adjoint, grade : médecin auxiliaire,
domicilié à Franceville, département du Haut
Ogooué (Moyen Congo) » indique qu'il est affecté au
Bataillon de Réserve du Moyen Congo stationné à
Brazzaville.
-
Février 1937 : Nommé Chef de subdivision de Franceville,
ville du Moyen Congo
(aujourd'hui Gabon), chef-lieu
de la province du Haut-Ogooué.
-
Septembre 1937 : Nommé Chef de subdivision d'Okondja, chef-lieu
du département de Sébé-Brikolo dans la province du
Haut-Ogooué.
-
Février 1938 : Évacué sur l'hôpital de
Brazzaville (actuellement capitale de la République du Congo).
-
Juillet 1938 : Nommé Chef de subdivision d'Aboudeïa,
chef-lieu de la région de Salamat, au sud-est du Tchad.
-
Avril 1939 : Nommé Chef de département intérimaire
du Salamat.
-
Décembre 1939 : Nommé Chef de subdivision d'Aboudeïa.
- 5
février 1940 : Évacué sur Fort-Archambault (ville
du sud du Tchad, centre militaire très important, aujourd'hui Sarh, sur le fleuve Chari) et
hospitalisé. C'est peut-être
à ce moment-là que les indigènes lui ont
sauvé la vie en le transportant jour et nuit.
- 9
mars 1940 : L'autorité de Bangui (territoire de
l'Oubangui-Chari, A.E.F.) lui accorde un congé de convalescence
(fin avril 1940, 3 mois sauf prolongation) et l'autorise à
revenir en France : Une réquisition de passage en 1ère
classe lui est délivrée sur le paquebot de la Compagnie
des Chargeurs Réunis qui quittera Pointe-Noire le (?) à
destination de Bordeaux.
- 10
mai 1940, se trouvant en congé en France, adresse une «
demande de mobilisation dans une unité combattante de la
Métropole ». Cette demande reçoit une
réponse favorable le 31 mai 1940 qui lui parvient à Dijon
au moment des évènements de juin 1940. Il se rend
à Sète, à la disposition des Autorités
Militaires, le 19 juin 1940 pour être incorporé dans une
unité combattante. La précipitation des
évènements politiques et militaires fait qu'il est trop
tard pour qu'il soit incorporé.
- 27
août 1940 : Le Tchad est le premier territoire d'Outre-Mer
à se rallier à la France Libre (télégramme
du Gouverneur Félix ÉBOUÉ) [André LATRILLE
est alors administrateur et chef du département de
Fort-Archambault].
-
Décembre 1940 : Retourne de nouveau en Afrique, affecté
cette fois en Côte d'Ivoire,
comme Administrateur-adjoint de 3ème classe des Colonies et Chef
de la Subdivision de Gagnoa. Son comportement y est très
critiqué par ses supérieurs [il écrira plus tard
qu'il à tout fait pour se faire enlever de ce poste,
situé à son goût beaucoup trop au milieu de la
Colonie, le projet qu'il avait formé dès la capitulation
de juin 1940, étant de passer la frontière et de
rejoindre la France Libre]. Il reçoit des observations
sévères et le Gouverneur de la Côte d'Ivoire le
fait muter à Touba, poste moins important, chef-lieu de la
région de Bafing, au nord-ouest du pays, mais proche de la
frontière avec la Guinée et non loin de celle avec le
Libéria.
-
8-10 décembre 1941 : Arrive à Man en camionnette,
prétextant une mission d'inspection à la frontière
pour repérer des points de passage de fuyards de Touba vers le
territoire de la Guinée, il se rend à M'zo, à
Danané (où il passe la nuit du 8 au 9), puis à
Ghouhouyé, puis en direction de Danipleu. N'étant pas
revenu le 10 au soir, son chauffeur et son interprète rejoignent
leur poste.
- 12
décembre 1941 : Le chef de subdivision de Danané est
informé que M. LAMBERT était passé au
Libéria [via la Guinée ?] et qu'il renvoyait les
clés du coffre de Touba « ne laissant ainsi aucun doute
sur ses intentions [de rejoindre les F.F.L.] ».
-
Après un emprisonnement de 15 jours au Libéria, traverse
à pied tout le Libéria et d'embarque à Monrovia.
- 19
janvier 1942 : Arrivé à Monrovia, Libéria, reçoit un
radio d'un correspondant (SICE) qui lui demande de se présenter
au Capitaine de Vilmorin pour être dirigé sur Pointe Noire
[Congo].
-
Février 1942 : Affecté à la mission des Forces
Françaises Libres d'Accra (Côte
de l'Or, aujourd'hui Ghana)
où il est chargé du bulletin d'information de la station
de Radio.
- 26
février 1942 : Lance un appel à Radio Accra. Cite
nommément tous les administrateurs qui collaborent avec les
boches, notamment en dirigeant l'exportation au profit de l'Allemagne
des principales productions agricoles de la Côte d'Ivoire, et
demande à tous ses camarades administrateurs de la Côte de
venir à leur tour rejoindre les Forces Françaises Libres.
Dans un autre appel extrêmement virulent à la radio,
stigmatise la « lâcheté allemande », la
« férocité des boches, ces brutes, ces
scientifiques du crime, ces organisateurs de massacres en série,
incapables d'un sentiment d'humanité » auxquels les
dirigeants de Vichy se trouvent associés.
- 28
février 1942 : Ordre de mission des Forces Françaises
Libres (Lagos, Nigeria) :
« à Monsieur Jean LAMBERT, Administrateur des Colonies,
rallié à la France Libre », de se rendre en Gold
Coast par les voies les plus rapides pour une mission de courte
durée. Dès son arrivée à Accra, il se
présentera au Chef de la Mission Française Libre de Gold
Coast, et se mettra à sa disposition pour lui fournir tous les
renseignements utiles »
- Vu
au passage à Accra, du 29 février au 4 mars 1942.
-
Avril 1942 : Demande à partir avec l'Armée Leclerc.
Affectation refusée. Est affecté au Tchad. Nommé (sous le
régime des Forces Française Libres) Administrateur de
2ème classe des Colonies, Chef du département du
Bas-Chari (chef-lieu : Fort-Lamy), Administrateur-maire de Fort-Lamy,
puis Chef du Département du Batha (Tchad). [On rappelle que le
Tchad a été le premier territoire africain à se
rallier à la France Libre : Le 26 août 1940, à la
mairie de Fort-Lamy, le gouverneur Félix Eboué proclame,
avec le colonel Marchand, commandant militaire du territoire, le
ralliement officiel du Tchad au général de Gaulle,
donnant ainsi « le signal de redressement de l'empire tout entier
» et une légitimité politique à la France
libre, jusqu'alors dépourvue de tout territoire. René
Pleven, envoyé du général de Gaulle assistait
à cette proclamation. Le 15 octobre Félix
Éboué reçoit de Gaulle à Fort-Lamy, qui va
le nommer, le 12 novembre, gouverneur général de
l'Afrique Équatoriale Française].
-
Octobre 1942 (ou 30 juillet 1942 ?) : André LATRILLE est
nommé Gouverneur du Tchad. Il prend ses fonctions lors du
départ de son prédécesseur, Pierre-Olivier LAPIE,
le 12 décembre suivant.
- 5
septembre 1942 à Dakar, Sénégal : le Tribunal
Militaire de Dakar qui, vu présomption de trahison pour avoir,
le 11 décembre 1941, « en temps de guerre, entretenu des
intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses
agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la
France, en quittant sans autorisation le territoire français
(Guinée française) pour se rallier aux troupes
dissidentes de l'ex-général de Gaulle en Libéria
», le condamne par contumace « à la peine de mort et
ordonne la confiscation au profit de la Nation, de tous ses biens
présents et à venir » [Ce jugement sera
annulé par arrêt du 8 novembre 1943 de la chambre de
révision en A.O.F. (application de l'ordonnance du 6 juillet
1943 portant légitimation des actes accomplis en faveur de la
libération de la France)].
-
Octobre 1942 : A un grave différend avec le Comité de
l'Eglise de Fort-Lamy (D'après courrier du 23 octobre accusant réception d'une lettre du 21 octobre).
-
Septembre 1943 : De retour en Côte
d'Ivoire et affecté au poste d'Administrateur, Chef de
cabinet de M. le Gouverneur de Côte d'Ivoire (d'après le
J.O.). Félicité par plusieurs anciens amis
indigènes de Touba. [André LATRILLE devient Gouverneur de Côte d'Ivoire le 5 novembre 1943].
- 5
juillet 1944 : Menacé de sanction (« d'être
relevé de son poste ») d'après
télégramme du Gouverneur LATRILLE qui évoque des
« faits qui lui sont reprochés », un «
jugement » et une possible « cabale par des
éléments douteux de Côte d'Ivoire ».
-
Télégramme de « Colonies Alger à Gougal
Dakar », du 29 juillet 1944. N° 1549 : « Solution
proposée me paraît bonne stop Ce qu'on reproche
essentiellement à LAMBERT est raideur excessive dans ses
rapports quotidiens avec Européens stop D'autre part je
n'entends pas que sa mutation paraisse être un désaveu de
la politique suivie par LATRILLE qui est celle voulue par gouvernement.
Dans ces conditions je n'ai pas objections au retour de LATRILLE
à Abidjan directement stop veuillez bien montrer ce
télégramme à LATRILLE.
- 4 janvier 1945 :
- 5
mars 1945 : Se trouve encore à Abidjan (d'après courrier
élogieux de l'un de ses anciens collaborateurs de Gagnoa).
- 26
mars 1945 : Écrit au Ministre des Colonies pour demander son
affectation au Corps expéditionnaire indochinois. Rappelle qu'il
a servi en 1918 en Macédoine au 10ème Bataillon
Indochinois ; qu'il a le grade de Médecin-auxiliaire de
réserve mais qu'il est volontaire pour servir dans n'importe
quelle arme avec n'importe quel grade ; qu'il serait heureux de pouvoir
participer à la libération de l'Indochine ;
qu'étant inscrit en tête de la deuxième liste de la
relève en A.O.F., il devrait quitter la Côte d'Ivoire dans
quelques semaines ; que son affectation au Corps expéditionnaire
d'Indochine ne diminuerait donc pas le nombre des Administrateurs en
service en Côte d'Ivoire. Demande transmise avec l'avis
très favorable du gouverneur LATRILLE, « preuve
supplémentaire de patriotisme fervent et agissant qu'a toujours
manifesté l'Administrateur LAMBERT ».
-
Avril 1945 : Est toujours Administrateur des Colonies et Chef du Bureau
des Affaires Sociales et Politiques à Abidjan. [C'est vers cette
époque qu'il rencontre et se lie d'amitié avec
Félix HOUPHOUËT (médecin, puis chef de village, puis
administrateur, puis planteur de caoutchouc, cacao, café et
syndicaliste agricole). HOUPHOUËT se présente aux
élections d'octobre 1945 pour devenir député de
Côte d'Ivoire au Parlement français. Jean LAMBERT le
conseille et l'aide à être élu [sous le nom de
HOUPHOUËT-BOIGNY - boigny, signifiant le bélier],
malgré des magouilles locales qui voulaient l'en empêcher.
HOUPHOUËT-BOIGNY vouera à Jean LAMBERT une amitié et
une reconnaissance indéfectibles].
- 25 avril 1945 : Départ en congé signalé dans une
lettre de reconnaissance des élèves-instituteurs de Dabou
(ville proche d'Abidjan) qui lui souhaitent « bonne
traversée ».
- 17
juillet 1945 : Décret du Gouvernement Provisoire de la
République Française (signé S. de GAULLE et P.
GIACOBBI) lui attribuant la Médaille de la Résistance
Française.
- 5
août 1945 : Le gouverneur LATRILLE écrit (c'est la 3e
fois) au Ministère des Colonies pour recommander Jean LAMBERT
« à une promotion au titre d'administrateur en chef avec
cote maximale et au très grand choix ». La demande n'est
pas acceptée.
- 7 août et 14
août 1945 : Ordres de Mission du Gouvernement Provisoire de la
République Française, Ministère des Colonies : lui
ordonne de se rendre depuis la Colonie de Côte d'Ivoire en
mission à Dijon (à sa résidence, 1 rue
Viollet-le-Duc) comme rapatrié sanitaire (ou en permission de
détente ?), seul, par voie aérienne et terrestre. Reprend sa carte du Parti communiste à Dijon.
-
Le Gouverneur Latrille doit être muté à peu
près à la même époque que Jean Lambert.
-
19 août 1945 : Félix Houphouët lui fait parvenir
depuis Abidjan une lettre manuscrite de 8 pages dans laquelle il lui
donne des nouvelles de la colonie, de son départ (« le
gouverneur Latrille et vous êtes regrettés »), de
ses détracteurs, de la préparation des élections
municipales et législatives. Il ne sait pas à
ce moment-là s'il va pouvoir se présenter aux
élections à la Constituante, n'étant pas citoyen
français. [En fait, dans la biographie de Félix
Houphouët, il est écrit : « En
octobre 1945, Houphouët est projeté sur la scène
politique ; le gouvernement français, décidé
à faire participer ses colonies à
l’assemblée constituante, organise l’élection
de deux députés en Côte d’Ivoire : l’un
représentant les colons, l’autre les autochtones.
Houphouët se présente et, grâce aux nombreux soutiens
qu’il a acquis par son action syndicale, est élu au
premier tour avec plus de 1 000 voix d’avance. Malgré
cette victoire, l’administration coloniale décide
d’organiser un second tour, le 4 novembre 1945, qu'il remporte
avec 12 980 voix sur 31 081 suffrages exprimés. Pour son
entrée en politique, il décide d’ajouter Boigny,
signifiant « bélier » (symbole de son rôle de
meneur) à son patronyme, devenant ainsi Félix
Houphouët-Boigny.]
- 21
mars 1946 : Le Chef du Service Colonial de Bordeaux lui accorde un
congé de convalescence de 3 mois, à Paris, 18 avenue des
Gobelins, avec effet du 21 novembre 1945 au 20 mars 1946.
- Avril 1946 : Retour en Côte
d’Ivoire comme Chef du Bureau des Affaires Politiques. C'est à cette
époque qu'il fait libérer 22 détenus à BOUAKE, ce qui donnera lieu (en
1948) à un courrier et à une demande de répondre à 5 questions
concernant les conditions dans lesquelles ont été effectuées ces
libérations conditionnelles ».
-
Juin 1946 : Toujours en Côte
d'Ivoire, en compagnie du Gouverneur LATRILLE.
Félicité par plusieurs anciens amis indigènes
Ivoiriens et Togolais.
- 10
juillet 1946 : En conférence dans le bureau du Gouverneur de la
Côte d'Ivoire (*), avec le Secrétaire Général,
le Président de la Coopérative des Planteurs Africains et
le Chef de Cabinet. Il s'oppose vigoureusement au Secrétaire
Général et au Chef des Affaires Économiques
à propos des parts importations. Ces derniers souhaitent
attribuer la totalité des parts d'importation à des
maisons de commerce, alors que Jean LAMBERT demande à ce que 25
% des importations soient attribués à des
coopératives de planteurs locaux. Devant la tournure que prend
la discussion et ne se sentant pas soutenu par le Gouverneur, il quitte
la réunion. Des récits plus ou moins fantaisistes de
cette réunion s'étant immédiatement
répandus dans Abidjan et risquant de dépasser le cadre de
la Côte d'Ivoire, Jean LAMBERT rédige dès le 11
juillet un compte-rendu détaillé (5 pages) «
des faits exacts alors qu’ils sont encore récents et
présents à la mémoire de tous » de la
conférence.
(*) Qui était gouverneur de la Côte d'Ivoire à ce moment-là ? On
sait [d'après sa biographie] qu'André LATRILLE
(1894-1987) quitte le Tchad le 5 novembre 1943 (où Jacques
ROGUÉ lui succède), pour la Côte d'Ivoire où
il demeure jusqu'en 1945 [il a été choisi à ce
poste par René PLEVEN, membre du Comité français
de la Libération nationale, après que l’AOF a
basculé dans le camp des Alliés, en remplacement de
Jean-François TOBY]. Il l'est à nouveau d'avril 1946 à
février 1947, en succédant à Henry De MAUDUIT. La
biographie d'Henry de MAUDUIT indique par ailleurs que celui-ci fut
« gouverneur de Côte d'Ivoire de 1945 à [avril]
1946, en remplacement d'André LATRILLE, puis de Mauritanie, puis
du Tchad de 1949 à 1951 ». Il est donc remplacé
à Abidjan en avril par André LATRILLE, à nouveau
nommé au même poste. Lors de la réunion du 10
juillet 1946, c'était donc André LATRILLE qui
était gouverneur de Côte d'Ivoire.
-
27 juillet 1946 : Le Secrétaire Général de la
Côte d'Ivoire Pierre DELTEIL écrit au Ministre de la
France d'Outre-Mer pour lui demander de bien vouloir le remplacer dans ses fonctions [en raison de l']'impossibilité dans laquelle [il se] trouve
de travailler en liaison avec l'Administrateur LAMBERT, Chef du Bureau
des Affaires Politiques (...).
- 18
mars 1947 : Passation de service et à transmission de toutes les
archives appartenant au Bureau des Affaires Politiques & Sociales
à Abidjan « entre M. Jean LAMBERT et M. Charles CLAVERIE,
Administrateur des Colonies, Chef du Bureau des Affaires Politiques
& Sociales, qui prend à la date de ce jour ses fonctions
».
- 30 mai 1947 : Affecté en Mauritanie.
« Le Haut Commissaire de la République du
Gouvernement Général de l’Afrique Occidentale
Française (…) décide : M. LAMBERT Jean,
Administrateur de 2° classe en service en Côte d’Ivoire
est mis à la disposition du Gouverneur de la Mauritanie ».
Signé R. BARTHES.
- 14
juin 1947 (depuis Saint-Louis) : Nommé Chef du Bureau du
Personnel et de l’Administration Générale.
- 14 août 1947 : Ordre de se rendre à Dakar en mission. Départ le 16 août 1947.
- 14
février et 8 juin 1948 : Se trouve à Saint-Louis (Sénégal).
- 17
mai 1948 : Courrier [mention SECRET] du Gouverneur
Général de l’A.O.F., l'invitant à
répondre à un questionnaire en 5 points concernant la
libération conditionnelle de 22 prisonniers en avril 1946 en
Côte d’Ivoire.
- 19
mai 1948 (de Saint-Louis du Sénégal) : Certificat de
déménagement : « Inventaire des bagages [en vue de
déplacement définitif] ».
- 24
mai 1948 (depuis Saint-Louis) : Dans un document manuscrit, il
répond, point par point, aux 5 questions du document qui lui a
été notifié par le Gouverneur de la Mauritanie.
- Retour en France (dans le courant du mois de juin 1948 ?) : C'est à cette époque que se situe la fin de sa
carrière. Il sera limogé en 1949 pour des raisons qui
n'apparaissant dans aucun document dont nous disposons, mais qui sont
très vraisemblablement liées à ses
idées politiques et pour avoir souvent pris le parti des
Indigènes contre les
Européens, qu'il s'agisse d'attribution de parts d'importation
aux planteurs africains (plutôt qu'aux maisons de commerce), de
libération de prisonniers en Côte d'Ivoire ou de
construction d'une église à Fort-Lamy.
- 30
juin 1948 : Totalise à ce moment-là 25 ans, 0 mois et 2
jours de services, dont 7 ans, 3 mois et 14 jours en France, et 17 ans,
8 mois et 18 jours en mer ou aux Colonies.
-
1948-1949 : Retour en France (sans doute pas à Dijon, car la
maison de son père - qui habite Nice depuis les années
1930 - avait déjà été vendue), mais
peut-être à Paris, quartier des Gobelins (?). Il se
trouve un certain temps sans salaire, ni retraite.
- Mars 1949 : Se trouve (ou est de passage) à Nice.
- 28
mars et 21 novembre 1949 : Décrets portant révocation de
M. LAMBERT Jean, Administrateur de 2° classe des Colonies, pour
compter du 1er avril 1949 [seront annulés par une
décision du Conseil d'État en date du 29 juillet 1953].
-
Février 1951 : Première mention de son adresse au
Beausset (Var). De 1951 à 1953 (d'après la datation de
ses livres), il évolue entre Le Beausset, Toulon et Nice (et
Marseille ? et Menton ?).
- 22
novembre 1953 : Atteint par la limite d'âge (55 ans).
- 15
octobre 1954 : Habite toujours route de Marseille, Le Beausset (Var).
Reçoit notification du décret du 4 août 1954
l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de
retraite pour ancienneté de services.
- 4
février 1955 : Vu la décision du Conseil d'État du
29 juillet 1953 annulant les décrets du 28 mars 1949 et du 21
novembre 1949 portant sa révocation, il lui est attribué
une indemnité en réparation du préjudice subi,
indemnité égale au montant des émoluments qu'il
aurait perçu s'il était resté en service dans la
Métropole, du 1er avril 1949 au 4 août 1954, soit
(…).
- Mai
1956 : Se trouve (ou est de passage) à Paris.
-
1956 : Achète un appartement à La Seyne-sur-Mer [seule municipalité communiste du
secteur de Toulon-Ouest] au 3e étage du 14 bis, boulevard
Staline.
-
1959 : Part en voyage seul en U.R.S.S., après avoir appris
quelques bases de la langue russe.
-
1960 : Décès de son père à Nice
(Alpes-Maritimes) où il s'était installé (avec sa
seconde épouse) auprès de sa fille Odette dans les
années 1930. (Sa seconde épouse était
décédée avant 1960).
-
1960 : HOUPHOUËT-BOIGNY devient Président de la Côte
d'Ivoire indépendante. Il va essayer de prendre des nouvelles de
Jean LAMBERT. Mais ce dernier était mort quand
l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France retrouve sa
trace. HOUPHOUËT-BOIGNY fait alors rechercher la famille de Jean
LAMBERT pour lui exprimer sa reconnaissance.
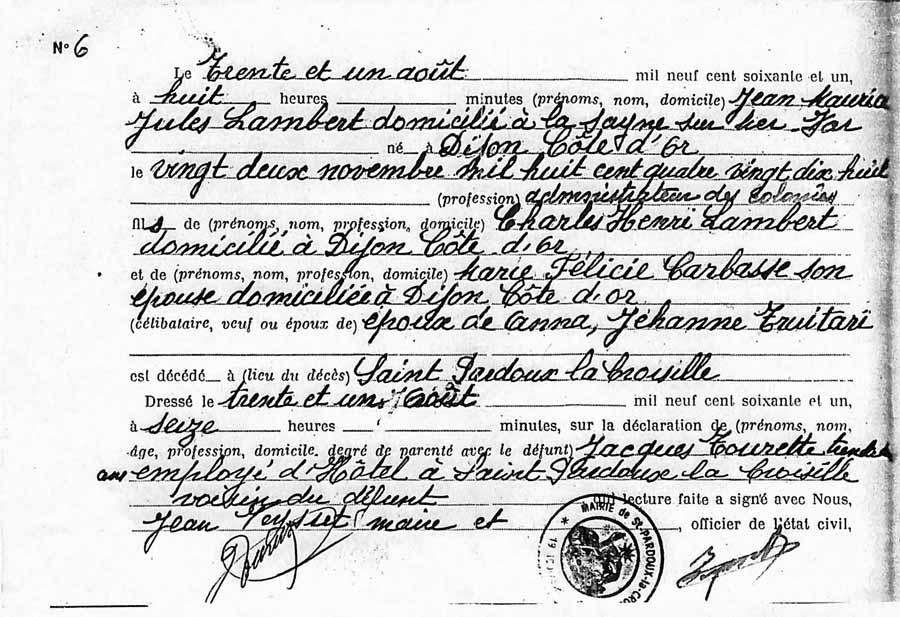 |
Acte de décès de Jean LAMBERT à Saint-Pardoux-la-Croisille le 31 août 1961
|
- 31 août 1961 : Décès à
Saint-Pardoux-la-Croisille (Corrèze) alors qu’il passait
ses vacances dans une pension de famille. Inhumation au
cimetière de Saint-Pardoux-la-Croisille, d’abord dans une
fosse commune, puis transféré dans une tombe que sa veuve
fera édifier.
- 8
juillet 1983 : Décès de sa sœur aînée,
Odette Pauline Thérèse LAMBERT, à Cantaron
(Alpes-Maritimes).
-
1989 : Décès (à Paris, Hôpital
Saint-Antoine) de son épouse Jeanne TRUITARD. Ses cendres sont
répandues au Jardin du Souvenir, au Père-Lachaise.
L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire assiste aux funérailles
sur la demande du Président Houphouët-Boigny, qui envoie
une énorme couronne de fleurs. C'est seulement par la suite que
sa fille fera apposer une plaque sur la tombe de son père
à Saint-Pardoux-la-Croisille (Corrèze) pour les
réunir dans le souvenir, mais elle n'a pas vraiment
été inhumée dans la même tombe.
R7. (5 octobre 2014, de Lynn, Massachusets)
Cher Jean-Claude,
Veuillez
m'excuser d'avoir tant tardé à vous répondre,
l'été est passé, je ne sais pas où et je
voulais consulter encore des documents avant de vosu écrire.
Merci
encore de m'avoir evoyé la chronologie de la vie de mon
père. Les choses se rectifient dans mon esprit avec les dates
qui se précisent. Alors que je croyais avoir vécu
plusieurs mois à Dijon entre mon père et ma mère,
je réalise qu'il s'agissait seulement d'un mois, car mon
père a été rapatrié en mai 1940, en
congé de maladie, et nous a quittés en juin 1940. Il
avait été évacué à l'hôpital
de Fort-Archambault le 5 février 1940. C'est peut-être
à ce moment-là que les indigènes lui ont
sauvé la vie en le transportant jour et nuit.
J'essaie
de répondre à vos questions. Le décès de Marie Félicie Carbasse Lambert, la mère de mon père,
a vraisemblablement eu lieu à Dijon, où ils demeuraient,
dans la maison que mon grand-père avait fait construire; mais je
n'ai pas de document précis.
L'hospitalisation
de mon père à Montpellier n'a eu lieu ni en
février 1938, ni en 1940. Elle serait postérieure
à son retour en France, mais je n'ai aucune date précise.
Ma
mère est décédée à Paris en 1989,
à l'hôpital Saint-Antoine, et ses cendres ont
été répandues au Jardin du Souvenir, au
Père-Lachaise. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire a
assisté aux funérailles sur la demande du
Président Houphouët-Boigny, qui a envoyé une
énorme couronne de fleurs. C'est seulement par la suite que j'ai
fait poser une plaque sur la tombe de mon père pour les
réunir dans le souvenir, mais elle n'a pas vraiment
été inhumée dans la même tombe.
Il
manque à coup sûr des documents sur ce qui s'est
passé dans la période de 1947. En définitive, il
ne semble pas que mon père ait été limogé
en 1947, mais en 1949. Il a été affecté en
Mauritanie entre ces deux dates. Vous trouverez ci-joint des documents
qui le prouvent. Je pense que les lettres concernant la
libération des jeunes gens vous intéresseront. Aurait-ce
été le prétexte de leur renvoi ? Il avait beaucoup
de détracteurs car il défendait les faibles contre les
puissants. Ainsi, il s'élevait contre les abus des
sociétés commerciales qui lésaient les planteurs
africains.
Un certificat de déménagement (copie ci-jointe)
avec un inventaire des bagages pour un déplacement
définitif est daté du 19 mai 1948. Cela aurait donc
marqué la fin de la carrière de mon père.
Les
raisons n'en apparaissent pas. Malheureusement, je n'ai pas
emporté tous les documents que maman avaient gardés
à La Seyne. Lorsque j'ai dû vider l'appartement,
très vite avant mon départ pour les Etats-Unis, je
n'avais plus de contact avec votre famille, et maman n'était
plus en état de participer.
Voilà,
cher Jean-Claude, le résultat de mes recherches. Je me perds
dans tout cela. Quant à l'histoire de l'église, je n'en
avais jamais entendu parler et elle me paraît bizarre. Les dates
ne semblent pas non plus correspondre avec le limogeage. Il n'est
jamais rentré en France entre 2 gendarmes !
(...)
sachez bien que je suis infiniment heureuse d'avoir l'occasion de me
pencher avec vous sur la vie de mon père et de savoir combien il
a été estimé et aimé.
Paule
Q8. (13 octobre 2014)
Bonjour Paule,
J’ai bien reçu vos deux derniers envois de documents
relatifs à la carrière de votre père. Je vous en
remercie beaucoup.
Bien des choses se sont en effet précisées peu à
peu - par rapport à ce que nous savions il y a un an à
peine.
Il est probable que plusieurs points obscurs vont subsister, soit parce
que certains documents ont disparu, soit parce que la mémoire
des souvenirs (que mon père avait recueillis et qu’il
m’avait transmis, il y a maintenant plusieurs décennies !)
a peut-être involontairement transformé les faits
d’origine. C’est probablement le cas de cette église
et de son renvoi “entre deux gendarmes” dont vous
n’avez jamais entendu parler. Peut-être que le jour
où votre père a conté cette histoire à mon
père, peut-il lui a-t-il dit tant de choses ce jour-là
que mon père à mélangé plusieurs souvenirs
différents (le lieu : Fort-Lamy ? [Un document fait bien
état d’un “grave différent avec le
comité de l’église de Fort-Lamy”] et aussi
car de Gaulle avait dit, je crois, “Monsieur le Maire” ; la
date ? 1942 ou 1944 ou ultérieurement ? : le renvoi entre deux
gendarmes ?? Peut-être qu’il ne s’agissait pas
d’un renvoi en France après la question de
l’église mais cela se rapportait-il à une autre
sanction (?) à une tout autre date ? Il faut certainement
être prudent avant de tirer des conclusions et cela va
certainement amener à rectifier la fiche biographique de votre
père, rédigée l’année dernière
(à partir des documents et souvenirs que nous avions à
l’époque) en vue du “Dictionnaire du Mouvement
Ouvrier et Social”.
Je vais examiner avec soin vos derniers documents et essayer de les
intégrer à la chronologie que j’avais essayé
d’établir et tenter de l’affiner encore un peu.
Toutefois, je ne vais pas avoir le temps d’examiner toutes ces
pièces à court terme car je suis actuellement très
pris par deux ou trois gros dossiers et conférences à
préparer. Je ne pourrai sans doute m’y mettre que
début novembre.
Je vous tiendrai au courant quand j’aurais pu vraiment m’y pencher.
Merci encore. Avec toutes mes amitiés.
Jean-Claude
R8. (18 octobre 2014)
Bonjour Jean-Claude,
Je viens de trouver votre message et vous en remercie. Je vous souhaite
bon courage pour tout ce que vous avez à faire. Ici l'automne
est flamboyant et la température est si douce que je vais de ce
pas sur la plage pour tenter une dernière (?) baignade dans
l'océan.
Bien amicalement,
Paule
Q9.
Chère Paule,
Deux
mois et demi ont passé depuis vos derniers envois de documents. J'ai
été encore plus occupé que prévu et c'est
seulement mi-décembre que j'ai pu me repencher sur la chronologie
de la vie de votre père.
J'ai
examiné soigneusement tous les documents que vous m'avez
adressés et j'ai été en effet extrêmement
intéressé par les courriers et questionnaires concernant
la libération des jeunes prisonniers de Bonaké
(Côte d'Ivoire), ainsi que par la transcription
détaillée des échanges relatifs à
l'attribution des parts d'importation aux coopératives de
planteurs locaux. Cette dernière affaire est
particulièrement significative de la cone de votre
père au cours de ses années d'Administrateur des Colonies
où il a chaque fois que possible défendu les
intérêts des Indigènes contre les abus des
Européens ou des maisons de commerce. Les derniers documents
éclairent aussi parfaitement la période 1946-1948 avec
son affectation en Mauritanie qui n'était pas apparue clairement
jusqu'ici. Mais cela explique pourquoi certains documents (ainsi que
plusieurs ouvrages annotés par votre père) portaient
l'adresse de Saint-Louis. Car à l'époque, c'était
Saint-Louis du Sénégal - capitale de l'AOF et du
Sénégal - qui était la capitale administrative de
la Mauritanie.
Vos
derniers documents ont donc permis de compléter et d'affiner la
chronologie que j'avais précédemment établie. Vous
trouverez ci-joint le nouveau document, qui inclut (en rouge) les
dernières modifications ou compléments. J'ai tenu
à y faire figurer in extenso les textes concernant la
libération des jeunes prisonniers et la réunion sur
l'attribution des parts d'exportations. Compte tenu de ces nouvelles informations, il
m'est également apparu nécessaire de rectifier la
biographie de votre père qui avait été
publiée sur mon site internet dans la rubrique "Dictionnaire du
Mouvement Ouvrier et Social Seynois" (projet de texte également
ci-joint). Je vais également demander à mon ami Jacques
Girault, qui en est le correspondant local, à ce que la
biographie soit également rectifiée sur le site national du Dictionnaire
du Mouvement Ouvrier. Je n'ai pas conservé l'histoire de
la mosquée de Fort-Lamy pour laquelle nous n'avons pas
d'élément historique valide qui serait venu étayer
le souvenir de mon père : je n'ai fait que parler de "grave
différend avec le comité de l'église de Fort-Lamy"
(qui se serait sans doute situé en 1942 et non en 1944 en
Côte d'Ivoire comme précédemment supposé).
Car
il apparaît de plus en plus probable que le "limogeage" de votre
père, acté en 1949, soit dû, non pas à un
coup d'éclat ponctuel, mais à la somme d'un ensemble
d'évènements ou d'actions qui résultaient des
idées qu'il avait défendues depuis toujours et qui, en
Afrique, ont consisté en son soutien affirmé aux populations locales,
aux faibles, aux opprimés, et sa lutte contre les abus des
Européens.
Naturellement,
si vous observez la moindre erreur ou anomalie dans cette
dernière version des textes, ou si certaines formulations ne
vous conviennent pas, n'hésitez pas à m'en faire part.
J'effectuerai alors les corrections que vous souhaitez.
Nous
voici déjà à la fin de cette année 2014. Je
suis heureux qu'en un peu plus d'un an nous ayons pu progresser de
façon très significative dans le décryptage de la
vie riche et complexe de votre père, bien que certains
aspectsrisquent de ne jamais être élucidés
totalement.
Je
vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 et espère
pouvoir continuer à échanger avec vous, qu'il s'agisse de
votre famille ou de tout autre sujet.
Avec mes amitiés, ainsi que ce celles de toute ma famille.
Jean-Claude
R9. (10 janvier 2015)
Cher Jean-Claude,
Voici
les documents mentionnés lors de notre dernière
communication téléphonique. Veuillez en excuser le
retard. Il me faut aller faire les photocopies à
l'extérieur et tout cela prend du temps.
J'espère
que vous avez un hiver agréable, ce qui est souvent le cas sur
la Côte d'Azur. Ici, malgré le soleil et la latitude
(celle de Rome), nous avons des jours très froids (-28° this
morning).
Merci
encore une fois de tout ce que vous avez fait pour les biographies de
mon père et merci de me les avoir communiquées.
Avec toutes mes amitiés
Paule
Q10.
Chère Paule,
J'espère
que vous traversé l'épisode de neige et de grand froid
qui a touché le nord est des Etats-Unis sans trop souffrir.
D'ici, nous avons vu des images impressionnantes et nous avons bien
pensé à vous. J'imagine que ce n'est toujours pas le
moment pour vous de sortir pour aller consulter vos messages à
la Bibliothèque. Et peut-être ne trouverez-vous celui-ci
qu'avec un peu de retard. Ici, dans le sud-est, nous avons eu
également quelques jours de froid (relatif) avec des
températures comprises entre +1° et + 9°, donc toujours
aucune gelée. S’il y a eu beaucoup de neige en
France, ce fut surtout dans le sud-ouest, les Pyrénées,
et naturellement le Jura et les Alpes. Mais rien sur la Côte
d’Azur, sinon de le pluie et du ciel gris.
Encore
un grand merci pour vos derniers documents. J'en ai pris connaissance
en détail et je les ai tous retranscrits pour les
intégrer à la liste chronologique des documents
biographiques précédents de votre père. Les deux
lettres signées de Félix Houphoët sont
extrêmement précieuses et permettent bien de comprendre la
situation en Côte d'Ivoire en 1945 et tous les aspects possibles
des conflits entre Colons et Indigènes. Il y a dans ces lettres,
à côté d'informations historiques, le détail
de combinaisons locales sordides - tout ce que votre père n'a
jamais pu supporter et ce qui a entraîné ses mutations
successives puis sa révocation - le tout raconté
par Houphouët avec une franchise émouvante. On comprend
mieux ainsi la situation que dans n'importe quel livre d'histoire. On
se situe alors au point de départ de l'engagement politique
national de Félix Houphouët, puisque (contrairement aux
doutes qu'il exprimait dans sa lettre quant à sa
possibilité d'être candidat), il sera élu.
Voilà d'ailleurs ce qu'on retrouve écrit dans l'une de
ses biographies :
«
En octobre 1945, Houphouët est projeté sur la scène
politique ; le gouvernement français, décidé
à faire participer ses colonies à
l’assemblée constituante, organise l’élection
de deux députés en Côte d’Ivoire : l’un
représentant les colons, l’autre les autochtones.
Houphouët se présente et, grâce aux nombreux soutiens
qu’il a acquis par son action syndicale, est élu au
premier tour avec plus de 1 000 voix d’avance. Malgré
cette victoire, l’administration coloniale décide
d’organiser un second tour, le 4 novembre 1945, qu'il remporte
avec 12 980 voix sur 31 081 suffrages exprimés. Pour son
entrée en politique, il décide d’ajouter Boigny,
signifiant « bélier » (symbole de son rôle de
meneur) à son patronyme, devenant ainsi Félix
Houphouët-Boigny. »
Et
je comprends qu'Houphouët, pour écrire ce qu'il
écrit, devait avoir une confiance totale en votre père et
qu'il lui vouera une reconnaissance indéfectible car tous deux
était parfaitement en phase sur l'appréhension de la
situation politique, économique et sociale locale. Ainsi
d'ailleurs qu'avec le gouverneur Latrille car ce dernier semble avoir
suivi une route proche de celle de votre père et a eu des
affectations et subi des mutations aux mêmes époques et
sans doute pour les mêmes raisons. Je n'ai cependant pas
retrouvé de preuve que Latrille était communiste. On
trouve dans l'une de ses biographies la chronologie suivante :
«
Le 5 novembre 1943, il quitte le Tchad, où Jacques Rogué
lui succède, pour la Côte d'Ivoire, où il demeure
jusqu'en 1945 ; il a été choisi à ce poste par
René Pleven, membre du Comité français de la
Libération nationale, après que l’AOF a
basculé dans le camp des Alliés, en remplacement de
Jean-Francois Toby. Il l'est à nouveau d'avril 1946 à
février 1947, en succédant à Henry De Mau. Un
boulevard d'Abidjan, situé dans le quartier de Cocody, le
Boulevard Latrille, porte son nom ».
J'en
déduis que, lors de la fameuse réunion du 10 juillet 1946
dans le bureau du Gouverneur, à Abidjan, c'était bien
Latrille qui était à ce poste. Sans doute était-il
dans une position difficile car, s'il partageait assez le point de vue
de votre père, il avait dû être obligé de
faire preuve d'un peu plus de souplesse face au Secrétaire
général et aux représentants des Colons, et il
avait semble-t-il essayé de calmer le jeu, contrairement
à votre père qui n'avait pas hésité
à aller au clash ce jour-là. Mais Latrille avait quand
même été muté à un autre poste en
1947, à peu près en même temps que votre
père. Mais je ne sais pas où Latrille avait poursuivi sa
carrière ou s'il avait été un jour aussi
révoqué. La biographie que j'ai ne le mentionne pas. Et
il a pourtant eu une longue vie ensuite puisqu'il est
décédé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
le 10 novembre 1987 à l'âge de 93 ans.
Un
dernier point : j'avais retrouvé il y a fort longtemps dans l'un
des ouvrages qui avait appartenu à votre père : Le poids
de l'Afrique (de Charles-Henri Favrod), un courrier qu'il avait
adressé à l'auteur et lui signalant que plusieurs
passages contenaient des erreurs flagrantes. Il y a aussi la
réponse et les excuses de l'auteur qui reconnaît que
certains de ses informateurs ont abusé de sa confiance et qui
écrit [on est en 1958] que
votre père « a gardé des ennemis virulents en
Côte d'Ivoire et aussi rue Oudinot [au Ministère des
Colonies] ». Ce qui est bien dans la logique de tout ce qu'on
savait déjà sur les relations entre votre père et
les Colons. Je vous adresse ces documents en pièces
attachées à ce message. (J'avais déjà
communiqué ces pages à Gérard Lambert lors des
premiers contacts que j'avais eus avec lui, mais il ne me semble pas
vous les avoir communiquées. On y trouve aussi quelques
compléments sur la chronologie du passage de votre père
au Tchad, ainsi que celui de Latrille au Tchad et en Côte
d'Ivoire).
Je
vous souhaite bonne réception de ces derniers documents et vous
dit : à une prochaine fois pour la poursuite de nos
échanges si intéressants et fructueux.
Amitiés.
Jean-Claude
Q11. (24 mars 2015)
Cher Monsieur,
Professeur émérite de l'Université
de Bourgogne en retraite depuis15 ans, je tente de ressortir de l'oubli
des Bourguignons et des universitaires qui sont vraiment rangés comme
des fossiles et que plus personne ne regarde. En ce moment je
m'intéresse à l'Esperanto et les dijonnais au début du 20ème siècle…
donc en particulier à Charles Lambert et je suis arrivé à votre site
familial où j'ai pu découvrir des renseignements très intéressants sur
Jean Lambert. Je peux vous apporter quelques compléments qui je pense
intéresseront sa petite-fille.
Aux Archives de la Mairie de Dijon, grâce à vos travaux :
J'ai eu ce matin l'acte de décès de
la grand mère paternelle de votre correspondante américaine à savoir :
le 11 octobre 1920 à Dijon au 1 rue Viollet-le-Duc. Je vais aller voir
sans doute demain si elle est enterrée au cimetière de Dijon.
J'ai pu avoir la date du second
mariage de son grand père le 25 octobre 1926 à Dijon avec une
tchécoslovaque Zdenka Krouzilkova,, Odette Lambert était l'un des
témoins. Charles Lambert s'était beaucoup intéressé à la création d'une
section tchèque au Lycée de Dijon.
D'autre part avec les archives
des Ardennes à Mouzon, j'ai pu en marge de l'acte de naissance de
Charles Lambert trouver la date de son décès à Nice le 30 juillet 1959
(il faudrait vérifier à Nice, ce que je n'ai pas encore fait) mais il y
avait aussi la date de son second mariage qui est bien celle de Dijon.
Voilà. Je pense que ces résultats vous apporteront des renseignements pour enlever des "blancs".
Je veux bien vous envoyer les copies
des actes de décès, de mariage et de naissance de Charles Lambert.,
ainsi que le texte que j'ai écrit (inachevé cependant) correspondant à
la carrière de Charles Lambert et ses différents travaux via internet.
J'avais, il y a plus de10 ans été consulter son dossier aux
Archives Nationales pour une exposition que j'avais faite au Centre
culturel de l'Université et j'ai ressorti mes documents pour un travail
que je fais sur les Bourguignons auteurs de dictionnaires ou grammaires
et Charles Lambert en fait partie.
J'ai trouvé aussi sur Internet en
cliquant Charles Lambert et espéranto , puis IPERNITY une photographie
dite de Charles Lambert mais je me méfie ! Pourriez-vous demander à sa
petite-fille si elle a une photographie de son grand père à moins que
vous en ayez une pour comparer.
Avez-vous des documents ou livres de Charles Lambert. dans l'héritage des livres de son fils?
Je tiens enfin à vous signaler que
je suis totalement bénévole et que vous pouvez avoir quelques
renseignements sur moi sur internet mais je n'ai pas de site personnel.
Je suis très content, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, lorsque
je fais découvrir à des petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui
était leur grand père … pour les grands-mères c'est plus difficile et
je n'en trouve pas beaucoup, la parité n'existait pas beaucoup au début
du 20ème siècle.!!!
Je me tiens donc à votre disposition
soit au téléphone : (...), soit par courriel (...), soit par lettre :(...)
Bien cordialement et de grandes félicitations pour tout votre travail sur la famille LAMBERT;
MP
R11.
Cher Monsieur,
Merci infiniment pour votre message et pour toutes les informations nouvelles que vous me communiquez sur Charles Lambert.
Je suis heureux que les éléments biographiques de mon site aient pu
vous être de quelque utilité, mais je tiens surtout à vous féliciter
pour l’œuvre très noble que vous avez entreprise dans le but de
ressortir de l’oubli la mémoire de nos grands universitaires tels que
fut Charles Lambert. Je n’avais sur Charles Lambert que des
informations fragmentaires provenant de son fils Jean (qui parlait peu
de son père et qui ne semble pas s’être rendu à ses obsèques à Nice) et
de sa petite-fille Paule qui avait un peu connu son grand-père
(davantage que son père d’ailleurs). J’avais noté que Charles Lambert
avait perdu sa première épouse, Marie Carbasse, vers 1922 (sans
certitude sur cette date) et s’était remarié par la suite (j’ignorais
que ce fut en 1926 et avec une tchécoslovaque – je ne suis pas certain
que sa petite-fille possède cette information). Il semble que Charles
Lambert ait vécu d’abord à Dijon avec sa seconde épouse et soit venu
s’établir à Nice auprès de sa fille Odette vers 1930 (date très
approximative) et que cette seconde épouse soit décédée avant lui.
J’avais noté, d’après une conversation avec Paule Lambert, que Charles
Lambert était décédé à Nice en 1960, donc quelques mois seulement avant
son fils Jean. Mais l’acte de décès porte bien la date du 30 janvier
1959. Cette date pourrait en effet être vérifiée avec l’état-civil de
Nice, mais il est possible que Paule Lambert ne se soit plus souvenue à
un an près de l’année exacte de décès de son grand-père.
Vous avez pu voir, d’après la reconstitution que j’ai tenté de faire,
du parcours de Jean Lambert et de celui de sa famille, qu’on a affaire
à des personnages d’exception, mais d’une nature difficile à décrypter
et qui n’ont cessé d’entretenir des relations complexes (pour des
raisons qui ne nous sont pas entièrement connues), particulièrement
entre Jean Lambert, son père, sa belle-mère, son épouse, et sa fille
Paule qu’il n’a pratiquement pas connue.
J’ai pu retrouver l’acte de naissance de Charles Lambert dans les
archives des Ardennes en ligne. Mais je serais intéressé de recevoir
les copies des actes de son mariage et de son décès, ainsi que le texte
que vous avez écrit sur lui. Je vous en remercie par avance. Je suis
certain que Paule Lambert (82 ans, vit maintenant près de Boston) sera
vivement intéressée par ces nouvelles précisions sur sa famille,
d’autant plus qu’elle n’a que peu connu ses ascendants et qu’elle se
raccroche aujourd’hui au moindre détail qui peut les concerner et qui
peut l’aider à mieux se les représenter.
Sur le site http://www.ipernity.com,
j’ai bien retrouvé une photo de Charles Lambert qui, bien que la date
de décès (1943) soit erronée, me paraît présenter une ressemblance avec
son fils Jean lorsqu’il était jeune (vers 1929-1930). Je vais aussi
faire parvenir cette photo à Paule Lambert et je pense qu’elle sera en
mesure de dire s’il s’agit ou non de son grand-père.
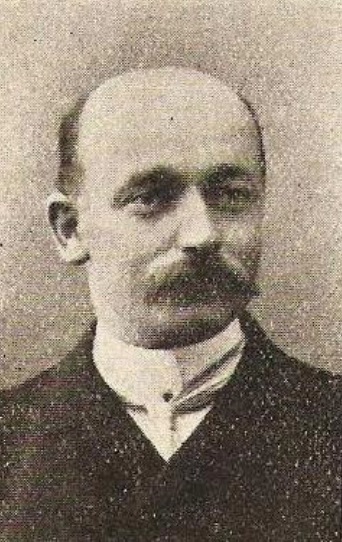 |
A
la question de savoir si j’ai conservé des documents ou livre ayant
appartenu à Charles Lambert dans l’héritage de son fils, la réponse est
oui. Ce dont je suis certain c’est : le Grand Dictionnaire Universel de
Pierre Larousse du XIXe siècle en 16 volumes, datés respectivement de
1867 (tome 1) à 1877 (tome 16, supplément), ainsi qu’un Littré en 4
volumes (1874 à 1878). D’autres ouvrages anciens nous sont venus de
Jean Lambert, mais je n’ai pas la certitude qu’ils provenaient de la
bibliothèque de son père, par exemple le traité de géographie physique
de De Martonne (1929), un recueil de poésies lyriques de Goethe et
Schiller (1909), la vie et les travaux des savants modernes (1904),
etc. Je vérifierai à l’occasion si certains de ces livres ne
porteraient une marque ou une signature de Charles Lambert [Jean
Lambert, lui, marquait souvent ses livres de ses initiales JL, avec la
date et le lieu d’acquisition – j’en ai plusieurs centaines qui sont
ainsi marqués].
Je suis, moi aussi, entièrement bénévole. Mon site et toutes les
informations qu’il contient sont d’un accès gratuit, sans aucune
publicité, et sont à la disposition de tous. J’ai été moi aussi très
heureux de retrouver, grâce à ce genre de “bouteilles jetées à la mer”,
plusieurs anciens amis et même parents éloignés, et de mettre en
communication entre elles des personnes qui s’étaient perdues de vue et
qui cherchaient à renouer contact.
Je reste, moi aussi, à votre disposition. Je vous tiendrai au courant
des réactions et des réponses de Paule Lambert à ces nouvelles
informations que j’imagine tout à fait inattendues et inespérées pour
elle.
Bien cordialement,
Jean-Claude Autran
Q12. (28 mars 2015)
Voici
une première version (inachevée) de l'article sur Charles Lambert (pas
terminée j'espère) car il y a quand même un blanc entre 1926
(second mariage) et sa retraite en 1936 puis le blanc absolu entre 1936
et 1959 ! je n'ai rien trouvé à ce jour. Il faudrait peut-être voir
avec Nice et une éventuelle possibilité auprès des espérantistes de
Nice (s'il y en a) ou dans l'entourage de sa fille… mais peut-on encore
avoir des contacts. Etait-elle connue où elle est décédée ?
Je vais essayer de voir auprès du Musée de l'Espéranto de Gray mais je pense avoir peu de chances.
Je rêve peut-être mais il me semble avoir lu un jour que Charles
Lambert n'était pas très facile de caractère !!!! J'ai peut-être rêvé
puisqu'il avait été doyen donc assez convivial. Il faut dire que le
décès de son fils puis de sa première épouse n' a pas dû favoriser la
sérénité ! Je n'ai rien trouvé sur sa nouvelle épouse tchèque. La
documentation sur les tchèques à Dijon ne m' a rien apporté. Il n'y a
pas de descendant a priori pour Charles Méray, donc rien de ce côté.
Les publications de Charles Lambert s'arrêtent en 1908 !!! Les papiers
de l'Université sont quasi inexistants et pour les Archives Nationales
consultées il y a bien longtemps je ne me rappelle que de ce que j'ai
écrit dans la notice. Peut-être avez -vous des "papiers" de Charles
Lambert pour nous éclairer (livres par exemple, copies d'articles).
Personnellement à la Bibliothèque de l'Université il n'y a que les
ouvrages et articles que j'ai indiqués.
Vous pouvez bien entendu envoyer copie de mon texte à sa petite fille
mais il ne faut pas le diffuser en dehors de ce cercle restreint tant
qu'il n'est pas terminé puisque je pense le mettre dans un ouvrage en
cours sur les" Bourguignons et les dictionnaires et grammaires…" qui
devrait paraître l'an prochain et ensuite je n'ai relu rapidement mon
texte que sur écran et pas sur papier… ce qui est indispensable !!! et
j'espère que d'ci là je pourrai le compléter un peu.
Je reste à votre disposition…mais je vous ai pratiquement dit tout ce que je sais sur Charles Lambert.
Encore un grand merci pour votre aide et bien cordialement.
MP
Vous pouvez donner mes coordonnées à la petite fille.
R12. (4 avril 2015)
Cher Monsieur,
Encore un grand merci pour toutes les informations que vous m’avez
communiquées sur Charles LAMBERT et que j’ai transmises à sa
petite-fille, Paule LAMBERT qui vit à Boston.
Celle-ci n’ayant pas d’informatique chez elle, ne consulte sa
messagerie que de temps à autre à la bibliothèque municipale. Ce qui
explique qu’elle n’en a pris connaissance qu’hier. Elle m’a aussitôt
téléphoné pour en accuser réception et me demander de vous exprimer
toute sa gratitude pour avoir effectué cette si précieuse recherche sur
son grand-père, recherche qui lui a apporté de nombreux éléments
nouveaux pour elle.
Elle confirme que la photo du site IPERNITY est bien celle de Charles LAMBERT.
Je lui ai communiqué vos coordonnées et elle m’a dit vouloir vous
appeler prochainement pour parler avec vous de son grand-père.
Peut-être l’a-t-elle déjà fait.
Encore merci pour tout.
Bien cordialement.
Jean-Claude AUTRAN
Q13.
J'ai
bien reçu votre courriel et je vous remercie de faire le lien entre la
France et les Etats- Unis. Je n' ai pas eu de contacts tėlėphoniques
car nous sommes en ce moment à Nantes avant de rejoindre la
Bretagne du nord (Erquy) pour une dizaine de jours pour retourner
ensuite en Bourgogne et me replonger dans les esperantistes
bourguignons et essayer de voir ce qu'est devenu Charles Lambert entre
1936 (sa retraite) et son décès !
Vous savez qu'Il faut être patient dans ce type de recherche et que des solutions arrivent quand on pense ne plus en trouver !
Bien cordialement.
Michel Pauty
Biographie de Charles Lambert, père de Jean Lambert
R11. (26 janvier 2016)
Cher Monsieur,
Un grand merci pour votre petit mot accompagnant la biographie de Charles Lambert que vous avez bien voulu m’adresser.
J’ai beaucoup apprécié la précision historique de son contenu et la qualité de sa présentation illustrée.
Je suis heureux si j’ai pu vous
aider un peu, notamment grâce au contact établi avec Paule Lambert,
dans la finalisation de ce très beau document.
Bien cordialement.
Jean-Claude Autran
La famille GAUTRAY
J’ai
connu cette famille, amie de mes parents, à partir de la fin des
années
40 et pendant seulement 6-7 ans puisqu’ils quittèrent
définitivement La
Seyne vers 1955. Mais j’en conserve des souvenirs très
précis et
surtout attristés après le très grand malheur qui
les frappa en 1957.
J’ai
connu le père, René GAUTRAY, né en 1905 ; la
mère, Simone GAUTRAY, née
MIGET en 1914 ; leur fille unique, Danièle,
née en 1939
; la grand-mère Jeanne MIGET, née en 1884.
C’était vers 1948 environ.
Ils habitaient alors Mar-Vivo, dans le quartier de mon
grand-père Simon
AUTRAN, et cela nous donnait l’occasion de nous rencontrer, avec
mon
grand-père, qui les connaissait bien.
Le père, René GAUTRAY, je
ne connaissais pas sa profession à l’époque. Ce
n’est que, bien plus
tard, en explorant le recensement de La Seyne de 1954 que
j’appris
qu’il était « démarcheur en appareils
à gaz ». C’était un homme de
taille moyenne, brun, plutôt mince, et portant, je crois, des
lunettes. Je ne
me rendais pas compte qu’il avait une dizaine
d’années de plus que son
épouse. Dans mes souvenirs, il paraissait encore jeune quand ils
quittèrent La Seyne, alors qu’il avait la cinquantaine, ce
qui aurait
dû le faire apparaître, à l’enfant que
j’étais, comme un « vieux ».
Recensement de 1954, brd 4septembre prolongé
|
Gautray René 1905
démarcheur en appareils à gaz
Simone 1914 professeur technique
Danielle 1939
Jeanne Miget 1884 |
La
mère, Simone GAUTRAY, je l’ai rencontrée beaucoup
plus souvent car elle
était collègue de travail de ma mère, au
collège Curie, à partir du
moment où ils arrivèrent à La Seyne (1947). Cette
femme était, je
crois, légèrement corpulente, avec un très beau
visage et une belle chevelure blonde. Elle était
aussi une proche de mon père car elle était militante au
Parti
Communiste, et elle fut d’ailleurs brièvement
conseillère municipale
sur la liste de Toussaint MERLE.
J’étais naturellement très
timide à l’époque et toute personne
étrangère à mes parents m’effrayait
et me paralysait. Je refusais toujours d’ouvrir la bouche pour
prononcer le moindre mot, et préférais disparaître
ou me cacher plutôt
que d’avoir à dire bonjour à quelqu’un... Une
fois, sans doute à
l’occasion de fêtes d’été aux
Sablettes, nous étions, mes parents et
mon grand-père, accoudés à un mur du
côté de la plage. La famille
GAUTRAY arriva. Mon grand-père les salua et, voulant que je les
salue
aussi, me dit : « Tu les connais bien ces personnes ? ». Je
préférai
alors détourner la tête en disant : « Non, non, je
ne les connais
pas du tout... ». Je me souviens que cette histoire fut ensuite
maintes fois
racontée par Madame GAUTRAY, pour illustrer ce côté
amusant de mon
extrême timidité, auprès de différentes
collègues du Collège Curie.
Sur
la carrière de Madame GAUTRAY, on dispose de davantage
d’éléments grâce
aux biographies des enseignants seynois rédigées par
Jacques GIRAULT en
2008 :
« GAUTRAY Simone, Germaine,
née MIGUET*, née le 26 mars 1914 à Dijon
(Côte-d'Or).
*
Nous appelions sa mère Madame MIGET, et le recensement de
1954 indique
bien Jeanne MIGET, née en 1884.
On trouve aussi le patronyme MIGET dans les actes de naissances de
1882-1891 à Dijon, mais pas de patronyme MIGUET.
«
Son père était employé aux chemins de fer.
Après avoir obtenu le
Certificat d'aptitude professionnelle et le brevet industriel (1929),
Simone MIGUET fut reçue au diplôme national de PTA
[Professeur Technique Adjoint].
« Elle se maria
en juin 1932 à Dijon avec un employé de commerce devenu
démarcheur en
appareils à gaz. Le couple eut une fille en 1939.
« Simone GAUTRAY
enseigna comme PTA auxiliaire de couture-lingerie au collège
technique
de Lisieux (Calvados) de décembre 1942 à octobre 1945,
puis comme PTA à
l'Ecole nationale professionnelle de jeunes filles La Martinière
à Lyon
jusqu'en 1947. Elle fut alors mutée au collège commercial
et technique
Curie à La Seyne. Le couple habita le quartier de Mar-Vivo, puis
se
rapprocha du collège et vint demeurer boulevard du 4 Septembre
».
Plusieurs
fois, nous étions allés chez les GAUTRAY, dans leur
maison entourée de
pins appelée « Les Diablotins » (je pense
qu’ils n’étaient que
locataires) située à l’intérieur de
l’épingle à cheveux que fait la
montée du boulevard de La Verne avec le début du chemin
de Mar-Vivo à
La Verne, à 150 mètres de la mer environ. Cette maison
existe
encore le même nom y est encore écrit sur un pilier
du portillon.
Elle ne semble pas avoir beaucoup
changé depuis que je l’ai connue à la fin des
années 40, sauf la façade
qui était plus nettement jaune autrefois.
 |
 |
La maison habitée par la
famille GAUTRAY entre 1947 et 1952 environ,
telle qu'elle apparaît de nos jours (2008) |
La maison se nomme toujours
« Les Diablotins » |
Une
ou plusieurs fois, en été, nous avions dîné
et passé la soirée chez
eux. Je m’amusais alors avec Danièle, de 5 ans mon
aînée. Nous étions tous deux enfants uniques. De
leur
terrasse, la vue s’étendait sur la rade de Toulon et
sur les
collines l’entourant. Une fois, nous avions assisté, de
très loin (mais
nous en avions néanmoins été effrayés) au
grand incendie qui avait
ravagé la pinède se trouvant encore sur les pentes sud et
sud-est du
Mont Caume. Etait-ce en 1950 ou 1951 ? Les pompiers avaient, je crois,
réussi à circonscrire cet incendie, mais j’ai
encore en mémoire,
la nuit venue, les images de points rougeoyants espacés qui
subsistaient sur les pentes du Mont Caume et qui formaient curieusement
un « secteur semi-circulaire » (que je comparais à
la pièce à trous du
même nom que j’avais dans mon meccano). Nos parents
devaient évoquer le
courage des pompiers et les risques qu’ils prenaient sur les
pentes en
feu, car je me souviens que Danièle ajoutait son commentaire :
«
pauvres gens... ».
Nous avions
également reçu la famille GAUTRAY une fois dans notre
propriété du quartier
Bastian. C’était il me semble à l’occasion
d’un retour (à pied) le soir
de la fête annuelle du P.C. à Janas, au mois de mai 1950
ou 1951. Je vois encore M.
GAUTRAY et mon père franchissant l’ancien petit portail de
la
propriété. Et même que M. GAUTRAY expliquait
à mon père un problème de
taille-crayon et qu’il faisait avec la main le geste du crayon
qu’on
fait tourner pour le tailler. Allez savoir pourquoi ce sujet de
conversation ? Et pourquoi l'ai-je mémorisé ?
C’est à cette époque que Simone GAUTRAY, qui
militait déjà à l'Union des Femmes
Françaises et au Parti Communiste,
s’était impliquée dans la vie municipale seynoise.
Lors des
élections générales consécutives à
l'érection de Saint-Mandrier,
candidate sur la « Liste d'Union Républicaine et
Résistante et de
Défense des Intérêts Communaux »
présentée par le P.C., elle fut élue
conseillère municipale le 18 juin 1950. Elle entra donc au
conseil
municipal de La Seyne (donc en même temps que mon père).
Mais elle ne termina pas
son mandat : elle démissionna en 1952. Ce n’était
pas parce que la
famille quittait La Seyne, car c’était environ 2-3 ans
auparavant. Il y
avait dû y avoir quelque problème politique ou personnel,
peut-être
avec Toussaint MERLE. Je ne saurais pas le dire. Naturellement, Simone
GAUTRAY, comme beaucoup de membres de l’équipe MERLE,
avait fait
l’objet de critiques de la part de leurs adversaires, critiques
régulièrement rapportées par
République, Le Provençal ou
Le Méridional,
notamment sous la plume d’Albert LAMARQUE et surtout
d’Henri MIDON. On
trouve ainsi la phrase : « des citoyens russes, « Cocomerle
», Autran et la « Cocotte » Simone Gautray ».
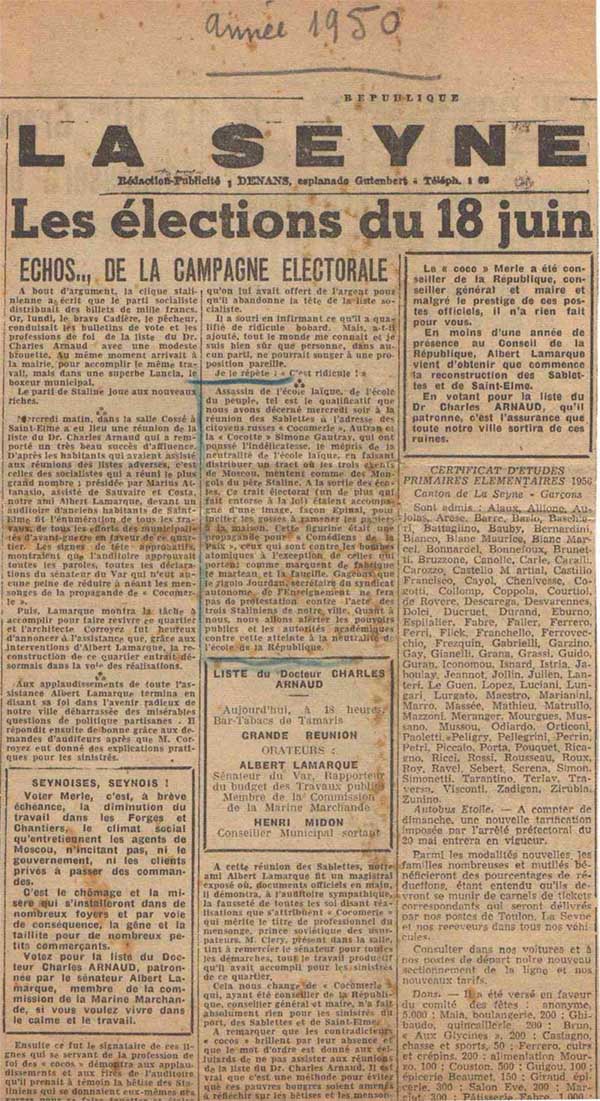 |
| Extrait du journal République,
Juin 1950 |
Le journal
République,
qui soutenait la minorité socialiste SFIO, le 12 juillet 1951,
dans un
article titré
Veritas,
l'accusa aussi de délaisser son enseignement,
précisant qu'au dernier CAP, sur 23 élèves
présentées, toutes avaient
été recalées et commentait «
qu'en pensent les papas et les mamans qui
payent pour cette maîtresse si remarquable ? ».
Aussitôt ses collègues
réagirent et le 15, un article de mise au point, signé de
la directrice
et du personnel de Curie, précisait qu'avec ce «
professeur de couture
dévouée et consciencieuse », sur les deux
CAP préparés, sur 19
présentées, 6 avaient été reçues au
premier et 14 au second.
Vers 1951 ou 1952, les GAUTRAY quittèrent
Mar-Vivo, sans doute pour se rapprocher du Collège Curie. Ils
vinrent
habiter tout près de chez nous, boulevard du 4 Septembre
prolongé
(devenu ensuite boulevard Staline, et actuellement boulevard de
Stalingrad), dans un immeuble de 3 étages, à
base carrée, situé face à l’actuel marchand
de journaux du square
Etienne Gueirard. Ils habitaient le dernier étage. On se voyait
donc
plus souvent. Ce n’est que de cette
époque que je garde le souvenir de la grand-mère, Madame
MIGET. Je ne
sais pas si elle était venue avec sa fille dès les
débuts à La Seyne où
si, veuve, elle était venue les rejoindre plus tard. Ma
grand-mère
avait sympathisé avec elle car elles étaient de la
même génération. Je
me souviens d’une chatte qu’elle gardait dans
l’appartement. Cette
chatte n'était descendue dans la rue que le matin et le soir. Je
me
souviens que
Mme MIGET avait dit à ma grand-mère, qui s'en
étonnait : « mais elle
peut rester tout le jour sans pisser ». On m’avait
raconté aussi que
les cloches de Pâques (1952 ?) avaient apporté une
bicyclette à
Danièle. J’allais quelquefois jouer avec elle. Je me
souviens d’une
sorte de jeu de sept familles avec des œuvres d’art. Une
fois, il me
manquait uniquement « La Joconde » pour terminer ma
famille. A chaque tirage de Danièle, je lui demandais
: « La Joconde » et jamais je ne l’obtenais...
En
1955, la famille quitta La Seyne pour s’établir à
Orléans. Pourquoi ?
Je ne le sais plus. M. GAUTRAY avait-il perdu son emploi à La
Seyne ?
Avait-il prévu de revenir un jour dans sa région
d’origine ?? (Je ne
sais pas d'ailleurs s'il était originaire d'Orléans).
D’après la
biographie rédigée par Jacques GIRAULT : « Pour
suivre son mari, Simone
GAUTRAY obtint un poste au collège technique d'Orléans en
octobre 1955
». Danièle avait alors 16 ans.
Quelques mois plus tard, un
courrier nous donnait de leurs nouvelles. Ma mère l’ouvrit
et le lut à
haute voix. Tout allait bien dans l’ensemble pour eux,
jusqu’à arriver
à la phrase : « Nous avons perdu Maman ». « Oh
! », s’exclama tristement ma mère.
Et j'entends encore ma grand-mère : « Oh ! Madame MIGET !
».
Le
temps passa encore. Nous habitions toujours au n° 9 du boulevard
Staline. Jusqu’à ce qu’un jour de mars 1957, je
rentrai de
l’école, j’ouvris la porte et j’entendis ma
grand-mère et ma mère qui
avaient, debout dans le séjour, une conversation inhabituelle.
L’une
d’elles dit : « c’est un gros malheur ». Et ma
grand-mère m’annonça : « Danièle
GAUTRAY est morte ». Je restai muet.
J’avais 13 ans, je ne réalisai peut-être pas
totalement, comme je le
réaliserai par la suite au fil des années, pensant
toujours à cette
famille, et aujourd’hui encore.
Je me souviens encore d’un
commentaire que fit ma mère : « Je ne crois pas que Mme
GAUTRAY puisse
maintenant mettre au monde un autre enfant (née en 1914, elle
avait alors 43
ans).
Que s’était-il passé ? Mes parents avaient
appris
le décès
par des amis qui étaient aussi très liés aux
GAUTRAY et qui avaient
gardé des contacts plus étroits que nous. Danièle
avait eu au cours
des derniers mois des saignements. Du sang se retrouvait
fréquemment
dans ses selles. On parlerait peut-être aujourd’hui
d’un cancer du
côlon ? Elle avait été opérée
(très probablement à Orléans) mais sans
doute trop tard, ou alors la maladie avait progressé de
façon tellement
massive que son état était
désespéré. On avait dit qu’on lui avait
retiré tout l’intestin (?). Ce à quoi le docteur
seynois Georges
RICHARD, à qui on avait raconté ce drame, avait dit :
« impossible, une
partie de l’intestin seulement ». A l’issue de
l’opération, la
température de Danièle était montée
à 43°. On avait dit (c’est ce que
j’ai retenu) qu’elle avait été placée
dans de la glace pour refroidir
le corps. Ses parents l’avaient encore vue au travers de la
glace. Mais
elle n’avait pas survécu très longtemps. Elle
mourut le 5 mars 1957 à
Orléans.
J’imagine
que mes parents avaient dû écrire à M. et Mme
GAUTRAY. Je ne sais pas ce qu’ils avaient pu leur dire, quel
encouragement à poursuivre leur existence avaient-ils pu leur
prodiguer
? Probablement
une référence au fait qu’ils avaient eux aussi
perdu un enfant, le
petit Robert, bien plus jeune il est vrai, à l’âge
de 3 ans.
Quelques
semaines plus tard, nous avions reçu une photo de
Danièle, âgée de 17
ans, prise à Orléans quelques mois avant sa mort. Un
très beau visage,
ressemblant beaucoup à celui de sa mère, dont je n'ai
aucune photo,
seulement le souvenir. Et aussi une carte
avec un poème recopié de la main de Mme GAUTRAY.
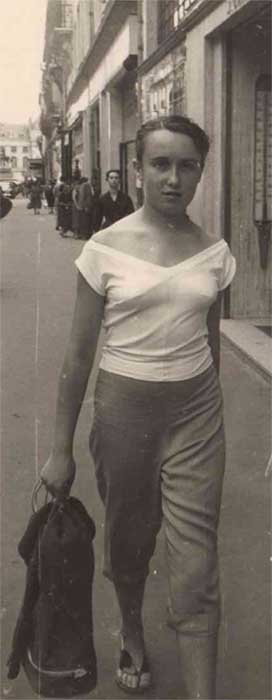 |
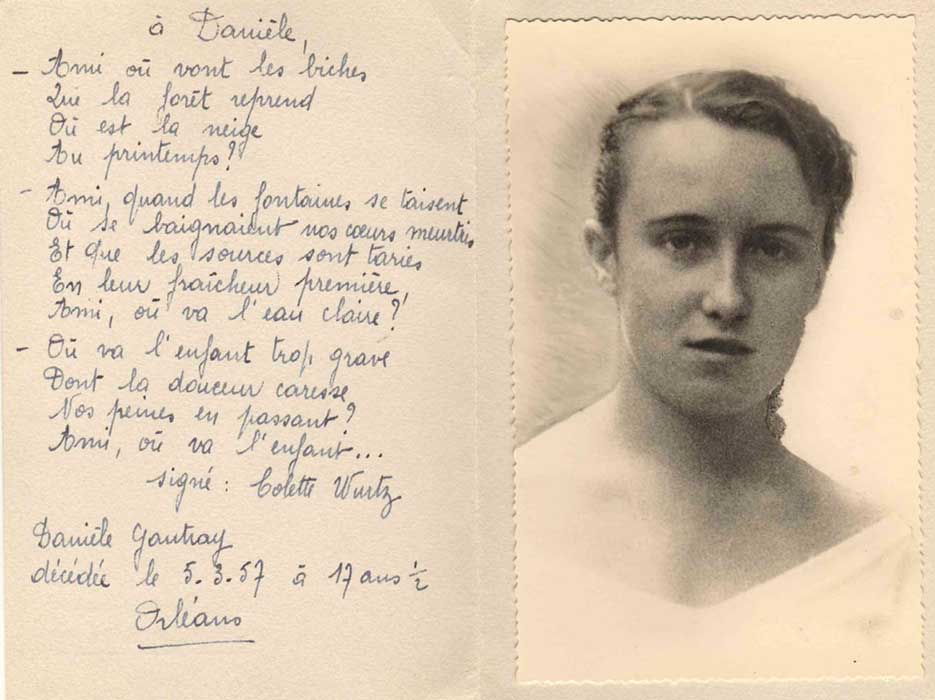 |
| Danièle GAUTRAY, Juillet
1956, 17 ans |
Poème
de Colette WURTZ, recopié de la main de Simone GAUTRAY,
mère de Danièle, décédée le 5 Mars
1957 à Orléans |
A ma
connaissance, il n’y eut plus jamais aucun contact avec mes
parents.
Nous avions eu, je crois, de loin en loin, quelques nouvelles par des
amis seynois. Mais je ne me souviens plus de ce qui avait
été dit à
propos du devenir du couple GAUTRAY. Nous passâmes une seule fois
à
Orléans, je crois de retour d’un voyage à Paris,
début septembre 1960.
Nous avions pensé à eux. Mais mes parents avaient-ils
leur adresse ? Et
avaient-ils le désir de revoir les GAUTRAY après ce drame
?
Plus
rien ensuite. D’après la biographie écrite par
Jacques GIRAULT, « le
couple habitait Fleury-les-Aubrais au milieu des années 1970
».
M.
GAUTRAY, qui aurait près de 105 ans aujourd’hui est
très certainement
décédé. Je n’ai pu faire encore aucune
recherche à ce sujet,
l’état-civil du Loiret n’étant pas encore en
ligne, et celui de la Côte
d’Or s’arrêtant à 1902. Mme GAUTRAY avait
été donnée décédée dans les
relevés des anciens élus seynois effectués par M.
Francisque LUMINET en
2007. Mais les recherches de Jacques GIRAULT dans
l’état-civil de Dijon
indiquèrent qu’en novembre 2008, aucune mention de
décès n’était faite
sur son acte de naissance. Aujourd’hui, elle aurait donc
près de
96 ans, mais, d’après l’annuaire, elle
n’habiterait plus le Loiret.
Je
ne sais rien de plus. J’ignore si M. et Mme GAUTRAY avaient des
frères
ou des sœurs. Si cela était le cas, il y aurait donc des
cousins et
cousines (et leurs descendants) de Danièle GAUTRAY, qui
peut-être un
jour trouveront ce texte, reconstitué à partir de mes
propres souvenirs d'enfant, et la photo de Danièle.
Jean-Claude AUTRAN
28 décembre 2009
La famille SAVART
Cette
famille, qui n'a jamais cessé d'habiter le département de
la Marne, est
devenue, par les hasards de la guerre de 1939-1940, une famille amie de
la nôtre. A cause de l'éloignement, nos rencontres ne
furent que très
rares, mais pourtant, vu notre attachement respectif, les contacts se
maintiendront pendant plus de 30 ans, essentiellement par courrier. Si
ma mémoire est bonne, mon père ne rencontra les SAVART
que 4 fois dans
sa vie (1939, ≈1945, 1956 et 1957), ma mère et ma
grand-mère 2 fois
seulement (1956 et 1957), et moi-même 3 fois (1956, 1957 et 1966).
Les
hasards de la guerre, c'est à l'origine le passage du
régiment auquel
appartenait mon père (3e Régiment d'Infanterie Alpine)
dans la Marne,
notamment dans le secteur de l'Argonne. La compagnie de mon père
s'installa pendant quelques semaines dans le petit village de Charmont
(arrondissement de). Mon père, et quelques autres officiers, fut
logé
dans une famille de ce village, les SAVART précisément.
Dans ce
contexte de la guerre, l'intendance devait repérer à
l'avance un
certain nombre de maisons pour y loger ses hommes et mon père et
ses
camarades officiers se présenta donc un jour chez les SAVART
avec son «
billet de logement » et tous furent logés dans les
pièces disponibles
de la maison que l'armée avait en quelque sorte
réquisitionnées. A
noter que le 3e RIA étant composé de militaires du
Sud-Est, les
SAVART furent surpris de voir tous ces hommes à la peau
plutôt
foncée ou bronzée, et Mme SAVART avouera par la
suite qu'elle
les avait pris, de prime abord, pour une bande de Marocains... Les
habitants de la Marne, qui ne voyaient pas souvent le soleil et qui,
à
l'époque, ne devaient avoir ni l'occasion ni l'habitude de se
faire
bronzer, étaient des gens à peau très blanche, par
rapport aux
Méditerranéens...
Marius AUTRAN à Charmont
La
famille SAVART (qui avait déjà connu la guerre de 14-18
et la proximité
de la ligne de front) logea ces officiers du 3e RIA très
aimablement.
Ils n'étaient pas tenus d'en faire davantage ni d'être
chaleureux avec
les soldats. Mais précisément, ils en firent davantage.
Car un jour mon
père fut malade, atteint, je crois assez sérieusement,
d'une angine.
Et les SAVART prirent l'initiative de le soigner et se
dévouèrent
pour lui jusqu'à sa guérison. Mon père n'oublia
jamais ce geste. Et,
lorsque le 3e RIA quitta le secteur, mon père conserva l'adresse
des
SAVART, se promettant de revenir les voir après la guerre, et de
leur
rendre service si l'occasion s'en présentait.
Et l'occasion se
présenta car les hordes allemandes ne tardèrent pas
à occuper la
région. Le village de Charmont fut dévasté et la
maison des SAVART fut
détruite ou du moins rendue inhabitable à la suite des
bombardements et
des tirs d'obus.
A partir de cette époque, les parents et les
SAVART échangèrent alors des courriers, se tenant au
courant de leurs
malheurs ou problèmes respectifs. Réalisant les
conditions de vie
précaire et même le dénuement dans lequel les
SAVART se trouvaient à la
fin du conflit (ils avaient été relogés dans un
baraquement de
fortune), mon père décida d'aller leur rendre visite et
de leur
apporter, avec son soutien moral, et quelques pros alimentaires
prélevés sur le peu que nous avions en cette
époque de restrictions et
de cartes d'alimentation. C'était une manière d'exprimer
sa
reconnaissance pour les services que la famille lui avait rendus.
C'était probablement en 1945. Pour
l'avoir entendu raconté des années plus tard, ce voyage
n'avait pas été
de tout repos. Il n'y avait pas à l'époque d'horaires
très précis,
encore moins de réservation. Montait dans le train qui pouvait
en
jouant des coudes. Lors du retour, je ne sais plus dans quelle gare,
les wagons étaient tellement bondés que mon père
ne put que s'accrocher
au train qui démarrait et passa un certain nombre de
kilomètres à
l'extérieur, sur le marchepied, se tenant d'une main à
une poignée et
retenant sa valise de l'autre main. Les gens le voyaient de
l'intérieur, mais ils étaient tellement serrés (et
la porte étant
obstruée de l'intérieur par des grosses valises) que,
malgré ses signes
et ses appels désespérés, ils ne pouvaient pas lui
ouvrir la porte.
Finalement, après un certain nombre d'efforts, on finit par lui
ouvrir
et il put entrer dans le wagon. Quelle époque ! Naturellement,
il dut
faire la plus grande partie du voyage, de jour comme de nuit, debout.
Pendant
les années qui suivirent, il y eut des contacts réguliers
entre les
deux familles, mais uniquement par courrier. C'était toujours
Mme
SAVART qui écrivait, et c'était soit ma mère, soit
mon père qui
répondait. Mais il fallut attendre plus de 10 ans (et que nous
ayons
notre première voiture) pour qu'on puisse se voir
réellement.
Mais, de qui était composée cette famille SAVART
à
l'époque ?
Lorsque
mon père les connut, pendant et aussitôt après la
guerre, ils étaient
quatre : le père, Joseph SAVART (né en 1874) ; la
mère, Sara (née LEROY
en 1886) ; le fils aîné, Maurice (né en 1906) ; le
fils cadet, Albert
(né en 1918). Je crois bien que les parents SAVART avaient eu
aussi une
fille, mais elle devait être mariée et ne résidait
plus à Charmont
lorsque mon père y vint. Joseph SAVART était, je crois,
agriculteur, et
élevait aussi des animaux (vaches, cochons). Son épouse
l'aidait dans
ses travaux et, par exemple, bêchait la jardin potager. (Mon
père
s'extasiait de voir la qualité et la
légèreté de leur terre, qu'une
femme âgée pouvait travailler facilement à la
bêche, en comparaison de
la terre argileuse qu'il avait dans sa propriété de
Bastian...). Le
fils aîné, Maurice, était menuisier. Le fils cadet,
je ne sais pas,
peut-être travaillait-il aussi à la ferme. Le seul
détail qu'il me fut
conté sur lui c'est qu'il avait la passion des modèles
réduits d'avion.
Il en avait confectionné un certain nombre en bois léger
et en toile,
avec un petit moteur à essence ou à alcool (?). Lorsque
mon père leur
rendit visite vers 1945, et qu'ils habitaient encore le "baraquement"
en bois, Albert SAVART, qui avait alors un peu moins de 30 ans, lui fit
une démonstration de vol de ses avions. Mon père
racontait ensuite : «
Avec le contenu d'un simple compte-gouttes d'essence (ou d'alcool ?),
l'avion décollait et volait plusieurs minutes au-dessus des
prés ».
La
famille SAVART, d'après les photos qui nous avaient
été envoyées au début des années 50.
Quelques
années se passèrent avec ces échanges
réguliers de courrier. Le nom des
SAVART m'était devenu très familier. Leur visage aussi,
grâce aux
photos que mes parents avaient placées dans leur propre album de
famille. J'avais observé que le fils aîné Maurice
avait l'avant bras
gauche coupé. On n'en sut que plus tard la cause.
En 1954, une
lettre de Mme SAVART vint nous annoncer la mort de son mari [Il était mort le 14 janvier à Charmont]. Il est
vrai qu'il avait 80 ans. Elle n'en avait encore que 68.
Et,
seulement quelques semaines plus tard, une autre lettre qui
commençait
ainsi : « C'est avec beaucoup de peine et de douleur que je dois
reprendre la plume pour vous annoncer... la mort de mon fils Albert...
». Il n'avait que 36 ans, je crois qu'il était
célibataire, tout comme
son frère aîné Maurice, qui le restera, à ma
connaissance, jusqu'à sa
mort. La disparition de ce jeune fils des SAVART [Il était mort le 13 février à Charmont], avait beaucoup touché
mes
parents, et ils plaignaient particulièrement Madame SAVART,
surtout
qu'elle perdait à un mois d'écart son mari et son fils cadet.
Ce fut mon
père qui dut répondre à leur courrier. Je ne
sais pas ce qu'il put
écrire à Madame SAVART. Moi, ça ne m'avait
guère touché, j'avais 10
ans. Et la seule chose que j'avais retenue c'était le timbre de
l'enveloppe. J'avais commencé depuis 1-2 ans une collection de
timbres,
grâce à mon ami Jacques GIRAULT. Et, début 1954
parut un timbre
spécial, une Marianne de Gandon à 18 fr de 1951, avec une
surcharge 15
fr. Ce timbre, relativement rare, qui manquait à ma collection
et que
je ne savais pas où trouver, m'arriva miraculeusement sur le
courrier
(posté à Reims, voir ci-dessous - car ce timbre est celui
qui figure
toujours dans ma collection France-oblitérés)
annonçant le décès
d'Albert SAVART. Et, alors que mes parents accusaient le coup : «
Pauvre femme, juste après son mari, maintenant elle perd son
fils », je me
souviens que mon commentaire à moi fut (en pensant au
timbre rare que j'avais récupéré) : «
Ah !
Je suis content ! ». On est parfois ainsi quand on a 10 ans...
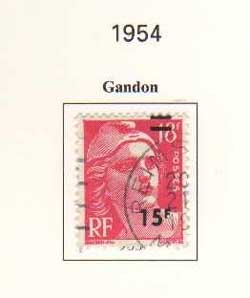 |
|
1954,
c'est aussi l'année où mon père passa son permis
de conduire. Il avait
44 ans. Quelques semaines plus tard, en janvier 1955, mes parents
achetèrent leur première voiture, une 203 noire,
d'occasion. On
commença à faire quelques sorties dans le Var, et
l'idée de faire un
jour un grand voyage, pour aller voir les SAVART, fut émise.
D'ailleurs, au cours des années précédentes, Les
SAVART n'avaient pas
dû manquer de les inviter à venir un jour leur rendre
visite à
Charmont. L'année suivante, en 1956 donc, un échange de
courrier avec
Madame SAVART permis de préciser cette possibilité et de
fixer une date
dans le courant du mois d'août. Les SAVART et mes parents
étaient ravis
à cette perspective. C'était le premier grand voyage que
nous allions
faire en voiture, plus de 700 km ! Et avec une voiture d'occasion, qui
plus est, avait déjà subi une grosse réparation
après que le moteur eut
gelé pendant les fameux froids de février 1956. Il
était prévu, tant
qu'à faire, de passer quelques jours chez les SAVART, et de
prolonger
le séjour dans la région en visitant un peu la
région de Verdun, puis
les Vosges (un hôtel avait été
réservé au moins une semaine, fin août,
à Remiremont).
 |
Carte postale de Charmont (années 50) : La Place et
l'Hôtel du Lion d'Or
(La maison des SAVART est indiquée par une croix bleue, en haut
à gauche) |
 |
Carte postale de Charmont (années 50) : La Colonie de
Vacances et le Centre
(Arrivée au village en venant de Vroïl) |
Nous
voici partis pour Charmont. Nous avions peut-être rendez-vous le
10
août, nous partîmes le 8. Ma mère avait donc
prévu 3 jours pour ce
voyage. C'était plus qu'il n'en fallait. La première
nuit, nous
couchâmes à Chalon-sur-Saône. C'était la
première fois que je visitais
cette région de France. Je me souviens des bords de La
Saône, du Canal
du Centre. Dans la soirée, je me souviens d'une promenade
où nous
assistâmes à la poursuite d'un gros rat par un groupe
d'enfants et
d'hommes sur les berges de la rivière. Le rat fut finalement
tué et,
comme ils ne savaient pas que faire du cadavre, l'un des hommes dit
à
un enfant : « Pousse-le en Saône ! ». Je
m'étonnai de cette expression,
avec l'accent des gens (en Sôôône !), et, avec mon
père, cela nous fit
longtemps rire. Car, dans notre pays, on aurait dit plus simplement
«
Fous-le à l'eau ! ».
Le lendemain, en milieu de journée, nous
étions évidemment presque arrivés. Ma mère
voulait faire une 2e étape,
à Bar-le-Duc, afin d'arriver chez les SAVART le jour
annoncé et non un
jour plus tôt. Mais mon père trouva ridicule de coucher
à l'hôtel si
près du but et on préféra aller directement
à Charmont dans
l'après-midi. Mon père trouva assez rapidement la maison
et gara la
voiture. Il n'y avait personne, car, naturellement, ils ne nous
attendaient pas ce jour-là. On attendit. Des voisins nous virent
et
allèrent prévenir Madame SAVART qui était quelque
part dans le village.
Celle-ci accourut et fut heureuse de faire connaissance de la famille
AUTRAN au complet, mais désolée que nous soyons
arrivée un jour plus
tôt car elle espérait avoir le temps de mieux
préparer notre accueil.
Je reconnus facilement cette Madame SAVART, dont on me parlait depuis
si longtemps, et qui était exactement comme sur les photos de
notre
album. J'ai dit qu'elle fut heureuse de nous voir, c'est
évident, mais,
sans exubérance particulière. Comme l'expliquait souvent
mon père, dans
ces pays, les gens sont plus froids, ne s'expriment pas avec les
mêmes
grands gestes et grands rires comme dans notre Midi. Et ma mère
avait
d'ailleurs prévenu Madame SAVART à notre arrivée
qu'elle ne devait pas
s'étonner de nous entendre parler et rire beaucoup et fort !
On
visita la maison, qui était relativement neuve (ils n'y avait
que peu
d'années qu'ils avaient pu quitter leur "baraquement" et obtenir
la
construction de cette maison (dont les murs étaient curieusement
bâtis,
non en briques, mais de tuiles plates superposées). La maison
était
attenante à l'atelier de menuiserie de Maurice SAVART. J'admirai
ces
belles machines (raboteuse, scie à ruban, etc.), que j'avais
déjà vues
à l'école technique Martini, dans l'atelier de
Pépé Lorenzini...) et
cette bonne odeur de bois. Au tour de la maison, ils y avait aussi
quelques bâtiments de ferme, dont l'un abritait un cochon que
Madame
SAVART engraissait, un potager, des tas de bois, des prés, mais
ils
n'avaient plus conservé de vache. Un peu plus tard dans
l'après-midi,
nous fîmes la connaissance de Maurice SAVART, un homme de bonne
taille,
à l'allure puissants, malgré son bras coupé. Mais
un homme assez
discret, avec un accent du nord-est de la France, avalant certaines
parties des mots, au point que, tout comme avec sa mère, il
fallait
parfois leur faire répéter pour comprendre... Depuis la
disparition de
son père et de son frère, il vivait donc,
célibataire, seul avec sa
mère.
Je n'ai plus guère de souvenir de la maison, sauf la
cuisine, qui communiquait plus ou moins avec la menuiserie. Il y avait
dans cette cuisine un buffet en bois remarquablement travaillé.
Madame
SAVART ne put résister à nous dire immédiatement :
« C'est Maurice qui
a fabriqué le buffet ! ». J'en fus surpris car j'imaginais
ce bonhomme
sciant ou assemblant des planches brutes dans son atelier. Je ne
l'imaginais pas, surtout avec un bras coupé, avec de tels
talents
d'ébéniste.
Notre séjour dura au moins 7 ou 8 jours. De nombreux
souvenirs très précis m'en sont restés.
L'essentiel des souvenirs que
j'ai de la famille SAVART et de leur village s'est constitué au
cours
de cette semaine-là.
Le type d'alimentation. Il était très différent du nôtre. Beaucoup d'aliments étaient bouillis, ce qui
déconcertait ma
grand-mère. Voyant Madame SAVART faire bouillir les girolles,
elle lui
disait : « Mais c'est pas comme-ça, il faut d'abord les
faire
revenir... ». Dialogue de sourds, on ne change pas des habitudes
culinaires régionales ancestrales. Dans la Marne, on ne
connaît pas les
safranés au gril arrosés d'huile d'olive avec du thym.
Mais dans
l'ensemble, on était bien et copieusement nourris. On fit des
découvertes, comme le potage à la ciboulette, le lait de
vache qu'on
pouvait boire à la ferme voisine directement après la
traite, et aussi
le cidre qu'ils avaient dans leur cave. Ce nom de boisson ne
m'était
pas inconnu mais je n'avais aucune idée de son goût et
l'idée d'en
goûter excita ma curiosité, alors que mon père en avait
déjà goûté.
Le village.
On en avait fait plusieurs fois le tour. Charmont avait à
l'époque quelques
centaines d'habitants. On avait promené le long des routes qui
en
partaient, notamment la route de Nettancourt bordée notamment
de
poiriers. Nous nous étonnions que des arbres chargés de
fruits mûrs
puissent ainsi border les routes, sans clôtures et sans que les
enfants
du village ne viennent chaparder ou saccager. [Chez nous, la maraude
existait et il y avait toujours des garnements qui s'attaquaient aux
fruits mêmes verts, ou qui les abattaient à coups de
pierre ou de bâton
par simple esprit de méchanceté]. Les champs
étaient constitués d'un
grand nombre de parcelles étroites et imbriquées
appartenant à des
propriétaires différents à la suite
d'héritages et de partages
successifs. Ici elle avait une parcelle de betteraves, la bas une
parcelle de pois, etc. Tout ceci sans clôtures et
imbriqué. A un
certain endroit, elle nous montra un arbre particulier, un poirier je
crois aussi, c'était l'Arbre de la Liberté du village,
qui, comme en
beaucoup de communes de France, avait été planté
lors de la Fête de la
Fédération de 1790, premier anniversaire de la
Révolution de 1789.
Les environs.
Les insectes et l'étang. 1956 c'était la fin de mon
année de 5e. J'avais 12 ans.
Le cochon
Le baraquement
La sortie à Reims et Epernay. Repas au restaurant : Mme SAVART
voulait payer. Visite chez sa fille ?
Verdun ?
Livre de papillons
Conversation sur la guerre de 14
La blessure de Maurice.
C'était au moment de la guerre de 1939-1940, pendant un tir
d'obus
allemand ou un bombardement aérien, je ne sais plus. Il
était à
bicyclette et, entendant les explosions, il s'était
aussitôt couché
dans la terre. Mais un éclat l'avait atteint, lui arrachant plus
ou
moins la main gauche et il avait du être amputé d'une
partie de l'avant
bras. Il racontait aussi que sa bicyclette était restée
intacte à côté
de lui, sauf la chaîne qui avait été coupée
par un autre éclat d'obus.
Conversations politiques. Conseil municipal
Repas ensemble. Soupe à la ciboulette
Le lait de vache et le champagne. Malade la nuit.
Matinée à Revigny, Heitz-le-Morupt
Donrémy ? Ste Menehould
Le montage du hangar.
L'essentiel de leur maison et des bâtiments annexes avait
été
reconstruit au milieu des années 50. Il y avait toutefois un
hangar
ouvert (piliers de bois et toiture) qui n'avait pas été
remonté. Et
c'est précisément la semaine où nous étions
là qu'une entreprise devait
venir le réinstaller à partir de matériaux
entreposés dans le jardin,
sans doute depuis plusieurs années. Tout était prêt
mais les pièces
métalliques avaient beaucoup rouillé depuis le temps. Une
matinée où
rien n'était prévu, mon père et moi, avec l'aide
de clés empruntées à
l'atelier de Maurice nous avions alors, pour nous occuper à
quelque
chose d'utile, travaillé à faire jouer et huiler tous les
boulons de
fixation qui était terriblement grippés.
L'après-midi, le patron de
l'entreprise pour commencer le montage du hangar. C'était un
homme
grand et ventru, à la gorge grasse et à la voix grave.
Mon père lui dit
aimablement : « On vous a préparé le travail
». Et il est vrai qu'on
leur avait fait économiser un temps substantiel à une
besogne ingrate.
Et le gros homme lui répondit seulement : « Ouaaaais !
». En aparté,
mon père me dit : « Quel rustre ! On lui fait gagner du
temps, et il ne
dit pas le moindre merci ! « Seulement ce Ouaaaais ! ». Cette
scène devint souvent par la suite entre nous un sujet de
plaisanterie.
Une récolte de
champignons
dans la forêt de l'Argonne.
C'était dans la région une période favorable pour
les champignons,
particulièrement les girolles, expèce que je ne
connaissais pas
particulièrement puisque chez nous on se limitait aux
safranés ou,
faute de mieux, aux pissacans ou aux coulemelles. Ce fut l'occasion de
s'enfoncer dans la célèbre forêt de l'Argonne dont
la lisière n'était
qu'à quelques km à l'est de Charmont. Nous y
passâmes une matinée avec
mon père et Maurice SAVART qui connaissait bien les coins et
nous
guidait. Car il y avait de quoi se perdre sous cette immense futaie,
bien que parfaitement sillonnée de chemins forestiers
réguliers. Nous
étions allés dans une zone connue par la présence
de deux arbres
immenses, un chêne et un hêtre, qui avaient poussés
côte à côte et qui
paraissaient soudés par leur pied. Des girolles, il y en avait
en
abondance. Maurice SAVART nous apprit à bien les
reconnaître et à les
distinguer des « fausses girolles ». Il y avait aussi dans
le sous-bois
un grand nombre d'énormes limaces rouges, qui devaient
dépasser les 15
cm. J'en avais déjà vu dans les Alpes, mais pas de si
longues.
Certaines se trouvaient en train de manger des girolles. Maurice
SAVART, cuillant une girolle, tomba sur une de ces limaces et je me
souviens que, la rejetant au sol, il s'exclama : « salope !
».
Les environs. Des noms connus : Nettancourt, Vroil, Possesse
Visité la région de Verdun, Points d'histoire : Varennes,
Ste Menehould
On
était allé au préalable rendre visite à
Joseph Augias : Son père enterré à Blercourt
L'atelier de menuiserie. La table, ça presse sans presser.
400 habitants à l'époque, guère plus de 200
aujourd'hui
Aucune photo de prise
Promenade, différentes parcelles à eux, routes
bordées de poiriers. L'arbre de la Liberté.
Le cidre, pour la première fois.
Conversation littéraire
Cimetière : la tombe, encore récente du père et du
fils.
Aucune photo de prise !
Le
jour du départ arriva. On se sépara en promettant de se
revoir. Mes
parents invitèrent la mère et le fils à leur
rendre visite dans le Var,
l'année suivante : 1957.
Un colis de provisions, avec du beurre fondu
Année 1957
La 403.
La carte au 50.000e
On habitait brd Staline.
Ils dormirent dans la chambre de ma grand-mère.
Ils
restèrent peu. Mon père avait prévu qu'ils ne
voudraient pas déranger
et ne resteraient que 2 jours. Ils ne restèrent et effet que 2-3
jours.
Le Gaou, la mer Méditerranée.
Visite à mon grand-père.
Montée au fort de Six-Fours !
Carte au 50.000e
Aucune photo
Invitation
à revenir, de manière à visiter plus largement la
région. Elle avait
parlé de Charleville-Mézières, peut-être
aussi de Luxembourg ?
Le départ. Ils ne se reverront plus jamais.
Les
échanges régulier par courrier continuèrent, au
moins une fois par an, à l'occasion des vœux du nouvel an.
Mon
père prenait maintenant plus souvent la plume. Mais le contenu
de ses
courriers était alors largement politique. Il sentait les Savart
politiquement modérés et ne se privait pas d'enfoncer le
clou de ses
idées d'extrême gauche. Après l'arrivée u
pouvoir du Général de Gaulle
(que les SAVART soutenaient manifestement), je me souviens parfaitement
mon père utilisa cette phrase dans une lettre : « la
victoire du
OUI me semble une gaffe immense pour la France... ». Madame
SAVART
n'appréciait pas ce discours et l'écrivit à ma
mère : « Je préfère que
ce soit vous qui me donniez des nouvelle, que M. AUTRAN... ».
Ma mère ne comprenait pas pourquoi, après qu'ils
eussent
connu deux guerres, ils
pouvaient ne pas être des pacifistes (donc d'extrême
gauche, comme nous
l'étions). Peu de différence entre gaullistes et hordes
nazies...
1958,
1959, 1960... Les années passèrent avec toujours les
mêmes échanges
réguliers de courriers. Mais nous ne pensions plus jamais nous
revoir.
En
1966, j'avais grandi, j'avais 22 ans, le permis de conduire depuis 4
ans et, à l'approche de mon mariage programmé pour la fin
août, mes
parents m'avaient acheté une Citroën 3CV d'occasion. Elle
avait
aussitôt servi une première fois pour aller faire un
séjour à Allevard
rejoindre mes futurs beaux-parents. Et au début d'août, il
se trouve q
Voyage d'Allevard à Verdun.
Quelques jours chez les GUIFFANT. Quelques sorties aux environs.
Je
n'avais pu résister d'aller pousser une pointe jusque chez les
SAVART.
C'était loin, nous étions rentrés tard, PBs avec
la famille. Mais
j'avais revu une dernière fois les SAVART à Charmont, 10
ans après
1956. Le gamin de 12 ans en avait 22, il était fiancé.
Les SAVART
n'avaient guère changé, ni la maison, ni la cuisine. Et
ils m'avaient
naturellement reconnu. On n'était resté que 30 ou 40
minutes, ils nous
avaient offert à boire dans la cuisine. Et on s'était
séparés, cette
fois pour toujours.
De retour à La Seyne, j'avais annoncé cette
rencontre, non prévue initialement à mes parents :
« Et vous avez aussi
le bonjour de... Madame SAVART ! ». Surprise et satisfaction. Mon
père
Encore
quelques années passèrent et toujours des courriers. Aux
vœux de 1967,
Madame SAVART rappela la visite que je lui avait faite. Mais les
courriers devinrent plus succincts et un peu moins lisibles. Madame
SAVART avait alors plus de 80 ans. Puis il y eut une interruption de
2-3 ans et ma mère n'écrivit plus. On pensa que Mme
SAVART devait être
morte maintenant, ou du moins impotente. Et puis, un jour, surprise. Ce
devait être vers 1973. Ma mère me dit : tu sais qui nous a
encore écrit
? Madame SAVART ! Mais après cela il n'y eut plus guère
qu'un ou deux
courriers et les échanges cessèrent
définitivement. Cette fois, on
pensa que Madame SAVART était bien morte. Peut-être pas
son fils, mais
lui n'écrivait jamais.
Mais quand était-elle morte ? Et Maurice ? On n'en avait
aucune
date, aucune preuve.
Le seul moyen était d'aller à Charmont, au
cimetière.
Mais
ce n'était pas sur mes routes habituelles qui étaient
Paris, ou
Toulouse, ou Nantes. Je n'étais même plus allé
à Reims depuis plusieurs
décennies. Or, justement, un contrat de recherche impliquant des
collègues de l'Université de Reims entre 1995 et 1998
m'amena plusieurs
fois dans cette ville. Je pensais bien sûr à Charmont et
aux SAVART,
mais je venais le plus souvent en train, et pour quelques heures. Il
aurait fallu rester un jour de plus, louer une voiture... Je n'eus
jamais l'occasion de le faire, mais l'idée demeurait en moi. Non
plus
pour revoir la famille vivante (En 1996, Madame SAVART aurait eu 110
ans !), mais pour en avoir le cœur net sur sa date de
disparition. Ce
fut en août 2002 (encore un mois d'août) , lors du mariage
de Gaëtan
Montels, neveu de Yolande, que l'occasion m'en fut enfin donnée.
Nous
étions partis en famille, en voiture cette fois-ci, dans l'est
de la
France. Le mariage avait lieu près de Provins, en
Seine-et-Marne, mais
nous avions pris quelques jours supplémentaires pour visiter
quelques
autres sites tels que Beaune, Colombey-les-deux-églises,
Chaumont,
Verdun, et les champs de bataille de la guerre de 14-18 notamment.
Et... sur le trajet de Verdun à Provins... le détour ne
fut pas grand
pour faire une halte au petit village de Charmont. On était le
23 août
2002. Nous nous rendîmes aussitôt au cimetière,
près de l'église.
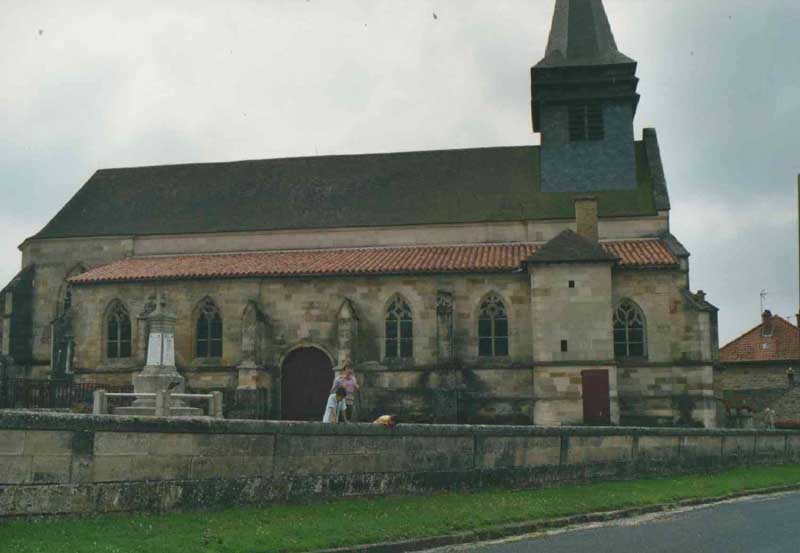 |
| Eglise et cimetière de Charmont (Marne) |
Et
les enfants, courant rapidement, trouvèrent en quelques secondes
la
tombe au nom de SAVART. Elle n'était pas là où je
l'imaginais lorsque
Madame SAVART nous y avait amenés en 1956 peu après la
disparition de
son mari et de son jeune fils. Peut-être mes souvenirs
s'étaient-ils
déformés avec le temps. Ou peut-être aussi la tombe
avait-elle été
reconstruite dans une nouvelle concession, plus élaborée
que celle
que j'avais vue, pour recueillir les restes de Joseph et d'Albert
SAVART, soit du vivant de Sara et Maurice, soit après la mort de
ces derniers, par leurs descendants ?
La tombe, photographiée pour la montrer à mon
père, portait alors 4 noms :
Joseph SAVART (1874-1954)
Albert SAVART (1918-1954)
Sara LEROY, épouse SAVART (1886-1981)
Maurice SAVART (1906-1986)
 |
| Tombe de la famille SAVART au cimetière de Charmont
(Marne) - 23 Août 2002 |
Ainsi,
Madame SAVART était bien morte, mais en 1981 seulement, donc
bien après
que les échanges de courriers ont cessé, 6 ou 7 ans
après environ.
Elle était morte à 95 ans. Et son dernier fils Maurice, 5
ans plus
tard, il avait 80 ans. Ainsi la boucle était bouclée.
J'en avais le
cœur net en m'en trouvai en quelque sorte apaisé.
Mais je voulus
savoir si la maison existait encore. Je fis plusieurs fois le tour du
village en voiture et ne retrouvai pas l'endroit. Pourtant le village
n'avait que 220 habitants seulement ! Alors, comme il était
midi, nous
avions pique-niqué aux alentours du village, en contrebas, dans
un
petit bosquet. Mais, après ce repas, à force de
réflexion, il me sembla
que je n'avais pas exploré un côté du village. J'y
retournai donc et
cette fois, je retrouvai bien leur rue en légère pente et
la
maison était bien là, identique à celle que
j'avais connue 46 ans
plus tôt. Bien sûr la façade avait dû
être repeinte, mais c'était bien
la même maison, avec, à droite, l'ancien atelier de
menuiserie.
Etait-ce toujours un atelier ou avait-il été
transformé en extension de
l'habitation ? Je ne sais pas. Je n'osai pas voir de plus près
quel nom
figurait sur la porte. Je me contentai de prendre la photo ci-dessous.
 |
| La maison autrefois habitée par les SAVART, rue neuve |
Savart : - Nom donné dans les Ardennes, aux terres incultes qui
servent de pâture. - Nom sous lequel on désigne, en
Champagne, les terres crayeuses
pauvres.
Le
patronyme SAVART est assez répandu dans la Marne : fin 2009, 48
SAVART
figuraient au Pages Jaunes de la Marne, dont 6 à Reims, mais
aucun au
village de Charmont.
Qu'est devenue la fille qui était, je crois à
Epernay ?
Son nom de mari ? Ses descendants ?
Samedi 6 décembre 2014 : Une réponse !
Bonsoir,
Je me présente, je m'appelle BP, j'ai 32 ans et
j'ai passé toute mon enfance avec mon frère cadet de 3
ans dans un petit village qui se prénomme Charmont.
Une connaissance vient de me faire part de cette Biographie où
on y voit une photo de la maison de mes parents située au
13 rue Neuves qui était celle de la famille SAVART.
Pour répondre à vos interrogations, l'annexe est toujours
un atelier où mon père y a
également installé ses machines à bois
(scie à ruban, toupie, tour à bois, etc...).
Cela me donne beaucoup d'émotions de connaitre une partie
de l'Histoire des personnes qui ont vécu avant nous dans ce
lieu qui nous est si cher ma famille et moi même.
Merci pour ce partage.
Cordialement,
BP
Mardi 9 décembre : Ma réponse
Bonjour,
Merci
pour votre message. Je suis extrêmement heureux que cette «
bouteille jetée à la mer » il y a plusieurs
années soit parvenue à quelqu'un qui à su en
apprécier tous le sens. Et que ces vieux souvenirs
conservés depuis les années 50 au fond de ma
mémoire aient pu vous être utiles et même vous
apporter de l'émotion.
Je
ne sais pas depuis quand la famille SAVART habitait Charmont.
D'après les archives de l'état-civil, Joseph SAVART et
son épouse Sara LEROY n'y étaient pas nés. Je ne
sais pas exactement où ils étaient nés. Ils
avaient connus la Première guerre mondiale, mais je sais pas
s'ils habitaient à Charmont à l'époque. Il est
certain qu'ils y étaient pendant la Seconde guerre mondiale car
c'est là que mon père les avait connus. Leur maison avait
ensuite été détruite et ils avaient
été logés pendant quelques années dans ce
qu'ils appelaient le "baraquement". La maison de la rue Neuves, avec
l'atelier de menuiserie) avait alors été construite, je
pense, vers 1952-1954, mais probablement pas à l'emplacement de
leur maison précédente. C'est dans cette rue que je les
ai connus lors de mes deux visites à Charmont (1956 et 1966),
avant que n'y repasse en août 2002, année où j'ai
photographié la maison.
Sara
SAVART étant morte en 1981 et son fils Maurice en 1986, je ne
sais pas si c'est à cette famille que vos parents avaient
acheté leur maison, ou s'il y avait eu d'autres
propriétaires entre temps. Je pose cette question car, les
fils SAVART n'ayant pas eu de descendant direct, les seuls membres de leur
famille qui aurait pu hériter de leurs biens ne pouvaient
être que du côté de la sœur cadette de Maurice
SAVART (que je n'ai pas connue et dont je ne me souviens pas du
prénom) qui habitait, je crois Epernay dans les années 50
- ou des descendants de celle-ci. Ma « bouteille jetée
à la mer » sur internet était également
destinée à retrouver les éventuels descendants de
cette fille SAVART, qui auraient été sans doute
intéressés de voir des photos de leurs ancêtres
qu'ils n'ont peut-être pas connus, ou dont ils n'ont plus le
souvenir. C'est pour cela que je me demandais si vos parents avaient
acheté leur maison à de la famille SAVART et s'ils
avaient eu une idée de ce qu'étaient devenus les
descendants SAVART du côté de la sœur d'Epernay.
Bien cordialement.
Jean-Claude AUTRAN
Dimanche 11 janvier 2015 : Voici les précisions que j'espérais recevoir :
Bonjour,
Voici comment nous sommes devenus acquéreur de cette maison. Moi
fille d'agriculteur originaire de Possesse 5 km de Charmont, mon mari
originaire de Villers le sec et dont les grands parents habitaient
Charmont, connaissions bien ce village.
En 1980, alors que nous venions rendre visite à la famille, nous
sommes passés devant cette maison, une grande affiche
était collée à la porte d'entrée,
c'était la vente aux enchères du mobilier et de
l'outillage. Nous sommes entrés dans cette maison et
assisté à cette vente aux enchères.
En 1981 nous nous sommes mariés, habitions dans un immeuble
à Sermaize Les Bains, notre vie à la campagne nous
manquait ainsi que les grands espaces.
En 1982, nous avions décidé de trouver une maison en
location ou à acheter. C'est alors qu'en passant de nouveau
devant cette maison, un panneau à vendre était suspendu
au grille de la fenêtre. Avec le notaire nous avons visité
la maison, les dépendances, le terrain, nous sommes
tombés sous le charme malgré les travaux importants
à réaliser. Tout était à faire. Il y avait
un moment qu'elle n'était plus habitée.
En juin 1983 nous sommes devenus acquéreur de cette maison. Les
vendeurs, Madame Lucienne Savart née à Grandpre (
Ardennes) le 25 mars 1908 sans profession, épouse de Monsieur
Lucquin Maurice demeurant à Saulchery (Aisne) et Monsieur
Savart Marcel Maurice né à Grandpré le 16
janvier 1906 demeurant à la maison de retraite de
Thieblemont Faremont
Nous pensons que Lucienne à une fille car le jour des
obsèques de Maurice elle est passée devant la maison et
dit c'était mes grands parents qui habitaient ici. Voilà
tout ce que l'on peut vous dire de cette famille
Cordialement
JLCP
Mardi 13 janvier 2015 : Ma réponse :
Bonjour,
Un très grand merci pour
votre message et pour les précieuses informations que vous
m’avez communiquées sur la famille Savart.
La date d’acquisition de votre
maison correspond bien à l’époque qui a
immédiatement suivi le décès de Madame Sara
SAVART, née LEROY (1886-1981), tandis que Marcel Maurice SAVART
était encore vivant puisqu’il n’est
décédé qu’en 1986. Comme je le pensais, les
parents Savart avaient bien aussi une fille. J’avais
oublié qu’elle se prénommait Lucienne et
qu’elle était née en 1908. (Nous étions
allés chez elle à Epernay avec mes parents et Mme Savart
en 1956). En 1982, les vendeurs de votre maison étaient donc
naturellement les deux héritiers encore vivants : Lucienne et
André Maurice Savart.
Un point très important que
vous m’apprenez aussi est le lieu de naissance des enfants Savart
: Grandpré (Ardennes). Ils n’étaient donc pas
natifs de Charmont, et effectivement, je me souviens vaguement que la
famille avait des attaches dans les Ardennes.
J’ai retrouvé dans un
site généalogique que Sara Leroy était, elle,
née à Senuc (Ardennes), une commune voisine de
Granpré, qu’elle était la cadette d’une
fratrie de 8 frères et sœurs, et qu’elle avait
épousé Maurice (Joseph ?) Savart (le père) «
à Charmont [à l’âge de 16 ans], le 22
novembre 1902 » (voir pièce ci-jointe). Mais je n’ai
pas pu retrouver l’acte de mariage dans les archives de
l’état-civil de Charmont en ligne sur internet, il y a
certainement une erreur de date ou de lieu. Je n’ai pas encore pu
comprendre le lien qu’avait le père Savart avec Charmont
et je n’ai pas retrouvé sa naissance dans les archives de
l’état-civil de Charmont, ni dans les recensements, ni
dans les archives des Ardennes (cette époque
n’étant d’ailleurs pas en ligne). Je ne sais
pas pourquoi le couple se serait marié à Charmont puisque
leurs deux premiers enfants sont nés plus tard à
Grandpré. Mais ils seraient certainement venus
définitivement s’installer à Charmont un peu
avant ou un peu après la Première guerre mondiale. Je
vais essayer de poursuivre les recherches avec les Archives des
Ardennes ou avec des généalogistes locaux.
Par ailleurs, vous me confirmez
qu’il y avait effectivement une petite-fille Savart (probablement
la petite fille celle que l’on voit sur des photos de la famille
Savart au début des années 1950) et qui doit donc
aujourd’hui avoir approximativement mon âge (70) et vous
m’apprenez que le nom de mari de Lucienne Savart était
Lucquin. Peut-être en faisant figurer ce nom en complément
de la biographie que j’avais écrite sur les Savart, cela
va-t-il permettre aux descendants de s’identifier un jour et de
découvrir les souvenirs de leurs ancêtres que j’ai
fait figurer dans mon site internet.
Un grand merci encore pour toutes
ces précieuses informations que vous avez bien voulu me
communiquer. Cela m’a déà fait beaucoup progresser.
Bien cordialement.
Jean-Claude Autran
 |
Fratrie de Sara Leroy, épouse Savart (extrait de l'abre Geneanet de Bernadette Leroy)
|