|
|
|
|
| Biographies familiales | Autres biographies |
Après la publication de ses 10 ouvrages d'histoire locale (entrre 1982 et 2001), Marius AUTRAN, tant qu'il a pu écrire, c'est-à-dire jusque vers 2005 (95 ans), s'est consacré à diverses rédactions, notamment à des biographies de ses ancêtres, et à son autobiographie. En réalité, il avait déjà esquissé les biographies de son père Simon AUTRAN et de son grand-père paternel Auguste AUTRAN dans un cahier datant de la fin des années 60, et il les a simplement complétées et remaniées vers 2001-2002. Par contre, son Autobiographie (200 pages manuscrites) a été rédigée pour la première fois, en 2002-2003, essentiellement de mémoire, sauf pour quelques dates précises qu'il a dû aller rechercher dans ses “Agendas” et ses “Cahiers du retraité”, dans lequel, depuis son départ à la retraite en 1966, il consignait, au jour le jour, puis dans des bilans annuels, de nombreuses informations.
Le texte intégral de l'autobiographie inédite de mon père a été dactylographié et imprimé, mais il n'a été diffusé qu'au sein de la famille. Pour ce qui est de la version mise en ligne sur internet ci-dessous, j'ai estimé nécessaire d'apporter les quelques modifications mineures suivantes :
Jean-Claude AUTRAN
A
voir également, les biographies
des autres membres de la famille (travail en cours)
Ainsi que les
biographies et
photos d'un certain nombre de personnes et de familles amies
de la nôtre : Autres
biographies
Autobiographie de Marius AUTRAN
- « Né le 2 Décembre 1910 à La Seyne-sur-Mer (Var), fils de Simon AUTRAN, matelot mécanicien né à Marseille le 5 décembre 1887 et de Victorine Laurence Charlotte, modiste, née à La Seyne le 4 novembre 1890. »
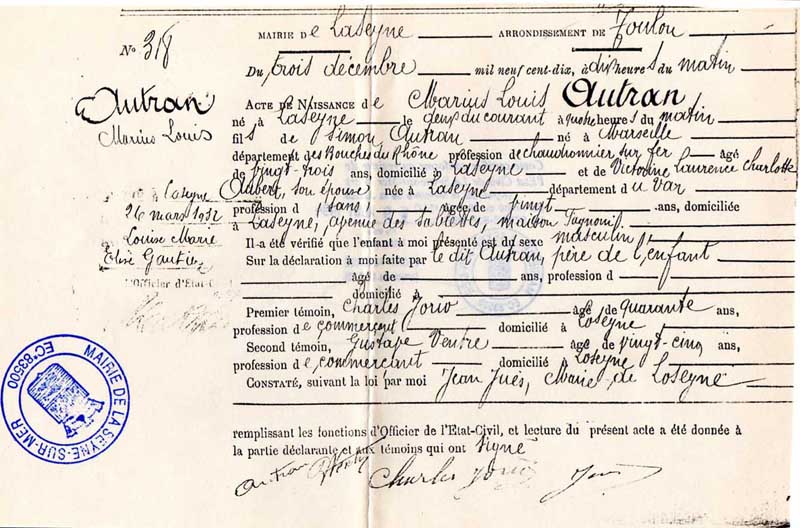 |
| Acte de
naissance de Marius
AUTRAN, signé du Maire de l'époque Jean JUÈS |
Tels sont les renseignements portés sur les registres de l’état-civil de la mairie de La Seyne-sur-Mer et mon livret de famille. Tout ce qui va suivre n’est écrit nulle part, exception faite de récits particuliers intégrés dans plusieurs ouvrages de la fresque « Images de la vie seynoise d’antan - Récits, portraits, souvenirs ». Tout ce que je vais raconter a été puisé essentiellement aux sources de ma mémoire qui habite encore fidèlement ma vieille tête chenue.
Obligatoirement, le plan de cette relation autobiographique a été établi suivant un ordre chronologique : L’enfance - L’adolescence - La vie scolaire - La carrière d’instituteur - La vie sentimentale - La rencontre avec Louise GAUTIER - La fondation de ma propre famille - Nos joies et nos deuils - Notre longue carrière professionnelle en passant par les villages varois (Saint-Cyr, Le Plan du Castellet - Montmeyan - Carcès) puis La Seyne - Les tribulations locales - Nos enfants - La carrière de notre fils Jean-Claude - Nos installations dans divers quartiers seynois - La guerre et ses désastres - Ma vie politique - Mes activités dans la vie associative et au sein des municipalités - La retraite, longue et fructueuse.
Cette longue énumération est significative d’une vie bien remplie, toutefois sans grands reliefs.
Le flot de tous ces souvenirs que je veux essayer de fixer par écrit est peu illustré par des documents. Certes, on retrouvera après ma disparition : livret de famille, cartes d’identité, livret militaire, brevets de pension, carnet de notes scolaires, rapports d’inspection de l’éduction nationale, cartes d’adhérents à diverses associations, articles de presse, etc.
Ma correspondance privée a été détruite en totalité par mon épouse (lettres des fronts de la guerre, de mon séjour à la prison maritime, par exemple). C’est dommage !
Aucune trace écrite ne reste de ma vie de normalien, des relations avec ma fiancée normalienne.
Malgré toutes les lacunes, je pourrais retracer avec précision toutes les périodes décisives de ma vie. Sans avoir été un héros, j’ai connu des vicissitudes et des tribulations suffisantes pour affirmer leur valeur d’exemple et dont j’espère que mes descendants trouveront quelque intérêt à les lire.
Revenons au point de
départ. Après leur mariage, célébré
le 30 janvier 1909 à Marseille, mes parents vinrent se fixer
à La Seyne-sur-Mer, rue Philippine Daumas, première rue
transversale que l’on rencontre après le rond-point
Kennedy, sur la droite, en allant vers les Sablettes. J’y naquis
l’année suivante.
|
|
||
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
||
 |
 |
 |
|
|
|
|
J’ouvre ici une parenthèse pour préciser le nom de la rue. Pendant longtemps, j’ai ignoré qui était Philippine DAUMAS. Cinquante ans plus tard, au hasard d’une lecture dans les documents administratifs municipaux, j’appris que cette honorable personne avait cédé à la ville une bande de terrain gratuitement pour permettre l’élargissement de la rue et la rendre carrossable pour des charrettes, cela au début du XXe siècle. En reconnaissance de sa générosité, la municipalité d’alors décida d’appeler la nouvelle voie « Philippine DAUMAS ». Indiquons en passant que la bienfaitrice fut la première à bénéficier avantageusement de sa largesse - toute sa propriété, mieux desservie par l’élargissement de la rue - en prit plus de valeur.
Ce fut le 2 décembre 1910 (voir le certificat de naissance ci-joint) que je fis mon entrée dans le monde, précisément dans cette rue Philippine DAUMAS, en présence de 3 femmes : ma mère Victorine, bien évidemment, ma grand-mère Joséphine AUBERT, et la sage-femme Madame PUGLIA, personnalité seynoise à qui des centaines d’enfants seynois (garçons et filles) doivent la vie. En ce temps-là on n’appelait un médecin seulement dans les cas d’accouchements laborieux et surtout dangereux.
Au milieu de la rue, à main gauche en allant vers le quartier Cavaillon, mes parents occupaient un appartement des plus modestes. Ils avaient pour voisins Madame et Monsieur Etienne GUEIRARD, professeur à l’école Martini, qui m’enseigna plus tard les mathématiques avec profit pour être admis brillamment à l’Ecole normale d’instituteurs de Draguignan.
 |
| Maison natale de
Marius AUTRAN,
3 rue Philippine Daumas (Photo de 2007) |
Les GUEIRARD me contemplaient au berceau et souvent sur leurs genoux, regrettant amèrement eux-mêmes de n’avoir pas pu s’assurer une progéniture.
 |
| Marius AUTRAN (en 1911) |
Dès mes premiers pas, ma jeune mère voulut me faire découvrir la mer et les bateaux du port. J’étais émerveillé de voir des multitudes de barques aux couleurs vives se balancer paisiblement au gré des flots, mais aussi des bateaux plus gros dont les cheminées hautes crachaient des fumées blanches ou noires et dont les sirènes stridentes me causaient une frayeur véritable au moment de leur départ.
Notre séjour rue Philippine DAUMAS fut de courte durée (deux ou trois ans à peine). Mon père voulait se rapprocher du port où, chaque matin, il embarquait dès le point du jour pour Toulon. Il était alors matelot mécanicien engagé pour trois ans au moins sur ce qu’on appelait alors l’Atelier Flotte.
Mes parents trouvèrent à se loger à la rue CARVIN, à quelque cent mètres de l’embarcadère, dans la maison du boulanger Victor MABILY, parrain de ma mère et cousin germain de ma grand-mère AUBERT.
A l’époque, mon père était un grand dormeur. Il me raconta qu’il sortit quelquefois de la maison les souliers à demi lacés, le « caban » sous le bras, franchisait la rue Cyrus Hugues en courant et sautait sur le ferry-boat pour finir de s’y habiller. Il risqua plusieurs fois un plongeon, ce qui l’aurait mis en difficulté certaine car il ne savait pas nager. Et pourtant le maître nageur de la Marine savait bien son métier. Mon père essayait de suivre ses conseils. En vain ! Il s’estimait incapable de flotter, se laissait couler à pic, après quoi un nageur d’élite allait le récupérer au fond du grand bassin de l’Arsenal où se faisaient les exercices de natation.
Je n’ai jamais pu comprendre comment mon père, si adroit dans ses gestes, si précis dans ses mouvements, avait pu s’avouer vaincu par la mer, sur laquelle cependant il vécut très souvent.
Aussi loin que remontent les souvenirs de mon enfance, c’est en ces lieux qu’ils ont pris leurs racines, et malgré l’épaisseur du temps écoulé, ils ont laissé des traces indélébiles. Et je suis encore en mesure de les rappeler avec une grande fidélité. Souvenirs des lieux ; des gens, des activités, de l’environnement, de la place du Marché, que l’on pouvait considérer depuis des siècles qu’elle fut le cœur de La Seyne.
 |
| Maison du 2 rue
Carvin où
Marius AUTRAN habita de 1912 à 1914 C'est là que se trouvait l'hôtel de ville de La Seyne jusqu'en 1847 Du temps de Marius AUTRAN, on pouvait encore lire l'inscription « Liberté-Égalité-Fraternité » sur la façade |
Je me revois dans cette maison des Mabily, véritable havre de paix et de bonheur, surtout pendant les rigueurs de l’hiver, devant le four à cuire le pain dont la chaleur bienfaisante rassemblait toujours dans les soirées les parents, les amis. Dans le magasin attenant défilaient les clients, les uns venant y chercher leur pain quotidien, les autres apportant des plats à cuire ou à réchauffer pour une redevance de deux sous en bronze.
Parvenu à mes trois ans, je descendais des trois étages où logeaient mes parents par un escalier étroit et obscur, aux marches hautes et dangereuses, quand j’échappais à la surveillance de ma mère occupée à son ménage. Mes petites jambes me permettaient d’atteindre l’étage inférieur où mon attention était attirée par le bruit du pétrin, de forme tronconique aux bords largement évasés, à l’intérieur duquel tournaient des pales malaxant la pâte préparée par l’ouvrier boulanger. Aux dires de mes anciens, ce pétrin aurait été le premier de La Seyne à fonctionner à l’électricité, ce qui ajoutait à mon admiration.
L’odeur de la pâte crue et du levain ne me déplaisait pas. J’étais en admiration devant cet ouvrier aux bras blancs, blancs de la fleur de farine fixée sur les poils drus de sa poitrine et de ses membres. Il travaillait presque dévêtu. Son pantalon de coutil descendait au-dessous de son ventre bedonnant à peine retenu par une cordelette. Ses pieds étaient simplement chaussés de savates, transformées en babouches. Sur sa tête, une calotte à peu près blanche protégeait son imposante chevelure de l’insidieuse fleur de farine. Une épaisse flanelle sans manche absorbait la sueur de son corps exposé aux rigueurs caniculaires du four au rez-de-chaussée.
Cet ouvrier chantait souvent, et sa voix doublée de l’accompagnement métallique du pétrin tournant et parfois grinçant retentissait jusque dans la rue Carvin.
De temps à autre, il posait sur son épaule une longue planche où s’alignaient les petits pains de pâte fendus et enduits de levain, descendait doucement l’escalier abrupt et allait « enfourner » au rez-de-chaussée. Jamais il ne faisait de geste maladroit. Jamais je ne vis un pain dévaler les escaliers.
Tonton Mabily, lui aussi en tenue légère, attendait devant le four. C’était presque toujours lui qui manipulait les pelles aux manches démesurément longs, plaçait sur les extrémités aplaties et lisses deux ou trois morceaux de pâte fraîche qu’il faisait tomber d’un retrait brusque. Et l’exercice d’enfournement durait un bon quart d’heure. Après quoi, la lourde pierre de fermeture du four se refermait, jusqu’à la cuisson des pâtes.
 |
 |
| Victor MABILY,
boulanger |
Victoire MABILY |
Une heure auparavant, Tonton Mabily avait fait brûler dans le four nettoyé de ses cendres au moins six grosses « fascines », c’est-à-dire des fagots de bois de pins en provenance de la forêt de Janas, qu’il fallait nécessairement éclaircir là où les pins avaient poussé “drus“. Ces fagots étaient vendus à tous les boulangers de la ville. Chaque semaine, on voyait s’arrêter devant la boulangerie une grande charrette chargée abondamment de fagots, combustibles naturels, qui donnaient aux pains cuits un arôme appétissant, ce qui fut remplacé plus tard par le mazout dont la clientèle n’appréciait guère les bienfaits en raison des odeurs de pétrole. Cet inconvénient persista longtemps, le temps qu’il fallut pour régler les proportions du dosage de ce dernier combustible.
Chaque semaine aussi, j’assistais à la livraison de la farine, apportée sur une grande charrette à plateau, distribuée par sacs de 100 kgs.
Le livreur, assisté d’un aide chargé de tenir à l’arrêt deux forts percherons aux pattes velues, battant leurs flancs de leur queue nerveuse pour en chasser les mouches, ce livreur, qu’on appelait plutôt débardeur, était un colosse nommé JÉROME, et son suppléant, dit Djordan (Jourdan), furent des personnages “hauts en couleurs“ de notre ville de La Seyne.
La corvée la plus dure incombait à Jérome qui s’approchait du véhicule, sa tête et son échine recouvertes d’un long sac en position de recevoir sur les épaules chaque quintal de farine. Se redressant sur ses jambes, le sac en équilibre sur la tête et le dos, notre Hercule s’avançait vers le couloir et l’escalier conduisant à la farinière, installée au ée étage, hors de l’humidité.
J’entendais alors le bruit sourd de chaque pas gravissant les marches de l’escalier.
Ces débardeurs accomplissaient des travaux de forçat. Quand la livrasion était terminée, le tonton Mabily appelait ces hommes de peine et leur offait un verre de vin rouge.
Tous les patrons boulangers faisaient de même, de sorte qu’en fin de journée, les débardeurs avaient bu 2 ou 3 litres de vin.. A une heure plus tardive, on pouvait les retrouver au bar de M. Contrucci, à l’angle du cours Louis Blanc et de la rue République. C’était alors l’heure du “Pernod”, qu’ils dégustaient après avoir recommandé au mastroquet : « Gueire d’aigo ! » de leur voix plutôt éraillée.
Revenons devant le four qu’on ouvrait plusieurs fois par jour pour livrer de petits pains appelés “navettes“. De la pâte cuite devenue dorée, brûlante, se dégageait l’odeur du pin brûlé qui chatouillait agréablement les narines humaines. Les “navettes“ remplissaient de grandes corbeilles en osier avant de passer dans le magasin où la tante Mabily (tante Victoire) attendait la marchandise à son comptoir, derrière une grande balance à plateaux entourée de poids cylindriques en cuivre, reluisant du “Naol“ dont les astiquait Marie, la bonne qui faisait office, dans la matinée, de porteuse de pain à domicile.
J’ai décrit dans un ouvrage précédent l’animation qui régnait devant la boulangerie Mabily, que jouxtaient d’autres commerces prospères : la boucherie Scotto, l’épicerie de Madame Marro, la grand-mère d’Henri Tisot, dont le père Félix fit plus tard une pâtisserie, le tripier dont les eaux de rinçage répandaient une puanteur insupportable dans un ruisseau sans écoulement. Face à la boulangerie, une autre boucherie tenue par Mme et M. Delaud. Tout à côté, le bijoutier Cauvière, réparateur de montres et de pendules, puis le pharmacien Armand, dont le magasin existait depuis la fin du XIXe siècle. Tous ces gens du commerce et de l’artisanat gagnaient bien leur vie à proximité de notre beau marché provençal in séparable de la poissonnerie bruyante où l’on ne vendait alors que les produits locaux : coquillages de la baie du Lazaret, poissons de toutes espèces venant de Sicié ou du Rascas.
Revenons encore au four des Mabily dont les animations prenaient d’autres formes le soir venu.
Il était admis que les voisins les plus proches, les amis surtout, s’y rassemblaient, surtout à la saison froide, pour y bavarder et faire le point des évènements locaux et même nationaux et internationaux, surtout dans cette période de mon enfance où les menaces de guerre se précisaient de jour en jour. Clément Blacas, bavard intarissable, rapportait tout ce qu’il savait sur les activités du chantier naval ; Pierre Revest, originaire du quartier Beaussier, et mon père Simon, donnaient des nouvelles de l’Arsenal maritime, alors en pleine prospérité. Giran, spécialiste des questions municipales, entretenait les auditeurs des problèmes de l’eau et de l’assainissement qui se posaient depuis longtemps et dont les solutions se faisaient attendre. Brefs, les sujets de discussion ne manquaient pas et parfois, tournaient à des empoignades auxquelles tonton Victor mettait fin en menaçant de mettre trout le monde à la porte. L’heure du souper arrivait et l’on se séparait pour recommencer sans rancune le lendemain.
Rentrés dans notre appartement, nous entendions le bruit sourd du pétrin qui fonctionnait une bonne partie de la nuit.
Ma mère allumait la lampe à pétrole et faisait réchauffer la soupe sur un de ces réchauds d’antan avec deux grands yeux lumineux, lui aussi activé au pétrole dont les émanations n’excitaient guère l’appétit. C’était ainsi !
Cette lampe à pétrole que j’admirais pour sa lueur blafarde, m’apparaissait comme une source de vie dans la cuisine obscure. Elle m’a laissé quand même un souvenir amer car elle fut la cause du premier accident de ma vie, que je tiens à décrire avec précision.
Un soir, installé dans ma chaise haute, non loin de la source de lumière, j’admirais le long verre de lampe au bas duquel un bouton moleté permettait le réglage de la mèche imbibée du combustible liquide.
On sait que, de très bonne heure, notre instinct de posséder ce qui fait notre admiration nous pousse à regarder avec intensité, à palper, et j’allongeais mon petit bras vers l’objet de ma convoitise. Mais Simon, tout en lisant son journal, s’exclama soudain avec force : « Ne touche pas ! Tu vas te brûler ! ». N’y tenant plus, ne tenant aucun compte de l’objurgation paternelle, je saisis à pleine main le verre brûlant, et poussai des hurlements de douleur.
Ma mère, terrorisée par mes cris, ne pensa qu’à me secourir avec une serviette et de l’eau fraiche. Mon père ne manifesta pas le même empressement. Rarement porté vers l’indulgence, il s’écria : « C’est bien fait ! Je te l’avais dit de ne pas toucher ! ». Vous pensez qu’il fallut bien des compresses avant que ma douleur fut radoucie.
Le lendemain soir, même scène. Me revoilà sur ma chaise haute avec la même lampe devant moi, toutefois plus éloignée que la veille.
Simon le moraliste, au sourire sarcastique, me dit : « Touche la lampe ! Touche-la, je te dis ! ». Mes regards soupçonneux allaient du verre de lampe maudit au visage inquisiteur de mon père et je ma gardai bien d’obéir à un tel mot d’ordre. « Tu vois, s’écria mon père triomphant, il n’y a que l’expérience qui paie ! », dit-il à son épouse. Et c’est vrai que je venais de recevoir une première leçon cruelle de la vie.
La rue Carvin fut donc pour moi ma première éducatrice avec ces spectacles d’activités créatrices de personnages hauts en couleur au langage cru, aux expressions d’une langue provençale que j’appris à parler sans difficultés majeures.
Les spectacles de la rue Carvin et de la place du marché s’égayaient le dimanche par des animations diversifiées qui rassemblaient beaucoup de badauds, plus intéressés ce jour-là par un montreur d’ours prudemment muselé, qui faisait danser le plantigrade au son d’une flûte ; ou alors une viole actionnée à la manivelle dont les rengaines suffisaient à faire danser des bohémiennes sur leurs longues échasses ; ou alors des vendeurs de chansons populaires, des acrobates épateurs à la recherche de quelque obole problématique, les spectateurs n’étant pas généralement des gens cossus.
Ma mère m’accompagnait souvent pour assister à ces démonstrations vivantes dont les Seynois, petits et grands, étaient toujours friands. Nous étions toujours tentés de pousser notre sortie jusqu’à la poissonnerie toute proche et là, j’eus tôt fait de me familiariser avec les produits de la mer : poissons blancs et dorés, girelles multicolores, poulpes aux ventouses redoutables remuant encore leurs tentacules, menus poissons (les poutigne) frétillants, et tout cela répandant les arômes du large. Déjà, la mer et ses richesses éveillaient en moi la passion de les exploiter et dans ce domaine mes parents et mes grands-parents surtout surent m’y intéresser admirablement.
Presque tous les dimanches, mon oncle Désiré venait me chercher et m’emmenait sur le port assister à l’arrivée et au départ des steam-boats dont je redoutais tout de même les coups de sifflets stridents et les escarbilles de leur cheminée haute. Remontant la rue Cyrus Hugues, mon oncle s’exclamait en entrant dans la pâtisserie de Mme Barbier : « Bonjour madame ! Je veux des gâteaux pour le petit !... et aussi les grands, bien sûr ». Inutile de dire que, déjà, j’aimais bien satisfaire ma gourmandise en dégustant les choux à la crème et les babas au rhum. Et l’on s’attardait sur cette place du marché. L’oncle Désiré s’était lié d’amitié avec des personnages folkloriques qu’il apostrophait avec sa faconde intarissable. Il brocardait, sans les vexer toutefois, Pierre la Chique, l’Anchoye, sec comme un sarment, Georgette alors toute jeunette mais déjà remarquable par ses propos mal embouchés, au moins autant que ceux de Ninon, la marchande de légumes, dont les clients s’écartaient de l’étalage à cause des odeurs de pipi de sa robe crasseuse.

|
| Désiré
AUTRAN
(1885-1918) |
L’oncle Désiré connaissait bien les joueurs de boules de l’époque : Lichou, le Bouc, la Cabre. Au retour devant la boulangerie Mabily, d’autres figures populaires nous saluaient tels que Lazare, du quartier Beaussier, buveur de vinasse dont la démarche était plutôt mal assurée, et aussi Pierre Revest, célèbre par sa petite taille qui lui avait valu le surnom de “Tacade”. Et je pourrais allonger la liste de ces citoyens au demeurant fort honorables et très respectés, les ivrognes mis à part. Il existait alors dans cette vieille Seyne une convivialité que la génération présente en l’an 2000 ne connaît plus, hélas !
Nos promenades du dimanche matin se limitaient donc au bas du marché, la rue Crus Hugues, toujours très animée, le port, les Esplageols. A l’opposé, l’église, que la tradition familiale me laissa toujours ignorer, et la rue d’Alsace (ancienne rue de l’Evêché) où se trouvait l’“Asile”, vocable qui signifiait alors l’école maternelle. Ce qui m’amène à parler de la première école de mon enfance. A dire vrai, ce n’était pas une école. Aujourd’hui, il faudrait la nommer “garderie”.
J’ai enregistré une cassette intitulée “Les écoles de mon enfance” où le fonctionnement de cette structure scolaire primaire a été précisé. Deux classes à un premier étage accueillaient plus d’une centaine d’enfants, une cour au rez-de-chaussée, sans aucun revêtement, où s’agitaient bruyamment les gamins dans des nuages de poussière. Ma mère était désespérée d’avoir à laver chaque jour mon sarrau noir. Elle faisait quatre fois par jour le trajet rue Carvin – rue d’Alsace. On ignorait alors les cantines scolaires. Les sanitaires étaient réduits à leur expression la plus simple. Le nombre de W.-C. ne pouvait répondre aux besoins naturels d’un effectif pléthorique. Au bout de quelques semaines, je quittai cette pauvre école surpeuplée et ce fut sans regret. Mes parents quittèrent La Seyne pour la Tunisie en raison des évènements de la guerre déclarée à l’Allemagne en août 1914. Une vie toute autre allait commencer pour ma famille, contrainte de s’expatrier pour de longues années.
J’ai certainement raconté dans d’autres ouvrages les circonstances de cet événement pour le moins inattendu et ce départ pour un pays étranger auquel il faudrait s’adapter, avec des doutes sur l’accueil qui nous serait réservé.
Quelques jours avant la déclaration de guerre, qu’on savait imminente, mon père arrivant de son atelier de l’Arsenal de Toulon dit à son épouse : « Prépare-moi un ballot de linge ! Je dois partir pour Bizerte, plus exactement Ferryville, où l’Arsenal de Sidi Abdallah a besoin de spécialistes de réparation des coques ». Profondément choquée, ma mère réagit violemment : « Et moi, et le petit ? Qu’allons-nous devenir si toi tu es en Afrique ? ». « Sois sans crainte, répondit Simon, tu viendras me rejoindre le mois prochain, les chefs de l’Arsenal nous en ont fait la promesse ».
*
Préciser les dates
Mon père avait été volontaire pour ce départ, et il avait pris, ce jour-là, l’une des décisions les plus heureuses de sa vie.
Il partit en compagnie d’autres Seynois et Toulonnais en qualité d’affecté spécial et évita ainsi la mobilisation dans la métropole évidemment plus dangereuse.
Quelques semaines plus tard, nous embarquions, ma mère et moi, à Marseille, après une nuit passée chez les Lieutaud, cousins éloignés de mon père, sur un paquebot appelé Ville d’Alger en direction du port de Bizerte.
En Tunisie
Dans le tome VIII des “Images de la vie seynoise d’antan”, dans un texte intitulé “Seynois migrants et colonialistes au temps de la IIIe République”, j’ai raconté avec force détails comment s’effectua notre première traversée de la Méditerranée, qui faillit tourner au drame en raison d’une violente tempête essuyée au large de Marseille quelques instants après avoir dépassé le Château d’If.
Je reviendrai plus tard sur d’autres traversées dont certaines ont pris pour moi un caractère vraiment épique. Les dangers de la guerre sous-marine étaient immenses par les torpillages de bateaux militaires et civils. Ceux de l’aviation ne devaient s’affirmer que beaucoup plus tard.
J’avais donc 4 ans quand mes parents s’installèrent à Tindja, hameau situé à quelques kilomètres de Ferryville et relié à cette dernière par un petit chemin de fer à vapeur.
Ce quartier était habité surtout par des ménages bretons, qui nous reçurent fraichement en nous traitant de “mocos”, sans savoir d’ailleurs l’origine de ce vocable. Ma mère ne se plut guère dans ce hameau hostile, mon père pas davantage, éloigné qu’il était de son lieu de travail. Ils logèrent ensuite quelque temps sur l’avenue de France, artère principale au cœur de Ferryville, puis se fixèrent définitivement rue Franklin, dans un appartement très confortable, ayant comme voisin un médecin français, le docteur CANAC.
Je n’aurai pas gardé de lui un bon souvenir pour la simple raison que, l’année suivante, ma mère voulut me faire soigner une carie dentaire et M. CANAC fit office de dentiste, profession inconnue alors à Ferryville. La carie étant si profonde qu’in conseilla l’extraction immédiate. Le docteur ne aucun moyen d’insensibiliser la douleur, me fit asseoir sur une vulgaire chaise de cuisine, recommandant à ma mère de tenir ma tête entre ses deux mains, tira d’un tiroir proche des tenailles nickelées et, avec une grande dextérité, m’arracha la dent cariée sans autre forme de préparation. L’opération fut suivie de nombreux bains d’eau froide. Il me fallut tout de même quelque temps avant que la douleur ne s’édulcorât. Ce fut le premier incident fâcheux que j’eus à subir à la rue Franklin*. Je n’ai jamais oublié cette première visite chez un médecin qui s’improvisa dentiste ce jour-là.
*
Marius AUTRAN racontait parfois
un horrible souvenir qu'il
avait conservé du cabinet de ce docteur. La ligne de chemin de
fer passait alors au milieu de Ferryville, non loin de la rue
Franklin. Les enfants étaient toujours passionnés par le
passage des trains et imitaient dans leurs jeux le tch-tch-tch des
locomotives à vapeur. Un jour, un jeune enfant dont le
père travaillait aux chemins de fer, reconnut celui-ci qui
manœuvrait une locomotive à faible vitesse en plein centre
ville. Il courut alors vers l'engin et monta sur le marche-pied pour
retrouver
son père. Mais il glissa du marche-pied et tomba sous la roue
qui lui sectionna la cuisse et lui écrasa la jambe et le pied
avant que le père ait pu stopper sa machine. Le père, fou
de douleur, prit son enfant dans ses bras et courut vers un docteur
qu'on lui indiqua tout à côté, le docteur CANAC.
Marius AUTRAN garda toujours le souvenir de ce couloir menant au
cabinet,
inondé de sang de l'enfant, dont on n'a pas su s'il avait ou non
survécu.
Dans
le tome VIII des
“Images de la vie seynoise d’antan”, j’ai
raconté tous les aspects de la vie tunisienne durant les
années 1914-1916. Ces deux premières années furent
pleines d’enseignements pour le jeune enfant que
j’étais : souvenirs d’écolier, souvenir de la
rue Franklin très animée, des parties de pêche et
de chasse partagées avec d’autres familles seynoises : les
Revest, les Gay, les Vial, les Tisot, les Robini, les Curet, les Roux,
les Soubic, et aussi des familles toulonnaises : les Couadou, les
Daumas, les Descombes, les Cheylan. Parmi les nombreux amis que
comptaient mes parents, il y avait aussi quelques Bretons (Pihuit,
Derouet), des Corses (Agostini, Maestracci).
 |
| Marius AUTRAN (x) à l'école primaire de Ferryville |
Ma mère rendait beaucoup de visites et en recevait fréquemment dans l’appartement confortable de la rue Franklin. Tous ces amis se retrouvaient le dimanche au cours de parties de chasse et de pêche.
Très économe, ma mère réussit à acquérir un minimum de mobilier. Mon père, bricoleur passionné, installa des penderies, des étagères, en sorte que, sans être luxueux, l’appartement devint très confortable. Je me souviens qu’il donnait vers une cour intérieure où je pouvais jouer tranquillement. Dans une encoignure, mon père avait aménagé une volière pour des chardonnerets qui cohabitaient avec un perdreau blessé capturé à la chasse. J’apportais chaque jour des grains à ces volatiles. Hélas ! Un beau matin, j’éprouvai un immense chagrin en constatant qu’un rat avait réussi à crever le grillage, à pénétrer dans la volière, à tuer le perdreau dont il avait grignoté la tête et les pattes. Je partis pour l’école ce jour-là et la tristesse me poursuivit toute la journée. Mon père me consolât en me promettant tout d’abord d’attraper le rat au piège et de remplacer la victime au cours d’une prochaine partie de chasse.
 |
| Marius AUTRAN
avec ses parents,
en Tunisie |
La vie à Ferryville était très agréable. Rien ne leur manquait. La nourriture, abondante, se trouvait à des prix modiques.
Les distractions ne manquaient pas : une fois par semaine, nous allions au cinéma, à proximité de la rue Franklin. Ah ! Certes, les films n’étaient pas en couleur et n’étaient pas parlants. On s’accommodait de ce cinéma muet, tout de même une révolution pour l’époque. Pouvait-on souffrir de progrès qu’on ne connaissait pas ?
Entre les images apparaissaient les textes explicatifs sur les écrans que l’auditoire lisait à voix haute (fort heureusement, tout le monde ne savait pas lire). En sorte que le brouhaha était tout de même supportable.
Le marché immense regorgeait de marchandises de toutes sortes : fruits, légumes, viande, gibiers variés, poissons, coquillages, tout cela à des prix que les colonialistes européens trouvaient dérisoires par rapport aux prix de la métropole. Le marché s’animait aussi de marchands d’étoffes, de vêtements, de tapis, d’objets d’art confectionnés par des artisans tunisiens ingénieux. De temps en temps, la place du marché s’animait de faiseurs de tours, d’acrobates, de cavaliers d’une fantasia, à l’occasion de fêtes religieuses spécialement.
Le commerce se faisait par une petite bourgeoisie de propriétaires arabes et de Juifs.
Chaque matin, les rues retentissaient des appels de marchands ambulants qui offraient du charbon de bois, du gibier, des aromates, des peaux d’animaux (lièvres et même, renards). Sans oublier les porteurs d’eau à la saison d’été, chargés de 50 litres d’eau de source dont ils avaient gonflé des peaux de boucs, portées en bandoulière et distribuées dans les habitations dépourvues d’eau potable. J’allais oublier des ânesses paisibles qui offraient aux mamans un lait très apprécié des enfants dont j’étais.
Leurs plus grandes distractions, mes parents les trouvaient au bord de la mer et dans les campagnes.
Mon père avait consacré ses premières économies à l’achat des bicyclettes. J’étais encore trop petit pour avoir la mienne. Aussi avait-il fabriqué une selle en bois*. Incliné sur le guidon, il pouvait se diriger sans peine et me faire ainsi partager les joies de la pêche et de la chasse : pêche aux poissons, aux grenouilles des oueds, aux coquillages.
*
La selle était
à l'avant du vélo. Simon allait parfois à la
chasse avec son enfant sur la selle. S'il voyait un gibier depuis le
chemin, il disait à Marius : « Abaisse-toi ». Il
s'arrêtait, épaulait et tirait depuis le vélo par
dessus la tête de Marius - dont les oreilles avaient donc
dû être habituées très jeunes aux
détonations d'un fusil de chasse... Un jour, il aperçut
un gros serpent (naja ? ou cobra egyptien ?) lové et
dressé au milieu de leur chemin. Même scénario :
« Baisse la tête » et Simon tua le serpent d'un coup
de fusil.
Au fond du lac de Bizerte, un superbe rivage, appelé bord joli, nous offrait des richesses d’une extrême variété en espèces comestibles : poissons, mollusques, crustacés. Je vois encore ma jeune mère, armée d’une simple fourchette, clouer à faible profondeur des soles dissimulées dans le sable fin. Elle m’apprit à deviner leur contour, à reconnaître les trous des siphons de la clovisse, les tache de sable fin remué qui trahissaient la présence des crabes. Quand le mauvais temps nous chassait du rivage, nous allions vers un oued de l’intérieur à la recherche des grenouilles attirées par un chiffon rouge dissimulant un gros hameçon. Le soir, ma mère, avec sa dextérité coutumière, dépouillait les batraciens pour n’en retirer que l’arrière-train et ses grosses cuisses que nous dégustions en fritures succulentes le lendemain.
Les soirées du dimanche ne nous offraient ni radio, ni télévision, mais l’abondance de nos récoltes de la journée nous imposait de trier, de décortiquer, de ranger nos marchandises à consommer pour la semaine : poissons, oiseaux plumés et flambés, salade sauvage, champignons, asperges, olives*.
*
Un jour que Victorine
promenait Marius dans une poussette dans la campagne,
accompagnée de 2-3 autres amies, le groupe avait, bien
imprudemment, cueilli une grosse quantité d'olives dans la
propriété d'un indigène. Elles entendirent alors
ce dernier, qui les avait vu de très loin, accourir à
cheval en leur criant des imprécations en arabe. Alors,
Victorine eut le présence d'esprit de soulever le siège
de l'enfant, de verser dans un compartiment caché sous le
siège la plus grande partie des olives cueillies, en n'en
laissant que quelques-unes de visibles dans le fond de leur panier.
Lorsque l'indigène (qui n'avait pas pu voir l'opération)
arriva, furieux, les femmes lui dirent qu'elles avaient seulement
cueilli ces quelques olives... L'indigène se radoucit
aussitôt et les laissa partir. Victorine avait
évité le drame et surtout sauvé leur cargaison
d'olives...
Sur le chemin du retour, il n’était pas rare que mes parents s’arrêtent dans un quartier “gourbis”, défendu par des chiens kabyles redoutables, pour y acheter de la volaille et des œufs. Les indigènes nous accueillaient gentiment, heureux de gagner quelques sous pour améliorer quelque peu leurs maigres ressources. On les voyait quelquefois occupés à écraser des olives dans un grand trou d’argile durcie qu’ils remplissaient d’eau bouillante à la surface de laquelle remontait la matière grasse recueillie par une grande écuelle. C’étaient des scènes de la vie courante qui rappelaient la préhistoire de leurs ancêtres lointains.
Ma mère acheta un jour un lièvre énorme à un Indigène qui venait de l’abattre par le moyen le plus primitif dont il disposait, c’est-à-dire une matraque en bois d’olivier*. En demandant le prix, elle sortit de sa poche une poignée de gros sous en bronze de l’époque. Ne comprenant pas la langue arabe, elle signifia au vendeur de se servir lui-même. Il ne chercha pas à la voler et préleva seulement 15 sous dans la main de ma mère, satisfaite d’avoir à manger pour plusieurs repas. Je pourrais parler longtemps de tous les aspects de la vie tunisienne à laquelle nous étions adaptés superbement.
* A cette époque, les Indigènes n'avaient en principe pas le droit de posséder une arme à feu et ils ne pouvaient chasser qu'avec des moyens de fortune (matraques, collets,...). Marius AUTRAN se souvenait tout de même avoir vu des Indigènes pêcher à l'explosif dans le lac de Bizerte... Les colons, bien sûr, avaient tous des fusils de chasse. Mais Simon AUTRAN (qui avait un grand respect pour les Tunisiens et - à la différence d'autres colons - n'avait jamais cherché à les exploiter, bien au contraire : il leur donnait souvent des cigarettes ou du tabac), faisait la leçon à son fils : « Tu vois, nous sommes ici chez eux, et eux n'ont pas le droit de chasser, alors que nous avons le droit de tuer leur gibier tant que nous voulons ; nous, nous envoyons nos enfants à l'école et eux ne peuvent pas, car ils n'ont pas les moyens de leur payer des chaussures [sans chaussures, on n'était pas admis à l'école] ; ils vivent dans des gourbis etn ous, nous avons des maisons avec tout le confort, etc. etc. Et Simon donnait plusieurs exemples semblables à Marius, en lui prédisant qu'un jour, cela finirait mal. Tout cela marqua durablement Marius AUTRAN et fut certainement à l'origine de ses futures convictions anticolonialistes.
 |
| L'Arsenal de
Sidi Abdallah
à Ferryville. Simon AUTRAN (x) y était affecté dans l'atelier de fabrication des coques des premiers hydravions |
Mes parents vivaient heureux. Mon père exerçait ses fonctions à l’Arsenal, sans difficultés majeures. Avec ses nombreux amis, ils organisaient souvent des sorties champêtres. Ils se retrouvaient aussi après le travail dans les cafés, disputaient amicalement des parties de poker, de billard, de jacquet. Cette vie paisible durait depuis deux ans. J’allais chaque jour à une école maternelle dirigée par Madame Martinot, institutrice d’élite dont j’ai gardé un excellent souvenir. Cependant, mes absences fréquentes dues à des maux de tête persistants allaient causer à mes parents une inquiétude grandissante. Le médecin, consulté à plusieurs reprises, conclut à une offensive de paludisme, ce qui n’était pas rare chez les jeunes Européens. Hormis la “quinine”, on ne disposait pas alors de médicament plus efficace pour combattre le mal.
Après maintes hésitations, il fut décidé avec mes grands-parents, que je serai ramené à La Seyne vers la fin de l’année 1915.
Une autre vie allait commencer pour moi, sous la clémence du climat provençal, chez mes grands-parents qui m’adoraient et me comblaient de mille manières. J’allais échapper à l’autorité inflexible de Simon et connaître une liberté absolue dont j’allais apprécier tous les aspects, sans débordements maléfiques dont mes parents auraient pu se plaindre, étant par nature un enfant tranquille et sans histoire. J’allais vivre là dans la propriété de mon grand-père, Marius AUBERT, un saint homme que je couvrirai d’éloges dans les lignes qui suivent, époux de Joséphine Hermitte, un cœur d’or qui lui faisait pardonner ses excès de langage, car ses bavardages excessifs furent parfois la cause de conflits familiaux.
J’ai gardé de cette période de ma vie d’enfant des souvenirs tellement attachants que je vais y consacrer plusieurs pages dans ce recueil de souvenirs familiaux.
Toutefois, avant d’entrer dans le vif de ce sujet, je n’aurais garde d’oublier de raconter en détail un événement hors du commun qui a failli me coûter la vie, la mienne et celle de ma mère chargée de me ramener dans la métropole pour les raisons exposées précédemment.
Les faits se situent vers la fin de l’année 1915. Ce fut sur un paquebot superbe appelé Gallia sur la carrière duquel je vais m’attarder quelques instants pour dire qu’il était un peu la fierté des travailleurs Seynois qui l’avaient construit dans nos chantiers. Mis sur cale en 1912, il avait été lancé en mars 1913. Long de 182 mètres, ce bateau de 15 000 tonnes pouvait atteindre 20,85 nœuds.
Il fut assuré à ses débuts à assurer des liaisons avec l’Amérique latine, mais la guerre de 1914 allait modifier son rôle par sa réquisition au service des transports de troupes de l’Afrique vers les fronts du Moyen-Orient (Salonique en particulier).
Ma mère et quelques autres civils avaient été autorisés à embarquer pour Marseille malgré la présence de quelque 2 000 Sénégalais couchés sur le pont et sur les entreponts.
A la nuit tombante, le Gallia s’éloigna lentement du quai de Sidi Abdallah. Mon père n’avait pu nous accompagner en raison de ses obligations professionnelles. L’encombrement était tel sur ce monstre navigant où grouillaient des milliers de vies humaines que ma mère trouva refuge dans une soute à charbon où elle réussit à déployer une chaise longue sur laquelle elle m’allongea pour assurer mon sommeil, elle-même repliée sur les tas de houille.
Un second maître de l’équipage voulut la chasser de la soute à charbon :
La discussion ne dura pas longtemps car on se bousculait dans les coursives. Que se passait-il d’étrange ? Le second maître se voulut rassurant en annonçant que le Gallia rebroussait chemin, la présence d’un sous-marin allemand ayant été annoncée au large de Bizerte. Devant le danger imminent d’un torpillage, le commandant du navire prit la sage décision de retourner à son point de départ.
Le lendemain matin, notre navire s’amarrait de nouveau au quai de l’Arsenal. Mon père, prévenu de ce contretemps, vint nous saluer de loin en agitant son mouchoir. Personne ne devait mettre pied à terre. Il fallut attendre une journée entière pour organiser un autre départ qui s’effectua cette fois sous la forme d’un convoi protégé par 3 contre-torpilleurs intercalés entre deux transports de troupes et deux hydravions (les premiers en usage dans la Marine). Et nous voilà repartis sur cette Méditerranée si pleine de dangers mortels.
Très au large de Bizerte, aucun danger n’apparut aux hydravions escorteurs et le convoi, si mes souvenirs sont exacts, se disloqua, l’un des transports de troupes prenant la direction de la Sicile. Quant au Gallia, il longea la côte algérienne pour s’amarrer à Philippeville pendant une journée entière. Les passagers furent autorisés à descendre et à faire quelques emplettes. Tout cela dans l’espoir de dérouter les sous-marins allemands. Le Gallia reprit la mer prudemment en direction des Baléares. Hélas, malgré la vigilance du commandant, en moins d’une heure, la vigie annonça la présence de l’ennemi. Notre tranquillité fut mise à rude épreuve. Un clairon retenti qui donna l’alerte : « Tout le monde sur le pont ! », criaient les officiers mariniers. « Mettez vos ceintures de sauvetage ! ». Les ordres se succédaient dans une ambiance frénétique. On attendait la torpille ! Quand tout à coup des coups de canon retentirent, partis du pont supérieur du Gallia. Précisons ici qu’en temps de guerre les navires civils étaient équipés d’une artillerie légère, mais tout de même dissuasive. Je me revois dans une embarcation de sauvetage au bras de ma mère, encombrée d’une ceinture de sauvetage énorme quand tout à coup un second maître survint, me saisit de ses mains vigoureuses en déclarant sur un ton péremptoire à ma mère qui ne voulait pas me lâcher : « J’exécute un ordre du commandant qui m’a chargé de sauver votre enfant ». Ce à quoi ma mère, furieuse, répondit : « Je sais nager aussi bien que vous, Monsieur ! ». Malgré mes cris et mes larmes, je fus confié à une chaloupe voisine occupée essentiellement par des hommes de l’équipage.
Les canons continuèrent de tirer sur leur objectif parfaitement identifié. Il est probable que le sous-marin allemand, dont nous ne pouvions savoir s’il avait été atteint, dut s’éloigner de sa proie. Mais la torpille ne vint pas. L’alerte avait été chaude. Le Gallia accéléra sa cadence pour gagner les côtes espagnoles. L’ordre revint à bord. L’espoir de revoir la France emplit à nouveau les cœurs. On oubliait déjà les minutes d’angoisse. Et pourtant, nous n’étions pas au bout de nos émotions. On nous annonçait que Marseille n’était plus très loin. Hélas, la vigie fit déclencher une nouvelle alerte et le même scénario bouleversant allait se reproduire quand la vigie cria très fort son erreur : « C’était une baleine ! », que ses jumelles avaient confondue avec un sous-marin. Pensez que cette information provoqua l’hilarité générale sur le navire !
En moins d’une heure, les officiers du bord nous firent identifier la silhouettée des côtes marseillaises et la position de Notre-Dame-de-la-Garde. Quel soulagement ! Quelles explosions de joie se manifestaient partout. Les sénégalais, nantis de leurs instruments primitifs, s’en donnèrent à cœur joie avec leur traditionnelle nouba.
Nous l’avions échappé belle après ces quatre jours de voyage que dura cette traversée de la Méditerranée. J’en ai entendu le récit des centaines de fois et il m’a semblé tout naturel d’en laisser une trace écrite.
Je reviendrai plus loin sur notre arrivée à La Seyne. Il me faut ici rappeler qu’à la fin de 1916, le superbe Gallia effectua son dernier voyage, donc quelques semaines après notre mémorable traversée. Le 3 octobre précisément, il partit de Toulon vers Salonique avec 2350 passagers dont 1650 soldats français, 350 Serbes et 350 marins. Son départ avait été retardé et le croiseur Guichen désigné pour l’accompagner n’avait pu remplir sa mission. Le 4 octobre, parvenu entre la Sardaigne et la Tunisie, il fut prévenu de l’arrivée d’une torpille, hélas trop tard pour manœuvrer et esquiver l’engin mortel qui atteignit des soutes à munitions dont l’explosion précipita le naufrage du beau Gallia. L’antenne de T.S.F. détruite, aucun secours immédiat ne fut possible. Le bilan fut très lourd : 950 passagers furent noyés. Voilà comment se termina la carrière de ce superbe navire – drame dont nous aurions pu être victimes, ma mère et moi, à quelques semaines d’intervalle.
 |
| Le paquebot Gallia
sur lequel Marius AUTRAN se trouvait lors de l'une des dernières
traversées de la Méditerranée par ce navire (Var-Matin, 2001) |
Revenons à Marseille où le superbe Gallia fut amarré au quai de la Joliette. En moins d’une heure, les milliers de fantassins sénégalais furent débarqués, alignés au commandement de leurs commandants d’unités hurlant des appels péremptoires. Ces soldats valeureux furent dirigés, au pas cadencé, vers la gare Saint-Charles où des trains les attendaient pour la direction du front de l’Est où ils iraient défendre leur mère patrie. Ils obéissaient servilement sans trop imaginer que la plupart d’entre eux verseraient leur sang et ne reverraient plus la savane qu’ils aimaient, ni leur famille africaine.
Les passagers civils, dont ma mère et moi faisions partie, furent soumis à d’autres obligations. Lesquelles, direz-vous ! A tour de rôle, il nous fallut assister à la fouilles des douaniers qui ouvrirent nos malles pour en vérifier le contenu et nous faire payer des droits sur certaines marchandises. Passons sur les détails ! Ma mère fut appelée au bureau de la douane et invitée à ouvrir une petite valise contenant seulement du “petit linge”. « Très bien, dit le préposé. Vous pouvez partir. A la personne suivante ! ». Je compris à son visage qu’elle éprouva un grand soulagement en nous éloignant de ces fonctionnaires inquisiteurs. Ele paraissait quelque peu incommodée dans sa démarche, à la recherche d’un porteur qu’il fallait trouver pour gagner la gare Saint-Charles où s’achèverait notre dernière étape pour Toulon et La Seyne.
Elle me fit alors une confidence qui me laissa stupéfait. Elle avait pris un grand risque en passant à la douane car, avant notre départ de la Tunisie, elle avait cousu dans la doublure de sa longue robe, traînant presque à terre, une quarantaine de paquets de tabac gris, qu’on appelait aussi le “caporal ordinaire”, marchandise contingentée à La Seyne, dont mon grand-père Marius AUBERT, fumeur invétéré, était cruellement privé.
Il est facile d’imaginer qu’un tel poids pouvait quelque peu gêner sa démarche hésitante. Je sus par la suite qu’avant son départ, elle avait procédé à des essais à la maison. Mon père lui avait dit : « Tu es folle ! ». Elle avait tellement le désir de procurer de la joie à son père qu’elle ne tint aucun compte des objurgations de son époux.
Un train omnibus nous amena en gare de La Seyne, après deux heures de marche d’une locomotive poussive crachant une fumée noire chargée d’escarbilles redoutables pour nos yeux si l’on avait l’imprudence de se pencher hors des compartiments.
La chance nous permit d’emprunter le dernier “Roulé” assurant la liaison avec la ville. Nous étions presque au bout de nos peines. La dernière étape, à pied celle-là, nous permit d’arriver enfin à Mar-Vivo, chez mes grands-parents, que nous avions quittés depuis plus de deux ans. Inutile d’insister sur l’émotion de ces retrouvailles, de nos embrassades, de nos larmes de joie, et sur les récits dramatiques des journées angoissantes vécues sur la Méditerranée.
J’allais donc connaître une nouvelle vie sous la garde, ô combien bienveillante, de mes anciens qui me semblaient vieux, alors qu’ils avaient à peine dépassé la cinquantaine.
Mes grands-parents, Marius AUBERT et Joséphine Hermitte avaient acquis depuis le début du siècle (le vingtième) une jolie propriété, une maison de campagne vétuste, mais fort bien conçue, avec un appartement de 3 pièces seulement dont une cuisine immense, flanquée à l’est d’une écurie au centre de laquelle on avait aménagé une noria pour l’arrosage du jardin étendu sur un demi-hectare. Ce local imposant abritait une ânesse appelée Madoun, une cuve à faire le vin, des tonneaux et tout l’outillage nécessaire au jardinage. A l’opposé de la partie habitable, un autre local avait été aménagé en buanderie nantie d’un puits, de lavoirs importants. Aucun engin mécanique n’existait alors. Mon grand-père retournait la terre à la bêche. C’était l’époque de la lampe à pétrole. La fée électricité était encore loin des foyers domestiques. Il n’y avait pas un seul tuyau dans la maison, pas un robinet à l’évier où régnaient deux grosses cruches alimentées par un puits voisin. Au centre de la cuisine, une cheminée basse immense habitée par un chaudron chauffé en permanence par un feu de bois en provenance de la taille des arbres et des haies de clôture, également de “têtes de bruyère” que périodiquement mon grand-père ramenait de la forêt de Janas, après avoir obtenu une autorisation écrite du garde forestier. L’appartement ne possédait aucune installation sanitaire. Le W.-C. était à l’extérieur et l’engrais humain permettait de récolter de beaux artichauts. Naturellement, c’est à l’extérieur que l’on avait aménagé le poulailler, les niches à lapins, et même, dans une certaine période, une auge pour l’élevage d’un porc.
Mes grands-parents n’étaient pas riches, mais ils ne manquaient de rien. Retraité de la Marine, mon grand-père avait terminé sa carrière comme premier maître mécanicien. Sa pension quotidienne atteignait 5 francs par jour, ce que des ouvriers qualifiés ne gagnaient pas toujours. Leurs ressources provenaient aussi de leur jardin, riche en légumes de toutes sortes, de l’élevage, de la chasse et de la pêche dont mon grand-père était fervent.
Malgré tous ces avantages en nature, ma grand-mère dépensait volontiers : Tata Bori, qu’elle appelait aussi Commère Bori, venait raccommoder le linge, repriser les chaussettes ; Madame Montera venait chaque semaine faire la lessive des AUBERT ; de temps en temps, la coiffeuse venait laver la longue chevelure de ma grand-mère, la rouler ensuite pour édifier un chignon gigantesque, coiffé par un grand chapeau traversé par une longue aiguille fixant à la fois la paille et le chignon afin d’éviter les effets désastreux du mistral. Ainsi, ma grand-mère, au cœur infiniment généreux, se plaignait se plaignait de l’insuffisance des retraites. Alors, elle encourageait son époux à exercer d’autres activités lucratives.
Dans les débuts de sa retraite, Marius AUBERT fut libraire dans la rue République. Quel esclavage ! Il lui fallait être au magasin dès le point du jour pour recevoir les premiers journaux. Ce métier ne lui convenait pas du tout. Il fut employé par la suite à la compagnie des bateaux à vapeur pour y encaisser l’argent des passagers. Quand il fut propriétaire à Mar-Vivo, il acheta l’ânesse Madoun et une petite charrette pour vendre ses légumes à La Seyne, activité dont il fut dégoûté quand il s’aperçut que lui, producteur, gagnait moins que les revendeurs.
 |
| Marius AUBERT |
Après toutes ces expériences décevantes, aggravées par la maladie occasionnée par un ulcère à l’estomac, il accepta tout de même vers la fin de la guerre de 14-18 un poste de dessinateur aux chantiers de construction navale. Il abandonna son jardin pour se consacrer à ses activités favorites : la pêche et la chasse. Une autre vie allait commencer pour lui, et sans doute la plus belle.
Je me suis sans doute écarté de ma propre biographie pour faire place à la vie de mes anciens, à laquelle j’ai été mêlé plusieurs années et dont j’ai le devoir de rappeler les souvenirs en reconnaissance des vrais bonheurs que mes anciens m’ont apportés.
Bien sûr, ma vie d’enfant n’était pas dénuée de toute contrainte. Jeune écolier des Sablettes, j’ai évoqué longuement dans le tome VI des Images de la vie seynoise d’antan les premières leçons de Joséphine Montpellier et de Mlle Suzini, devenue Mme Aball, le directeur du Crédit Lyonnais de l’époque.
 |
| Marius AUTRAN
(x) à l'École des Sablettes en 1917 |
J’ai souvent raconté à mon entourage familial comment se passèrent les années de mon enfance chez mes grands-parents, années de soins attentifs et surtout de liberté absolue, Marius AUBERT et Joséphine Hermitte étant si indulgents pour moi. Il faut dire ici que ma nature paisible ne leur donnait pas l’occasion de m’adresser des réprimandes sévères. Je ne me souviens pas de leur avoir causé la moindre contrariété, malgré toutes les libertés qui m’étaient offertes : liberté de m’occuper dans le jardin potager, d’aller me baigner à Mar-Vivo dont nous étions éloignés de 200 mètres à peine, cette plage où ma mère m’avait appris à nager dès l’âge de quatre ans ; liberté de pêcher les premiers rouquiers et les premières girelles depuis une éminence rocheuse voisine de la plage, appelée l’“Estèou” ; liberté d’escalader les cyprès de la clôture. Agile comme un singe, je sautais de branche en branche et me retrouvais au sol en sautant de plusieurs mètres sans la moindre écorchure ; liberté de courir en tous sens dans la pinède des Audibert, nos voisins.
 |
| Plage de
Mar-Vivo, vers 1910 |
 |
| Crique de La
Vernette |
Je me rappelle même la première matinée d’octobre où je pénétrai dans ces bois de pins et de chênes où sans doute je fus saisi par la beauté de la nature sauvage. Par un temps magnifique, sans le moindre souffle de vent, ma grand-mère m’avait demandé de lui ramener un petit fagot de brindilles pour faire griller quelques poissons que mon Pépé AUBERT avait pêché la veille. Et me voilà parti avec une cordelette terminée par un crochet métallique. Cet engin tout simple me permettait d’accrocher les branches mortes et de confectionner ainsi un joli fagot ramené sur mon dos, en quelques minutes.
J’interrompis un instant ce travail amusant et facile dont j’avais bien conscience de l’utilité. Je m’assis sur un tapis de mousses vertes, épaisses, alternant avec d’autres végétaux blancs et bleus dont j’appris bien plus tard qu’on les nommait des lichens. Mon regard se prit à observer dans le détail les végétaux environnants. Quel spectacle merveilleux s’offrait à mes yeux ! Des bruyères toutes fleuries de mille clochettes, des romarins aux corolles violacées répandaient des arômes inconnus pour moi, des gouttes de rosée perlaient à l’extrémité des aiguilles de pin et scintillaient sous l’effet des rayons du soleil levant.
Une espèce de rêverie, mêlée d’une émotion indéfinissable s’empara de ma petite tête pensante. A ces images troublantes de beauté, à ces parfums sauvages, venaient s’ajouter la petite chanson des rouges-gorges, les ritournelles des fauvettes et des mésanges bleues. Alors, saisi par une véritable émotion enivrante. Assis sur les tapis moelleux de mousse, ma contemplation n’en finissait plus et mes petits yeux bleus s’embuèrent de larmes.
Ce fut sans doute ce jour-là que la nature et ses splendeurs exercèrent sur moi un attrait magistral. J’aurai sans doute des choses semblables à dire à propos de ma découverte des rivages et des fonds marins.
La pinède des Audibert m’attirait toujours pour de multiples raisons, indépendamment des aspects poétiques fascinants évoqués à l’instant. Chaque saison m’offrait l’occasion d’y exploiter de modestes ressources. Après les premières pluies de l’automne, la recherche des champignons me procurait des joies indicibles : les “pissacans”, les “morvellous”, précédaient de quelques jours les délicieux safranés dont ma grand-mère faisait des grillades parfumées à l’huile d’olive et à la farigoulette. La recherche des champignons se poursuivait jusque vers la Noël si les froids n’étaient pas précoces. Il fallait tout de même observer une certaine prudence, car les oiseaux migrateurs envahissaient la pinède des Audibert : merles, grives, bécasses, passereaux aux espèces infiniment variées recherchaient les fruits sauvages et les vers du sous-bois. Et les chasseurs et les braconniers nantis de leurs fusils… et aussi de leurs pièges, se manifestaient parfois bruyamment. Mon grand-père, chasseur passionné, n’allait pas toujours dans la forêt de Janas pour ramener du gibier à la maison. Les bois de Mar-Vivo et de Fabrégas n’accueillaient-ils pas les lapins, les bécasses et autres gibiers ? Le printemps venu, la nature généreuse nous offrait les asperges sauvages, les escargots, la “coustelline”, les plantes aromatiques : le thym, le romarin, les baies de la salsepareille (“aglaria”) dont ma grand-mère faisait d’excellentes liqueurs.
Mes activités de plein air s’exerçaient aussi à la maison et surtout au potager dont je contribuais à la prospérité malgré mon jeune âge. J’aidais bien mon pépé pour l’arrosage des légumes, possible grâce à la noria actionnée par l’ânesse Madoun dont j’ai parlé plus haut. Mais la pauvre bête tournait péniblement pour remonter la chaîne de godets se vidant dans la rigole d’arrosage. Lassée par la monotonie de sa tâche, elle s’arrêtait souvent pour reprendre son souffle. L’eau n’arrivait plus aux salades assoiffées. Mon pépé m’appelait alors : « Marius ! Va faire marcher Madoun ! ». Piquetée par une badine acérée, l’ânesse repartait sans beaucoup d’enthousiasme.
Ce jardin potager m’apprit beaucoup sur les travaux agricoles : plantations, semis, récoltes, activités auxquelles je pris un goût certain que j’ai toujours apprécié malgré le grand âge auquel je suis parvenu. Ma grand-mère, spécialisée dans l’élevage des poules, des canards et des lapins, m’avait appris le nom des plantes comestibles pour les rongeurs : la “cardelle”, le séneçon, la pimprenelle.. Peut-être fut-elle à l’origine de l’intérêt que je pris dix ans plus tard pour la botanique.
Je n’en finirai pas de parler de Mar-Vivo où je découvris toutes les beautés de la nature, tout l’intérêt que l’home porte à l’exploration de ses richesses, les joies qu’il éprouve au travail de la terre malgré les caprices du temps. J’ai été confronté à des spectacles difficilement soutenables, celui du cochon qu’on égorge, du bassinage du sang noir pour fabriquer les boudins, des canards dont la tête tranchée sur un billot de bois n’empêchait pas l’animal d’échapper aux mains de son bourreau, des lapins égorgés et dépouillés de leurs entrailles, des nichées innombrables de petits chats qu’il fallait noyer dans des jarres, de la capture de couleuvres immenses qui pullulaient dans la roselière limitant la propriété. Tous ces spectacles m’étaient devenus familiers et contribuèrent dans une grande mesure à me donner un caractère courageux.
Ah ! Cette roselière (j’y reviens) où poussaient des roseaux immenses fut pour moi une source de joies infinies. C’est elle où l’on coupait de belles cannes pour la pêche, où je puisais des armatures pour ériger dans un coin du jardin des cabanes recouvertes de feuillages et de vieux sacs pour en assurer l’étanchéité en attendant des pluies providentielles. Alors, je m’y abritais comme un lièvre dans son gîte et je me réjouissais d’être capable de résister aux intempéries.
C’était aussi dans cette roselière drue que mon grand-père me faisait couper des tiges pour confectionner des canisses protectrices des rigueurs du froid pour sauver les salades du jardin. J’en profitais pour me fabriquer aussi des sabres dont j’imaginais qu’ils pourraient peut-être servir pour transpercer le corps des soudards de Guillaume II qui avaient envahi le nord de la France et pillé toutes les richesses de ses terres fertiles. Quand des amis de la familles venaient, on parlait beaucoup de la guerre et de ses désastres. Mes grands-parents vivaient dans des angoisses incessantes. Leur fils Paul avait été mobilisé dans le 7e Génie basé à Avignon, puis à Montargis. Il n’était pas sur la ligne de feu, mais ne tarderait pas à la connaître. Leur beau-fils Joseph AUGIAS avait été blessé grièvement à Verdun, où son père Louis avait péri sous les obus allemands en 1915. Notre voisin Audibert avait vu partir son beau-fils Marius Teissore pour le Maroc dont les indigènes, sous la conduite d’Abd-el-Krim luttaient pour leur indépendance. Bref, toutes les familles du quartier vivaient dans une perpétuelle inquiétude. Enfin, le 11 novembre 1918 arriva, avec l’armistice et la capitulation allemande, et ce fut un soulagement général. J’ai raconté dans le tome III des “Images de la vie seynoise d’antan”, chapitre “Les Audibert”, comment nous avions appris, en pleine forêt de Janas, le 11 novembre à midi, la fin du cauchemar qui durait depuis 4 ans, au terme duquel un million et demi de jeunes Français avaient laissé leur vie sur les champs de bataille par la faute des criminels de guerre. C’est un sujet que je n’aborderai pas ici. Beaucoup d’autres avant moi l’ont fait avec beaucoup de clarté. Je veux seulement faire référence à la parole d’Anatole France : « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels ». L’année 1918 s’acheva donc dans une ambiance d’espérances nouvelles.
 |
| Carte
écrite par Marius AUTRAN depuis La Seyne à sa mère
en Tunisie |
Mes parents, dont j’étais séparé depuis plus de 2 ans, arrivèrent à l’improviste un beau matin. Inutile d’évoquer les embrassades interminables, les rires, mais aussi les larmes de joie de ces retrouvailles familiales. Autant qu’il m’en souvient, je ne fus pas tellement ému et, confusément, je ressentis une sorte de gêne lorsque mes parents annoncèrent qu’ils venaient me chercher. Naturellement, ils m’avaient trouvé grandi. J’étais devenu un garçonnet qui allait sur ses huit ans. Mon père voulut savoir si je savais lire et compter. Il me posa de multiples questions auxquelles je ne pus répondre pour la simple raison que ses accents autoritaires m’impressionnaient au plus haut point. Sacré Simon ! Qui n’a jamais péché par indulgence !
Au bout de quelques jours, ce fut le départ pour la Tunisie, au grand regret de mon pépé et de ma mémé qui m’adoraient et savaient si bien satisfaire tous mes désirs d’enfant.
Notre retour s’effectua en toute sérénité, les dangers de la guerre sous-marine ayant disparu. Tout à fait. Je retrouvai l’appartement de la rue Franklin, des camarades de la rue bien grandis eux aussi. Ma mère s’occupa sans tarder de me faire inscrire à l’école primaire dans un cours moyen 1ère année. L’école était dirigée par un maître très sévère nommé M. FAUREL. L’instituteur qui me prit en charge était un mutilé de guerre dont la jambe droite était restée sur les bords de la Marne en 1914. Il exigeait une discipline stricte et son enseignement était d’une grande qualité. Je sus m’adapter à cette classe et, rapidement, je fus calasse dans les premiers. Une fois par semaine, le maître nous faisait chanter avec l’accompagnement d’une clarinette dont il jouait fort bien. La première chanson qui captiva mon attention s’appelait “Les Allobroges”, dont la musique est restée gravée dans ma vieille tête.
Je ne reviendrai pas sur la vie tunisienne que mes parents avaient appréciée depuis quelques années déjà. Dans la biographie de mon père, j’ai raconté beaucoup de scènes de la vie des petits colonialistes que nous étions. Je n’y reviendrai pas, ou à peine, pour expliquer les raisons, deux ans plus tard, de notre retour dans la métropole.
A partir de 1921, j’allais connaître la vie seynoise. Mes parents s’établirent tout d’abord sur le cours Louis Blanc, au n° 38, chez un propriétaire, vieux Seynois, nommé Guillaume BESSON, qui leur loua un appartement sans confort : pas d’eau potable, pas de W.-C. Il fallait monter tous les jours l’eau d’une fontaine de la rue d’Alsace, descendre à 5 heures du matin, toujours dans la rue d’Alsace, attendre le passage du vidangeur, collecteur de “toupines”.
Malgré les inconvénients de ce logement, au bout de la deuxième année, le propriétaire en augmenta le loyer, ce que mon père n’apprécia pas du tout. Alors, mes parents décidèrent un déménagement. Ce fut alors que Mme et M. DELAUD leur proposèrent un appartement au 3e étage d’un immeuble au n° 6 de la rue Hoche. [Mme DELAUD était une nièce de notre oncle Victor HERMITE. Son mari avait acheté à Victor HERMITE la boucherie jouxtant la pâtisserie Tisot au bas du cours Louis Blanc. Ma grand-mère Victorine HERMITTE (*), y était d’ailleurs bouchère et charcutière, au service de son frère Victor, avant de se marier avec Marius AUBERT. Ce magasin fut tenu ensuite par les sieurs AUTARD et VILLEDIEU dans les années 1920-1950]. Mes parents apprécièrent les avantages de ce nouveau logement où ils avaient l’eau courante et des W.-C., un balcon d’où l’on découvrait le port et la rade. Mon père se trouvait à quelques minutes du bateau à vapeur qui l’amenait chaque jour à l’Arsenal qu’il avait réintégré à son retour de Tunisie.
(*) Cette
orthographe n'est pas erronée, elle est conforme à
l'état-civil : le nom de mes ancêtres HERMITE est
orthographié avec un seul T jusqu'à Sauveur HERMITE et
son aîné Victor, avec 2 T pour ses autres enfants et leur
descendance.
J’étais devenu un élève de l’École Martini où j’avais été admis dans la classe de M. AILLAUD, instituteur d’élite qui me fit passer mon certificat d’études en 1921-22. Je n’insisterai pas sur ma carrière scolaire, évoquée longuement dans on premier ouvrage intitulé “Histoire de l’École Martini”.
 |
 |
 |
 |
 |
| Marius
AUTRAN, de 18 mois à 15 ans |
||||
Entre 1922 et 1928, je fréquentais l’École Primaire Supérieure avec profit, où un quatuor de professeurs (MM. GUEIRARD, ROMANET, LEHOUX, AZIBERT) travaillèrent tant et si bien qu’en juillet 1928, sept élèves de la classe de préparation à l’École Normale de Draguignan y furent admis avec brio.
Je crois bon de rappeler les souvenirs scolaires des quelques années écoulées entre 1922 et 1928. En 1923, je reçus l’enseignement de M. Lions au cours supérieur. Cette année ne fut pas très bénéfique pour moi. J’étais un élève moyen, jugé tout de même capable d’être admis l’année suivante en 1ère année de l’École Primaire Supérieure, dirigée par M. Peyron, chargé d’une heure de cours par semaine consacrée aux sciences naturelles. Ce professeur m’intéressa vivement à la botanique à tel point qu’il nous incita à confectionner un herbier où j’avais tout de même conservé une centaine de plantes étiquetées, portant les noms latins, le lieu de leur récolte, leur appartenance à des familles bien connues : composées, graminées, légumineuses,…
Dans cette 1ère année d’E.P.S. qui manquait de professeur de maths, nous allions prendre un bon trimestre de retard. Fort heureusement, le distingué Etienne GUIERARD, professeur de maths dans les 2e et 3e années (l’E.P.S. n’avait que 3 classes), prit l’initiative de créer un cours de rattrapage d’une heure tous les jeudis matins. Il nous apprit les premiers rudiments de l’algèbre et de la géométrie. Ces cours étaient payants (10 F par mois), mais mes parents furent bien satisfaits de cette initiative. Au bout de plusieurs mois arriva enfin un “professeur” de mathématiques, nommé BALDOCCHI, lequel n’avait jamais enseigné. Depuis peu, il avait quitté son uniforme de lieutenant pour entrer dans l’enseignement, déjà déficient en professeurs d’anglais, d’éducation physique, de dessin. La grande misère de l’enseignement sous la IIIe République était manifeste. Je pourrais multiplier les exemples vécus dans notre École Martini. Ce furent souvent les professeurs de français et de maths qui furent chargés des cours de gymnastique. L’ingénieur des Chantiers, M. LOVICHI, venait à “Martini” donner des cours de dessin, etc.
J’en reviens à ce soi-disant professeur BALDOCCHI, ex-lieutenant d’artillerie, dont l’enseignement n’était pas du tout adapté à nos connaissances, alors que nous découvrions à peine les rudiments de l’algèbre et de la géométrie. On collectionnait les zéros. Dégoûtés de l’enseignement de BALDOCCHI, la classe entière déserta ses heures de cours pour aller jouer aux boules chez un tenancier de bistrot du quartier Saint-Honorat. Naturellement, un conflit s’ensuivit. Nos parents furent convoqués et nos absences furent sanctionnées (Voir l’“Histoire de l’École Martini” et le passage savoureux intitulé “un jeudi inoubliable”. Mais, à quelques temps de ce conflit, le professeur incompétent fut muté, je ne sais où.
 |
| Classe de l'Ecole primaire supérieure de l'Ecole Martini au début de l'année 1928. On reconnaît notamment, assis au premier rang, de gauche à droite : Marius AUTRAN, E. CARRIÈRE, Vincent FOURNIER, André JAUFFRET, Toussaint MERLE, MEISTER, BRÉANDON, Émile GUIEU |
Malgré les incompétences, les insuffisances, les dysfonctionnements, tout ne fut pas négatif dans cette première année à l’E.P.S.. Deux heures par semaine de notre emploi du temps, nous recevions un enseignement pratique dans les ateliers de l’école : ajustage, menuiserie, chaudronnerie. Je fus affecté à cette dernière discipline, assurée par un contremaître des Chantiers nommé M. SAUVAIRE, qui se révéla bon technicien et bon enseignant. Il nous familiarisa avec les outils les plus usuels : martin, burin, fer à souder, limes, etc. Ces activités manuelles nous apprirent à “tomber des bords”, à emboutir, à confectionner des objets utiles, entonnoirs, par exemple.
Je fus admis en 2e année d’E.P.S. au cours de laquelle arriva un professeur originaire de la Normandie, un géant de 1,94 m exactement, d’une extrême sévérité. Il assurait essentiellement les cours de physique et chimie dans un laboratoire construit depuis peu en bordure de la rue Jacques Laurent. Ses cours me captivèrent et j’obtins avec ce professeur nommé LEHOUX des notes satisfaisantes.
Les autres enseignants de l’E.P.S. étaient M. AZIBERT (anglais, histoire et géographie), M. Étienne GUEIRARD, excellent professeur de mathématiques et M. ROMANET, nommé professeur de français depuis le début du XXe siècle.
A la fin de l’année 1926, dans le but dans le but de me familiariser avec des examens qu’il me faudrait bien affronter tôt ou tard, mon père exigea que je m’inscrive au concours des bourses (4e série). J’y réussis assez bien, obtins une bourse de 50 francs par an. Le fils de fonctionnaire que j’étais ne pouvait obtenir mieux. Ce n’était pas l’argent qui m’avait tenté mais seulement le mécanisme d’un examen qui comprenait un écrit et un oral. Mes notes de l’écrit avaient été convenables. Par contre, l’oral ne fut pas brillant. J’ai gardé un souvenir amer de l’épreuve de français où j’eus à expliquer un texte de Voltaire, auquel je ne comprenais rien. L’examinateur était l’inspecteur primaire Kléber SEGUIN dont je parlerai plus loin à propos de mon C.A.P. Il me donna une très mauvaise note en me disant : Monsieur, vous ne mordez pas trop au Voltaire ! ». Passons !
Malgré mes défaillances littéraires, je fus tout de même admis au concours des bourses 4e série.
Cette bourse annuelle de 50 francs me fut attribuée une seule fois. Ce dont je m’étonnai auprès du directeur de l’École Martini, M. MENDÈS, qui me renvoya sèchement en me disant qu’il m’aurait fallu en demander le renouvellement. J’ai le sentiment qu’il m’avait menti.
 |
| Classe de l'Ecole primaire supérieure de l'Ecole Martini au début de l'année 1928. On reconnaît notamment, assis au premier rang, de gauche à droite : Marius AUTRAN, E. CARRIÈRE, Vincent FOURNIER, André JAUFFRET, Toussaint MERLE, MEISTER, BRÉANDON, Émile GUIEU |
Et me voici maintenant en « 3e année d’E.P.S. au bout de laquelle il fallut affronter le concours d’entrée à l’École Normale de Draguignan.
J’y fus admis sur une liste supplémentaire d’où j’aurais pu accéder à la 1ère année à Draguignan s’il y avait eu des défections parmi les 15 premiers. Il n’y eut aucune défection, mais tout ne fut pas négatif car le concours à l’E.N. passé avec une bonne moyenne nous permettait tout de même d’obtenir le B.E.P.S. (brevet d’enseignement primaire supérieur et brevet élémentaire), titre ouvrant tout de même la voie à diverses administrations (P.T.T., Contributions, Secrétariat). Mes parents insistèrent pour une 2e préparation au concours de l’École Normale d’Instituteurs en 1928. J’ai raconté longuement dans l’“Histoire de l’École Martini” combien cette année-là me fut bénéfique, également pour 6 autres camarades de ma classe. Je rappelle le nom des lauréats : MIROY (2e), JALABERT (4e), GUILLAMET (5e), AUTRAN (7e), GUIEU (8e), MERLE (11e), BERNARD (15e).
7 élèves reçus sur une promotion de 17, c’était pour l’École Martini un succès flamboyant, dont la presse locale se fit l’écho. L’Amicale Laïque, que dirigeaient alors Étienne GUEIRARD et Pierre FRAYSSE (les francs-maçons de l’époque) nous offrit un goûter et une série de livres de la collection “Nelson”.
On fêta en famille mon premier succès universitaire, garant d’un avenir assuré. Mes parents et mes grands-parents n’arrêtaient pas leurs congratulations avec tous les parents, proches ou éloignés, les amis, les voisins.
J’en viens tout naturellement à parler des 3 années qui suivirent
Le concours de Draguignan, que nous appelions alors Dracène, puisque les habitants se nommaient les Dracénois. Il me semblait que les trois années d’internat à passer dans cette institution seraient interminables, dans une ville sans relief particulier. Dans quelles conditions d’accueil ? De la Direction ? Des professeurs ? Pourrait-on y trouver quelque distraction à nos heures de loisirs ? Autant de questions inquiétantes qui nous tenaillaient. Sans doute serai-je privé des attraits de me vie seynoise, de la campagne de mes grands-parents qui m’avait apporté tant de joies saines, des parties de pêche vers les “Deux-Frères” et le cap Sicié, de l’abondance des coquillages de la Petite Mer. Sans doute aussi mon pépé regretterait mon départ, moi qui tirait si fort sur les avirons de la Joséphine.
Et pourtant, il me fallait bien admettre cette vie nouvelle dont mon avenir tout proche dépendait.
Ma mère se mit en devoir de préparer mon trousseau de linge, de vêtements, de chaussures exigés par l’Économat de l’école. Ne fallait-il pas se procurer du matériel d’enseignement que l’administration de l’Éducation exigeait de chacun des lauréats du concours : trousse à dissection, microscope, boîte de compas et, sitôt inscrits en 1ère année, on nous annonça la nécessité d’acheter un violon. Bref, rien ne devait manquer aux équipements essentiellement culturels.
 |
| Marius AUTRAN à l'École Normale d'Instituteurs |
A la rentrée d’octobre 1928, nous retrouvâmes les admis toulonnais au concours. Ils étaient cinq seulement, ce qui autorisait les Seynois de l’École Martini à crâner sur le quai de la gare, accompagnés pour quelques-uns de leurs parents, dont ils seraient séparés pour de long mois.
Sur ce même quai se mêlèrent aussi quelques jeunes filles, toutes accompagnées de leur maman. Ce fut ce jour-là que je rencontrai pour la première fois la chère Louise GAUTIER, ma future épouse, dont j’étais alors bien loin de penser que, 4 ans plus tard, elle deviendrait la compagne de toute ma vie (64 ans de vie commune). Sa mère l’avait accompagnée et ne cachait pas son inquiétude de voir sa fille mêlée à la turbulence de quelques jeunes Seynois et Toulonnais jouant au matamore.
Le train s’éloigna dans un nuage noir aux redoutables escarbilles. Des cris de « Adieu La Mecque ! » retentirent, exclamations incompréhensibles pour le plus grand nombre des voyageurs. Il fallut changer de train à la gare des Arcs. En fin d’après-midi seulement, nous entrions dans notre école, passablement épuisés par de lourdes valises. Le surveillant général nous familiarisa avec les structures de l’établissement : salles d’études, dortoirs, vestiaires, réfectoire, etc.
 |
| L'École
normale
d'instituteurs de Draguignan |
Puis, le directeur, M. GILET, que nous n’avions plus vu depuis le mois de juillet, lors de la proclamation des résultats du concours d’entrée, vint prendre contact avec la promotion, nous parla de notre séjour à l’internat, multiplia conseils et recommandations, insista sur les exigences de la discipline collective. Son verbe, marqué de l’accent du nord dont il était originaire, et surtout l’expression de son langage, nous impressionnèrent au plus haut point. Il eut, sur la promotion attentive, un ascendant fait d’intelligence rare et d’autorité subite. De taille menue, visage émacié portant moustache et barbiche pointue, il impressionnait par son éloquence, la richesse de son vocabulaire, son regard luisant d’intelligence, son front largement dégarni, rayé d’une multitude de plis parallèles, le timbre de sa voix forte et persuasive, on sentait chez cet homme une volonté inflexible d’assumer toutes ses responsabilités et que, sous sa direction, rien ne serait laissé au hasard.
L’emploi du temps nous fut distribué, ainsi que les horaires quotidiens, auxquels il nous faudrait obéir, dès le lendemain matin.
 |
|
Il nous fallut une bonne semaine pour nous familiariser avec les locaux : toutes les salles de classe en rez-de-chaussée, salles d’études au 1er étage, dortoirs au 2e étage.
Le
lever à 6 h 30,
puis la toilette, puis la corvée de nettoyage des locaux avec la
sciure humide, mise en ordre de la literie, puis, petit déjeuner
au réfectoire (rez-de-chaussée), puis une demi-heure
d’étude avant le début des cours qui se
déroulaient de 8 h à midi.
 |
| Le service du dortoir |
J’en viens tout naturellement à parler des professeurs, hommes et femmes, sur l’enseignement desquels, dans son ensemble, je n’ai pas à formuler de critiques sévères. Le directeur, M. GILET, enseignait la psychologie en 1ère année, la sociologie en 2e année et la philosophie en 3e année. Son éloquence, sa puissance de persuasion, captivaient toutes les promotions. Sans conteste, il séduisait les élèves. Il nous apprit surtout la pédagogie*, l’art de savoir intéresser les jeunes auditoires auxquels nous serions confrontés bientôt. Il forçait le respect de tous, s’ingéniait à nous procurer des loisirs par la venue de conférenciers de haut niveau, traitant de sujets fort diversifiés : la musique, le droit, la mémoire, le pouvoir judiciaire, etc. Il nous emmena au moins une fois par trimestre en excursion pédagogique dans les villages environnant Draguignan. Ce jour-là, nous allions écouter des instituteurs dans leur classe respective – peu d’institutrices pour la simple raison qu’elles étaient rares à enseigner dans cette période. Rentrés à l’école, on faisait une sorte de critique, au demeurant fort courtoise, sur le travail des maîtres, la qualité de leur enseignement, la marche de l’établissement visité. Profitant de cette sortie, M. GILET eut le souci de nous faire connaître mieux notre département : Vidauban et son barrage, arènes de Fréjus, coopératives vinicoles, etc.
* M. GILET disait notamment :
« Vous devez en permanence captiver les enfants, vous devez
retenir leur attention, vous devez les intéresser. Si, à
un moment, vous en voyez un qui n'écoute plus, qui regarde en
l'air, attention ! C'est peut-être sa faute, mais commencez par
vous dire que c'est peut-être vous qui ne savez plus capter son
attention et qui ne l'intéressez plus ! C'est peut-être
vous et votre discours qu'il faut remettre en question ! ». Et
Marius AUTRAN saura mettre à profit ces conseils. Au dire de ses
élèves, il aura toujours su les intéresser et
jamais il ne sera chahuté (ses anciens élèves s'en
souviennent fort bien...).
M. GILET, entendait former des
maîtres d'élite, mais sa mission était aussi de
former des "Hussards de la République". Il n'hésitait pas
à conditionner ses futurs maîtres au contexte de
l'époque et à leur enseigner, non seulement la
laïcité, mais même l'anticléricalisme. Il dit
ainsi à ses élèves (je cite textuellement les
récits, maintes fois entendus, de mon père) : «
L'Église et l'Etat ont été clairement
séparés grâce à la Loi de 1905. C'est une
affaire entendue. Et l'Église n'a plus à intervenir dans
nos enseignements. Mais, faites attention car, ces curés, ces sales curés,
ils feront tout pour reprendre les prérogatives qu'ils ont
perdues. Alors, soyez vigilants ». (On n'imagine pas aujourd'hui
un Directeur d'IUFM utiliser un tel langage devant ses
élèves...). Marius AUTRAN retiendra aussi ces
leçons. Déjà issu d'une famille un peu "rouge" et
plutôt anticléricale, il sera jusqu'au bout un ardent
défenseur de l'école laïque. Il sera de ceux qui
diront à leurs élèves (dont certains,
naturellement, allaient aux cours de catéchisme après la
classe : « Je ne veux pas voir apparaître un livre de
catéchisme dans ma classe. Si j'en vois un (que vous auriez
sorti ou fait tomber par mégarde, il passe aussitôt dans
le poêle à charbon ! ». Je ne crois pas que cela se
soit produit avec lui, mais d'autres maîtres l'ont fait.
 |
| Alphonse GILET*
(extrait de la
photo de promotion 1920-1923) |
*
M. GILET avait alors seulement une quarantaine
d'années. Les élèves - cet âge est sans
pitié - le surnommaient pourtant le
vieux" ! Il avait fait la guerre de 14-18 et avait
été blessé à une jambe, qu'il
traînait un peu en marchant. Les élèves poussaient
l'ingratitude jusqu'à se moquer de lui pour ce léger
défaut ! Mais M. GILET était très économe
et, à titre d'exemple, il ressemelait lui-même ses
chaussures avec le caoutchouc tiré de vieux pneus. Ce qui lui
permettait d'inspecter discrètement l'école et de
s'aprocher des salles de classe ou d'étude sans se faire
entendre. Or, il était de coutume pour les élèves,
qu'après reçu quelque semonce de leur directeur, la
promotion toute entière, revenue dans sa salle d'étude,
réplique en faisant, à l'initiative d'un meneur, ce
qu'ils appelaient « Un bon geste pour le
vieux », c'est à
dire, tous ensemble, une série de trois bras d'honneur. Et un jour, au
milieu du troisième bras
d'honneur collectif, la porte s'ouvre brutalement et M. GILET
apparaît. On imagine les élèves ainsi surpris,
essayant de se donner une contenance en transformant leur geste en
quelque chose de naturel, se grattant l'oreille ou l'épaule...
Autres professeurs : M. LIEUTAUD, professeur de maths, excellent maître que les élèves avaient tendance à brocarder à cause de son articulation linguistique. Il ne disait pas « le travail manuel », mais « le travail manul ». Nous sûmes, par les traditions de l’école, Que M. LIEUTAUD avait beaucoup souffert de la guerre de 14-18, ayant été enseveli sous l’effet de l’explosion d’un obus de gros calibre alors qu’il commandait un escadron d’artillerie dont il était la capitaine. Les survivants avaient bien réussi à le déterrer, mais la commotion avait été si violente qu’il avait gardé des difficultés de langages consécutives au mauvais fonctionnement de son maxillaire inférieur. Les élèves le respectaient, ce qui n’excluait pas des farces qu’on lui jouait, à la nuit tombante, quand il nous emmenait observer les étoiles, car il était chargé aussi de nous enseigner la cosmographie. La lunette astronomique de l’école nous fit découvrir les cratères de la lune et même les anneaux de Saturne. Les mauvais plaisantins de la promotion arrivaient parfois à obturer l’objectif du télescope avec un cercle de carton de même diamètre. Alors, BISSON, l’auteur du forfait, protestait violemment : « Monsieur, je ne vois rien ! » - et il retirait ou remettait le carton en douce selon que c'était le professeur ou un élève qui avait l'œil devant l'oculaire. Mais le père LIEUTAUD comprenait tardivement la supercherie. Alors, il nous faisait rentrer plus tôt que prévu dans la salle d’études.
M. ESCULIER, professeur de lettres, assurait également l’économat de l’école. Il inspectait chaque matin la propreté des locaux que les élèves eux-mêmes devaient entretenir à la sciure humide. Les élèves de 1ère année, appelés les “Protos”, étaient chargés de l’entretien d’un grand dortoir (réservé aux 1ères et 2e années). Un petit dortoir (15 à 16 places) était occupé par les Vétérans (3e années). Les cours de français de M. ESCULIER (que nous appelions “Cucu”) étainet bien fait, mais ne m’ont jamais passionné. Les exploits du Cid et les amours d’Andromaque m’ont toujours laissé indifférent. “Cucu” était marié à une institutrice, obèse. Il était père de deux fillettes. On les voyait partir, tous les quatre, chaque dimanche matin, prendre le chemin de l’église pour assister à la messe, ce que je n’appréciais guère pour un professeur de l’enseignement laïque (il était libre, bien sûr !).
La chaire d’histoire et géographie était assurée par une dame, célibataire, âgée de 30 ans à peine, qui répondait au nom de Mlle CORNU*, un nom que les élèves trouvaient ridicule. Ses cours n’avaient rien de captivant. Une heure durant, ce professeur (si l’on peut dire !) lisait son cours. Sa myopie l’obligeait à pencher sa tête sur ses textes, de sorte qu’elle ne regardait jamais ses élèves – des textes semblables à ceux des livres en notre possession. On gribouillait quelques notes sur des papiers de brouillon qu’on jetait à la fin des cours. Une telle manière d’enseigner engendrait forcément le chahut dans la classe et même des désordres plus graves. Son bureau n’étant pas fermé sur le devant, Mlle CORNU, aux robes plutôt courtes, ne craignait pas de croiser ses cuisses bien haut et les élèves du premier rang en profitaient même pour observer sa culotte dont ils faisaient des croquis qui circulaient de main en main. On devine la cause des rires étouffés et des désordres qui s’ensuivaient. Alors, la prof d’histoire et géographie s’interrompait par instants et s’exclamait : « C’est inimaginable d’avoir affaire à des élèves pareils ! ».
*
Vingt ans plus tard, Mlle
CORNU
deviendra directrice de l'École Normale de Jeunes Filles de
Draguignan.
On lui aurait sans doute pardonné la mauvaise qualité de son enseignement si elle avait été belle. Hélas ! la nature ne l’avait pas gâtée et ses galants furent sans doute très rares. Et pourtant, elle essayait de séduire par des parfums très mal choisis. Si mal que le professeur qui luis succédait (il s’agissait de M. MONDET, enseignant de la langue italienne et aussi de la musique), pénétrant dans la classe exprimait avec sa truculence coutumière, alors que “La CORNU” était sortie (heureusement, d’ailleurs) : « Ça sent la charogne ici ! Pour ne pas dire la putain ! ».
J’ai aussi beaucoup à écrire sur le professeur MONDET, très estimé par contre de tous les élèves, à cause de ses compétences et surtout de ses indulgences. Chargé de l’enseignement de l’italien et de la musique, il savait intéresser son auditoire par sa faconde intarissable, et pourtant les difficultés ne manquaient pas. En effet, les Normaliens originaires de Toulon, De Fréjus et de Lorgues savaient déjà parler et écrire l’italien qu’ils avaient pratiqué pendant deux ou trois ans dans leurs écoles respectives. Mais nous, les Seynois, avions eu l’anglais comme seule langue. M. MONDET avait donc affaire à des élèves nuls en italien et d’autres (la moitié de la promotion) à des élèves d’un bon niveau leur permettant de surclasser tous les autres. M. MONDET fut d’une grande indulgence pour les Seynois qui, parvenus au Brevet supérieur, n’eurent jamais de notes éliminatoires pour leur insuffisance. C’est pourquoi je parlais plus haut des indulgences du professeur MONDET, dont nous savions par ailleurs qu’il exerçait des fonctions de traducteur officiel dans les tribunaux où des accusés d’origine italienne avaient à se défendre de leurs forfaits éventuels.
Les horaires de M. MONDET comportaient 2 heures d’enseignement de la musique, ce qui supposait que nous connaissions le solfège. Hélas ! Dans ce domaine, nos lacunes étaient immenses. Dans les E.P.S. d’où nous venions, les professeurs de musique n’étaient pas toujours faciles à trouver et leur enseignement intermittent manquait plutôt d’efficacité.
A notre grande surprise, il nous avait été demandé d’acheter un violon. Je n’ai jamais compris la raison du choix de cet instrument, le plus difficile sans doute, pour apprendre à nos futurs élèves de l’école primaire à chanter des choses faciles, alors qu’un simple galoubet aurait permis de le faire.
Quand je fus instituteur, j’achetai une grande mandoline, mais je dois dire que l’enseignement de la musique et la pratique du violon me furent tout de même bénéfiques.
Passionné de musique, M. MONDET fut pendant longtemps dirigeant de la philharmonique La Dracénoise, qu’il fit prospérer avec des musiciens de haut niveau, avec M. Milhaud, virtuose du saxophone, dont j’aurai à reparler en sa qualité d’instituteur d’élite, maître qui me fit faire ma première leçon d’histoire à l’école dite annexe, de Draguignan.
Si M. MONDET fut estimé à la fois pour son enseignement de l’italien et de la musique, un autre professeur de très haut niveau, M. COUX, doit être félicité et remercié pour la haute qualité de son enseignement des sciences physiques et naturelles. Particulièrement autoritaire, exigeant du travail bien fait, il ne fut jamais porté vers la plaisanterie. On le craignait, on le redoutait. Je ne me souviens pas de l’avoir vu sourire une seule fois et il forçait tout de même l’admiration de ses élèves pour l’immensité de son savoir et surtout pour la puissance de sa persuasion. Il disposait de deux tableaux immenses qu’il recouvrait de formules pour la chimie, écrites à la perfection, nous laissant la liberté, même après ses cours, de les consulter, de les recopier, sans nous renvoyer à la lecture d’un ouvrage de physique ou de chimie. Les expériences, les dissections, se faisaient spécialement dans la salle de sciences et le laboratoire, présidé par l’Oscar, un squelette humain complet, suspendu près de la porte d’entrée. M. COUX nous apprit les sciences naturelles, la botanique en 1ère année. J’adorais les exercices de détermination des plantes sauvages, les coupes de tiges grossies au microscope où l’on découvrait les structures cellulaires des végétaux. Et puis, dans les années suivantes, ce furent les collections d’insectes, de papillons qu’il fallait conserver. Bref, malgré son caractère austère, M. COUX sut intéresser ses élèves à son enseignement de haute qualité.
Pour la petite histoire, il me semble nécessaire de dire que nous avions pour lui le plus grand respect. Sans chercher à le brocarder, la tradition normalienne voulait qu’on l’appele Nan-Na en raison de ses accents pyrénéens qui lui faisaient dire, par exemple, cette AN-NÉE au lieu de ANNÉE. Un détail de l’histoire !
Un autre personnage que je n’aurai garde d’oublier fut le professeur de dessin, M. NADAL, très compétent dans son métier, d’un caractère quelque peu suffisant. Il nous contait parfois des faites de la guerre de 14-18, où sa conduite courageuse l’avaient fait accéder au grade de caporal. Aussi ses élèves le surnommaient tout bonnement “le caporal NADAL”.
L’essentiel a été dit sur les professeurs principaux, leur enseignement, leurs qualités généralement excellentes, rarement leurs défauts.
Je ne parlerai pas ou peu d’autres enseignants appelés à faire des stages ou des remplacement de professeurs en congé de maladie. Je pense à M. CLERC, à Mme NOYER, à Mlle BOUCHERY, à M. GAUTIER. J’en oublie certainement (le professeur d’éducation physique, dont le nom ne m’est pas revenu – M. DEAMRBRE, je crois).
*
Marius AUTRAN a omis de
parler du médecin scolaire, le Docteur PÉLOQUIN, que les
promotions de normaliens, garçons et filles, avaient
surnommé “PÉLO” et qui n'était
guère apprécié en raison de sa
grossièreté et de ses commentaires plutôt crus
lorsqu'il examinait les jeunes normaliennes partiellement
dénudées. Une longue chanson humoristique avait
été composée par les normaliens, que mes parents
chantaient encore en chœur dans les années 50,
malheureusement oubliée depuis, sauf la fin d'un couplet qui
disait : « ... et alors Pélo - N'aura plus d'boulot !
».
Il me faut tout de même ouvrir une parenthèse à propos de la préparation militaire qui se passa en 2e année. Cet enseignement nous prenait deux heures par semaines, mais à titre facultatif. Je n’étais pas porté sur cette discipline, mais les copains m’incitèrent à suivre les cours de la P.M. en m’expliquant les avantages que l’on pouvait en espérer si l’on était admis au concours des élèves officiers de réserve de Saint-Maixent, à notre sortie de l’École Normale.
Dans cette période, la durée du service militaire avait été réduite à 1 an. Après 5 mois ½ de Saint-Maixent, nous serions officiers, et mieux rétribués que dans l’enseignement primaire. Et puis, en cas de conflit (ne parlait-on pas déjà de la seconde guerre mondiale ?), il valait mieux faire la guerre comme officier. Je me laissai convaincre par plusieurs amis, dont GUILHAMET, dont le père, officier, avait disparu en 14-18. Avec lui, je trouvai JALABERT, MIROY, MORVAN, BISSON, MERLE, BERTORA.
Les instructeurs venaient généralement de Nice chaque jeudi (commandant GRISAUD, Adjudant-chef CARRÉ). Les exercices avaient lieu dans un immense champ inculte, face à l’École Normale (le champ du père Achard).
 |
| Préparation
militaire
supérieure, avec l'adjudant-chef CARRÉ |
Tous les élèves de la P.M. furent admis en juillet 1931 à l’École des Officiers de Réserve, sauf MERLE qui avait abandonné les cours à la suite d’une altercation avec l’instructeur.
Avant d’en venir au volet militaire de ma vie, je veux en terminer avec Draguignan et son École Normale.
Les conditions de la vie matérielle laissaient à désirer. Seule la grande salle était chauffée par un poêle à charbon de dimensions modestes que les élèves eux-mêmes devaient alimenter. Les dortoirs n’étaient pas chauffés, ni les lavabos, et on allait aux douches une fois par semaine. La nourriture laissait beaucoup à désirer. On mangeait pas table de 8 (3 protos, 3 dotos, 2 vétérans – lesquels se servaient les premiers et copieusement). La viande, mangée le plus souvent en ragoût, était de qualité très inférieure et restait souvent dans les assiettes. Une fois par semaine, on nous servait du poisson desséché venu de l’océan à prix plus que modeste*. Il arriva que les chefs de promotion demandent audience auprès de l’économe, M. ESCULIER, pour lui exprimer le mécontentement des rationnaires, qui mangeaient tout de même à leur faim. Outre la qualité de l’alimentation qui laissait à désirer, les gamelles en fer blanc, ainsi que les quarts de même nature, n’incitaient guère à l’appétit de notre jeunesse. On ne souffrait pas de la faim mais, le plus souvent, pendant la récréation de 10 h, nous allions dans la salle des malles où chacun avait des provisions de saucisson, de fromage, et même des œufs. Le cuisinier était un gendarme en retraite et ne pouvait guère supporter les récriminations des élèves.
*
Un jour, un élève
se rebella, jugeant ce poisson impropre à la consommation.
Alors, le directeur, M. GILET, envoya l'élève chez ses
parents (à Fréjus ou Saint-Rapahël ?) avec pour
mission de leur amener le poisson enveloppé dans du
papier, comme pièce à conviction, avec un courrier qu'il
avait signé leur demandant de constater que ce poisson
était parfaitement consommable et leur expliquant qu'il ne
pouvait offrir mieux à ses élèves vu le budget
sont il disposait.
L’économe, quant à lui, justifiait les insuffisances en expliquant qu’il disposait de 7 à 8 F par jour et par élève pour nourrir, laver notre linge, entretenir les locaux. Il aurait bien voulu faire mieux. Hélas ! Il n’en avait pas les moyens.
Par mesure d’économie, le directeur nous faisait ramasser les sarments des vignes taillées à la fin de l’hiver, dans les propriétés voisines de l’école. Ce combustible permettait, seulement l’année suivante, d’allumer le feu des poêles de l’École Normale et de l’École Primaire annexe. Cette corvée nous amusait plutôt. Les vétérans, élèves de 3e année, en étaient exemptés.
Nos heures de loisirs n’étaient pas des plus variées. Le règlement de l’école nous autorisait à sortir en ville le jeudi après-midi et le dimanche toute la journée. On profitait de la visite de parents ou d’amis pour prendre un repas au restaurant, sans oublier de prévenir le cuisinier qui faisait quelques économies à cette occasion.
Le plus souvent, le dimanche se passait en ville avec le secret espoir de croiser dans les rues, des Normaliennes, lesquelles, dans les années 1928-30 sortaient en colonne par deux, accompagnées d’une surveillante de l’école. Personnellement, je fus autorisé, à la fin de la 2e année, à rencontrer ma fiancée au parloir de l’École Normale de filles en vue du mariage “péda”, expression de l’époque.
 |
| Louise GAUTIER |
Louise avait été reçue Normalienne en 1928, comme moi. Nos entrevues au parloir de l’école ne duraient pas plus d’un quart d’heure. Pour en arriver là, des échanges de correspondances avaient été indispensables entre mes parents et la directrice de l’École Normale de filles, Mme Weill, d’une part ; entre ma future belle-mère et la directrice, d’autre part.
Généralement, nous passions nos dimanches après-midi dans la nature dracénoise. Avec quelques camarades aux mœurs paisibles (AUTRAN, Guieu, Bernard, Coudenq), nous ne fréquentions pas les bars ni les cafés. Pour satisfaire aux exigences de M. COUX nous allions à la recherche des plantes, des papillons et autres insectes dont nous faisions la collection. Certains capturaient des hannetons, des capricornes, des criquets, qu’ils emprisonnaient dans leur bureau où s’accumulaient les grosses boîtes d’allumettes. Mais la plupart des Normaliens passaient leurs dimanches dans les cafés à jouer aux cartes (activité que j’ai toujours détestée).
Il y avait bien un cinéma à Draguignan, mais il n’ouvrait qu’entre 4 et 5 heures, heures auxquelles nous devions être rentrés à l’internat.
Autrement dit, la vie dracénoise n’avait rien de particulièrement attractif. De loin en loin, M. MONDET, chef de la musique locale, offrait à la population un concert de musique classique. Il n’y avait pas de bal du dimanche. On ne notait une animation inaccoutumée qu’au moment des examens et concours [lesquels déroulaient à la Préfecture du département], au moment aussi des instances du tribunal correctionnel, où nous avions parfois l’occasion de rencontrer des Seynois, désignés pour être membres de jurys. Plusieurs d’entre eux m’invitèrent au restaurant de la gare et nous régalaient de menus succulents auxquels le cuistot de l’École Normale ne nous avait guère habitués.
Avant
d’en finir
avec la vie dracénoise et l’École Normale,
j’en reviens à des sujets que j’aurais dû
évoquer au début de ce récit : les
“traditions”. Elles consistaient à mettre à
l’épreuve les “protos” en leur faisant subir
une série d’épreuves durant la première
quinzaine qui suivait la rentrée, des mesures vexatoires,
toutefois sans gravité excessive. Les organisateurs (les
élèves de 2e et de 3e année) voulaient, par le
biais de ces mesures, affirmer leur autorité sur les nouveaux
venus. De telles choses se pratiquaient ailleurs dans toutes les
Grandes Écoles de France. Elles se concrétisaient par des
farces, par exemple, les lits en portefeuille préparés
à l’insu des victimes, obligées de refaire
complètement leur lit au moment du coucher ; commander aux
protos de monter dans le grand dortoir du 2e étage de vieux
poêles à charbon, corvée bien inutile
puisqu’on ne chauffait jamais (bien évidemment, il fallait
les redescendre à la cave le lendemain) ; passer devant un
tribunal qui accusait tel ou tel élève d’avoir,
paraît-il, manqué de respect à un
vétéran (ce tribunal était constitué de
plusieurs juges cagoulés, recouverts d’un drap blanc dans
une pièce obscure à peine éclairée par la
lueur d’une bougie brûlant à
l’intérieur du crâne de l’Oscar, et le
condamné devait embrasser le crâne [brûlant] et
recevoir quelques coups sur la tête du gros dictionnaire
Littré) ; être inspecté dans le dortoir, chemise de
nuit relevée, par un jury d'Anciens notant les attributs sexuels
des “Protos” avec des commentaires désobligeants :
« Moi, je lui mets 11/20 » - « Tu rigoles, ça
vaut même pas la moyenne ! », etc.
*
Marius AUTRAN écopa comme
tâche d'avoir à aller graisser une
girouette, fixée
à une hauteur inaccessible, et d'aller d'abord demander la graisse à
l’économe de l'école. Il y alla en toute
sincérité mais, au sourire en coin que lui fit l'M.
ESCULIER, il comprit alors seulement qu'il faisait l'objet d'une farce.
Les “Protos” devaient subir ainsi une multitude de vexations auxquelles d’ailleurs ils se soumettaient patiemment pour ne pas s’attirer la vindicte des Anciens. Tout cela se terminait un dimanche par une réception au plus grand café de la ville au cours de laquelle les “Protos” offraient aux Anciens une liqueur qu’on appelait le kummel.
Je crois savoir que ces pratiques, que j’ai toujours estimé ridicules, n’ont plus cours aujourd’hui. Je m’empresse d’ajouter qu’à Draguignan, il n’y a plus d’internat, l’École Normale ayant été supprimée.
Nous voici en octobre 1931. Le 15 de ce mois, je devais être appelé au service militaire.
Du 1er au 15, je fus nommé instituteur adjoint à l’école primaire de Saint-Cyr-sur-Mer. Profitant de ce cours séjour, j’avais demandé à l’Inspection Académique de passer mon C.A.P. (Certificat d’Aptitude Professionnelle). Quelques jours avant de rejoindre la caserne du 3e R.I.A. à Hyères, je fus donc inspecté par M. SEGUIN (Kléber, de son prénom), qui me jugea sur une leçon de grammaire et sur une leçon de géographie, épreuves dont je pensais m’être tiré avec aisance. Mais, à ma grande surprise, l’inspecteur m’accabla de vives critiques en présence du jury, auquel participaient le directeur de l’école de garçons, M. VINCENT, et la directrice de l’école de filles dont j’ai oublié le nom. Quand le jury eut délibéré, Kléber SEGUIN m’informa qu’il m’accordait mon C.A.P. avec beaucoup de réserves. Il me donnait la note de 10 ½ sur 20. Je fus profondément vexé. Après son départ, les autres membres du jury m’affirmèrent leur soutien total et me racontèrent que la discussion avec l’inspecteur avait été des plus vives : « Ce jeune homme a tout de même des qualités pour enseigner », lui dirent-ils. Ils étaient 2 sur 3 pour me défendre. L’inspecteur s’inclina. Comment n’aurais-je pas été vexé, moi qui était sorti major de ma promotion avec une note pédagogique de ma promotion, avec une note pédagogique de 19/20 (coefficient 4) ? J’informai dès le lendemain M. GILET de ma déconvenue. Il me répondit sa satisfaction de mon succès, même relatif.
 |
| Rapport du stage
effectué par Marius AUTRAN à l'école primaire
d'application de Draguignan |
Avant de rejoindre la caserne Vassoignes à Hyères, je partis à bicyclette informer ma fiancée qui, de son côté, avait été nommée institutrice au Plan-du-Castellet (nous n’avions pas de téléphone à cette époque). On fêta modestement ce succès. Louise passa son C.A.P. avec succès dans le courant de l’année 1931 avec ce même inspecteur, sans doute plus courtois avec les jeunes filles. Passons !
Je crois bon d’ajouter, pour compléter mes débuts dans l’enseignement,, le texte de mon premier rapport de stage, rédigé par M. MILHAUD, instituteur d’élite, travaillant sous la direction de M. GOÏBAS.
Je fus appelé plusieurs fois, pendant mes années passées à l’École Normale de Draguignan, à effectuer des remplacements d’enseignants en congé de maladie (cela à titre absolument bénévole), comme il m’arriva pendant plusieurs mois de remplacer le surveillant général de l’époque, M. Bouvier, appelé au service militaires. Décidément, j’avais vraiment conquis la confiance du directeur Alphonse GILET, dont j’ai gardé un souvenir particulièrement attachant de sa rectitude à tous égards et surtout de sa vive intelligence.
Il me faut ajouter qu’avant d’obtenir mon C.A.P. en octobre 1931, avant de quitter l’École Normale, le 4 juillet 1931 précisément, j’avais obtenu, après des épreuves d’éducation physique de haut niveau, un diplôme de maître de gymnastique, ce qui me permettrait, le cas échéant, de donner des leçons d’éducation physique et sportive dans un Collège d’Enseignement Secondaire.
Au mois d’août, avec les camarades de la préparation militaire supérieure, il fallut nous rendre à Marseille, présenter le concours d’entrée à l’École Militaire de Saint-Maixent, formalité qui dura seulement une matinée (manœuvres d’une section d’Africains, très disciplinés d’ailleurs ; interrogatoires sur les armements en usage ; le service de places ; manipulation du fusil-mitrailleur, de la mitrailleuse Hotchkiss). Nous furent tous admis sans difficultés majeures. Il nous fallut alors attendre le 15 octobre pour être appelés à la caserne Vassoignes à Hyères.
Cette période de ma vie n’a duré qu’une année, la durée du service ayant été ramenée à 1 an depuis peu. Je retrouvais mes camarades normaliens pour 3 ou 4 jours seulement. Le temps de voir des soldats occupés dans la cour à passer les lits en fer au chalumeau, seul moyen pour les débarrasser des punaises ! La nourriture était exécrable. A la surface de la soupe surnageait une épaisseur de suif qui collait à la cuillère. Les haricots secs étaient plus ou moins cuits et les ratas de pommes de terre étaient souvent au menu. Passons !
Le deuxième jour, passage à l’infirmerie pour le vaccin anti-typhoïde. Diète et fièvre carabinée, épaule terriblement douloureuse.
Le jour suivant, l’ordre arriva de nous embarquer pour Saint-Maixent. Nous reçûmes tout l’équipement à transporter (40 kgs chacun) alors que nous étions encore souffrants de la maudite piqûre, obligés de rejoindre la gare de La Farlède à pied ! Accablés par nos fardeaux, nous avions bien failli manquer un train qui devait nous amener à la gare de Toulon, d’où nous devions prendre un autre train pour Marseille, un autre pour Bordeaux et encore un autre pour Niort (Deux-Sèvres). Ce voyage devait durer 2 jours. Nous avions assisté au désastre des inondations de la Garonne : une immense partie de l’Aquitaine avait vu ses cultures et ses fermes noyées. Un spectacle affreux. Le train qui nous amenait à Bordeaux roulait à faible allure, car la voie ferrée émergeait à peine de l’eau des inondations.
Finalement, notre voyage vers Saint-Maixent dura presque 3 jours. En fin de parcours, les autorités militaires nous attendaient à la gare de Saint-Maixent. Des sous-officiers courtois nous conduisirent à la caserne immense des E.O.R. qui recevait l’effectif d’un bataillon.
*
Dès
leur arrivée, le réglement imposait qu'ils fussent
obligatoirement vaccinés contre la typhoïde. Or, ils
venaient de l'être trois jours auparavant et n'en étaient
toujours pas remis ! Rien à faire, aucune explication ne fut
recevable pour le major. Le réglement, c'est le
réglement. Ils furent donc re-vaccinés avec de nouveau
une fièvre de cheval ! Dans la nuit, l'un des
élèves faillit en mourir d'étouffement. Le niveau
de fièvre qu'il avait était tel qu'il avalait sa langue...
Je ne parlerai pas, ou peu, de la ville elle-même, de prime abord au caractère austère, dont l’histoire remonte au Moyen Âge. On trouvera dans ma bibliothèque un ouvrage qui lui a été consacré, ouvrage que mon petit-fils Nicolas m’offrit à l’occasion de mon 90e anniversaire. Elle fut mêlée aux luttes patriotiques que mena Philippe Auguste pendant la Guerre de Cent Ans, qui refoula les Anglais hors de la France.
Il bruinait lors de notre arrivée dans la cité et la grisaille du climat persista pendant tout notre séjour, ce qui n’empêchait pas les paysans de labourer la terre et les habitants de vaquer à leurs occupations quotidiennes de la ville.
Les bâtiments de l’École portaient des noms de batailles de la guerre de 14-18 (Verdun, Grivesnes, etc.). Chacun reçut l’effectif d’une compagnie (4 officiers, 11 sous-officiers, 185 hommes). Chaque section occupait une chambre. L’effectif comportait des E.O.R. en provenance de toutes les provinces françaises. Je trouvai cela très sympathique et aussi très ingénieux pour nous donner une idée de la France. J’ai le souvenir précis de camarades parisiens, toulousains, provençaux, alsaciens, auvergnats avec un accent très particulier.
 |
Pour la première fois, je fis la connaissance de “pieds-noirs”, venus d’Algérie (École Normale de Bouzarca). Ma section comportait une majorité d’enseignants. A la tête de notre lit était disposé ce qu’on appelait le paquetage : libé de corps, tenue de sortie, objets personnels, arme. Le règlement exigeait des alignements impeccables.
 |
| Marius AUTRAN et
son paquetage |
La chambrée occupée, on nous affecta une place dans la salle d’étude. Il y avait une par section, un bureau par élève équipé de papier brouillon et surtout de livres – une vingtaine – portant sur tous les aspects de la culture militaire que nous allions recevoir : règlement de manœuvre, service de place, armes en usage dans l’infanterie (mitrailleuse, fusil-mitrailleur, canon de 37, mortier, fusil individuel – le fusil Lebel qui avait remplacé le Chassepot de la guerre de 1870), histoire complète de la guerre de 14-18.
Par la suite, il nous fallut assimiler chaque ouvrage sur lequel nous fûmes interrogés chaque semaine par un instructeur devant lequel il fallait se présenter en tenue de sortie et ganté de blanc.
La compagnie à laquelle j’étais affectée était commandée par un capitaine de “chasseurs alpins” nommé Combalat, homme de petite taille que l’on tournait souvent en dérision à cause de son langage maladroit, hésitant, quelquefois bafouillant. Par contre, notre lieutenant instructeur, nommé Jonglez de Ligne, homme distingué par sa parole, son savoir militaire, sa puissance de persuasion, jouissait d’une grande considération parmi les élèves-officiers.
 |
| Marius AUTRAN
(X) et sa promotion Au premier rang, au centre, le lieutenant JONGLEZ de LIGNE et le capitaine COMBALAT |
La première journée fut consacrée à des réunions d’information sur le règlement intérieur, les activités, la marche générale de l’établissement, la discipline. Tout nous parut normal : lever à 6 h 30, toilette, petit déjeuner à 7 h, étude, départ pour les exercices du matin, toujours vers les terrains d’exercice (le fameux Panier Fleuri, dont les fleurs ne devaient guère se montrer qu’au printemps). Tous les après-midis étaient consacrés à des cours théoriques faits par des spécialistes (artilleurs, service géographique de l’armée, etc.). Tous les mouvements des unités (sections, compagnies) devaient se faire au pas cadencé, en colonne par trois et chacun des élèves devait les commander à tour de rôle 1 ou 2 fois par mois.
On allait à la cantine 3 fois par jour en bon ordre. La cantine était en fait un véritable restaurant recevant 600 à 700 rationnaires par table de 10. Le silence n’était rompu que par des conversations sans éclat de voix. Un officier, ganté de blanc, sabre au côté, circulait entre les travées pour intervenir en cas de désordre. Pendant toute la durée de mon séjour, aucun incident ne se produisit.
Une fois par quinzaine, il fallait se rendre au stand de tir situé à 15 km de Saint-Maixent. Les exercices se faisaient souvent à plusieurs kilomètre de la caserne. Il est évident qu’il nous fallait marcher beaucoup et hélas ! sous le crachin des pays de l’Ouest, ce qui nous posait de graves problèmes pour le séchage de nos capotes et vareuses. A ce propos, il me revient une réflexion pour le moins ridicules de notre capitaine Combalat qui, se voulant compatissant, nous conseilla en entrant dans notre chambrée : « Mes enfants, vous êtes bien mouillés ! Hâtez-vous de vous changer et d’endosser des pantalons secs ! ». Il nous fallut beaucoup d’efforts pour ne pas répondre par des sarcasmes. Sacré Combalat !
 |
 |
 |
| Manœuvres de la section de
Marius AUTRAN, avec le lieutenant JONGLEZ de LIGNE |
 |
|
| Marius
AUTRAN pendant l'exercice |
|
Pour me résumer sur mon passage dans cette école militaire, je dois dire très franchement que j’en ai gardé de bons souvenirs. La camaraderie y fut excellente, la nourriture excellente et variés, la discipline supportable et très humaine (*).
(*) En
6 mois, Marius AUTRAN n'écopa qu'une seule fois d'une punition :
2 jours de consigne pour avoir, avec un camarade, fumé en
étude (et avoir vainement essayé de dissimuler la
fumée dans un tiroir de son bureau...).
En fin de séjour, en mars 1932, après un stage à Souges, non loin de Bordeaux, où l’on fit des démonstrations de tirs de nuit à balles traçantes, nous avons évité de peu une catastrophe : les balles rougies déclenchèrent un incendie dans la forêt des Landes qui ne put être maîtrisé qu’après intervention d’un régiment de Sénégalais appelé en renfort.
Rentrés de ce stage, il nous fallut affronter l’examen de sortie qui nous fit obtenir le titre de “Brevet de chef de section”, indispensable au grade de sous-lieutenant de réserve.
Je devais me présenter au colonel de mon régiment d’origine vers la fin du mois de mars pour connaître l’affectation que j’aurai pour les 6 derniers mois de mon service militaire. J’avais alors un projet plus important à réaliser. Fiancé à la Normalienne Louise GAUTIER, nous avions décidé, sa famille et la mienne, de nous marier avant la fin de mon service militaire. La date en fut fixée au 26 mars 1932. Je reviendrai longuement sur cette date capitale. Mais, auparavant, je veux en terminer avec le “volet militaire” de ma biographie.
Je répondis à la convocation du colonel commandant le 3e R.I.A., qui s’appelait je crois, V, un personnage hautain, à peine poli. La communication fut brève : il nous informa, moi et 6 autres sous-lieutenant affectés aussi au 3e R.I.A., que les 3 premiers prendraient leurs fonctions à Hyères et que les 4 autres seraient dirigés sur Sospel (Alpes-Maritimes), où se trouvait le 3e bataillon du 3e R.I.A. Sur les 7 affectations, j’étais classé 4e. Avant que ne s’ouvrit la discussion sur ces affectations, je demandai discrètement à mes camarades si l’un d’entre eux accepterait de permuter avec moi et d’aller à Sospel à ma place, ce qui me permettrait de rester à Hyères, non loin de ma femme qui avait été nommée institutrice au Plan du Castellet, village situé entre Bandol et le Beausset. Malgré la crainte que m’inspirait le colonel V et sa longue moustache gauloise, j’eus l’audace de lui faire part de ma proposition, à laquelle il répondit de façon péremptoire : « Monsieur ! Ce n’est pas à vous de donner des ordres ! Je suis là pour exécuter des ordres et ce n’est pas à vous d’en donner ! ». Ce fut la première fois qu’un officier me parlait sur ce ton ! Et ce ne fut pas la dernière, comme je le montrerai plus loin, lors d’une algarade qui m’opposa à ce même V, à Sospel cette fois, à l’occasion d’une revue militaire, un certain 14 juillet.
Nous fûmes congédiés quelques minutes plus tard dans la plus grande froideur. Décidément, les fonctions d’officier commençaient plutôt mal pour moi.
Il fallait faire avec et, dans les jours qui suivirent, il fallut nous mettre en route pour rejoindre la bataillon des Alpes et là, fort heureusement, l’atmosphère y fut très sereine. Ce bataillon était commandé par un lieutenant-colonel nommé Teissère, à la tête de 3 compagnies : l’une à Sospel même, une autre au Col Saint-Jean à quelques kilomètres, une autre à Beuil. Je fus affecté à la compagnie de Sospel, commandée par un capitaine nommé GUARRIGUES, un catalan, ancien de la Légion Étrangère, héros de la guerre de 14-18, où il avait obtenu de nombreuses décorations (Légion d’honneur, Croix de guerre, etc.).
La compagnie GUARRIGUES voisinait avec une compagnie de mitrailleuses commandée par un ancien instituteur qui avait opté pour l’armée après la guerre de 14-18. Il se nommait Greusard, homme jovial, aimé de tout le monde. Un autre capitaine commandait la compagnie de Beuil. Couvert de décorations, il avait été blessé 5 fois. On l’appelait Cariou, d’origine bretonne. Lui aussi très estimé, il avait souffert et administrait sa compagnie avec bonhommie. Ce qui n’était pas le cas du capitaine Rault, commandant de la 10e compagnie au col Saint-Jean. Celui-là était détesté pour ses excès disciplinaires. Pour la moindre peccadille, il infligeait à ses hommes des peines de prison dans des locaux ignobles, à peine éclairés par une lucarne, et dont les murs avaient été noircis au “noir de fumée”, ce que l’autorité militaire aurait dû interdire. Je crois me rappeler que ce capitaine avait surtout commandé des tirailleurs marocains.
Les officiers de ce 3e bataillon auquel j’étais affecté nous accueillirent fort courtoisement au cours d’un apéritif amical où participaient des officiers d’active : lieutenants Guy, de Vervillère – un noble sorti de l’École des Jésuites – etc. La pension Alavena nous accueillit (restaurant, chambre, pour un loyer modique). Je me liai d’amitié avec l’adjudant-chef Delorme, le sergent-chef comptable Blavet, et surtout un sous-lieutenant de réserve nommé Sicard (qui devient après son service notaire à Marseille, boulevard Chave).
* Pendant
ce séjour à Sospel de Marius AUTRAN, sa jeune
épouse lui rendit quelquefois visite par la ligne de train, qui
suivait le trajet compliqué interminable de Nice à
Sospel. Marius lui avait dit, pour savoir quand il faut se
préparer à descendre, il faut compter les tunnels, il y
en a 22, et on est arrivé à Sospel. Mais Louise avait
compté et les ponts et les tunnels. Arrivée au compte de
22, elle se prépara à descendre, mais quelqu'un lui dit :
Non, vous êtes seulement à l'Escarène... A Sospel,
Marius avait un jeune soldat comme ordonnance, chargé de
s'occuper de ses affaires, de laver son linge, etc. Mais, pendant la
journée, Marius étant de service, Louise n'ayant rien
d'autre à faire, préférait laver elle-même
le linge de son mari. L'ordonnance restait à côté,
se reposait ostensiblement, et échangeait des clins d'œils
avec ses camarades qui, eux, effectuaient des corvées, leur
montrant par des signes dans le dos de Louise, que lui avait
tiré le bon numéro, la femme de son chef faisant le
travail à sa place...
Nos occupations se limitaient à l’instruction militaire des jeunes recrues (sur les terrains de manœuvre ou en salle). Le capitaine GUARRIGUES m’accorda la plus grande confiance et s’efforça de varier mon travail (visite des avant-postes à la frontière italienne, qu’il fallait faire à dos de mulet, ce qui m’amusait plutôt).
 |
| Marius AUTRAN
(à gauche), sur un mulet, à Sospel, avec le capitaine
GUARRIGUES |
Durant les derniers mois de mon service, je redevins instituteur, le colonel ayant reçu une note ministérielle obligeant les sous-officiers à devenir titulaires du certificat d’études primaires, nombre d’entre eux ne l’ayant jamais présenté. Pendant 3 mois, je fis faire des dictées et des problèmes à 10 sergents que j’avais emmenés à Menton pour passer leur certificat d’études. Il l’obtinrent tous avec succès, un succès fêté par la suite dans la plus grande camaraderie. Je peux affirmer sans forfanterie que tous ces militaires de carrière ont gardé un bon souvenir du sous-lieutenant AUTRAN.
Il me faudrait développer longuement tous les aspects de la vie à Sospel, dont l’animation était générée essentiellement par la présence des militaires. J’aurais pu parler des farces que les officiers de carrière jouaient aux arrivants dès le début de leur arrivée à Sospel, par exemple des visites à faire au commandant Pendariès alors qu’il n’avait pas été prévenu, des fausses visites médicales effectuées par un faux médecin en blouse blanche, qui devait conclure positivement ou non sur notre aptitude à la montagne, etc.
J’aurais pu raconter nos randonnées dans le massif de l’Authion, à Peïra Cava où je vis des skieurs pour la première fois (des militaires, bien sûr !), la descente de la vallée de la Bévéra où un éboulement de la montagne faillit nous ensevelir vivants sur la route de retour vers Sospel, un jour de pluies diluviennes.
 |
| Marius AUTRAN
à
Peïra Cava (1932) |
 |
| Marius AUTRAN
(2e à gauche), massif de l'Authion (1932) |
Par contre, découverte de champignons safranés un 15 août dans les forêts du Mont Agaisen.
Avant d’entrer dans les moindres détails, je voudrais revenir sur un incident qui m’opposa encore au colonel râleur V, le jour de la revue traditionnelle du 14 juillet, revue qui devait se dérouler sur la place de la gare, à proximité du Monument aux Morts de la guerre de 14-18.
Toutes les compagnies devaient défiler au pas cadencé devant l’état-major, V en tête. La cérémonie terminée, ce dernier demanda une réunion des officiers. Arrivé à ma hauteur, il s’arrêta et me toisa d’un regard mauvais : « Monsieur ! me dit-il, vous auriez pu apprendre à vos soldats à marcher au pas ! Ce n’est tout de même pas difficile : un ! deux ! un deux ! ». Je ne répondis rien, éberlué que j’étais de cette remarque. Je dus sans doute rougir. Fort heureusement, mon voisin SICARD interrompit le colonel en lui disant : « Ce n’étais pas la section de mon camarade AUTRAN qui a marché dans le désordre, c’était la mienne ! ». Le colonel ne m’adressa aucune excuse et répondit à Sicard : « Les reproches que j’ai faits à votre camarade s’adressent donc à vous ! » et il s’éloigna pour chercher des noises à quelqu’un d’autre.
Et je n’ai pas encore fini avec ce colonel râleur. Vers la fin de mon séjour à Sospel, ma compagnie, capitaine GUARRIGUES en tête, fûmes désignés pour effectuer des travaux de défense vers la frontière italienne et me voilà avec une équipe de terrassiers pour creuser des tranchées et des abris souterrains. D’une automitrailleuse descendit une délégation d’officiers non loin de notre lieu de travail. Qui vois-je en tête de cette délégation ? L’incontournable V venu en inspection. « Que faites-vous là ? », me dit-il sur le même ton péremptoire qui lui était coutumier. « Ce n’est pas ici qu’il faut creuser ! ». Alors, très très courtoisement, je lui répondis, documents à l’appui, que j’exécutais les ordres reçus. Il ne les regarda point, tourna sur ses talons et partit en maugréant.
Plusieurs années après mon service militaire, j’eus encore l’occasion de voir, ou plutôt de revoir, ce personnage. Au cours d’une période de réserve (1935-1936, il vint inspecter le 3e R.I.A. en manœuvre dans les Alpes. Pendant le repas de midi, il s’exclamait à haute voix des injustices que ses supérieurs lui avaient faites en le lui proposant pas le grade de général qu’il attendait depuis plusieurs années. A quelques mètres de lui se trouvait un lieutenant de chasseurs, particulièrement jovial, qui avait entendu les récriminations de V attendant ses étoiles. Ce lieutenant se nommait Kulmann et il était le fils du richissime propriétaire des Potasses d’Alsace. Il ne devait pas porter dans son cœur le colonel déçu, car il confia à son voisin de table, sur un ton ironique insuffisamment discret : « Ce n’était qu’une étoile filante ! ». Mais V, qui n’était pas sourd, avait bien entendu et s’adressant au jeune lieutenant, hurla quasiment : « Kulman, taisez-vous ! ». Je reste persuadé que le fils du milliardaire fut réjoui des déconvenues du colonel. Je ferme ainsi tout à fait la parenthèse V dont la réputation ne fut pas des meilleurs dans la hiérarchie du 3e R.I.A..
Vers la fin de l’année de mon service militaire, je rentrai dans la vie civile.
Avec mon épouse Louise GAUTIER, nous reçûmes une affectation au village de Montmeyan.
Mes histoires militaires m’ont fait dépasser de quelques mois la date du 26 mars qui devait consacrer mon union avec Louise.
Cette date avait été arrêtée à mon retour de Saint-Maixent et j’avais décidé de me marier en uniforme d’officier, gants blancs, sabre au côté. Un copieux repas avait été commandé par mon père au restaurant VIDAL, son ami des Sablettes. Y assisterait toute la famille, c’est-à-dire les AUTRAN, les GAUTIER, les AUGIAS, c’est-à-dire une vingtaine de convives.
 |
 |
| Marius AUTRAN en
uniforme de
lieutenant du 3e R.I.A. |
Louise GAUTIER |
Hélas ! Ces réjouissances n’eurent pas lieu. Un deuil cruel frappa la famille la veille par la mort du petit Louis AUGIAS, neveu de ma mère, décédé accidentellement d’une chute de vélo sur le chemin d’accès à la maison paternelle. Le malheureux, dans sa chute, cogna sa tête à hauteur de la tempe droite, sur un caillou volumineux. Il se releva néanmoins, rentra chez lui en se plaignant de vives douleurs à la tête. Son père partit chercher un médecin qui tenta une ponction lombaire, sans succès. Un heure après, le pauvre enfant s’endormit pour l’éternité.
Inutile de dire les souffrances générées par un tel malheur pour les parents, les grands-parents, toute la famille. Le petit Louis était le frère de mes jeunes cousines, Marie-Louise (“Sissi”) et Paulette, celles qui devaient devenir respectivement Mme Ganzin et Mme Bagliotto quelque dix ans plus tard.
Mon mariage fut retardé et remplacé par l’enterrement du petit Louis. Cérémonie terriblement pénible, d’autant qu’à l’époque le corbillard était actionné par des chevaux. L’enterrement civil nous amena au cimetière après une heure de marche. N’ayant pas encore de tombeau familial, mon oncle Joseph AUGIAS avait obtenu l’accord du cousin de ma mère, le boulanger Victor Mabily, de recevoir le cercueil du petit Louis.
Le malheur entraîna le retard de notre mariage, l’annulation du banquet au grand dam de la mère de Louise (“Mémé GAUTIER”) qui aurait souhaité tout de même un minimum de réjouissances à quelque temps de cette journée néfaste. L’opposition violente de mon père faillit créer de dissensions entre ma future belle-mère et ma famille. Autrement dit, ma vie conjugale, comme on doit le penser, commença plutôt mal.
Néanmoins notre mariage eut lieu, le 28 mars. Malgré notre chagrin, nous partîmes en voyage de noces à Marseille, où après une première nuit passée dans un hôtel, place Castellane, mon oncle Gabriel nous reçut pendant quelques jours chez lui au 45 boulevard Oddo.
Je fis visiter la ville à Louise pendant quelques jours, puis, il nous fallut songer à reprendre nos postes d’enseignante pour Louise (au Plan du Castellet) et d’officier pour moi à Sospel) en attendant notre nomination dans ce qu’on appelait un poste double d’instituteurs. Dans le courant de l’été 1932, nous reçûmes notre affectation au petit village de Montmeyan, dans le haut Var.
Quand j’annonçai cette nouvelle à mes grands-parents, ils furent au comble de la joie parce que la cousine de mon grand-père AUBERT, Geneviève Blanc, d’une famille six-fournaise, avait épousé un riche propriétaire de ce petit village, Emile SICARD, dont le frère Prosper était le conseiller général du canton de Tavernes.
Mon grand-père AUBERT informa donc de notre nomination sa cousine Geneviève, laquelle demanda dès le lendemain son fermier Henri BROCARD de nous accueillir avant la rentrée des classes et de nous présenter au Maire du village, M. REYNIER, qui nous permit de visiter les locaux, les appartements, les classes et nous assura de la convivialité que nous allions trouver dans une population essentiellement paysanne, vivant surtout de la polyculture : vignes, élevage, cultures de fruits et de légumes, exploitation des bois, sans parler des ressources abondantes de la chasse.
L’école comportait 2 classes : une de cour préparatoire et élémentaire dont Louise se chargerait, une autre de cours moyen dont je m’occuperais. J’allais commencer ma carrière d’enseignant comme directeur d’école (2 classes).
L’appartement était immense, il comportait 6 pièces dont une cuisine spacieuse, deux chambres et un bureau. De grands travaux de propreté allaient toutefois être nécessaires.
Les effectifs scolaires n’étaient pas surchargés : une cinquantaine d’élèves pour les 2 classes. Les élèves, dociles, ne posaient pas de grands problèmes de discipline.
Ainsi, dans ce paisible village, nous allions passer 3 années heureuses dont je pense, avec le recul du temps et surtout au regard des années douloureuses vécues entre 1936 et 1945, que ces années passées loin de la ville furent peut-être les plus heureuses de notre vie conjugale. Il va sans dire que Mémé GAUTIER, ma belle-mère, y contribua pour une large part. Veuve depuis 1911, elle ne pouvait envisager de se séparer de sa fille Louise pour qui elle avait tout donné : l’instruction surtout, et naturellement, son amour sans limites.
A Montmeyan, on peut dire que c’est elle qui dirigeait notre ménage. Elle assumait toutes les tâches les plus ingrates : ravitaillement, cuisine, lavage du linge, entretien de la maison, etc. Par la suite, c’est bien la Mémé GAUTIER qui éleva nos enfants. Je reviendrai sur ces questions à toutes les étapes de ma vie conjugale, qui dura 64 ans.
Certes, tout n’était pas parfait dans notre vie quotidienne. Le médecin le plus proche était à 25 km, à Carcès précisément (Dr Chaix et Dr Peloux).. On ne trouvait pas certains commerces de vêtements, de coiffeuse pour dames, d’artisans spécialisés. Selon les besoins, il fallait se rendre au chef-lieu du canton (Tavernes) ou alors à Barjols (la patrie de mon grand-père Auguste AUTRAN). Certaines formalités ne pouvaient se faire au village, et comme nous n’avions pas d’auto, on avait recours à des nantis du village particulièrement serviables.
Mais nous ne fûmes jamais confrontés à des problèmes administratifs sérieux, surtout pas avec la Municipalité qui nous offrait le bois de chauffage à volonté ; les fournitures scolaires étaient gratuites ; nous vivions en bonne intelligence avec le secrétaire de mairie M. HUGUES, le garde forestier M. BROCARD, le chef cantonnier M. Artaud, l’épicier M. CARLAVAN, le maréchal-ferrant M. AUTRAN, et bien d’autres. Je m’efforçais de leur rendre des services quand je le pouvais, à commencer par le Maire M. REYNIER qui n’était pas débordé par ses activités administratives, ne réunissant son conseil municipal que deux fois par an. Et pourtant, des problèmes municipaux se posaient avec acuité. Jugez-en si je vous dis que le village ne recevait aucune canalisation d’eau potable : il y avait seulement le puits communal au centre de l’agglomération. Et pourtant, le barrage de Quinson, sur le Verdon, n’était qu’à 7 kilomètres ! Passons !
La collecte des ordures ménagères avait lieu une fois par semaine par un véhicule déversant sa cargaison à la sortie du village, en bordure de la route de Régusse. De loin en loin, on brûlait sur place les immondices pour en diminuer le volume. Le père REYNIER était cependant réélu depuis de nombreuses années, malgré les lacunes de sa fonction.
J’ouvre ici une parenthèse pour vous en donner une illustration. Une semaine après la rentrée des classes en octobre 1932, pendant notre repas du soir j’entendis frapper à notre porte. « Tiens ! Quelle surprise ! Monsieur le Maire, je vous salue ». « M. AUTRAN, me dit le premier magistrat, excusez-moi si je vous dérange ! Mais voilà ! J’ai besoin de votre service ! ». « Bien volontiers ! Si je peux ! ». « Vous pouvez le faire ! Je viens d’apprendre la mort d’un conseiller municipal, un de mes amis. Je voudrais lui adresser mon dernier adieu au cimetière, après-demain, mais je vous avoue mon incapacité à le faire. Pourriez-vous m’écrire quelques mots, pas un long discours, bien sûr ! La famille sera sans doute sensible à ça. Qu’en pensez-vous ? ». « Je veux bien vous être agréable, lui répondis-je, mais il m’est bien difficile de parler de quelqu’un que je ne connais même pas ». Le Maire me donna alors quelques renseignements sur l’infortuné défunt (origine, activités, chagrin, etc.). Je lui promis une réponse pour le lendemain. Néanmoins, je fus confronté à un exercice littéraire hors du commun car, dans ma carrière d’étudiant, jamais je n’avais eu l’occasion d’écrire ou de prononcer une oraison funèbre. Il me fallut un certain temps pour écrire une vingtaine de lignes empreintes de chagrin, de regrets. Le lendemain, M. le Maire paraît-il, fut très fier d’avoir accompli sa délicate mission.
Que pourrai-je dire encore sur notre séjour à Montmeyan. Quels furent nos loisirs ?
Les promenades sur les routes tranquilles d’Aups, de Quinson, de Tavernes, de Fox-Amphoux, où n’apparaissaient que de temps en temps des charrettes chargées de foin, de bois, de gerbes de blé à l’époque des moissons. Nous apprîmes tous les aspects de la vie paysanne du haut Var, vie rude face qux intempéries : le gel, la sécheresse, la grêle.
Je me dois, ici, d’ouvrir une page spéciale sur la chasse dont je fus un amateur passionné. Dès l’âge de 18 ans, j’avais été autorisé à obtenir un permis de chasse et mon premier coup de fusil m’avait rapporté une bécasse dans la forêt de Janas. Encouragé par cet exploit, pensez bien qu’à Montmeyan, pays giboyeux, j’allais me donner à ce sport auquel mon grand-père AUBERT m’avait familiarisé depuis mon enfance.
A la chasse traditionnelle, s’ajoutait aussi quelque peu le braconnage classique : collets pour la capture des lapins, pièges pour les oiseaux,… Dans l’immense commune de Montmeyan vivaient en permanence les perdrix, les lapins, les geais. Mais les moments les plus forts, je les éprouvais au passage des migrateurs à partir du début octobre. Les grives abondaient dans les vignes non encore vendangées dans le haut Var.
Alors, tous les jeudis et dimanches, je partais au lever du jour vers les postes de chasse que les paysans m’avaient fait connaître. Je ne rentrais jamais bredouille. J’emportais souvent des “appelants” en cage, nourris dans ma maison avec des figues sèches. Le nombre de kilomètres parcourus derrière les compagnies de perdreaux me serait bien difficile à calculer aujourd’hui, parvenu à l’âge où les jambes ne me portent plus guère. Comme on dit communément : « On ne peut plus être et avoir été ». Il faut bien se résigner à la réalité des choses. Passons !
J’ai mangé du gibier dans ma vie, et même du gibier faisandé, et j’ai eu la chance, jusqu’à plus de 90 ans, d’avoir eu un foie à toute épreuve. Le souvenir des meilleurs chasseurs de Montmeyan me hante toujours : les Pélissier, les Pourrière, les Saint-Martin, les Carlavan, tous ces gens qui manquaient rarement leurs victimes. Comme je les admirais !
Mes loisirs, je savais les varier autrement. A la maison, je lisais, je dessinais. Je m’étais même, sans avoir jamais suivi de cours spéciaux, initié à peindre des natures mortes dont il me reste encore quelques traces.
 |
| L'un des
tableaux peints par
Marius AUTRAN dans les années 1930 |
Les premiers jours sui suivirent notre installation, je fus très occupé par la réfection de notre logement. Il fallut peindre, tapisser, réparer. Le Maire était ravi de me voir enthousiaste pour des travaux qui auraient dû être à la charge de la commune. Il m’avait fait livrer des pots de peinture par un artisan local, mais la ville ne me paya pas les heures de travail, ce que, d’ailleurs, je n’aurais pas accepté. Par contre, il me faisait cadeau d’une grande quantité de bois de chêne, débité en petits morceaux, pour notre cuisinière que Mémé GAUTIER de régalait d’approvisionner. Elle, au dévouement inlassable, participait aussi à la vie de l’école. Durant les rudes mois de l’hiver, après avoir allumé la cuisinière chez nous, elle se charger de charger et d’allumer les poêles de nos classes respectives plus d’une heure avant la rentrée du matin, ce que les parents appréciaient au plus haut point… Le Maire aussi, parce qu’il aurait dû payer un employé municipal pour le faire.
Tout cela illustre bien l’atmosphère de convivialité qui existait à Montmeyan
Les soirées auraient pu être plus animées si nous avions eu la “télé”. Nous eûmes tout de même le plaisir d’écouter la radio, la dernière année de notre séjour. Il nous arrivait souvent aussi de jouer aux cartes, an nain jaune ou au loto.
Un fait nouveau aller nous procurer une distraction toute nouvelle. Je pris l’initiative d’organiser, parmi la jeunesse du patelin, une équipe de football. Ce ne fut pas simple de trouver 11 joueurs. Je commandai des maillots, des bas, des chaussures. Il nous fallut louer un terrain empierré dont la mise en usage dura plusieurs semaines. Notre premier match fut un succès. L’équipe de Tavernes, chef-lieu de canton, qui nous était opposée fut battue par nous (2 points pour Montmeyan, 1 point pour l’adversaire). Les gens de notre village furent très fiers de ce succès. Pensez donc ! Avoir battu le chef-lieu de canton et son Maire, conseiller général, était un exploit. D’autres compétitions suivirent avec des villages voisins. Après notre mutation sur Carcès, je crois bien que mon camarade Toussaint MERLE qui me remplaça comme directeur, sa femme Malou étant son adjointe, s’occupa temporairement au moins de l’équipe de football de Montmeyan.
Je répète que notre séjour à Monmeyan fut bénéfique à tous égards. L’inspecteur primaire, M. COTTE, nous fit de bons rapports, car les succès au certificat d’études primaire furent très significatifs.
Et pourtant, il nous fallut partir. Pourquoi ? Pour une raison très simple : le 7 septembre 1933 nous arriva notre premier enfant Robert César et le médecin le plus proche se trouvant à 25 km (à Carcès), nous vivions dans l’inquiétude de ne pouvoir le soigner correctement. Et il fallait aussi veiller de très près sur la santé de Louise, durement éprouvée par son accouchement dans une clinique de Toulon. Sans doute y avait-il aussi le désir confus de nous rapprocher de La Seyne, Mémé GAUTIER surtout qui se plaignait tout de même du manque de commodités élémentaires.
La naissance de notre premier enfant intervint 17 mois après notre mariage. La grossesse de Louise avait été laborieuse. Elle portait un enfant très gros et les médecins consultés avaient estimé que l’accouchement serait difficile et devrait se faire en clinique. Je ne sais plus très bien sur les quels amis nous avions été orientés vers la clinique Coulomb de Saint-Jean-du-Var. Le spécialiste en obstétrique s’appelait le Dr JAMIN, un géant fort accueillant, certes, mais qui se révéla (...) pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec la médecine et dont je parlerai très longuement plus loin. Il nous conseilla d’entrer en clinique bien avant la date prévue de l’accouchement. Nous lui fîmes confiance et les premiers jours de septembre, Louise fut admise dans l’établissement de Saint-Jean-du-Var.
A la date prévue pour la naissance, aucune manifestation prénatale ne se produisit. Alors, le Dr Jamin me fit appeler pour m’annoncer la nécessité d’une opération, la césarienne évidemment ! Je dirai plus loin l’avis d’un autre médecin qui me fut donné, 11 ans plus tard, le Dr Malartic, dont la célébrité fut grandement appréciée dans notre région. J’y reviendrai plus loin. Après l’avis du Dr Jamin, je lui répondis : « Je vous fais confiance, mais je vous supplie de sauver ma femme ! ».
Le lendemain, la césarienne eut lieu et, dans la chambre où nous attendions, ma belle-mère et moi dans la plus grande inquiétude, une infirmière triomphante nous apporta un gros bébé joufflu, déjà souriant, et nous dit qu’il pesait 4,750 kg et que la maman se portait bien.
Inutile de décrire notre joie, écornée quelque peu de voir Louise regagner la chambre, où elle ferait connaissance avec son fils. En moins d’une heure, un chariot accompagné de deux infirmières et du Dr Jamin apparut, tous réjouis et confiants. Louise se portait à merveille et ne put retenir des larmes de joie. Tout le monde contemplait le héros emmitouflé dont la tête superbe n’avait pas souffert et était celle, impeccable, d’un césarien.
Alors le Dr Jamin s’exclama bruyamment : « C’est la 5e césarienne que j’ai réussie de cette année ! ». Ce qu’il ne savait pas encore, c’est tout de même une complication avec l’apparition d’un abcès sur la cicatrice abdominale de la maman, inconvénient qui persista plusieurs semaines après notre retour à Montmeyan.
La venue au monde de cet enfant admiré apporta évidemment beaucoup de joie chez mes parents, mes grands-parents, et toute la famille.
Rentrés à Montmeyan pour assurer la rentrée des classes d’octobre, notre vie allait connaître des aspects nouveaux et Mémé GAUTIER aurait des tâches supplémentaires à remplir, mais elle était bien fière, les jours de beau temps, de partir dans les rues et les chemins montrer son beau bébé à la population du village.
 |
 |
| Robert AUTRAN et
sa mère,
à Montmeyan |
Robert AUTRAN
entre ses deux
grand-mères, Victorine AUTRAN et Joséphine GAUTIER, à Montmeyan |
L’année 1933 nous apporta donc une immense satisfaction, assombrie tout de même par les évènements nationaux et internationaux qui ne présageaient rien de bon pour notre avenir.
Ce fut précisément en 1933 que l’Allemagne se donna comme dirigeant un certain Adolf Hitler, raciste, fasciste, revanchard, ambitieux d’une grande nation dominatrice de l’Europe, et pourquoi pas du monde ?
Avec l’aide de capitaux américains, il conquit le pouvoir par la force, fita assassiner les dirigeants des partis socialistes et communistes. Poussé par les capitalistes du monde entier, les Américains surtout, il devait devenir le gendarme de l’Europe et s’opposer avant tout à la progression du communisme triomphant à l’échelle mondiale. Hitler avait ses partisans en France. Rappelons-nous les “Croix de Feu” avec le colonel de la Roque à leur tête, lesquels voulaient détruire la République française. L’agitation fasciste devait aboutir à un complot et à une tentative de coup d’état au début de l’année 1934.
Jusque-là, je ne m’étais jamais mêlé à la politique locale. Mon père, socialiste à l’époque, m’avait quelque peu initié par quelques joutes oratoires à la Bourse du Travail de La Seyne, où s’opposèrent le député Renaudel et le célèbre et immortel Gabriel Péri, orateur exceptionnel.
Au début de février 1934, la tentative des fascistes de s’emparer du Palais Bourbon, le 6 février exactement. Le 9 février, le Parti communiste français, dirigé par Maurice Thorez depuis 1930, appela la population française à réagir. La C.G.T. lança un mot d’ordre de grève générale pour le 12 février. Les enseignants, dans leur grande majorité, y furent favorables.
Si je rappelle ces évènements, c’est pour dire que les petits instituteurs des villages, dont nus faisions partie Louise et moi, nos amis de Tavernes (Carle), de Barjols et de partout ailleurs, étions tous prêts à défendre la République, malgré notre isolement.
A partir de ce jour, j’allais m’intéresser de plus près aux problèmes de la politique française en lisant L’Humanité, Le Populaire du Var (socialiste), Rouge-Midi (communiste). Par surcroît, je fus rappelé pendant l’été 1934 à effectuer une période de réserve de mon régiment. Je compris alors mieux l’ampleur du danger fasciste en écoutant plusieurs officiers de l’armée d’active dont les opinions rejoignaient celles des “Croix de Feu” et de l’Action française (royaliste).
Les paysans de Montmeyan, peu expansifs sur la politique, ne cachaient pas leur “tripe républicaine” et approuvèrent notre grève du 12 février 1934 qu’on peut qualifier de journée historique.
La grande joie que nous apporta le triomphe de la République fut tout de même assombrie par un deuil de famille dont je souffris beaucoup dans cette période. L’hiver de 1934 fut fatal à mon grand-père AUBERT, décédé à la suite d’une congestion pulmonaire contractée sur le port de La Seyne. Sa disparition me toucha infiniment. Il était si bon, si généreux, si tolérant, lui qui me régala pendant plusieurs années de mon enfance dans les parties de pêche vers le cap Sicié, ou dans la baie du Lazaret aux richesses prodigieuses en coquillages, lui qui toléra toujours mes caprices d’enfant, mes imprudences, lui qui m’apprit toutes ses ruses de chasseur passionné, lui dont la vie très dure de marinier dans les colonie d’Extrême-Orient avait profondément marqué ma jeune tête. Je fus littéralement terrifié en assistant à sa mise en bière en présence de tous les siens, profondément bouleversés. Ses obsèques furent suivies par une assistance nombreuse tant il avait d’amis à La Seyne et à Six-Fours dont il était originaire. Ah ! Si les antibiotiques avaient existé à l’époque, il aurait pu connaître une retraite bien plus longue. Hélas ! Il avait à peine 71 ans.
Les évènements nationaux et internationaux se précipitaient. Hitler affirmait sa puissance. Il occupa la Sarre, menaça la Tchécoslovaquie sous prétexte qu’elle avait accueilli beaucoup de citoyens d’origine allemande (les Sudètes). La menace d’une guerre commença à se préciser vers 1935.
De plus en plus, nous envisagions de nous rapprocher de La Seyne. Satisfaction nous fut donnée par une mutation à Carcès où je devins directeur d’une école de 3 classes avec, comme adjoints, un instituteur chevronné, M. BALLANDRAS, et un jeune instituteur, M. GRAVIER. Je vais donc, comme je l’ai fait pour Montmeyan, vous parler de notre passage à Carcès, qui dura 3 années, dont l’année 1936 qui fut sans doute la plus cruelle de notre existence.
Au plan matériel, tout était satisfaisant : école magnifique, bien équipée à tous points de vue, appartements spacieux, eau courante, sanitaires, lavoir, jardinet, etc. Tout cela non loin de la ville bien achalandée à tous égards.
Louise fut mon adjointe pendant un an avant de prendre une classe à l’école maternelle toute proche.
Je m’entendais à merveille avec mes collègues. M. BALLANDRAS m’emmenait souvent à la chasse ou à la pêche sur les rives du Caramy ou sur les bords du barrage de Carcès récemment inauguré pour alimenter Toulon en eau potable.
J’entretenais des rapports courtois avec tous les parents d’élèves dans une convivialité tout de même amoindrie par rapport à la paysannerie de Montmeyan. La population se composait de riches viticulteurs, de propriétaires cossus, mais aussi d’humbles familles de mineurs de la bauxite, abondante dans les environs, d’ouvriers agricoles, de commerçants assez nombreux. Autrement dit, il y avait une population diversifiée, des riches et des pauvres. Le prolétariat existait vraiment, ce qui impliquait déjà l’existence de problèmes politiques, dont l’amplitude allait croissant avec le développement des menaces fascistes, de l’approche de conflits armés. Pensons à la guerre d’Espagne, au danger de la politique guerrière de Mussolini, avec, en contrepartie, la naissance du Front Populaire, les victoires électorales des socialistes et des communistes.
À Carcès, où l’influence religieuse était forte, et les opinions réactionnaires solidement ancrées, les partis de la gauche républicaine s’affirmaient de mieux en mieux ? Les réunions publiques de plus en plus suivies laissaient présager des victoires électorales prochaines. Une importante délégation de militants de la gauche, à laquelle je participais sans être encore un passionné, se rendit à Brignoles en 1935 pour entendre Maurice THOREZ développer la politique offensive des communistes. Cette journée parfaitement réussie fut le point de départ des succès communistes varois. A partir de là, les militants de la gauche auraient bien voulu avoir parmi eux le Directeur de l’école. Le Maire socialiste de l’époque me sollicita pour adhérer au parti socialiste. Je déclinai très courtoisement sa proposition.
Depuis le meeting de Brignoles, je m’étais lié d’amitié avec le secrétaire de la cellule communiste du village qui se nommait Victorin ROUX, ancien combattant de 14-18. Il m’invita un soir à la réunion de sa petite formation, forte tout de même d’une trentaine de membres, âgés pour la plupart, dignes représentants du « Var Rouge » de l’époque, et que les appels pathétiques de Maurice THOREZ pour un large front populaire englobant les catholiques, laissaient perplexes.
Par la suite, Victorin Roux me sollicita pour accepter la fonction de Secrétaire du « Secours Rouge International ». Il fut au comble de la joie quand je lui donnai mon accord. Malheureusement, je ne pus faire grand chose pour les opprimés de la politique car il nous fallut quitter Carcès plus tôt que prévu, le malheur nous ayant anéanti pour longtemps. J’y reviendrai bientôt.
Des élections municipales amenèrent à la direction du village une majorité socialiste et un groupe communiste important. Les élections législatives affirmèrent la suprématie du Front Populaire.
Le corps enseignant du village s’associa aux victoires populaires auxquelles il nous fut interdit de participer en raison du malheur immense qui frappa la famille par la disparition de notre enfant chéri. Je tremble encore en relatant par écrit les heures dramatiques vécues en ce mois de Juin 1936.
 |
| Robert AUTRAN,
chez son
grand-père, à Mar-Vivo, quelques semaines avant sa
disparition |
Dès le matin, Robert se plaignit de douleurs violentes abdominales, poussant des cris perçants. Le médecin, le Dr Mazard, intervint quelques minutes plus tard, palpa avec précaution son petit ventre, et, sans hésiter, conclut à une occlusion intestinale à opérer le plus vite possible. Un ami, M. FÉRAUD, accepta de nous amener à Toulon à la clinique Coulomb de Saint-Jean-du-Var, là où précisément Robert était né (le 7 Septembre 1933).
Les médecins l’examinèrent et décidèrent de mettre l’enfant en observation (décision que le Dr MAZARD, mis au courant par la suite, considéra comme une grave erreur, car, nous dit-il : « Il fallait opérer tout de suite ! » - Qui croire ?).
Le lendemain, Robert fut opéré et ramené dans sa chambre une grosse plaque de sparadrap sur son ventre. Il ne devait pas survivre longtemps. Je demandai l’avis des médecins qui me reçurent avec froideur et me signifièrent que l’enfant était perdu. Croyez-moi, ami lecteur, rien n’est plus terrible que de voir mourir un enfant. Robert s’éteignit une demi-heure après l’opération en délirant, en notre présence, de Louise, sa mère et moi. Aucun médecin n’était présent. Enfin, le fameux Dr JAMIN manifesta son impatience de nous voir quitter l’établissement, nous procura un taxi pour nous emmener à La Seyne au milieu de la nuit - Robert, allongé sur mes genoux, sa mère et sa grand-mère éplorées. Notre refuge tout indiqué fut la maison familiale du quartier Touffany, celle où Louise avait grandi auprès de sa mère, et où habitaient encore sa grand-mère Madeleine l’arrière grand-mère de Robert, ainsi que sa tante Fernande et son époux Louis MEUNIER.
Inutile de décrire les scènes déchirantes qui suivirent quand mes parents, informés au milieu de la nuit, arrivèrent dans la chambre mortuaire.
Oui ! C’était bien fini pour notre enfant adoré, avec ses superbes boucles blondes, dont l’une d’elles demeure toujours dans l’armoire de sa grand-mère, tout près de celle de son grand-père Louis GAUTIER, disparu tragiquement le 25 Septembre 1911 dans la catastrophe du cuirassé « Liberté ».
Enfin le jour se leva. Au matin qui suivit, il fallut bien préparer les obsèques, informer les parents, les amis, les enseignants de Carcès. Robert allait rejoindre AUBERT, notre grand-père, disparu l’année précédente.
Au moment de la mise en bière, Louise exprima le désir que moi seul toucherait Robert. Alors je dus accomplir, probablement, l’un des actes les plus cruels de mon existence : coucher mon propre enfant dans son cercueil. Après les derniers baisers des uns et de autres sur le petit front glacé, le tonton Louis MEUNIER se chargea de visser le couvercle autour duquel nous étions tous prosternés. Nous vivions là les heures les plus dramatiques de notre vie.
Les obsèques civiles se déroulèrent le lendemain matin en présence d’un cortège impressionnant, en présence de nos collègues de Carcès chargés de fleurs. Le Dr MAZARD de Carcès fit parvenir une gerbe de belles fleurs blanches. Mais il était bien évident que toutes les marques de sympathie et d’affection nous allaient droit au cœur mais hélas ne nous rendraient pas notre cher disparu.
Dans les jours suivants, accablés de douleur, il nous fallut bien reprendre le chemin de l’école avec, il faut le rappeler, toute la mansuétude de l’Inspecteur, M. COTTE, qui ne tient aucun compte de nos absences prolongées. L’année scolaire touchait à sa fin, fort heureusement, si l’on peut dire, car nous n’avions guère de cœur à l’ouvrage, Louise et moi.
 |
| Marius AUTRAN
portant le deuil
du petit Robert avec ses deux adjoints de l'école de Carcès : MM. BALLANDRAS et GRAVIER |
Rentrés à La Seyne pour les vacances de juillet, nos visites au cimetière étaient fréquentes et, depuis la disparition de Robert, il fut de plus en plus question de nous rapprocher de lui. Cette idée mûrissait dans nos têtes, mais en fait, ce ne fut qu’à la rentrée scolaire 1938 qu’une affectation à La Seyne nous fut accordée, l’école Martini pour moi, l’école Curie pour Louise. Hélas ! D’autres épreuves nous attendaient, d’un caractère tout différent.
Les menaces d’une nouvelle guerre mondiale se précisaient Les sinistres accords de Munich qui, paraît-il, devaient assurer la paix et arrêter la politique belliqueuse de l’Allemagne nazie, eurent pour conséquence d’aggraver les risques de la guerre. Dans l’été de cette manœuvre diplomatique, je fus mobilisé à Hyères dans l’attente d’un conflit. Je devais être présent tous les jours à la caserne. N’ayant pas d’auto à utiliser, dans l’impossibilité de louer une chambre, je fis l’acquisition d’un beau vélo. Parti chaque jour à 6 heures du matin, je dus pendant une dizaine de jours pédaler vers Hyères (à 25 km de La Seyne) pour répondre à un appel vers les 8 heures. Et, naturellement, avec 25 km pour le retour, je faisais donc 50 km de vélo par jour. J’avais des jambes de 18 ans, heureusement.
L’alerte à la guerre fut donc très chaude et donc significative. Nous n’allions pas tarder à voir les évènements se précipiter. Je disais sans cesse à Louise : « Tu comprends mieux mes inquiétudes de 1933, quand Hitler arriva au pouvoir, surtout grâce à la capitulation des socialistes allemands de l’époque ».
Néanmoins, nous prîmes nos fonctions à La Seyne en octobre 1938.
Le directeur de l’école, M. MALSERT, m’accueillit courtoisement et me proposa un poste vacant, un cours supérieur 2e année, classe à laquelle les élèves accédaient après le certificat d’études. J’acceptai avec joie cette proposition.
 |
| Monsieur MALSERT Directeur de l'École Martini (1932-1952) |
M. MALSERT me faisait confiance. Pendant une quinzaine d’années, j’allais travailler avec cet homme sévère, compétent, au dévouement inlassable, lui rendant beaucoup de services, et qui me défendit dans des circonstances difficiles que je connus pendant plusieurs années consécutives et sur lesquelles je reviendrai très longuement.
Mais, en attendant les orages, je veux dire quelques mots sur l’année scolaire 1938-1939 en compagnie de deux autres camarades sympathiques, responsables aussi d’un cours supérieur, MM. Arnaud et Honorat. Nous faisions du bon travail avec des effectifs ne dépassant pas la trentaine d’élèves. M. MALSERT dirigeait l’E.P.S. avec 3 années, l’École pratique qui précéda la Section technique et l’École primaire forte d’une dizaine de classes (Aillaud, Guigou, Vacchero, Arène, Mouret, Lombardi, etc.).
 |
| A l'école
Martini : MM. Léon SOLÉRI, HONORAT, Francis ARNAUD,
Marius AUTRAN |
Je ne reviendrai pas sur le fonctionnement des 3 Sections, décrit avec beaucoup de précision dans mon Histoire de l’École Martini, avec les biographies des principaux responsables, MM. MALSERT et Baude.
Nous étions particulièrement attentifs aux problèmes politiques, car les menaces de guerre se précisaient. La fin de l’année scolaire nous amena à la mobilisation à la suite des agressions hitlériennes sur la Tchécoslovaquie, le Danemark, etc. Cependant, Louise et moi avions décidé d’un voyage à Grenoble, qui fut hélas ! écourté par la mobilisation, fin juillet. Il nous fallut rentrer précipitamment à La Seyne, d’où je dus me rendre à Hyères. Les transports étaient déjà perturbés, à un tel point qu’à mon arrivée au bataillon auquel j’étais affecté, je fus reçu vertement par le commandant. « Ah ! C’est maintenant que vous arrivez ! Vous devriez déjà être sur le front des Alpes ! ». « Monsieur, répliquai-je à cette vieille baderne, étant en vacances dans les Alpes, je ne pouvais pas savoir le moment d’une déclaration de guerre ! ». Passons !
Il me donna un état nominatif et l’endroit des équipements de mes soldats. Heureusement, j’avais sous mes ordres un sergent très dévoué qui conduisit une camionnette et, en moins d’une heure, les hommes ahuris reçurent leur tenue militaire, leurs sacs, leurs armes. Le lendemain, un train spécial emmena notre bataillon à Menton pour rejoindre, les jours suivants, la frontière italienne. Précisons ici que la guerre avec l’Italie n’était pas encore déclarée. Depuis la Côte d’Azur, il nous faudrait gagner Beuil, dans la vallée de la Tinée, cela à pied avec tous les équipements.
Après une étape épuisante (20 ou 30 kilomètres, je ne sais plus très bien) où les trainards ne se comptaient plus il nous restait 3 heures de marche pour atteindre le poste frontière appelé “Les Portes de Longon”. Des officiers d’active bornés s’imaginaient que des civils, habillés en soldats quelques heures auparavant, allaient pouvoir affronter la montagne allègrement. Quels imbéciles !
Ma compagnie, la 9e, était commandée par un prétentieux du nom de AIRBAUT, avec lequel je ne m’entendais pas du tout. Il n’aimait pas les instituteurs, « peu enthousiastes pour faire la guerre », disait-il. Et cependant, sur les 21 officiers que comptait le bataillon, il y avait 19 instituteurs, officiers de réserve ! A ces fameuses Portes de Longon, nous étions logés sous des toiles de tente appelées marabouts. En attendant les événement, on occupa les soldats à creuser des tranchées, des emplacements de tirs, des fortifications sommaires en prévision d’une offensive italienne, peu probables d’ailleurs, les reliefs abrupts étant interdits aux chars d’assaut.
 |
| Le camp, sous
des marabouts, à Beuil |
Nous allions passer deux longs mois dans cette nature superbe mais tout de même dangereuse en raison des orages et des coups de tonnerre fréquents, mais aussi par un ravitaillement déplorable (haricots secs et mouton étaient le menu quotidien, aucun légume frais n’étant livré aux cuisiniers). Le capitaine Guyot, commandant de mon bataillon dut protester au niveau de l’État-Major pour obtenir de la salade et des tomates, alors que nous étions à quelques kilomètres de Nice seulement. Le moral de la troupe s’en ressentait, d’autant plus que nous ne recevions aucune nouvelle de nos familles. Tous ces inconvénients ressemblaient à un véritable sabotage, comme il nous fut donné de le constater par la suite. Oui ! Le sabotage et la trahison organisés par les traîtres à la Patrie à tous les niveaux.
L’automne approchant ne nous permettait plus de vivre sous les toiles de tente qui ne pouvaient plus résister aux intempéries de la montagne.
Alors, par petites étapes de 20 ou 30 km par jour, le commandement nous dirigea vers le Var, par Puget-Théniers, puis Bargemon, puis Claviers, et enfin le haut Var, Comps exactement. On fut alors autorisé à recevoir nos épouses, pour 2 jours seulement. Enfin, ce fut la gare de Toulon où un train très long devait nous emmener vers le “front” de la Champagne sans préciser l’emplacement exact, pour cause de secret militaire. Quelle hypocrisie. Notre famille l’avait appris par la radio française, contrôlée déjà par la 5e colonne fasciste.
Deux jours de voyage, une étape à Chaumont, une autre à Vitry-le-François. Enfin, après une interminable marche de nuit, nous arrivâmes à Charmont, un petit village de la Champagne, tout près de l’immense forêt de l’Argonne, à quelques kilomètres de Vroïl, de Possesse, de Bettencourt.
Cantonnés chez des paysans, fort accueillants d’ailleurs, les hommes se disputaient les bottes de paille des étables et des écuries, pour en recevoir quelques centimètres sous leur échine. En ma qualité d’officier, je fus hébergé chez la famille Savart-Leroy, de braves gens qui me cédèrent leur propre chambre à coucher.
Je me dois de consacrer quelques lignes à cette famille composée du père, bûcheron des Ardennes, abattant des arbres à la hache du matin au soir, s’alimentant d’un modeste casse-croûte le midi. Cela même par les froids les plus rigoureux (parfois 20° au-dessous de zéro dans cette région). Son épouse s’occupait essentiellement du ménage, des jardins potagers, de l’élevage : une vache laitière, des lapins, des poules. Ils avaient eu 3 enfants : 2 garçons et une fille institutrice. Le fils aîné exerçait le métier difficile de tonnelier.
 |
| La famille
SAVART à Charmont, vers 1950 : Sara, née LEROY
(mère, 1886-1981), (Albert, fils, 1918-1954), (Joseph,
père, 1874-1954), Maurice (fils aîné, 1906-1986) |
Ils avaient beaucoup souffert, ces braves gens, pendant la Première guerre mondiale au cours de laquelle Charmont fut rasé par les Allemands. Réfugiés dans le centre de la France, ils purent reprendre leurs terre mais durent attendre fort longtemps la reconstruction de leur maison. Ils n’imaginaient pas alors que, 20 ans plus tard, ils seraient encore victimes des mêmes désastres et de manière encore plus cruelle. Je reviendrai sur le sujet plus loin.
Mme Savart m’offrait du café chaque matin, mais j’allais prendre mon petit déjeuner au mess des officiers dans un petit restaurant du village.
Notre séjour à Charmont dura plusieurs semaines, interrompues tout de même par une permission dont je pus bénéficier à la Noël.
A mon retour momentané à La Seyne, je ne tarissais pas de parler de la sinistre comédie qu’on faisait jouer aux Français. La France en guerre avec l’Allemagne mettait en place un dispositif défensif vers ses frontières du Nord, mais ses troupes ne devaient pas tirer un coup de fusil sur l’ennemi, soi-disant pour ne pas dévoiler sa stratégie. On appelait ça la “drôle de guerre”. Ce ne fut que dans les années qui suivirent que l’on apprit la complicité du gouvernement français, qui laissaient surtout les Allemands préparer leur gigantesque offensive contre l’U.R.S.S., alors que la Pologne était envahie depuis plusieurs semaines.
Donc, on attendait les évènements, et l’État-Major du régiment n’en savait pas plus que les soldats.
Vers la fin de l’année 1939, on occupait les hommes à des taches banales : marches quotidiennes, creusement de tranchées (qu’il fallut bientôt interrompre en raison du gel), revues d’armes. Les soldats, sur la paille de leur remise, faisaient des parties de cartes interminables.
Le mess des officiers ne manquait de rien. Le tabac était gratuit et mon traitement d’officier (1200 francs par mois, au lieu des 600 francs que je recevais comme instituteur) me permettait de réaliser des économies pour notre ménage.
Cette drôle de guerre entretenait dans la troupe de douces illusions et on espérait confusément des arrangements dans la politique étrangère et, pourquoi pas, le retour dans nos foyers ?
Hélas ! Nos illusions allaient se dissiper à mon retour de permission. Dans les premiers jours de l’année 1940, l’ordre arriva de partir pour le front véritable. Quel front ? Personne dans le régiment du 3e R.I.A. ne le savait. Par petites étapes, nous prîmes le chemin de la Lorraine. Il serait fastidieux d’énumérer la multitude de villages traversés, alors qu’une vague de froid exceptionnelle s’abattit sur la France entière, les régions de l’Est en particulier, Val-Esersing, Barts, Biding, etc.
J’ai gardé un souvenir inaltérable d’une nuit où nous marchions par 26° au-dessous de zéro, le casque couvert de glaces dentelées, nos boissons gelées dans les bidons. Sans cesse, il fallait relever des fantassins que la glissade sur le verglas de la route avait jetés à terre. Vers le milieu de la nuit apparurent quelques maisons obscures. Personne ne nous attendait. Alors, ce fut le sauve-qui-peut généralisé. Toutes les écuries et les étables où régnait une douce chaleur animale furent prises d’assaut et la compagnie s’endormit lourdement entre les pieds des chevaux et des vaches. Au petit jour, il fallut bien s’organiser pour installer la roulante et boire un café chaud. L’officier précurseur chargé de préparer la veille le cantonnement de Val-Esersing de triste mémoire, réussit tout de même à loger tout le monde. Les officiers dont j’étais eurent droit aux logements des enseignants de l’école désertée. Mais une seule couverture nous couvrait, ce qui m’oblige à rappeler que, pendant une semaine, pour dormir dans ces locaux sales et froids, il ne fut pas possible de nous déshabiller. Quelle situation lamentable !
 |
 |
| Les lieutenants
ANDRÉ et
AUTRAN dans la neige à Charmont (Marne) |
Les
lieutenants AUTRAN et
POGGIO dans la neige à Charmont (Marne) |
Et il nous fallut repartir quelques jours plus tard, je ne sais plus vers quel village, un peu plus accueillant tout de même. Le Maire m’attendait pour me donner un “billet de logement”. Son accueil fut aussi glacial que le climat. Non seulement il ne me salua même pas, mais il me montra la clé du logement sur son bureau : « Voilà, Monsieur ! ». Et je repartis sans me retourner pour le remercier.
Nous étions alors au delà de Château-Salins, une région occupée par les Allemands depuis la guerre de 1870. Il paraît, je l’appris par la suite, que les habitants avaient été si bien germanisés que les Français n’y étaient pas très bien tolérés. Voilà qui promettait pour la suite.
Je fus tout de même accueilli par une famille courtoise. L’ancêtre de la famille, dont les hommes avaient été mobilisés, se plaignait amèrement des évènements : « C’est la 3e guerre que je connais. Dans mon enfance, je connus la guerre de 1870, plus tard, celle de 14-18. Et voilà la 3e qui commence ! ». La vieille dame avec sa fille et ses deux enfants à charge se lamentait. Elle montra ma chambre au 1er étage, tout aussi glaciale que celle de l’école. Là non plus, je n’eus pas le courage de me déshabiller.
Et, par petites étapes, nous atteignîmes la frontière allemande sans rencontrer la moindre résistance. Vers la mi-janvier 1940, je reçus l’ordre de pénétrer dans un petit village, en territoire allemand*, abandonné par l’armée allemande désireuse de rectifier ses lignes d’attaque. Cet endroit avait été entièrement saccagé par l’armée française et rendu presque inhabitable, sauf l’école primaire demeurée intacte. Ce fut pour mes hommes un véritable paradis par le confort. On pouvait s’y chauffer abondamment, le charbon de la Sarre étant à proximité. Mais le danger d’un encerclement nous menaçait. L’école avait été transformée en véritable fortin entouré de murs en pierres sèches et en “barbelés”. On nous apporta des cartouches de fusils et de mitrailleuses, des caisses de grenades, tout cela à profusion et nous avions pour mission d’y organiser une résistance de longue durée dans le cas d’une attaque allemande qui semblait se préparer à quelque deux kilomètres de nous, aux abords de la forêt de la Warnd ? (le pendant de notre chaine des Vosges).
* Il s'agissait de
Naßweiler, dont Marius AUTRAN a ramené plusieurs photos et
divers objets en souvenir.
 |
| Village de
Naßweiler |
Nous apercevions nettement à la jumelle les fantassins allemands de leur côté, s’affairant à leurs préparatifs. Les guetteurs attentifs se relayaient toutes les deux heures. Aucun des problèmes de ravitaillement ne nous inquiétaient : chaque jour, des mulets de notre régiment de montagne nous apportaient viande, légume, boisson, tabac. C’était presque la vie de château dans cette forteresse improvisée. Notre lieutenant Larroudé, un officier compétent et courageux, dont j’ai gardé le meilleur souvenir, ne quittait cependant pas le téléphone, se tenant prêt à toute éventualité.
Un beau matin, tout de même, braquant mes jumelles vers le front allemand, la campagne blanche d’une neige d’au moins trente centimètres laissait apparaître des traces suspectes jusqu’aux abords de notre forteresse. Etaient-ce celles d’une patrouille allemande en reconnaissance ?
Je fis appel à mes soldats pour aller vérifier de plus près les traces ennemies, mais ils ne furent pas très réceptifs à ma demande, sauf le caporal Jardet, un homme des plus estimables qui répondit : « Je suis volontaire, mon lieutenant ! ». « Merci, mon petit, mais tu ne partiras pas seul », lui dis-je. Alors, les langues se délièrent et Jardet trouva lui-même l’aide d’autres partants. Du haut de mon observatoire, je les suivais à la jumelle, mais leur expédition ne put pas longue. Une demi-heure plus tard, je vis revenir mes combattants tout réjouis pour me dire : « Ce n’étaient pas des traces humaines, mais celles d’un lièvre énorme, obligé de bondir dans la neige pour chercher sa pitance ». L’ami de Jardet, un Toulousain nommé Tisseyre, me dit sans rire : « Mon lieutenant, demain, vous mangerez du lièvre ! ». Et le fort braconnier toulousain n’avait pas menti. Les collets qu’il posa le soir même s’avérèrent de la plus grande efficacité pendant la nuit qui suivit.
Vers la fin du mois de mars 1940, l’immense manteau de neige nous séparant de l’ennemi commença à fondre. Le paysage changeait d’heure en heure. C’est alors qu’après deux mois d’une vie quasiment monastique passés en observation d’un ennemi invisible, silencieux, immobile, des nouvelles indiscrètes nous parvinrent par le vaguemestre et l’agent du ravitaillement. Le bruit courait que notre unité serait bientôt relevée de notre avant-poste. Mais la confirmation officielle se faisait attendre, les parties de cartes reprenaient, la correspondance aussi et tout le monde s’ennuyait de nouveau.
Enfin, l’ordre de départ me fut donné par téléphone et l’itinéraire fut fixé. Ce fut par une nuit des plus noires que nous allions prendre notre route vers le sud, et notre marche fut un véritable calvaire. Partout où la neige fondait, elle faisait place à des flaques d’eau profonde et nous perdîmes souvent notre route en pataugeant dans l’eau à mi-jambes. En traversant les bois, nous recevions sur nos casques la glace fondante des branches d’arbres, cela dans un bruit infernal. Notre départ, qui aurait dû s’effectuer dans un silence absolu, ne se faisait guère dans la discrétion !
Parvenus sur une crête dénudée, j’aperçus vaguement un lumignon à peine visible. Je lançai un appel de reconnaissance verbal auquel une voix française répondit positivement.
A grand pas, j’arrivai devant, le poste à peine visible. J’écartais la tenture qui en masquait l’entrée et devant la pâle lueur d’une bougie, apparut la silhouette d’un officier penché sur des livres et des dossiers, un gars dont la physionomie ne m’étais pas inconnue.
J’éclatai de rire bruyamment : « En voilà une bien bonne ! ».
Et c’était pourtant vrai. L’instituteur Saint-Martin avait été normalien avant moi à Draguignan et, à La Seyne, je connaissais son père, agent de la Police d’État.
- « Nous ne faisons absolument rien ici. Alors, je prépare mon avenir ».
Ces retrouvailles me firent chaud au cœur. Mon camarade me fit apporter une tasse de café, mais il ne fut guère possible de prolonger cet entretien, on peut dire des plus inattendus.
Exténués par cette marche de nuit, nous prîmes quelque repos dans des abris de fortune en bois, des maisons abandonnées, en attendant le lever du jour.
D’étape en étape, une fois au moins grâce à un “tortillard”, nous allions reprendre un peu de courage et d’espoir dans le département de la Haute-Saône, au petit village fort sympathique nommé Anjeux. Je pus enfin coucher dans un lit confortable à l’école du village toujours occupé par la population civile. Nous allions prendre en ces lieux paisibles 2 ou 3 semaines d’un repos absolu. Nous eûmes tôt fait de nous lier à la population paysanne, occupée essentiellement à l’élevage des poules, des lapins, des canards. Notre cuisinier s’approvisionnait chez les rares commerçants du village, ravis de pouvoir faire des affaires fructueuses.
 |
| A Anjeux, avril
1940 |
Il me souvient d’avoir commandé un jour une marche militaire avec dépôt de gerbe au Monument aux Morts de la guerre de 14-18. Nos rapports avec la population furent d’une extrême courtoisie. Il y avait, comme partout, quelques coureurs de jupons, mais les filles étaient rares. Tout de même, deux ou trois officiers, dont j’étais, avaient réussi à en convaincre quelques-unes de participer à un pique-nique, tout près d’un bosquet à proximité du village, sous l’œil vigilant des mamans quelque peu inquiètes. Mais, le prestige de l’uniforme aidant, il fut convenu d’un jour et d’une heure précise.
Je crois bien me rappeler du jour (5 mai) et de l’heure (12 h). Mais, au moment de préparer nos modestes victuailles, un ronron sinistre retentit à faible altitude au-dessus de nos têtes, suivi de plusieurs explosions de bombes qui s’abattirent sur la gare du village, à moins de 200 mètres de nous. Quelques minutes plus tard, un appel téléphonique nous enjoignit de nous préparer au départ. Pour aller où ? Nous n’en savions rien ? Les mêmes instructions furent transmises à toutes les compagnies du 3e R.I.A., cantonnées, comme ma section, dans les villages de la Haute-Saône (Jasney,…).
Ce bombardement était significatif. Si l’ennemi détruisait les gares et les voies ferrées, c’es que la guerre “en dentelles” allait finir. Précipitamment, il fallut nous embarquer dans des autocars et prendre la direction du nord-ouest. On finit par savoir que c’était la route de Beauvais, et aussi que les Allemands avaient envahi la Belgique.
Bien évidemment, comme l’avaient fait leurs pères en 1914, ce fut par la Belgique que la France allait connaître l’invasion. Les stratèges français avaient consacré des sommes colossales à la construction de la ligne de défense dite Ligne Maginot, qui ne protégeait aucunement la France sur la frontière belge. Et, par surcroît, un pays plat, aisément franchissable par les divisions blindées allemandes.
A partir du 19 mai et jusqu’au 5 juin, nous allions connaître des évènements décisifs : bombardements aériens, déplacements précipités des plus imprévus. Les Allemands prirent Amiens, qu’ils incendièrent.
Je ne vais pas raconter, à partir de là, les jours dramatiques vécus sur les bords de la Somme, la retraite de nos unités à travers les départements de l’Aisne, de l’Oise, de la Seine-et-Oise, pour la simple raison que ces évènements douloureux, affreux, ont fait l’objet de longs développements dans le tome IV des “Images de la vie seynoise d’antan”, avec des récits parfois bien surprenants comme “Le mitrailleur et le cheval miraculés”, “Verneuil-sur-Oise”, “Le pont d’Orléans”, “Pithiviers”, “Évasion réussie”. Il m’aurait fallu tout un volume pour évoquer mes souvenirs personnels de la guerre 1939 (août) – 1940 (juillet).
Je reprends donc mon autobiographie à la fin de la guerre, à ma démobilisation qui eut lieu, je crois bien, le 26 juillet 1940. Dans le courant de l’été qui suivit, mon retour et celui d’autres camarades fut fêté chez M. Poggio, commerçant bien connu à La Seyne. Un repas copieux nous rassembla avec nos familles dans une propriété sise au quartier de Janas. Quelques jours auparavant, j’avais invité mon camarade Costes, mon compagnon d’évasion, à un repas fraternel chez mon père, à Mar-Vivo.
J’étais bien sur bien heureux d’avoir retrouvé mon épouse, sa mère, mes parents, ma grand-mère. Mais d’autres inquiétudes nous attendaient.
Après la débâcle de la France, trahie et vaincue, le maréchal Pétain fut appelé au pouvoir pour liquider les institutions démocratiques. La “République française” devint l’“État français”.
J’attendais la rentrée d’octobre 1940 pour reprendre ma classe de cours supérieur à l’École Martini où je n’avais enseigné qu’une année (1938-1939).
La disparition de la IIIe République et son remplacement par l’État français allaient sans doute créer des conditions nouvelles de vie pour la population.
Quelles incidences sur notre vie quotidienne ? Sur notre profession, nos libertés, notre mode de vie ? Nous n’allions tarder à mesurer l’ampleur des nouveaux désastres. La France, pillée par l’ennemi, ses institutions détruites, ses élus limogés et remplacés souvent par des incapables, militaires pour la plupart, sa vie associative anéantie.
A La Seyne plus particulièrement, le conseil municipal élu en 1935 fut dissous par simple arrêté préfectoral, les syndicats interdite, les francs-maçons de l’enseignement expulsés de l’école laïque (MM. Varangue et Boudon, notamment, professeurs à l’École Martini).
Le gouvernement de Vichy accepta que nos chantiers de construction navale soient placés sous tutelle allemande. Il lança l’idée d’un grand mouvement patriotique appelé La Légion, pour soutenir la politique de l’État français. Bref, on n’en finirait pas de développer tous les aspects du vichysme.
Nos chantiers n’avaient plus de travail. Le ravitaillement devenait de jour en jour plus problématique. La pratique des cartes d’alimentation se généralisa en quelques mois. Les Seynois manifestèrent très tôt leur mécontentement à l’égard de la politique nouvelle imposée par l’Occupant allemand et les mesures répressives l’accompagnant.
Au plan politique, les partis de gauche, surtout le Parti communiste, furent frappés. Des centaines de militants furent enfermés dans des camps (Chibron fut le plus près de La Seyne).
La rentrée des classes eut néanmoins lieu en octobre. Je repris le Cours supérieur de l’École Martini et Louise son poste à l’École Curie.
Nous habitions alors au quartier Touffany, chez ma belle-mère, celle que nous appelions familièrement “Mémé GAUTIER”, un des personnages les plus aimés de la famille, veuve depuis l’âge de 22 ans, depuis le 25 septembre 1911 où son mari Louis GAUTIER fut tué par l’explosion du cuirassé Liberté en rade de Toulon (voir le tome I des “Images de la vie seynoise d’antan”). Dans cette maison du quartier Touffany, Mémé GAUTIER avait hérité d’un appartement, ainsi que sa sœur Fernande, épouse MEUNIER.
Cet appartement spacieux, nous l’avons occupé pendant 5 ans, jusqu’en 1944, année du sinistre bombardement du 29 avril où sa toiture fut partiellement détruite. Les conditions de notre vie matérielle y étaient satisfaisantes, à l’exception du ravitaillement qui était réduit à la plus grande indigence et nous allions connaître encore pendant plusieurs années des privations intolérables.
Et nous voici en 1942, encore une année terrible pour de multiples raisons, à commencer par des raisons professionnelles les plus inattendues, les plus inimaginables.
Durant l’année 1941-1942, l’E.P.S. (École Primaire Supérieure) Martini, structure datant de 1833, fut transformée en Collège moderne, allant d’une classe de 6ème jusqu’à une classe de 2nde. L’École ne préparait pas encore au baccalauréat. Et voilà qu’un conflit éclata au sein des 4 professeurs, enseignant dans les grandes classes, qui refusèrent d’enseigner dans la classe de 6ème, à des enfants d’âge moyen de 11 ans.
Avec hauteur, ils refusèrent d’enseigner à des “petits”. Ils estimaient qu’il y avait atteinte à leur dignité de “professeurs” certifié et protestèrent auprès du directeur, M. MALSERT, qui tint informé M. l’Inspecteur d’Académie de ces difficultés pour le moins surprenantes. Ce dernier, M. Drouillon, homme très affable et surtout très ouvert, trouva sur le champ une solution à ce problème :
M. MALSERT me convoqua le jour même pour me proposer la 6ème. « Mais, ajouta-t-il, votre travail ne sera pas de tout repos car il vous faudra enseigner du français, des mathématiques, des sciences, de la musique, du dessin, et même de l’anglais, première langue obligatoire. Par contre, votre horaire se réduira à 18 heures de cours, contre 30 heures que vous devez au primaire ».
Illico, je donnai mon accord à M. MALSERT. Même l’enseignement de l’anglais ne m’effrayait pas. Il m’avait bien fallu en apprendre un peu pour réussir mon B.E.P.S. !
 |
| Marius AUTRAN au milieu de ses élèves de 6ème et 5ème de l'École Martini (1946-1947) |
Et ma nomination pour la classe de 6ème arriva le surlendemain, au grand dam des professeurs, dont un certain AD, d’origine corse, un individu des plus méprisables que j’aie rencontré dans ma vie et dont je vais parler longuement.
Ce sinistre personnage protesta auprès de l’administration de l’Instruction publique contre le fait qu’un instituteur avait été nommé dans un établissement du second degré. Il alerta un de ses amis politiques, socialiste, devenu grand directeur de l’Enseignement, lequel enjoignit M. MALSERT de renvoyer M. AUTRAN à l’école primaire (ce que d’ailleurs il n’aurait pas pu faire !). Bref, une véritable cabale fut montée contre moi, jusqu’au niveau ministériel.
De mon côté, j’allai tout faire, bien sûr, pour me défendre auprès de l’Académie et du Ministère. J’écrivis à un ami personnel, Sénateur-Maire de Douai, président de la Commission de l’Éducation Nationale du Sénat en lui expliquent l’imbroglio dans lequel le AD (qui avait fait franciser son nom pour en effacer la consonance corse, dont il devait avoir honte !) m’avait placé.
Ce brave homme de Douai, M. Canivez, me rassura aussitôt en me déclarant : « Du moment que l’Académie du Var vous a désigné dans ses nouvelles fonctions, vous avez des droits acquis ».
Tout cela était bien réconfortant, mais je dus réagir sur une autre attaque. Le AD, professeur de mathématiques, voulut se faire attribuer des heures supplémentaires pour m’empêcher d’avoir un horaire complet, et donc d’exercer mes fonctions. Je demandai alors audience à l’Inspecteur d’Académie auprès de qui je demandai justice. « Partez d’ici tranquille, me dit M. Drouillon. En accord avec M. MALSERT, vous garderez toutes vos prérogatives ».
Merci M. Drouillon, c’est à vous que je dois ma situation de professeur de collège et surtout de la retraite correspondante (une retraite qui dure depuis plus de 36 ans à l’heure où j’écris ces lignes). Merci à l’école laïque que j’ai bien servie et qui n’a pas été ingrate !
Il me semble nécessaire, pour ajouter à mes démêlés avec ce personnage odieux que fut AD, un aspect politique amusant qui doit se situer dans les années 50-53. Quand je fus candidat aux élections municipales sur la liste T. MERLE, dirigeant communiste au niveau fédéral, je me trouvai encore opposé à ce AD, représentant d’une liste socialiste animée par un anticommuniste féroce. J’éprouvai une immense satisfaction à l’annonce des résultats : la liste socialiste était écrasée. A l’École Martini, j’eus le triomphe modeste, mais la grande majorité de mes collègues fut réjouie de ce soufflet magistral qu’avait reçu le calomniateur infernal, qu’une destinée cruelle allait frapper deux ou trois ans plus tard, au delà des problèmes électoraux. Comme il avait empoisonné l’atmosphère l’école, il avait aussi rendu sa vie familiale infernale. Sa femme, excédée du caractère de son époux, se suicida dans l’École des Moulins, à Toulon, où le ménage était logé. AD ne revint alors plus jamais à l’École Martini. Il obtint une mutation pour le Vaucluse où il avait exercé son métier avant de venir à La Seyne. On sut quelques mois plus tard que des inscriptions murales avaient déjà fait leur apparition aux abords de l’école : « A mort AD ! ». Je n’en dirai pas plus sur lui, qui sema la zizanie partout où il passa.
J’en reviens maintenant à cette année 1942 qui laissa dans ma vie de douloureux souvenirs.
Dans la maison familiale des GAUTIER et des MEUNIER demeurait aussi Louis MEUNIER (Loulou), neveu de ma belle-mère. Chaudronnier de son état, Loulou travaillait à l’Arsenal maritime, dans les ateliers du Mourillon. Peu après la démobilisation (juillet 1940), avec ses camarades de travail, ils avaient organisé un syndicat C.G.T. et une cellule communiste qui, maladroitement, appelaient à la résistance contre l’ennemi allemand et ses alliés vichyssois. Ils imprimaient et distribuaient des tracts, sans grande méfiance. Jusqu’au jour où la police s’en mêla et procéda à l’arrestation de 17 camarades des ateliers du Mourillon.
Interrogé sous la torture, Loulou révéla le fait que nous habitions dans la même maison. Les flics toulonnais pensèrent que, moi aussi, je devais appartenir au même réseau clandestin, ce qui était faux, archi-faux. C’est pourquoi, le 17 mars 1942, vers 11 heures du matin, les policiers toulonnais vinrent procéder à mon arrestation, dans ma classe de 6ème de l’École Martini, en présence de mes élèves et du directeur, M. MALSERT.
 |
| Cahier
de notes (2e trimestre de l'anne scolaire 1941-1942) de la classe de
6ème moderne de Marius AUTRAN, interrompu du fait de son
arrestation, dans sa classe, le 17 mars 1942 |
Je fus d’abord emmené à ma maison pour assister à une perquisition qui s’avéra infructueuse. Puis, je dus subir un interrogatoire à Toulon. Après avoir dit à ma femme que je reviendrai bientôt, je fus enfermé à la prison du commissariat de Toulon – arrestation dite préventive. J’appris par la suite qu’ils revinrent par la suite perquisitionner dans ma classe, sans résultat intéressant pour eux. Puis, malgré leur insuccès, je fus conduit à la prison maritime avec le motif d’accusation affiché au-dessus de la porte de la cellule : « Atteinte à la sûreté de l’État ». Et pourtant, aucun chef d’accusation véritable n’avait été démontré. (Elle est belle la justice française !). Si belle et si juste qu’on dut me relâcher 2 mois plus tard après que mon avocat, Me Le Bellegou confondit les juges de leur erreur. Il n’en resta pas moins que je subis 2 mois de cachot dans une cellule de 3 m2, quasiment obscure, sans relation humaine, nourri sommairement. Je fus autorisé à lire et à écrire après le premier mois de détention. Le garde-chiourme m’autorisait à faire quelques pas dans une cour intérieure, absolument seul. Après un quart d’heure d’air pur, je retrouvai mas cellule, mon lit de planches et mon oreiller, une barre de fer à section carrée. Tout de même, un dimanche matin, le geôlier vint m’ouvrir pour me proposer d’aller à la messe dans une petite chapelle de la prison. « Ça te fera voir du monde », me dit-il. Je refusai de sortir et il en fut tout étonné. « Je n’ai pas besoin de l’aide de Dieu pour me sortir d’ici », lui dis-je. Alors, il referma bruyamment la porte du cachot en faisant cliqueter son immense trousseau de clés.
 |
| La sinistre
Prison Maritime de Toulon, au début du XXe siècle |
Après 2 mois de séjour dans cet enfer humain, peuplé surtout de marins punis pour la moindre incartade par un juge d’instruction féroce appelé Gaullène, lequel d’ailleurs n’avait rien pu tirer de mes interrogatoires.
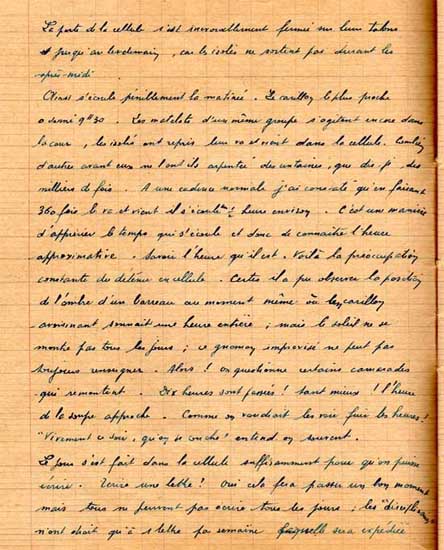 |
| Une page du
cahier écrit par Marius AUTRAN pendant son séjour
à la Prison Maritime |
Bref, sorti des griffes de la justice militaire (ce fut une cour martiale qui jugea les 17 inculpés du mois de mars), je repris contact avec la vie civile le 5 mai 1942, mais il fallu des mois pour que l’Éducation nationale se décide à me restituer ma classe de 6ème, sans toutefois me payer mon traitement. J’avais théoriquement un rappel à toucher, que je n’ai jamais perçu.
Sur l’insistance de M. MALSERT, défenseur de ma juste cause – puisque j’avais bénéficié d’un non-lieu de la justice – je repris mes fonctions à l’École Martini le 1er octobre 1942.
Mais mes collègues instituteurs et professeurs me réservèrent un accueil plutôt froid. Plusieurs d’entre eux me considéraient comme un suspect surtout ceux qui avaient adhéré à la Légion de Pétain. Leur attitude évolua tout de même en fonction des évènements de la guerre, surtout à partir de la débâcle allemande de Stalingrad, fin 1942.
Après une absence de près de 6 mois à l’École Martini, nous vécûmes dans l’inquiétude et surtout l’incertitude avant ma réintégration dans l’Enseignement. L’Éducation nationale, aux ordre des Vichyssois, n’allait-elle pas considérer qu’ayant fait 2 mois de prison, je n’avais plus le droit d’enseigner ? Si j’étais limogé, il me faudrait bien penser à trouver du travail. Quel travail ? Et quel travail lucratif. Ma famille vivrait bien chichement avec le seul salaire de Louise. J’aurais sûrement des difficultés à trouver un emploi à caractère administratif. Alors, j’eus l’idée d’acquérir une petite propriété dont je pourrais tirer profit par la culture.
Nous avions réalisé quelques économies pendant la guerre (mon salaire d’officier ayant été exactement le double de celui de l’instituteur que j’étais). En prospectant dans les campagnes, j’appris le désir des époux Rocchia de vendre une partie de leur propriété du quartier Bastian. La parcelle mise en vente mesurait entre 8 000 et 9 000 m2, dont un bon tiers était planté en vignes et fruitiers. C’était précisément cette partie qui m’intéressait. Hélas ! Il aurait fallu morceler pour acheter ce seul tiers désiré et les nouvelles lois de Vichy interdisaient le morcellement des terres. Je fis part de ces difficultés à mon petit cousin Lucien Sicard, qui occupait alors des fonctions départementales importantes en tant que directeur de la maison de retraite du Luc. Lucien Sicard était bien en cours à la Préfecture du Var, où il avait aussi son oncle Prosper, conseiller général de canton de Tavernes et riche propriétaire des vignobles de Montmeyan dont j’ai parlé précédemment. Lucien connaissait bien le Préfet de l’époque nommé, je crois me rappeler, M. Haag.
Il me promit de s’occuper de ces difficultés et, quelques semaines plus tard, la parcelle cultivée des Rocchia fut détachée, au mépris des lois pétainistes. Propriétaire de ce terrain que j’ai cultivé pendant plus de 50 ans de ma longue vie, il me semble nécessaire de lui consacrer quelques développements, sous la rubrique “Bastian”.
Bastian
Ce nom est probablement celui d’une ancienne famille dont la tradition a perpétué le nom en l’attribuant au quartier.
La propriété Rocchia, émigrai italien des années 1920, avait acheté plusieurs hectares, qu’il ne parvenait plus à cultiver avec son épouse Moracchini, d’origine corse.
L’acte de vente se fit au mois de mai de l’année 1942 aux conditions suivantes : paiement au comptant et surtout, avec les récoltes sur pied. De sorte qu’entre le mois de mai et la fin 1942, j’eus du vin, de l’eau-de-vie, des fruit en quantité : cerises, pêches, abricots, mandes, noisettes, prunes, figues, coings, poires, etc., sans parler des légumes secs.
Quelle belle affaire ce jour-là ! Et tout cela pour la somme de 32 000 francs, de l’époque, bien sûr.
J’aurais pu écrire tout un ouvrage sur Bastian en évoquant les années heureuses que ce lopin m’a procurées : années de travail fructueux, mais aussi de détente, années de projets réalisés d’année en année pour améliorer, certes modestement, la productivité, la sécurité.
Il fallut clôturer, car je fus souvent victime des vols de fruits, imputables souvent aux voisins mêmes, et aux soldats italiens d’occupation du sol varois, pour quelques mois seulement, en 1943, heureusement !
Il me fallut faire construire un cabanon pour abriter mes outils de travail, l’agrandir par la suite pour aménager un pressoir, une cuve à vin, des bonbonnes et un tonneau. Le vignoble vieillissant, un plantier neuf fut envisagé et réalisé… enfin le travail ne manquait pas. Mon travail d’enseignant me donnait tout de même deux jours et demi par semaine pour faire face à tout l’entretien qui peut se résumer ainsi : labours au moins deux fois par an, taille de 1200 pieds de vigne et de 30 arbres fruitiers, désherbage permanent, plantations de légumes secs (haricots, pois chiches), de pommes de terre, autant de denrées alimentaires rares pendant la période de restrictions occasionnées par la guerre et l’occupation ennemie.
 |
| Le cabanon de
Bastian, peinture de Marius AUTRAN, vers 1957 |
J’étais bien familiarisé avec les travaux de la campagne, que je connaissais depuis mon enfance à Mar-Vivo chez mes grands-parents, depuis ma jeunesse aussi au temps des vendanges chez les Audibert, les Teissore, les Barbaroux. Mais je ne disposais alors d’aucun engin mécanique : ni motoculteur, ni fouloir pour le raisin. Des voisins compatissants m’aidèrent dans ma tâche, mais l’essentiel se faisait avec les outils traditionnels de mes ancêtres : pioche, bêche (béchard, disaient-ils), fourche-bêche (liché), sadounet, magouillet, etc. Et, ma foi, après des journées de travail harassantes, le bilan des récoltes était tout de même positif, et nous pouvions mieux satisfaire notre faim.
En possession d’une bicyclette comme seul moyen de transport, il me fallait amarrer en permanence un cageot sur le porte-bagages et me charger également d’un sac tyrolien. Par la suite, le cageot fut très souvent remplacé par un siège en osier où prenait place mon fils Jean-Claude, intéressé lui aussi au plus haut point par la terre et le cabanon de Bastian où, dans les années qui suivirent la Libération, je pus obtenir une adduction d’eau de la ville.
J’en reviens à l’année 1942 dont je disais il y a quelques instants qu’elle fut particulièrement douloureuse, surtout pendant le mois d’octobre.
La mort de ma mère
 |
| Victorine
AUBERT, épouse AUTRAN, vers 1940 |
Depuis une dizaine d’années, mes parents avaient acquis, par la vente des AUBERT, une pinède à Mar-Vivo dénommée “Leï Gari” (les rats, en langue française) où se trouvait un cabanon délabré qui recevait nombre d’ordures du quartier et dont fréquenté par les rats à la recherche de leur provende, ce qui explique l’appellation qui précède.
Mon père et ma mère y construisirent une petite maison, suffisante pour eux, cela dans les années 1930, où ils abandonnèrent leur logement Seynois de la rue Hoche. Dans cette sorte de petit chalet, mon père se retira lorsqu’il prit sa retraite de l’Arsenal.
 |
| La Maison
"Leï Gari” de Simon et Victorine AUTRAN à Mar-Vivo |
Avec sa fidèle épouse que fut ma mère, ils passèrent là sans doute les plus belles années de leur vie. Rien ne leur manquait. Mon père, grand bricoleur, aménagea les clôtures en fer forgé, une véranda, fit construire un garage. Il disposait d’une petite voiture (une 201 Peugeot), d’un bateau de pêche (une bette nommée La Noune, équivalent marseillais de “Ma chérie“). Il chassait dans les bois environnant et cultivait aussi un peu de jardin. Ma mère, toutefois, éprouvait quelques difficultés pour le ravitaillement et il lui fallait aller de temps en temps faire des provisions en ville, le quartier de Mar-Vivo à l’époque ne possédant que peu de structures commerciales. Habituée depuis sa jeunesse, ma mère se déplaçait ainsi souvent à bicyclette.
Je crois me rappeler de la date du 17 octobre où elle partit ce jour-là vers la ville pour y faire ses courses. Vers les 11 heures, elle rentrait, chargée modestement, par la route des Sablettes. Entre le quartier Pont de Fabre et La Maurelle, une tranchée importante avait été ouverte pour remplacer des canalisations d’eau potable et, de fait, la largeur de la route était réduite de moitié.
La circulation n’était pas très dense à l’époque. Quand elle s’engagea sur la voie réduite, aucun véhicule ne venait vers elle, aucun véhicule ne la suivait. Quelques minutes plus tard, un camion de 20 tonnes de l’entreprise Barla voulut la doubler sur la voie réduite. C’est alors que se produisit le drame. Le chauffeur crut pouvoir la doubler. Hélas ! Elle fut accrochée, sa robe déchirée en porta témoignage. Elle fut culbutée et la roue arrière du camion écrasa sa jambe gauche et sa hanche fut heurtée violemment. A ses cris, des habitants de La Maurelle accoururent et l’installèrent dans une chaise longue. Elle perdit beaucoup de sang. Personne n’avait de téléphone dans le quartier. Je ne saurais dire comment l’hôpital de La Seyne fut informé. Mon père était à la pêche ce jour-là, moi à l’École Martini. Avant que l’un et l’autre nous soyons informés, ce ne fut qu’aux environs de midi que nous pûmes la voir encore vivante à l’hôpital.
Je passe sur la multitude des détails dont je n’ai oublié aucun, pour en venir au fait qu’elle fut amputée de la jambe gauche et, le lendemain matin, on vint me prévenir de son décès à l’École Martini. Je restai à son chevet toute la nuit qui suivit. Mon père l’avait assistée jusqu’à son dernier souffle. Affaiblie considérablement par les restrictions de la guerre, et surtout par la gravité de l’opération, elle ne put en supporter davantage.
J’assistai à sa mise en bière en présence de notre tante Louise Pisany. Mon père, très éprouvé, n’avait pas voulu être là ; il tenait surtout à parlementer avec les autorités de l’hôpital qui allaient ordonner la mise du cadavre à la morgue en attendant les obsèques. Satisfaction lui fut donnée, mais il fallut attendre la tombée de la nuit pour que le corbillard put sortir de l’hôpital afin que ma mère puisse passer sa dernière nuit chez elle, à Mar-Vivo, dans sa maison qu’elle avait tant aimée.
Je tiens à souligner que j’ai accompagné le cercueil de l’hôpital à Mar-Vivo, seul, absolument seul, à pied bien entendu, car les Pompes Funèbres de l’époque ne possédaient aucun engin mécanique.
Ce fut pour moi une des épreuves les plus cruelles de ma vie d’homme.
Le jour suivant eurent lieu les obsèques, civiles comme le voulait la tradition familiale. Elles rassemblèrent beaucoup de monde. Nous reçûmes les condoléances, mon père, mes oncles et moi.
Bien évidemment, mon père allait se retrouver aux prises avec des difficultés matérielles auxquelles il n’était pas du tout habitué. Il me faudrait bien l’aider à supporter sa dure épreuve laquelle, hélas ! ne fut pas la dernière dans cette période dramatique de la guerre, comme la suite des récits va le montrer.
Quelques jours se passèrent. Sur les conseils de la famille et de ses amis, mon père tenta d’obtenir une réparation à son désastre. Convaincu de l’innocence de son épouse, il porta plainte contre l’auteur de l’accident, employé de la société Barla. Cela fut la lutte du pot de terre contre le pot de fer. La justice désigna un agent de police chargé d’effectuer une enquête sur les causes de l’accident et d’établir des responsabilités. Ce petit fonctionnaire, quasiment illettré, expliqua que ma mère n’avait pas été maîtresse de son vélo, que le sac de provisions, étant trop lourd, avait faussé sa conduite et que, finalement, c’est elle qui avait tort. Le chauffeur ne fut accusé de rien et l’entreprise Barla gagna le procès que mon père avait engagé contre elle. Par surcroît, tous les frais de justice furent payés par le plaignant.
Mieux encore ! Le vélo de ma mère avait été amené au Palais de Justice et il ne fut jamais restitué à la famille malgré les réclamations. Il ne représentait pas une fortune, c’est vrai, mais il n’appartenait pas au tribunal de s’en accaparer. Ce fut là un aspect peu reluisant de cette institution qu’on appelle la Justice.
La vie reprit son cours avec toutes les difficultés de cette période dramatique de la guerre : restrictions alimentaires occupation allemande et italienne, actions clandestines contre l’ennemi étranger et aussi contre l’ennemi français vichyssois.
Au plan local, avec mon ami Toussaint MERLE, nous nous efforcions de collecter des fonds pour la Résistance et les maquis du Var. J’eus la responsabilité d’organiser un mouvement nommé “Front National”, qui n’avait aucun rapport avec celui d’aujourd’hui ! (an 2000).
On imprimait des tracts, on les distribuait nuitamment, on collait des affichettes, on préparait peu à peu la population à l’idée de la victoire des Alliés sur le fascisme qui avait assassiné la IIIe République, pendant que les camarades des chantiers navals accomplissaient des actes beaucoup plus concrets par les sabotages et même les grèves.
L’année 1943 fut marqué dans ma famille par la mort de ma grand-mère AUBERT (Joséphine Hermitte). Elle atteignait ses 80 dans sa maison “Le Bocage”, sise tout juste en face de celle de mes parents “Leï Gari”, demeure qu’elle occupait avec son fils Paul.
 |
| Joséphine
HERMITTE,
épouse AUBERT, en 1933 |
Ce deuil nous frappa moins cruellement que la perte dramatique de ma mère, l’année précédente, mais ce fut tout de même un malheur qui s’ajouta aux autres. Comment aurais-je pu oublier les bienfaits de cette grand-mère AUBERT, si dévouée pour les siens, si genreuse pour tout le monde !
La fin de l’année 1943 nous apporta une immense satisfaction : la défaite allemande de Stalingrad, point de départ de la chute de l’hitlérisme et du fascisme italien.
Les collaborateurs pétainistes de la municipalité seynoise du capitaine Galissard commencèrent à trembler, ce qui facilita notre propagande clandestine contre eux. A la permanence du Mouvement dont j’étais responsable, je reçus des adhérents de la classe moyenne seynoise : des commerçants, des gens des professions libérales (Me Taddei, par exemple, et même le chanoine Chateminoy, qui me présenta le docteur Sauvet (qui sera le premier maire de La Seyne après la Libération).
 |
| Carte
d'identité de Marius AUTRAN, avec photo de profil, en 1943 |
L’année 1943 nous apporta de grandes satisfactions à l’annonce des nouvelles réconfortantes : les armées allemande battaient en retraite partout en direction de Berlin.
Le soir, dans notre maison du quartier Touffany, avec l’oncle de Louise, Louis MEUNIER [le père de Loulou qui, lui, était toujours en camp d’internement depuis son arrestation en mars 1942 – il ne sera libéré qu’en mars 1944], nous écoutions la radio clandestine malgré un brouillage des ondes puissamment organisé. Nous en apprenions assez pour mesurer l’ampleur de la débâcle allemande. Les gens s’en réjouissaient maintenant à haute voix sur le marché et dans les ateliers.
Alors, les jeudis et les dimanches, nous partions à la “campagne”, à notre Bastian où nous pouvions améliorer notre ordinaire en récoltants fruits et légumes : légumes frais, légumes secs, fruits frais, fruits secs également (amandes, noisettes).
Les jours de classe nous pesaient moins dans la perspective de la libération prochaine, malgré les alertes aux bombardements libérateurs. Conscientes de leurs responsabilités, les autorités municipales d’alors envisagèrent d’assurer la protection de la population civile menacée de toutes parts. Les habitation de la zone côtière furent évacuées à plusieurs kilomètres du bord de la mer. Mon père dut ainsi abandonner sa maison de Mar-Vivo, mais, avant de partir, il fit tout son possible pour la rendre inhabitable. Il démonta patiemment toutes les installations électriques, les enferma dans des cartons numérotés dans l’espoir de les reconstituer après les ravages de la guerre, si sa maison n’avait pas été détruite. Il fit de même avec les canalisations d’eau potable. Après quoi, il trouva à se loger à La Seyne, place Martel Esprit d’abord, rue de Lodi par la suite. Mon oncle Paul AUBERT occupa, lui, un appartement, propriété de ma grand-mère AUBERT, rue Louis Blanqui.
De nombreux appartements avaient été libérés à partir de l’année 1943 en raison du départ de nombreux Seynois vers l’intérieur du département du Var et aussi vers des contrées plus éloignées de la côte : l’Ardèche, le Vaucluse, les Basses-Alpes.
Le maire avait créé un service des évacuations. Tout le hameau de Saint-Elme, le village de Saint-Mandrier furent évacués sur les ordres de la “Kommandantur” allemande, par nécessité stratégique, l’ennemi redoutant la possibilité d’un débarquement de troupes sur les plages des Sablettes et de Fabrégas.
La Seyne se dépeuplait. Les écoles fermaient les unes après les autres. Les enfants furent dirigés majoritairement vers le département de l’Isère. Les enseignants n’ayant plus d’élèves, l’administration les mit le plus souvent au service des municipalités, ce à quoi, personnellement, je refusai d’obéir. D’ailleurs, la pagaille s’installait partout, et surtout la peur. Un bombardement particulièrement meurtrier effectué par les Alliés fut celui du Mourillon, qui fit près d’un millier de victimes. Et c’était l’Arsenal qui était visé !
Les jours s’écoulaient dans une ambiance trépidante. Les sirènes des Chantiers, de l’Arsenal et d’ailleurs retentissaient presque chaque jour, contraignant les habitants à gagner les campagnes seynoises et six-fournaises, car les villes n’étaient pas équipées d’abris souterrains.
L’année 1944
Depuis la fin de l’année 1943, ma vie familiale allait être confrontée à des problèmes particulièrement délicats : Louise attendait un bébé. Si nous n’avions pas de soucis professionnels en raison des évènements, les écoles étant désertées, nous étions par contre dans la plus grande inquiétude sur les conditions d’un accouchement qu’on imaginait difficile. Louise était suivie par un docteur réputé de Toulon dénommé André, retraité de la Marine. Ce médecin, qu’on allait voir au Mourillon, nous avait mis en confiance sur la venue de cet enfant. Il prévoyait un accouchement normal, en nous conseillant toutefois d’entrer en clinique une quinzaine de jours avant la naissance, prévue pour le milieu du mois de mai.
Ce que nous n’avions pas prévu, ce fut le fameux bombardement du 29 avril, de sinistre mémoire, qui nous obligea à quitter La Seyne précipitamment, notre maison du quartier Touffany ayant été gravement sinistrée.
Dans le tome 2 de la série “Images de la vie seynoise d’antan”, à la rubrique “Des années dramatiques” (page 344), j’ai raconté avec beaucoup de précisions ce douloureux événement pour notre ville de La Seyne. Ce jour du 29 avril, vers les midi, une alerte aux avions fut suivie presque rapidement par l’arrivée de bombardiers lourds américains venus dans l’intention de détruire les Chantiers navals. Résultat : les Chantiers reçurent 4 bombes, l’une endommagea une cale de lancement de bateaux, l’autre coulant un petit remorqueur. Et c’est la population agglomérée qui reçut 700 projectiles de 500 à 1000 kg. La Seyne fut sinistrée à 65 %. Plus de 100 morts, des centaines de blessés, des milliers de maisons détruites, voilà le beau travail de nos alliés américains.
Au quartier Touffany où nous habitions, le souffle d’une bombe tombée à proximité emporta une partie de la toiture, juste au-dessus de notre chambre. Pendant le passage des bombardiers, nous étions blottis au rez-de-chaussée dans l’appartement des MEUNIER. Louise, à trois semaines de son accouchement, nous causa beaucoup de soucis.
Il nous fallait partir au plus vite. Mais où aller ? En accord avec les médecins, il fut convenu que Louise entrerait en clinique dans les jours suivirent. Il s’agissait de la clinique Malartic qui, d’ordinaire, accueillait les gens dans son établissement du Pont-du-Las. Mais M. Malartic, en homme très avisé, prévoyant les dangers qui planaient sut Toulon, avait pris l’heureuse décision de transférer ses tables d’opération et son personnel soignant composé surtout de religieuses, vers l’intérieur du département, à Méounes-les-Montrieux, dans un monastère bien éloigné des théâtres de la guerre côtière.
Comment nous y rendre ? Aucun moyen de transport collectif n’existait dans cette période. Aucun taxi. Aucune voiture d’ami, les véhicules à moteur avaient été réquisitionnés ou interdits par l’occupant allemand. Je ne me souviens pas par quel hasard heureux je rencontrai, dans les premiers jours du mois de mai, mon ami Paul Pratali avec qui j’avais quelques relations au plan de la Résistance. Je lui fis part de mes difficultés pour rejoindre la clinique de Montrieux.
Sans hésiter, il me dit : « Rentre chez toi, prépare ta femme. Demain matin, je t’enverrai un copain avec son véhicule ».
Ma femme et sa mère furent bien soulagées de pouvoir partir. Mais dans quelles conditions ? Nous n’en savions encore rien.
Je tiens à entrer ici dans les moindres détails d’une aventure que j’ai racontée maintes fois, aventure qui me paraît encore aujourd’hui à peine croyable. La voiture promise par Paul Pratali arriva à l’heure dite au quartier Touffany. On s’y engouffra précipitamment avec nos bagages.. Mais, au moment de m’asseoir à côté du chauffeur, un gars que je ne connaissais même pas, mon regard découvrit sur le pare-brise une inscription qui me fit froid dans le dos : “KOMMANDANTUR ALLEMANDE !”. Comme je manifestai mon étonnement et surtout mes craintes, le chauffeur me rabroua : « Ne discute pas, il faut faire vite ! ».
Et nous voilà partis pour le monastère de Montrieux avec une voiture de la Kommandantur allemande ! En traversant La Seyne et Toulon, je masquai mon visage avec un vieux journal trouvé dans la voiture, par crainte d’être reconnu par l’un de mes nombreux amis : Marius AUTRAN, vu dans une voiture allemande, qu’est-ce que cela voulait dire ? Etait-il emmené par la Gestapo ? Ce fait n’aurait sans aucun doute pas manqué de se répandre à La Seyne avec la rapidité de l’éclair.
Je sus bien plus tard que le véhicule qui nous emmenait à Montrieux était celui de la sécurité sociale que les Allemands utilisaient aux frais de l’administration française. Ils n’avaient pas changé le conducteur, dont je sus qu’il s’appelait Retou MILANO, qu’il était résistant communiste, et qu’il ravitaillait à l’occasion en armes et munitions certains maquis du Var, avec cette voiture qui, grâce à l’inscription de la Kommandantur, lui permettait de franchir facilement les barrages allemands !
On peut bien qualifier de service éminent celui que me rendit mon ami Paul PRATALI, d’aventure romanesque et particulièrement dangereuse.
Bref ! Nous voici en moins d’une heure devant le monastère dirigé administrativement par des religieuses, les mêmes que les Toulonnaises de la clinique Malartic du Pont-du-Las, solidement verrouillées dans le monastère. Il fallut frapper fort à la porte d’entrée, qui fut timidement ouverte par une religieuse littéralement terrifiée à la vue de ce véhicule suspect, ne cachant pas son identité ennemie. Elle faillit refermer la porte immédiatement, mais j’vais en main une lette à remettre à M. Malartic. Elle la prit et referma la porte aussitôt, nous laissant dans une expectative douteuse.
 |
| La chartreuse de
Montrieux (entrée principale) |
| La chartreuse de
Montrieux (aile ouest) : Jean-Claude est né 2e fenêtre
à gauche |
Enfin rassurée, elle nous fit entrer et nous conduisit vers la chambre qui était prévue depuis quelques jours.
Je me confondis en remerciements pour le chauffeur, qui me répondit sur un ton péremptoire : « Entre nous, il n’y a pas de merci ! ». Et il repartit aussitôt.
Jean-Claude
Je ne me souviens pas de la date exacte de ce jour mémorable, qui se situait dans la première semaine du mois de mai. Louise n’était pas séparée de sa mère, qui avait été acceptée avec elle au monastère en échange d’une participation à diverses tâches ménagères. Les religieuses étaient impatientes de voir ce nouveau-né qu’on attendait tous les jours. Le docteur SAUVET, un Seynois résistant replié aussi dans la région (à Signes) avec sa famille, venait souvent aux nouvelles. L’enfant tardait à faire son entrée dans le monde. Il fallut procéder à un traitement pour accélérer les douleurs prénatales. Enfin, le 24 mai, en fin de matinée, Jean-Claude arriva, avec bien des difficultés, avec l’aide d’un médecin espagnol de compétence discutable, un clandestin du régime de FRANCO, que le docteur MALARTIC avait pris sous sa protection.
Le bébé Jean-Claude pesait 4,250 kg. Il pesait moins que son frère aîné Robert (4,750 kg) mais son visage avait souffert, avec une hémorragie nasale et une bouche quelque peu déformée dont, paraît-il, nous n’avions pas à nous inquiéter.
Louise eut bien du mal à se remettre de son accouchement difficile, mais les religieuses, ravies d’avoir à s’occuper de notre gros garçon, se dépensaient sans compter pour leur prodiguer les plus grands soins. De mon côté, j’avais été dans la nécessité de rejoindre l’École Martini par obligation professionnelle. Au bout d’une quinzaine de jours, nous quittâmes la clinique.
Dans cet intervalle, il se produisit un événement peu commun qu’il ne me semble pas inopportun de mentionner dans ce récit. Voici le fait. On sait que les maquisards menaient la vie dure aux Allemands. En cette fin du mois de mai 1944, il advint que l’ennemi avait pris en chasse quelques résistants armés dans la forêt de Signes. L’un d’eux, poursuivi de près par un groupe ennemi, jugea bon de chercher refuge dans le monastère devenu clinique. Le jeune résistant en haillons frappa à la même porte d’entrée que nous connaissions bien. Une religieuse effrayée vint ouvrir et entendit la supplique de l’homme poursuivi : « Sauvez-moi ! ma sœur, les Allemands vont me tuer ! ». « Attendez, dit la religieuse, je vais voir mon patron ! ». elle revint précipitamment quelques instants plus tard pour dire au jeune menacé : « Entrez ! ». Le docteur Malartic reçut le résistant et lui dit : « Déshabille-toi, mon brave ! Allonge-toi sur la table d’opération ! ». Le docteur Malartic piqua le patient inattendu, l’endormit et, sans hésitation aucune, l’opéra de l’appendicite, ce qui n’était certainement pas nécessaire. Il était temps ! Les Allemands surgirent sans ménagement dans l’établissement, fouillèrent les chambres, firent irruption dans la salle d’opérations. Voyant le docteur affairé sur un abdomen taché de sang, ils s’excusèrent auprès de M. MALARTIC et repartirent bredouilles. A ma connaissance, un tel acte de courage ne fut jamais connu de la population, mais il faut bien dire que le docteur courageux sauva la vie d’un résistant en danger, grâce à sa prompte initiative. Même après la guerre, il ne s’en vanta point, pas plus qu’il ne se vanta d’avoir accepté dans le monastère un stock important de biscuits d’une organisation vichyste nommés “Secours national” et dont la marchandise permit le soutien de résistants clandestins. Saluons la conduite du docteur et de son personnel religieux, qui s’exposèrent ainsi pendant plusieurs mois aux dangers les plus mortels face à la barbarie ennemie, dont on connaît l’ampleur de ses forfaits commis pendant la guerre.
J’en reviens maintenant à la vie du monastère, qui ne comptait guère plus d’une dizaine de religieux retirés ans la vie monastique, sans toutefois ignorer les aspects de la vie terrestre. Il n’y avait aucun contact entre les moines passant la plus grande partie de leur temps à prier dans leur cellule individuelle et, pour les plus valides, à s’occuper de la culture d’un jardin potager, alors que les sœurs assuraient des tâches ménagères et administratives.
Pendant les six derniers mois de la guerre, le monastère connut donc une animation à laquelle il n’était guère habitué par le fait des visites des familles de gens opérés à la clinique ou convalescents. Les fournisseurs de marchandises y venaient chaque jour et apportaient aux malades des nouvelles des théâtres de la guerre, notamment d’un possible déparquement des Alliés sur les côtes provençales.
La direction de la clinique autorisa Louise à rester une semaine de plus, mais, dans les premiers jours de juin, il avait bien fallu penser à un départ du monastère, où l’on vivait bien.
C’est alors que se posa pour moi un problème délicat : celui du déménagement de notre maison de Touffany que, de toute façons, il fallait évacuer en raison du sinistre du 29 avril. Le hasard voulut que j’entre en contact avec le chauffeur d’un gros camion stationné devant la Poste de La Seyne et qui livrait des matériaux. Je lui proposai de faire mon déménagement de sinistré. Il n’y fit aucune objection. Bien que son véhicule, poussif, marchait au charbon de bois, il n’y avait pour moi aucune hésitation possible.
Deux jours plus tard, me voilà sur la route du haut Var, avec nos meubles, mal ficelés, nos malles, notre vaisselle. Partis en début d’après-midi de La Seyne, nous espérions arriver à Montmeyan avant la nuit. Hélas ! Une panne interrompit notre voyage pendant plusieurs heures. Le conducteur et son aide durent changer une pièce importante du moteur, une pièce qu’ils trouvèrent dans un garage éloigné de plusieurs kilomètres, dans les environs de Brignoles. Nous ne fûmes donc dépannés que le lendemain matin. Heureusement, nous étions au mois de juin et la nuit ne fut pas trop fraiche.
J’ai omis de dire plus haut pourquoi nous allions nous réfugier à Montmeyan. Je ne sais plus comment les Sicard, cousins de mon grand-père, avaient su que nous avions été sinistrés et que nous cherchions un abri éloigné de la côte. Ils eurent alors l’amabilité de mettre à notre disposition leur habitation du village, où ils n’allaient que rarement, leur résidence principale étant au Luc, Lucien Sicard exerçant les fonctions de directeur de la maison départementale de retraite pour les personnes âgées.
Enfin arrivé à Montmeyan où je retrouvai de nombreuses connaissances, j’eus encore la chance (une de plus !) de rencontrer des gens réfugiés du bord de la mer et installés à Montmeyan par mesure de sécurité. Il s’agissait d’un entrepreneur en maçonnerie de Carqueiranne qui faisait souvent la route depuis son entreprise jusqu’à Montmeyan. Je lui fis part de mes problèmes familiaux, de la naissance de mon fils Jean-Claude et du souci que j’avais pour transporter ma famille, obligée de quitter la clinique du monastère. Cet entrepreneur, du nom de Viziale, me fit lui-même la proposition, en venant de Carqueiranne, de les prendre en charge sur la route de Montrieux. Quel soulagement pour moi, qui était toujours à la recherche de rares véhicules !
Enfin, quelques jours plus tard, les question de logement et de transport furent réglées et je peux l’affirmer, sans aucun frais de transport, M. Viziale ayant refusé de monnayer le service qu’il m’avait rendu. Naturellement, il n’en fut pas de même avec les déménageurs.
Tout s’arranger sauf toutefois le fait qu’il me fallait reprendre mon poste à l’École Martini où, malgré les évacuations des classes, les enseignants du secondaire devaient répondre “présent” à l’école. Il nous arriva ainsi de participer à des réunions du personnel, sous la direction de M. MALSERT, réunions qui se tenaient à la mairie d’Ollioules, par mesure de sécurité.
Durant les mois de juin et juillet 1944, il m’arriva d’effectuer le trajet La Seyne – Montmeyan à bicyclette av , avec mon vélo aux pneus gravement endommagés. Les pneus neufs étant introuvables dans le commerce, il me fallut parfois les faire tenir avec des bouts de ficelle (ce qui rendait alors impossible l’utilisation des freins…), alors qu’il y avait tout de même 100 kilomètres à parcourir !
Une autre aventure imprévue
J’avais pu aussi un jour bénéficier de la gentillesse d’un autre entrepreneur Seynois, M. Baudisson, dont la famille était repliée dans le haut Var. Il consentit ainsi à me transporter à Montmeyan. Pour le trajet de retour à La Seyne, j’avais pris un autocar qui devait m’amener à Toulon en passant par Brignoles. Après avoir quitté Montmeyan, nous allions atteindre Tavernes par une route très accidentée et des virages en épingle à cheveux. Le chauffeur dut ralentir avant le dernier virage. Et voilà que, profitant de ce dernier ralenti, la route fut barrée par un peloton de soldats allemands, dont les casques avaient été camouflés par des feuillages touffus.
Poussant des hurlements de bêtes féroces, ces combattant d’Hitler nous intimèrent l’ordre de descendre. A leur tête, un lieutenant à la stature impressionnante (au moins deux mètres) nous obligea à descendre les mains en l’air. « Alignez-vous, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre ». Cet officier parlait un français impeccable. Alors ses hommes commencèrent à nous fouiller. Puis ce furent des interrogatoires individuels avec présentation de nos pièces d’identité. « D’où venez-vous ? Où allez-vous ? Pour faire quoi ? ». Il fallait répondre avec précision à toutes ces questions.
Certains voyageurs s’exprimaient entre eux en langue provençale. Même dans les moments difficiles, il se trouve toujours des plaisantins pour dominer la gravité de situations. L’un d’eux disait :
- « Si soun régala de chaspa lei frumo ! » (Ils se sont régaler de tripoter les femmes).
Un autre, se moquant de la taille exceptionnelle de l’officier inquisiteur dit :
- « Aqueou a creiscu, si vis que vint d’un pais ounte plou ! » (Celui-là a poussé. On voit qu’il vient d’un pays où il pleut !).
Mais les fouilleurs ne trouvaient rien de compromettant, mais les interrogations se poursuivaient en espérant pour les Allemands trouver des relations entre les voyageurs et les résistants des maquis du haut Var. Et voilà que mon tour arrive.
L’officier (oberlieutenant, faut-il peut-être dire) lut ma carte d’identité. Voici exactement sa question :
Le questionneur soupçonneux parut accepter mes explications, lesquelles, d’ailleurs, étaient l’expression de la vérité la plus pure. Je lui montrai également ma carte d’identité militaire où j’apparaissais en uniforme de lieutenant, ce qui parut le rassurer, et il passa à la personne suivante.
Mais ce ne fut pas tout. Il fit emmener plusieurs voyageurs à l’écart, qui ne repartirent pas avec nous. Ces vérifications terminées, nos inquisiteurs firent descendre les bagages des voyageurs, qui durent, chacun à leur tour, leur en montrer le contenu. L’un d’eux dut montrer un lapin des champs. Ce lapin avait été tué par arme de chasse et notre infortuné voyageur dut expliqué qui avait été le chasseur, qui allait certainement être inquiété, car nous étions dans une période où tous nos fusils de chasse et nos munitions avaient dû être apportés à la mairie et où la chasse était rigoureusement interdite dans toutes les communes.
Et la visite des bagages se poursuivait quand, tout à coup, l’un des fouilleurs lança un appel triomphant à son chef en montrant un révolver qu’il venait de découvrir. Le propriétaire de la valise maudite se mit à sourire en déclinant son identité : Police française !
Alors, le chef autorisa notre embarquement pour un vrai départ, sauf pour les trois ou quatre personnes que les Allemands gardèrent auprès d’eux. Que sont devenus ces infortunés que les Allemands estimèrent peut-être qu’ils étaient des “terroristes”. Je n’en ai jamais rien su.
Et nous voilà repartis en direction de Brignoles, rassurés après cette épreuve qui dura près d’une heure.
Mais notre car fut de nouveau arrêté, peu avant l’entrée de Brignoles. Une autre patrouille allemande voulut faire descendre les voyageurs. Alors, un vent de révolte violent obligea les Allemands à calmer leur arrogance. Il se trouva par chance un passager qui savait s’exprimer dans la langue des Teutons et qui expliqua clairement que la fouille des voyageurs avait été faite quelques minutes auparavant. Vérification faite sur le champ par téléphone, nos inquisiteurs furent suffisamment convaincus pour permettre à notre chauffeur de poursuivre sa route en direction de Toulon. Enfin, deux heures plus tard, nous pûmes espérer arriver à destination. Mais il me fallait encore gagner La Seyne, car les autocars de la place Noël-Blache ne partaient que dans l’après-midi. Je pensai alors gagner La Seyne par un bateau à vapeur dont les services s’étaient aussi raréfiés. Je descendis donc la rue d’Alger en quête d’un magasin vendant quelques marchandises comestibles. Avant d’atteindre le port, j’entrai dans un bar, espérant calmer mon estomac par une boisson quelconque.
Oh ! Surprise ! Le comptoir était tenu par un camarade de l’École Martini nommé Vincent FOURNIER, qui avait été, lui aussi, prisonnier au camp de Pithiviers, dont je m’étais évadé avant la fin de la guerre. Il m’accueillit avec joie et me dit : « Tu veux manger ? ». « Tu parles, je meurs de faim ! ». Il m’offrit alors des sandwiches au jambon, qu’il vendait au “marché noir”. Mais peu importait la défense ! Après avoir dévoré, le mot n’est pas trop fort, les sandwiches au jambon. Je le remerciai chaleureusement en lui laissant espérer une prochaine rencontre dans une ambiance plus sereine que celle que nous subissions depuis des années et, finalement, je pus arriver à La Seyne en fin d’après-midi. Mon voyage avait duré une journée entière.
Je logeais alors dans la maison sinistrée du quartier Touffany. Je me présentai le lendemain à l’École Martini, en racontant ma mésaventure.
Les vacances de juillet me permirent de gagner de nouveau Montmeyan où Louise, sa mère et notre bébé, celui que nous appelions déjà “Claudet”, vivaient en paix dans la maison des cousins Sicard. Mis ils éprouvaient des difficultés de ravitaillement (c’était l’époque des tickets de rationnement).
Quand je fus dégagé de mes obligations à La Seyne, je m’installai à Montmeyan, mais n’y restai pas inactif. Mon activité principale fut la chasse. Je n’avais pas d’arme - mon fusil ayant été confisqué et se trouvait entreposé à la Bourse du travail de La Seyne – mais un fin braconnier m’avait appris à confectionner des collets pour la capture des lapins. Car, à cette époque où la chasse était interdite, les lapins pullulaient dans le terroir de Montmeyan. Il m’arriva d’en capturer deux ou trois dans le même matinée. Leur chair délicieuse vint compléter les rations de viande ridicules auxquelles les gens avaient droit. Et, ma foi, même si nous n’avons pas beaucoup de pain à manger, nos estomacs digéraient bien la chair des lapins des champs.
Jean-Claude avait sa ration de lait et nous vivions dans une quiétude, toutefois relative, car les évènements demeuraient toujours incertains dans cet été 1944 où les alertes du ciel devenaient de plus en plus fréquentes.
On avait peu de nouvelles des théâtres d’opération, mais nos cœurs se gonflaient d’espoir quant on apprenait la débâcle allemande sur tous les fronts : on espérait un débarquement des armées alliées. Mais où et quand ?
Vers la fin de juillet 1944, les escadrilles des armées alliées multipliaient les rondes sur les côtes varoises, repérant avec précision les positions allemandes. Nous n’avions au village aucune relation avec les autorités civiles et militaires de la côte, mais les alertes aériennes se succédaient avec une telle intensité qu’il fallait d’attendre à des évènements décisifs.
Un beau matin de la première quinzaine du mois d’août des avions anglais ou américains lancèrent des milliers de tracts intimant à la population varoise de ne pas circuler sur les routes au risque de se faire mitrailler. Hélas ! l’imprudence d’un habitant du village rentrant chez lui avec une camionnette fut la cause d’un drame. Mitraillé par un avion allié, l’un des occupants du véhicule fut frappé à mort. Il se nommait Roger Saint-Martin, l’un de mes anciens élèves des années 1934, âgé d’une vingtaine d’années. Ce deuil plongea la famille et tout le village dans la plus grande consternation. A partir de ces actions violentes, on pouvait bien comprendre l’imminence d’opérations d’une plus grande envergure.
Enfin, les Alliés
Je ne saurais dire avec précision si ce fut le jour même du débarquement qui eut lieu le 15 août sur les plages de l’Est Varois (Sainte-Maxime) que les chars américains atteignirent le haut Var. De la maison des Sicard que nous habitions, nos regards prenaient en enfilade la rue principale du village. Vers les midi, un char d’assaut apparut à l’entrée, stoppa sa marche, hésitant à poursuivre sa course dans l’incertitude où il se trouvait de franchir la rue en raison de sa grosseur.
Des riverains affolés se mirent à hurler : « Ne sortez pas, les Allemands sont là ! ». J’entrouvris la porte et je m’aperçus, malgré l’éloignement, que le char qu’on croyait allemand portait sur son avant-train une énorme étoile blanche. Le char d’assaut était américain et il était conduit par un homme de couleur noire.
Alors, ce fut l’allégresse générale : « Les Américains ! Les Américains ! ». Une colonne de chars suivait et leurs occupants distribuaient aux habitants rassurés des boîte de conserves, des friandises. Tout naturellement, nous serrions chaleureusement leurs mains. Des femmes et des vieillards versaient des larmes de joie. Toute la rue fut paralysée.
J’eus la curiosité d’interroger un noir américain en utilisant quelques réminiscences scolaires de mauvais anglais : « What country are you ? ». « Oklahoma ! » me répondit-il. Je dis à mon voisin, M. ARTAUD, cantonnier du village : « Pauvre garçon ! Venir de si loin pour nous délivrer du fascisme hitlérien, il faut le faire ! ».
Après ces émouvantes rencontres, il fallait bien laisser partit nos libérateurs vers les Alpes. Mais le général qui commandait l’armée américaine décida de marquer un temps d’arrêt et de prendre son repas à l’auberge du village. L’Etat-Major américain avait pris contact avec le Maire du village, M. Reynier, à qui il demanda de rendre à la population les armes de chasse réquisitionnées par les Allemands et stockées à la mairie. Un officier français assurait la liaison entre l’armée et les autorités civiles. L’officier français fut renseigné par le Maire qui lui fit part de ma présence d’instituteur dans le village et de ma qualité d’officier de réserve. Aussi, quelques heures plus tard, je pris le commandement d’un groupe de civils armés d’un fusil de chasse, et on me chargea de surveiller une route que les Allemands auraient pu emprunter pendant leur retraite. Des résistants varois arrivèrent en renfort, des gens courageux, à moitié vêtus, affamés. Un incident qui faillit mal tourner m’opposa à certains qui voulaient fusiller des prisonniers. J’eus de la peine à convaincre certains de ces résistants que les lois de la guerre ne permettent pas de fusiller des prisonniers.
On sait que le débarquement du 15 août des armées alliées fut un succès complet, que l’armée français y prit une part importante et que Toulon et toute la région jusqu’à Marseille devait être l’œuvre du général de Lattre de Tassigny. J’ai gardé de ces journées exaltantes des souvenirs particulièrement attachants.
Comment pourrais-je oublier qu’en qualité d’officier de réserve, le général américain m’invita à sa table à l’auberge de Montmeyan. Il m’offrit la moitié d’un poulet rôti et une moitié de melon que je dévorai à pleines dents.
Pour la première fois, j’entendis parler du général de Gaulle par l’officier français de liaison. Il était l’un de ses partisans, dont il louait la conduite courageuse.
Dans l’après-midi de ce jour mémorable de la libération de Montmeyan, avec quelques amis, nous nous fîmes un devoir d’accompagner le convoi américain jusqu’à Quinson, village des Basses-Alpes sur les bords du paisible Verdon aux eaux bleues. Les engins blindés de l’armée américaine franchirent aisément le cours d’eau à faible débit pour s’engager vers la route Napoléon et gagner les départements alpins.
A notre retour au village de Montmeyan, j’y retrouvai mon cousin Sicard et sa mère qui, eux aussi, étaient venus chercher refuge vers des lieux plus sûrs. Nos retrouvailles se firent dans l’enthousiasme d’autant que Lucien, poursuivi par la police de Vichy en tant que résistant, lui aussi, s’était réfugié non loin de Montmeyan, à Saint-Julien-le-Montagnier, plus précisément.
Dès le lendemain, Lucien voulut reprendre ses fonctions départementales au Luc, où il dirigeait la maison départementale des personnes âgées.
Toute mon attention se fixa alors sur Toulon et La Seyne, dont nous apprîmes que la libération avait été confiée à l’Armée française commandée par le général de Lattre de Tassigny.
Ma présence à Montmeyan, même à la tête de civils armés, n’était plus nécessaire, les maquisards ayant chassé du haut Var les hordes d’Hitler, fait des prisonniers, et allaient se préoccuper de mettre en place les anciennes municipalités limogées par les Allemands et faire en sorte qu’une vie administrative reprît dans tout le département du Var.
Que devenaient Toulon et La Seyne, dont nous étions sans nouvelles ?
Lucien Sicard et sa mère décidèrent de rejoindre Le Luc. Je décidai alors de partir avec eux, en espérant par la suite trouver un véhicule pour Toulon. Deux heures plus tard, me voilà sur les bords de la route nationale à faire du stop ! Je ne tardai pas à trouver un camion militaire dont le chauffeur, réticent, accepta de me prendre à son bord, en me laissant entendre que la libération de Toulon n’était peut-être pas terminée.
- « Tant pis, lui dis-je, nous verrons bien ! ».
Le camion me laissa place Noël Blache. Aucun civil dans les rues. On n’y voyait que des engins militaires.
Je remerciai le chauffeur et me décidai à faire à pied le chemin Toulon - La Seyne, aucun transport collectif n’existant. Un rare passant me dit que l’Arsenal avait été libéré depuis deux ou trois jours. Je descendis donc, rassuré, le boulevard de Strasbourg à pied, jusqu’au Pont du Las, sans incident notable, constatant tout de même des dégâts importants : vitrines brisées, de-ci, de-là, des volets arrachés par des obus de petit calibre.
Arrivé au Pont du Las, j’assistai alors à un spectacle d’horreur. D’abord averti par des odeurs de cadavres décomposés qui jonchaient les trottoirs, je compris que ces lieux avaient été le théâtre sanglant de terribles combats.
A l’angle de la place d’Espagne, une batterie anti-char allemande avait été anéantie par l’artillerie des Alliés venus par le boulevard de Strasbourg. Les corps des servants gisaient sur leurs pièces détruites. Leurs corps ouverts laissaient pendre leurs entrailles puantes au soleil, leurs têtes éclatées, noires comme du charbon, étaient vraiment effrayantes à regarder. Je ne pus m’attarder longtemps devant un tel spectacle. Mes yeux se remplirent de larmes à la pensée que des mamans et des épouses allemandes attendaient sans doute dans leur village le retour de leur enfant ou de leur mari, des êtres chers qui étaient en train de pourrir par la faute d’une idéologie barbare dont ils n’avaient pas compris les buts. Les comprendraient-ils jamais ?
Je me hâtai de quitter ce spectacle atroce, tenant bien serré sur mon nez mon mouchoir pour résister à l’odeur insupportable des cadavres qu’il me fallut enjamber pour poursuivre ma route vers La Seyne.
Le pont de Lagoubran ayant été détruit, il me fallut descendre au fond de la rivière, le Las, pour parvenir à la Pyrotechnie. J’approchai enfin de La Seyne, d’où me venaient aux oreilles des bruits d’armes automatiques.
J’avisai un motocycliste, hésitant à poursuivre ma route. « Il paraît, me dit-il, que les Allemands sont toujours à Brégaillon ! ». La Seyne n’était donc pas encore libérée ! Que faire ?
Je ne pouvais en aucune manière envisager mon retour sur les cadavres du Pont du Las. Alors, je décidai de gagner la route de la gare, et d’avancer en contournant Brégaillon.
Me voici bientôt à l’avenue Gambetta, absolument déserte. « Que sont devenus tous ses habitants », me disais-je. Ils ne sont sûrement pas tous partis. Je sus, par la suite, qu’il y avait encore à La Seyne, pendant cette période dramatiques, quelques milliers d’habitants claquemurés dans leurs appartements, vivant de menues provisions de bouche et d’eau fraîche.
Je constatai le vide absolu dans la rue Gambetta, la place Martel Esprit, la rue Cyrus Hugues. Le cœur même de la ville était mort.
 |
| Une rue de La
Seyne, avec les ruines que dut retrouver Marius AUTRAN à son
retour |
J’éprouvai une sensation d’hostilité, d’abandon, à emprunter ces rues désertes, si vivantes à l’ordinaire. C’était bien vrai qu’on n’y voyait même pas un chat !
Je remontai la rue Blanqui, la rue Voltaire. Enfin, me voici rue de Lodi, adresse de mon père, Simon. Tous les volets sont fermés. Est-il parti ? J’en serais très étonné ! Je frappe à la porte du rez-de-chaussée. Lui, se trouve au 1er étage. Enfin, un crissement de ferrure, et un volet d’entrouvre timidement.
Quelques minutes après, je tombe dans ses bras. Emotion vive. Larmes.
- « J’ai eu bien du mal à venir jusqu’à toi ».
Je raconte mon voyage, mes émotions, la vie tranquille de Montmeyan.
Il me dit avoir entendu beaucoup de bruit à La Seyne. Il n’a rien vu du spectacle désolant de la destruction du port, des chantiers. Il s’est enfermé une semaine presque entière, sans manger grand chose, ce qui ne changeait guère ses habitudes, Simon ayant toujours mangé comme un oiseau !
La vie seynoise allait reprendre son cours normal, mais avec lenteur. Les bâtiments publics sinistrés furent remplacés par des structures provisoires. L’hôtel de ville fut condamné par mesure de sécurité. Les services de l’état-civil fonctionnèrent dans les locaux de « l’Asile » de la rue d’Alsace. Les services techniques purent se loger dans les restes de l’Hôtel-Dieu de la rue Messine. Et il faudra attendre 15 ans avant la reconstruction de la Mairie sur le port, à son emplacement primitif. Dans les écoles partiellement sinistrées, les cartes de géographie furent utilisées pour remplacer les carreaux brisés, car il n’était guère possible d’enseigner dans les courants d’air. Malgré tous les désagréments, il fallait bien penser à la rentrée scolaire du mois d’octobre 1944.
Il nous fallut donc quitter Montmeyan au mois de septembre, ramener notre mobilier à La Seyne. Mais où ? Mon père avait réhabilité sa maison de Mar-Vivo (« Lei Gari »), reconstitué les fils électriques, les canalisations d’eau. La maison était de nouveau habitable, mais trop de souvenirs intimes lui rappelaient les jours heureux qu’il avait eus avec ma mère, sa chère Victorine.
Deux ans environ après sa disparition, il avait rencontré une autre femme en la personne de Joséphine Guimberty, veuve depuis quelques années. Son choix ne fut pas des plus judicieux. Il se remaria néanmoins, évitant ainsi les corvées de cuisine, de lavage, de ménage, pour lesquelles il n’était guère préparé. Mais sa nouvelle épouse, sans beaucoup d’éducation, ne manifestait qu’un intérêt secondaire à faire du ménage. Il me confia plus tard sa déception. Par surcroît, Phi-Phi, comme nous l’appelions, était d’une avarice sordide et ne le nourrissait qu’avec une grande parcimonie. Elle avait trouvé le retraité qui lui convenait, car ses ressources personnelles étaient plus que modestes.
Phi-Phi et Simon célébrèrent leur union en tête à tête. Je fus seulement invité à prendre un repas chez eux, dans un appartement du quartier La Gatonne.
Mon père renonça à réoccuper sa maison de Mar-Vivo, ce qui me permit de l’utiliser (après que mon père l’eut de nouveau rendue habitable en y réinstallant notamment l’électricité) à notre retour de Montmeyan. La rentrée des classes approchait. Il me fallut me démener pour trouver des véhicules ramenant toutes nos affaires à Mar-Vivo. Néanmoins, je fus secouru par de bons camarades qui assurèrent avec dévouement notre installation à Mar-Vivo, pendant que mon père et sa nouvelle épouse trouvèrent à se loger au « Chalet René », en bordure de la route des Sablettes. A noter que le petit bateau de pêche (la Noune que mon père possédait, avait dû être enlevé de son port d’attache des Sablettes dès le début de l’occupation allemande et qu’il avait été remisé dans le jardin de ma propriété de Bastian, où il resta abrité jusqu’à la fin de la guerre.

|
| Jean-Claude dans
son landau au “Chalet René”, impasse René,
aux Sablettes, vers 1946 |
D’autres difficultés nous attendaient. L’hiver approchait, et il faudrait bien nous chauffer. J’eus l’audace d’explorer les installations allemandes du bord de mer, des abris confectionnés avec des madriers d’un bois superbe. Pendant plusieurs jours, j’allais débiter sur place des étais de soutènement. Personne de l’administration municipale ou militaire ne s’intéressait aux matériaux que l’ennemi avait abandonné dans se retraite précipitée.
La rentrée des classes arriva. De Mar-Vivo à La Seyne, les services de transports collectifs n’étaient pas encore rétablis dans leur intégralité. Avec mon vélo, je n’étais qu’à un quart d’heure de l’École Martini, mais Louise, la pauvre, devait faire la route à pied pour gagner l’École Curie. Au surplus, le quartier de Mar-Vivo manquait plutôt d’approvisionnements dans cette période. La solution de notre logement à Mar-Vivo ne pouvait être que provisoire. Fort heureusement, de bons amis nous secoururent. Juliette SICARD, amie intime de Louise, sachant nos difficultés, nous proposa un logement disponible au quartier Tortel. Nouveau déménagement ! Mémé GAUTIER, qui avait alors une force herculéenne, m’apporta une aide considérable pour démonter et monter des lits, fixer des glaces, bref à rendre l’appartement dans on véritable confort.
Cette maison appartenait à Alexis CURET, un frère de la mère de Juliette, Mme BESSON, vieille, très vieille famille seynoise.
 |
| Jean-Claude, sur
la terrasse de la maison d'Alexis CURET, vers 1946 |
Jean-Claude jouait dans le jardin potager de M. CURET, qu’il appelait tout simplement “Èt”.
Ce quartier Tortel (personnalité seynoise qui fut, à l’origine, avec les familles Beaussier, Daniel, Lombard, Beaussier,…, les fondateurs de notre communauté) était agréable par sa tranquillité, sa proximité du marché, les nombreux amis que nous y avions.
Hélas ! Tout ne fut pas tout rose, car les problèmes de santé s’accumulèrent pendant quelques années. Jean-Claude faillit mourir d’une intoxication causée par le lait en poudre américain et fut sauvé grâce aux soins que lui prodigua le docteur Weill (médecin d’origine juive qui faillit tomber aux mains de la Gestapo). Dans cette période (novembre 1950), je dus être hospitalisé pour une opération de l’appendicite, inconvénient qui fut tout de même pour moi une chance, si je me souviens que j’aurais pu périr dans un accident de l’auto conduisant une délégation de la Caisse des Écoles, dont je devais faire partie, dans lequel, près du village de Cuges, Pierre FRAYSSE trouva la mort, tandis qu’Aimé MOLINARI et Paul PRATALI étaient gravement blessés. Il faut rappeler aussi que, un an ou deux avant cet accident, Louise dut être opérée d’urgence d’un kyste énorme de l’ovaire dans une clinique toulonnaise (docteur JEAN). Heureusement, sa forte constitution physique lui permit de se rétablir rapidement de cette opération.
Mais en 1953, le développement d’un fibrome l’obligea à subir une nouvelle opération qui nécessita en outre l’ablation du second ovaire. Cela entraîna alors des complications du côté de la glande thyroïde qui amenèrent à la pose d’implants dans le bas-ventre, sans grand succès d’ailleurs. Et c’était hélas ! loin d’être terminé pour elle, car, des opérations, elle devra en subir encore trois autres dans les années 80 et 90. Nous y reviendrons.
De mon côté, au début des années 50, je dus être opéré d’une hernie inguinale qui faillit mal tourner, problème résultant d’un effort intensif que je fis pour monter notre cuisinière au 2e étage de notre appartement du boulevard Staline. Au début, le médecin qui me soignait m’avait conseillé le port d’un bandage, que je ne pus supporter longuement et il fallut en venir à l’opération, pratiquée par le docteur Francis Fabre à la clinique toulonnaise Saint-Michel. En fait, j’avais été victime de deux hernies et une seconde opération fut encore nécessaire 4 ou 5 ans plus tard. La première opération se déroula très mal car elle fut suivie d’une infection causée par des catguts mal stérilisés. Ma plaie suppurait dangereusement et le chirurgien dut venir à la maison en compagnie du docteur Sauvet. Il rouvrit carrément la cicatrice pour en faire sortir une véritable “purée de pois”, noya la balafre d’alcool pur, alors que je poussai des hurlements de douleur. Tranquillement, le docteur chirurgien me conseilla d’exposer tous les jours ma balafre au soleil, ce que je fis, et au bout de quelques jours, tout rentra dans l’ordre. Il paraît que cinq cas semblables, dus à ces catguts mal stérilisés, s’étaient produits dans la même période. Hormis ce fâcheux événement qui m’obligea à garder la chambre pendant 3 semaines,, la vie familiale n’eut pas trop à souffrir. Mais comme je l’ai dit, la seconde hernie fut à opérer 4 ou 5 ans plus tard, vers 1957, et cette fois-ci, tout se passa normalement et je fus rapidement rétabli. C’était, à 47 ans, ma troisième opération.
Le bombardement du 29 avril 1944 nous avait chassé de notre maison du quartier Touffany, mais avait aussi détruit la maison de la rue Louis Blanqui dont j’avais une part d’héritage. Cette demeure à deux étages avait été transmise à ma grand-mère par son frère Victor Hermitte. Après le décès de ma grand-mère en 1943, cette maison revint à 3 héritiers (Paul AUBERT, Geneviève AUBERT, épouse AUGIAS, et moi-même, héritier de la part de ma mère Victorine AUBERT, épouse de Simon AUTRAN). Cette maison ayant été littéralement pulvérisée par une bombe, les héritiers dont j’étais étaient en droit d’obtenir une indemnité de sinistre. En accord avec mes cohéritiers, je pris l’initiative de constituer un dossier de sinistre, qui nous permit de récupérer quelque argent. Je n’ai plus le chiffre en tête, mais nous pouvions envisager d’acheter, Louise et moi, un logement quelque part dans les environs de notre lieu de travail.
Ce fut dès l’année 1946 que le Ministère de la Reconstruction, dirigé alors brillamment par François BILLOUX, commença la construction, en prolongement du boulevard du 4-Septembre, de bâtiments de 6 appartements pour les sinistrés. Je m’occupai alors activement d’obtenir un superbe logement en échange de ma part d’héritage du sinistre de la rue Blanqui, en rajoutant tout de même, pour obtenir un F4, un complément substantiel que nous payâmes à crédit sur une dizaine d’années. Nous y emménageâmes au printemps 1950.
 |
| La maison du 9
boulevard Staline Au balcon, 2e étage à gauche, Mémé GAUTIER |
Donc, nouveau déménagement, nouvelle installation, nouveaux travaux imprévus, dont une salle de bains réalisée rapidement par mon ami Francioli, maçon de son état. Notre appartement se situait au 2e étage et nous eûmes par la suite des voisins de copropriété plus ou moins agréables, les familles Provost, Girault, Isay, Bonzi, Mlle Rolland,… Ce fut surtout avec les Girault que nous liâmes une amitié des plus solides.
Au boulevard Staline
Nous allions passer 11 ans de notre vie commune (Louis, Mémé GAUTIER, Jean-Claude et moi) dans une ambiance tout de même améliorée par rapport aux heures dramatiques de la guerre que nous avions subies. Ce qui ne signifie pas que cet intervalle 1950-1961 ne fut pas jalonné de nombreux avatars dont je vais succinctement énumérer quelques aspects.
Personnellement, je fus surchargé de travail : Classe de 6ème moderne – Conseil municipal – Responsabilités politiques – Répression des communistes en 1952 – Entretien de Bastian – Deux hospitalisations pour des interventions chirurgicales pour moi – Des ennuis de santé pour Louise avec aussi une intervention chirurgicale, etc. (Lire aussi les volets de ma carrière politique écrits par Jacques Girault).
Notre installation matérielle nous apporta de grandes satisfactions. Jouxtant la petite cuisine, un lavoir permettait à l’infatigable Mémé GAUTIER d’y faire la lessive. La salle de bain fut aménagée avec une superbe baignoire, la première de ma vie. L’immense salle de séjour donnait, côté sud, sur l’immense “boulevard du 4-Septembre prolongé” (qui sera dénommé “boulevard Staline” en 1952) et, côté nord, une terrasse nous faisait découvrir la campagne, des jardins potagers, avec une vue superbe sur la rade de Toulon et les hauteurs du mont Faron. J’allais oublier de signaler qu’à main droite, en entrant dans l’appartement, je m’étais aménagé un petit bureau. Ce fut là que, par la suite, Jean-Claude prépara son baccalauréat.
En attendant, il nous fallut l’inscrire à l’École Ernest Renan, toute proche, où sa grand-mère l’accompagnait chaque matin et l’attendait aux heures de sorties.
Louise n’était pas éloignée de l’École Curie et j’avais peu à faire, à bicyclette, pour me rendre à l’École Martini.
Élu conseiller municipal en 1950, mes obligations administratives et politiques m’accaparaient tous les jours, tous les soirs et souvent une partie de mes nuits. Dans cette période, j’avais accédé au Comité Fédéral du P.C., où d’ailleurs j’ai assumé des fonctions diverses pendant 17 ans (réunions intérieures, réunions publiques, responsabilité des cellules communistes de l’ouest varois (Six-Fours, Sanary, Bandol, Saint-Cyr, Le Beausset, Ollioules, Sainte-Anne d’Évenos, Le Castellet, La Cadière,…). La visite des cellules m’obligeait à sortit pratiquement tous les soirs jusqu’à des heures tardives. Sans parler de la Section de La Seyne, en ma qualité de secrétaire politique, responsable de la propagande et de l’organisation (10 ans).
| Quelques-unes
des premières cartes d'adhérent de Marius AUTRAN au Parti
Communiste Français |
 |
| Marius AUTRAN
à une fête du Parti communiste au début des années 50 |
Fort heureusement, j’avais lors une santé de fer. En 1959, je fus désigné comme adjoint au maire dans la municipalité de Toussaint MERLE. Là aussi, mes responsabilités durent des plus variées (Caisse des Écoles et toutes ses variantes : fournitures scolaires, colonies de vacances, cours de moniteurs, restaurants scolaires, cours d’alphabétisation,…).
 |
| Dans le bureau
du Maire du nouvel hôtel de ville, récemment inauguré (janvier 1959) : Toussaint MERLE, Philippe GIOVANNINI et Marius AUTRAN |
Pendant plusieurs années, je fus aussi chargé d’assumer la coordination de la publication des “Bulletins municipaux” (dont la collection complète est conservée dans mes archives). Il me serait impossible d’énumérer la quantité d’articles de presse que j’ai écrits (qui figurent aussi dans mes archives), et qui étaient soit signés de mon nom, soit signés “La Municipalité”. J’ai rédigé aussi un certain nombre d’articles de la fameuse rubrique L’estancaïre du journal Le Petit Varois – La Marseillaise.
 |
| Préparation
des colonies de vacances municipales de 1970 Marius AUTRAN pendant son allocution, entouré d'Étienne JOUVENCEAU, adjoint, Philippe GIOVANNINI, Maire et Maurice PAUL, Conseiller général |
 |
| Article de
Marius AUTRAN dans le Bullétin Municipal de 1971 |
 |
| Quelques
exemples de la rubrique L'Estancaïre
écrits par Marius AUTRAN dans la page locale du journal Le Petit-Varois - La Marseillaise |
Au plan fédéral, en ma qualité d’instituteur, je fus désigné comme responsable régional de la revue “L’École et la Nation”. J’obtins à ce titre un 2e prix, au plan national, pour sa diffusion.
Cette énumération d’activités et de responsabilités, sans doute incomplète, faisait dire à mon épouse, pas toujours enthousiastes pour toutes les tâches écrasantes qui furent les miennes : « Je me demande comment tu peux faire tout ça ! ».
Tout cela, je le faisais parce que, tout simplement, j’avais la foi dans un idéal, que je crois toujours aussi respectable malgré les déconvenues éprouvées depuis.
J’en viens à réserver quelques développements sur la fameuse année 1952, au moment de la “guerre froide”, où la bourgeoisie française tenta de porter des coups mortel au P.C. Elle inventa le “complot des pigeons voyageurs”. Il faut rappeler que Jacques DUCLOS, le n° 2 du P.C., avait été interpelé lors d’une manifestation à Paris par un barrage de police, et que dans son véhicule fut trouvée une paire de pigeons qu’un ami de la campagne venait gentiment de lui offrir. La presse réactionnaire s’empara de ce fait, vraiment miner, pour clamer qu’il s’agissait de “pigeons voyageurs”. Jacques DUCLOS, totalement innocent, allait ainsi être accusé de communiquer secrètement avec l’U.R.S.S de Staline, et donc de comploter contre la nation. Pas moins ! Il fut d’ailleurs emprisonné pendant 5 semaines, tandis qu’une offensive générale était déclenchée contre les communistes à l’échelle nationale. A Toulon, les communistes furent accusés de sortir des armes de l’Arsenal. Mensonge grossier qui fut démonté quelques jours plus tard. Un juge d’instruction nommé Roth fut chargé de faire arrêter des dizaines de communistes (et j’étais de ce nombre). Mais, prévenu par un ami travaillant chez un juge d’instruction, j’appris qu’il était prévu d’arrêter 3 Seynois (le maire Toussaint MERLE, le secrétaire de Section Marius AUTRAN et le secrétaire de l’union locale des syndicats Louis PUCCINI). Ces arrestations avaient d’ailleurs été réclamées par la voix de la presse (République), l’auteur n’étant autre que le socialiste Henri MIDON, provocateur patenté de la racaille politique.
En fait, les mandats d’arrêt ne furent pas expédiés (je n’ai jamais su qui avait pu y faire opposition). Néanmoins, la direction fédérale du Parti nous demanda d’entrer en clandestinité ; ce qui d’ailleurs était une erreur, car nous n’étions coupables de rien et nous n’avions pas à nous cacher. Cependant, ayant été averti en temps voulu, je ne rentrai pas à la maison pendant une quinzaine de jours : je me réfugiai au cabanon de Bastian, d’abord, ensuite dans une petite maison de campagne inoccupée dont mon ami Francioli me donna la clef.
Le féroce juge ROTH fit emprisonner une trentaine de militants, à titre préventif, mais sans résultat positif, sans preuve d’accusation à tel point que ce juge se couvrit de ridicule et fut appelé à s’occuper d’autre chose que de la chasse aux communistes. Il fut alors remplacé par un autre juge, très conciliant, de qui je reçus une convocation pour un interrogatoire de quelques minutes et devant qui je n’hésitai pas à dire que l’orchestration de cette campagne de mensonges se terminerait très mal pour ses auteurs. Trois jours plus tard, tous les militants emprisonnés furent libérés. La baudruche s’était dégonflée *. Rappelons que le journal République avait publié une photo de la porte de l’Arsenal avec ce commentaire ignoble : « C’est par là que les communistes sortaient des armes de l’Arsenal ! », mais que les responsables communistes de l’époque n’avaient même pas réagi à cette déclaration calomnieuse. Jacques DUCLOS, quant à lui, fut libéré le 1er juillet 1952 et écrivit une brochure intitulée “Écrits de la prison”. Elle figure encore dans mes archives personnelles.
* Lire, par ailleurs, le texte : «
Conséquences de l'affaire des pigeons voyageurs à La
Seyne (1952) »
Néanmoins, malgré la multiplicité des tâches énumérées plus haut, je trouvai le temps et les moyens d’entretenir ma petite propriété du quartier Bastian, acquise en mai 1942.
Je l’avais clôturée avec des “barbelés”, du côté de M. V, prédécesseur de Francioli. Du côté de la route, je plantai des cyprès (100 exactement), qui m’avaient coûté 20 francs de l’époque. Il fallait bien me protéger des larcins. M. et Mme V., des gens mesquins venaient me chiper les premières figues. M. A faisait de même de son côté. Des gens qui avaient les mêmes arbres chez eux et en plus grand nombre que les miens ! Une locataire de M. Rocchia (mon vendeur) avait un jour cueilli un panier de figues noires, que je fis disparaître à son insu quand j’arrivai, alors qu’elle prospectait d’autres récoltes à l’extrémité de la propriété. Dissimulé sous les noisetiers, je me délectai à la voir chercher son larcin – qu’elle ne trouva plus ! Autrement dit, j’avais des voisins voleurs, que je pris parfois sur le fait, car j’arrivai généralement à mon cabanon à l’improviste. Quand toute la propriété fut clôturée, ces mêmes voisins osèrent un peu moins venir se servir en figues, poires, cerises, fèves, etc. Triste mentalité, il faut bien l’avouer.
Mais ma propriété ne fut bien protégée que lorsque vint s’installer mon ami Gaspare Francioli (“Gaspard”), avec qui je me liai d’une solide amitié. A lui, je permis de prélever mes fruits, en échange des asperges ou des champignons de sa pinède, giboyeuse par surcroît, un coin magnifique où je pus aménager un poste de chasse et, au moment du passage des grives et des merles (il y avait encore du gibier en ce temps-là), je rentrais avec des brochettes d’oiseaux à la maison. Il m’arriva même de rentrer avec une bécasse, ce que Mémé GAUTIER appréciait beaucoup.
Je ne saurais plus me remémorer tous les travaux effectués à mon Bastian. Après les clôtures, le cabanon fut agrandi pour l’aménagement d’un cellier et, chaque année, après les vendanges de septembre étaient effectuées en famille (mon père Simon, sa seconde épouse, Louise, Mémé GAUTIER, Jean-Claude, mon oncle Paul AUBERT, “Tante Louise” (tante de Mémé GAUTIER), nos petits cousins Michèle et Roland, Jacques Girault et parfois d’autres copains de Jean-Claude,…). Nous avons vécu d’heureuses journées au grand air, rentrant toujours avec des produits de nos récoltes. Vers la fin des années 50, la partie centrale du vignoble vieillissant fut ensuite renouvelée avec l’aide de mes camarades Aristide (“Tide”) Ivaldi, Joseph Garron et son père, spécialiste du greffage. Des arbres furent également renouvelés. Je ne conservai alors que 5 cerisiers sur 8, qui me donnaient tout de même près de 100 kg de fruits. Je récoltai des fèves, des pois chiches. Je faisais aussi sécher des figues à la maison. Bref, notre alimentation fut des plus riches en produits naturels.
 |
| Photo des
vendanges 1958, à Bastian Debout : Joséphine AUTRAN, Marius AUTRAN, Louise AUTRAN, Joséphine GAUTIER, Michèle MEUNIER, Louise PISANY ; accroupis : Simon AUTRAN, Paul AUBERT, Roland MEUNIER |
Que de belles journées vécues dans ce lopin de terre à travailler, récolter toutes sortes de ressources naturelles, à nous réunir en famille et avec des amis (M. et Mme MALSERT, par exemple, y vinrent plusieurs fois, de même que Toussaint MERLE et Malou et bien d’autres). Souvent, les fruits que nous avions à profusion étaient distribués à des parents, des amis proches ou des voisins vivables. Généralement, j’apportais à mon père, demeurant alors à Mar-Vivo, du vin et des fruits, ce que son épouse, d’une avarice sordide, appréciait beaucoup.
Les années passaient et ma bonne santé me permettait de faire face à des activités multiples. Mais les années passaient si bien que l’âge de la retraite pointait à l’horizon de notre vie professionnelle. Je dis bien “nous” car Louise elle-même y pensait intensément d’autant que son travail au collège Curie n’était pas des plus simples et je tiens à précisée ici qu’elle ne fut jamais gâtée par sa directrice, Mme TODESCHINI. Louise, maîtresse d’élite de l’École, avait été proposée depuis plusieurs années pour le titre d’Officier de l’Instruction publique. Mais sa directrice, estimant son adjointe supérieure aux autres pour l’efficacité de sa pédagogie, lui avait confié l’enseignement des classes les plus difficiles, à savoir les 5èmes techniques peuplées de beaucoup d’élèves en retard dans leur cursus scolaires. « Avec vous, disait-elle à Louise, je sais que ça marchera ! ». Ça marchait, il est vrai, mais au prix de quels efforts. D’autres enseignantes, sans doute aussi compétentes que Louise, mais mieux en cour auprès de la directrice, s’arrangeaient, bien sûr, pour que leur soient réservées les “meilleures” classes à savoir les 6èmes moderne 1 et les 5èmes moderne 1.
Je conseillai donc à Louise de prendre sa retraite le plus tôt possible. Ce qu’elle fit à l’âge de 53 ans et demi, chose permise puisqu’elle avait eu 2 enfants. J’assistai à la cérémonie de son départ, qui se fit à l’École Curie en 1965, parmi tout le personnel de l’École et de nombreux amis. Louise était très estimée de ses chefs et de toutes ses collègues. Elle allait connaître enfin la liberté totale et tout le temps nécessaire pour s’occuper de Jean-Claude qui poursuivait des études solides et envisageait des projets matrimoniaux. Mais la santé de sa maman, âgée alors de 76 ans, commençait aussi à se dégrader et allait nous causer des soucis croissants.
Mais peu avant son départ à la retraite, elle fut aussi bien occupée avec notre déménagement depuis le boulevard Staline vers le quartier Châteaubanne, sur un terrain dont j’avais fait l’acquisition en 1959 en vue d’y construire la maison de notre retraite.
Nous étions, certes, confortablement logés au boulevard Staline mais, vers la fin des années 50, la circulation était devenue si intense que le quartier était maintenant bruyant. J’ai oublié de mentionner que, dans la décennie où nous avions habité là, nous avions fait construire un garage (toujours par mon ami Francioli) pour abriter notre première voiture, une 203 Peugeot) en 1955, qui fut remplacée 2 ans plus tard par une 403 Peugeot.
Moi aussi, je voulais prendre ma retraite et me retirer à la campagne, du moins à quelque distance du centre ville. Mes prospections me conduisirent au quartier Châteaubanne, qui était quasiment désert à l’époque. M. Zunino, dont je fis la connaissance, me proposa une parcelle dans le lotissement Riboni., ami de M. Césana. J’en devins propriétaire au bout de quelques semaines pour la somme de 1 100 000 anciens francs. C’était un terrain qui était un peu difficile d’accès, en contrebas, côté nord, d’un chemin communal qui était à l’époque tout juste empierré, le chemin du Vieux Reynier. Ce terrain pentu avait été auparavant planté en vignes, oliviers et amandiers. Pour pouvoir y implanter notre maison, il avait fallu arracher toutes les ouches de ces végétaux. Jean-Claude m’aida beaucoup pour assurer ces tâches difficiles. Mon ami Francioli, mon voisin de Bastian, entrepreneur-maçon, construisit alors ce qui devait être notre dernière habitation, en moins de 3 mois, pour la somme globale de 6 millions d’anciens francs. Auparavant, les plans m’avaient été dessinés mon ami adjoint au maire, expert-géomètre, Alex Peiré.
 |
| La maison de Châteaubanne en fin de construction, vers 1962 |
Je passe sur les détails de cette construction, qu’il fallut améliorer et agrandir par la suite. Au nord de la maison, j’avais une surface cultivable de 200 m2 environ et aussi des voisins sans histoire.
Depuis les vacances de Noël 1961 où nous déménageâmes depuis notre appartement du boulevard Staline, j’ai vécu là avec Louise pendant environ 35 ans, un peu moins avec sa mère, une vie tranquille qui, hélas ! dut cesser un jour !
Les années 1961-1962 marquèrent des changements considérables de notre vie commune. Nous étions très heureux de notre installation dans le quartier Châteaubanne, dont l’ambiance campagnarde me convenait tout à fait. J’avais mon jardinet qui me procurait beaucoup d’agréments, j’avais un garage, une voiture, un bureau-bibliothèque.
La maison spacieuse, bien chauffée pendant l’hiver grâce à l’installation du chauffage central au mazout, auquel mon père avait participé par ses dernières économies (1 million d’anciens francs de l’époque qu’il m’avait généreusement offert à l’automne 1961, peu avant sa disparition, qu’il sentait prochaine). Mais il n’eut pas le bonheur de voir la construction terminée – il ne put voir, qu’une seule fois, le gros œuvre.
Ceci m’amène halas ! à parler de la maladie qui devait l’emporter le 30 mars 1962 après des souffrances épouvantables Je l’ai aidé de mon mieux, mais, hélas ! le cancer du poumon ne pardonne guère. Je l’ai aidé maintes fois à passer des radios au Centre Médico-Social où le suivait le docteur Raybaud. Durant la dernier année, il avait perdu l’envie de fumer, même plus les cigarettes de luxe que je lui apportais. Je me demande parfois ‘il avait vraiment eu conscience de la cause de son mal.
Ses nombreux amis l’accompagnèrent à sa dernière demeure où il repose à côté de “Noune3, ma mère, la vraie Mme AUTRAN qu’il aima intensément.
Les trente années qui vont suivre de cette autobiographie sont émaillées d’une multitude d’évènements heureux et aussi très douloureux : évènements de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie associative, dont il me sera impossible de conter tous les aspects.
Après la disparition de Simon, son épouse se sentit bien seule dans la petite maison dénommée “Leï gari”. Je ne lui fis pas la proposition de s’installer chez nous, la vie eut été impossible. Joséphine Guimberty, de son nom de jeune fille, était une personne détestable par son avarice sordide, ses bavardages, son désir de tirer les plus grands profits de son union avec Simon, qu’elle avait supplié (le l’avais su par des voisins) de lui laisser la totalité de la maison en héritage. Sa bêtise n’avait pas de limites. Car elle aurait pourtant dû savoir que, depuis la mort de ma mère, je possédais déjà la moitié de cette propriété et que j’avais des droits sur l’autre moitié. Renseignements pris chez le notaire, je suis que la part qui lui revenait représentait, au mieux, 1/8 de la propriété en jouissance. Alors, elle me proposa de vendre pour récupérer quand même une part. Le prix de vente proposé par le notaire lui paraissant insuffisant, je lui fis savoir que je ne vendrai pas la maison. Mais je ne voulus tout de même pas la chasser.
Elle voulut aussi que je lui rende “le million” que mon père m’avait donné quelques mois avant sa mort pour que je puisse améliorer la maison de Châteaubanne avec un chauffage central au mazout. Nous eûmes alors une altercation des plus dures : « Depuis 18 ans de mariage avec Simon, vous avez vécu sur ma part d’héritage que je n’ai pas demandée à mon père. Après sa mort, c’est moi qui me suis occupé de votre pension de réversion que vous avez touchée moins d’un mois plus tard. C’est moi qui ai payé la totalité de ses obsèques sans rien vous demander, etc. Me voilà bien récompensé ! Si vous faisiez les comptes, vous trouveriez que c’est vous qui m’en devez ! ». Nos relations rompues, la veuve Guimberty ne put se résoudre à vivre seule et finit par déménager à Toulon, dans l’année 1963, chez des neveux, qui ne la supportèrent pas longtemps. Je crois me rappeler qu’elle est morte en 1974 dans une maison de retraite à Hyères.
La petite maison que nous appelions toujours “Leï gari” fut enfin libérée, mais elle exigeait d’importantes réparations. Pendant toute une année, je me mis en devoir de la remettre en état. Avec Louise et sa mère, nous allions y passer nos dimanches et procéder à des travaux d’entretien. C’est alors que mon oncle Paul AUBERT, qui demeurait en face dans la propriété “Le bocage”, tomba malade. Au souvenir de ma mère et de mes grands-parents, je me fis un devoir de le secourir. Veuf depuis 1928 de Malou Tagliamaco (il avait 30 ans, elle 28), sans enfant, il eut grand besoin de mes services (visites médicales, hospitalisation par deux fois à la suite de troubles circulatoires et respiratoires). Il mourut en 1965 et fut enterré dans la tombe où reposaient son épouse et ses parents AUBERT. J’assumai toutes ces épreuves courageusement.
Depuis notre installation à Châteaubanne, les épreuves ne me furent pas épargnées. Il me tardait à moi aussi de connaître une vis plus tranquille, d’autant qu’au plan de la vie associative, mes activités ne s’étaient jamais ralenties, avec mes fonctions d’adjoint au maire, de président de la Caisse des Écoles, mes responsabilités au sein d’une multitude d’associations (A.R.A.C., A.N.A.C.R., Société Nautique, amicales diverses,…). Si je suis aujourd’hui président d’honneur de sept associations locales, c’est tout simplement parce que mes services ont été reconnus partout.
L’année 1966 fut marquée par deux évènements remarquables : mon départ à la retraite le 1er juillet, d’une part, le mariage de Jean-Claude, d’autre part.
Mon départ à la retraite, tant espéré (55 ans et demi) allait combler mes espérances en me laissant du temps libre pour mes activités favorites : Bastian et ses vignes, ses arbres, les jardins de Bastian et de Châteaubanne, la chasse, la pêche, la vie associative. Mon départ à la retraite eut lieu au Lycée Beaussier en présence des professeurs du Lycée Beaussier et du “Cycle d’observation” du Collège Curie, où j’avais été affecté depuis plusieurs années (ce cycle groupait alors les classes de 6ème et de 5ème). Nous fûmes trois enseignants à partir le même jour : Toussaint MERLE, maire de La Seyne, et mon camarade Paul CAMOIN. Ces derniers, hélas ! ont disparu depuis longtemps.
 |
| Départ
à la
retraite, le même jour, de Marius AUTRAN, Toussaint MERLE et Paul
CAMOIN (1er juillet 1966) |
Au mois d’août, Jean-Claude se maria avec Aline Agasse, alors étudiante à Toulon, dont il avait fait connaissance sur la plage des Sablettes deux ans auparavant. Cette union dura un peu plus d’une vingtaine d’années, qui virent la naissance de mes deux petits-fils, Rémy (né en 1968) et Nicolas (né en 1970). Je reviendrai plus loin sur les difficultés qui survinrent dans le ménage (...).
Dans cette période j’eus à faire face à d’autres problèmes plus simples, mais auxquels il me fallut tout de même trouver des solutions.
La disparition de mon oncle Paul en 1965 posa le problème de sa succession. Sa petite propriété “Le bocage” fut mise en vente (maison avec pinède de 1 100 m2. Nous étions 4 héritiers : les 3 enfants de Geneviève AUGIAS, première sœur de Paul AUBERT, c’est-à-dire ma cousine Marie-Louise Ganzin, ma cousine Paulette Bagliotto, et mon cousin Paul AUGIAS (qui allait mourir peu d’années après à l’âge de 39 ans), et moi, représentant Victorine AUTRAN, ma mère, seconde sœur de Paul AUBERT. Nous eûmes à nous partager le produit de la vente qui s’élevais, je crois à 6 millions d’anciens francs. Je donnai une partie de ma part à Jean-Claude pour l’aider à terminer ses études et à s’installer dans la vie. Cette vente eut lieu le 30 mars 1967 chez le notaire de Sanary.
 |
| Paul AUBERT
(1898-1965) |
Il n’y eut entre mes cousins et moi aucun motif de discorde. Hormis l’argent de la vente, chacun reçut sa part de vaisselle, de linge, d’armes de chasse,… Personnellement, je fus intéressé par le bateau de pêche, une “bette” appelée Pax, dont je possédais déjà la moitié, mon oncle, malade, ayant accepté quelques mois auparavant de me vendre la moitié (vente à mi-part). Car il avait gardé l’espoir de retrouver un jour la santé pour continuer à pêcher à quelques encablures de la cale de La Verne dont mon grand-père était auparavant le propriétaire depuis la mort de son beau-frère Victor Hermitte. Ainsi, en quelques mois, l’ancienne propriété des AUBERT sortit de la famille.
La barque dont j’avais hérité, je décidai de la transférer dans la baie du Lazaret deux ans plus tard. Pourquoi le Lazaret ? Parce que dans cette période, on trouvait encore, dans cette “Petite mer” de mon enfance, des coquillages en abondance et aussi du beau poisson. Par ailleurs, la cale de mon grand-père devenant libre, je fis une autre acquisition, celle d’un pointu nommé Arlette, que je fis débaptiser pour lui donner le nom de mon petit-fils, Rémy. Pendant quelques années, je me trouvais donc en possession de deux bateaux, l’un à La Verne, l’autre aux Sablettes, chacun me procurant des joies différentes. Jusqu’au jour où je m’aperçus que l’entretien de deux bateaux me coûtait beaucoup d’efforts, quelquefois anéantis par les tempêtes.
Restons encore dans les années 1968-1970, fertiles en évènements des plus divers auxquels je fus mêlé.
Entre 1968 et 1970
Depuis mon départ à la retraite en 1966, j’avais régler ou presque la succession des AUBERT, celle de mon père, assuré l’avenir de Jean-Claude qui, en possession de son baccalauréat, était entré au Lycée Thiers à Marseille en vue de présenter des concours nationaux.
J’ai peu parlé de lui jusqu’ici. Il existe un volumineux dossier le concernant et sur lequel je ne reviendrai pas, sauf pour mentionner quelques dates importantes ayant marqué sa brillante carrière à l’I.N.R.A. dans lequel il entra en janvier 1968.
Un incident familial d’importance qui nous causa pas mal de tracas à Louie et à moi, le 10 novembre de cette même année 1968, Mémé GAUTIER s’effondra brutalement dans le jardin des “Gari”, à Mar-Vivo, en descendant une marche d’escalier. Je tentai de la remettre sur pied, mais impossible. Médecin et infirmière accoururent et leur conclusion fut la même : fracture du col du fémur. On devine la suite : dès le lendemain, ce fut le transport en clinique et l’opération fut réalisée avec succès par le chirurgien Francis Fabre (?) qui nous laissa espérer qu’elle marcherait encore à l’aide d’une canne. Il avait fait du bon travail le docteur Fabre puisque Mémé GAUTIER vécut encore 18 ans après cette chute. Naturellement, elle avait perdu son dynamisme d’antan et ne pouvait plus assurer les tâches ménagères qu’elle assuma toute sa vie durant à notre service. Louise dut commencer à se faire aider par des femmes de ménage, bien dévouées d’ailleurs (Mmes Bonnet, Rossi, Décugis, etc.).
Un événement inattendu qui provoqua à La Seyne une émotion profonde : la mort du maire Toussaint MERLE, le 24 mai 1969. Fatigué depuis plusieurs mois, il s’acharnait à vouloir dominer la vie seynoise dans tous ses aspects.
J’ai fait partie des municipalités dont il eut la charge entre 1950 et 1969, presque 20 ans, sans parler de la Résistance où, pendant 2 ans, nous avions contribué à la reconstruction d’un parti communiste clandestin, période très dangereuse où j’apportai mon concours sous les formes les plus diverses : rédaction de tracts, diffusion ; collecte d’argent, de vêtements pour les maquis du Var. Le Parti communiste avait été décimé. Des dizaines de militants Seynois avaient rejoint les maquis et plusieurs furent fusillés ou tués dans les combats de la Libération. D’autres avaient quitté La Seyne et leur famille, de sorte que les luttes menées par nos militants contre la municipalité vichyste devinrent plus difficiles Néanmoins, la population seynoise faisait de plus en plus confiance aux combattants de la Résistance.
Revenons un instant sur la mort de Toussaint MERLE, qui causa un grand vide, qu’il fallait impérativement combler. Le camarade Jean Bartolini, membre du Comité Central du Parti communiste fut chargé de résoudre le problème. Une réunion toute discrète* se tint dans la maison mortuaire quelques instants avant que la dépouille du maire ne fut transférée à l’hôtel-de-ville. Trois personnes seulement étaient présentes : Jean BARTOLINI, Philippe GIOVANNINI et moi. Philippe, premier adjoint, marqua une certaine réticence à l’idée d’occuper le poste de Maire et déclara qu’il éprouverait les plus grandes difficultés à exercer des fonctions qui lui paraissaient au-dessus de sa compétence. Il sollicita mes opinions et il se déclara prêt à me céder la place du Maire. Ce que je refusai, mais en lui promettant le concours le plus loyal. Je compris d’ailleurs que le représentant de la plus haute instance du Parti éprouva une satisfaction certaine, pour deux raisons. La première, c’est que GIOVANNINI, héros de la Résistance, méritait bien le titre de Maire de La Seyne. La seconde, c’est le sentiment corse qui devait prévaloir. Et puis, je ne me voyais pas être dans l’obligation de tenir tête à toutes les ambitions des communistes, aux appétits de militants dont certains recherchaient des avantages personnels. Il semblait à beaucoup d’entre eux que la mairie communiste était à leur service. Le syndicat C.G.T., dirigé par des communistes, se donnait tous les droits. Je suis sûr, qu’ayant accepté les fonctions de Maire, je n’aurais pas tardé à me fâcher avec bon nombre de militants. Je pense sincèrement avoir pris une bonne décision à refuser ces responsabilités, comme d’ailleurs je l’avais fait en 1953 en permettant à GIOVANNINI de devenir premier adjoint. Je n’ai jamais brigué des places et des honneurs. Je pense avoir bien fait de garder mes libertés.
* Une
autre réunion plus officielle eut lieu (cf. Biographie de Marius
AUTRAN par Jacques GIRAULT) : « Aussi, à la mort de
Toussaint Merle, en 1969, le bureau fédéral, en
présence de François Billoux, envisagea-t-il qu'il
pouvait devenir premier adjoint "avec perspective de maire en 1971",
selon les termes du rapport de Billoux, le 9 juin 1969. Mais ce dernier
ajoutait que, AUTRAN lui avait déclaré qu'il "ne se sent
pas en mesure d'accepter le poste de premier adjoint" ».
 |
| Garde d'honneur autour du corps de Toussaint MERLE à l'Hôtel de Ville : Philippe GIOVANNINI, Jean PASSAGLIA, Maurice PAUL, Marius AUTRAN |
Inutile de développer ici ce qu’il advint dans les jours qui suivirent. Les problèmes administratifs furent réglés sans difficultés. Le poste de premier adjoint fut confié à un certain PM, arriviste qui s’empressa d’organiser sa propagande personnelle car il visait ostensiblement le poste de Maire. (...). Son incapacité à gouverner conduisit la municipalité à sa perte, laissant la ville de La Seyne dans le plus grand dénuement.
Ne quittons pas l’année 1969 qui vit, le 22 octobre, la disparition de mon cousin germain Paul AUGIAS, âgé de seulement 39 ans. Il était alors préposé des P.T.T. à Marseille. Il mourut d’une maladie du foie, la cirrhose, mal qui, je crois me rappeler, touche généralement les alcooliques. Or, ses proches ont toujours affirmé qu’il ne buvait jamais. Comprenne qui pourra. Les médecins non plus.
Ce cousin, frère de mes cousines Sissi et Paulette, était un garçon fort intelligent, mais dont les parents négligèrent l’instruction. Il avait fait sa classe de 6ème à Martini où j’avais pu juger de ses aptitudes intellectuelles. Mais on père avait besoin de main d’œuvre pour les travaux de la campagne, surtout à l’époque où la famille AUGIAS s’était installée au Thoronet. Ainsi, il ne poursuivit malheureusement pas ses études et, après quelques années de travaux agricoles, il se retrouva simple préposé des P.T.T., alors qu’il aurait pu accéder à un bien meilleure situation.
Louise et moi, n’avions pas pu être présents aux obsèques de Paul AUGIAS et accompagner la famille dans ces circonstances douloureuses, pour la bonne raison que, cette semaine-là, nous étions chez Jean-Claude, dans la région parisienne, à Antony* exactement, où Jean-Claude, entré à l’I.N.R.A., habitait alors.
* J’étais en fait à Igny à cette date, ayant déménagé, depuis seulement quelques semaines, de la Résidence Universitaire d’Antony.
Je pourrais, à ce moment de mon récit, retracer sa brillante carrière, que je vais tout de même évoquer dans ses grandes lignes (un dossier spécial sur sa carrière existe dans mes archives).
Je tiens seulement à rappeler qu’après avoir obtenu son baccalauréat (Martini et Beaussier), Jean-Claude était entré au Lycée Thiers, à Marseille, dans une classe de Mathématiques Supérieures. Après 3 ans d’études, il présenta plusieurs concours nationaux. Il fut admis à l’E.N.S.I.A. (École Nationale Supérieure des Industries Agricoles et Alimentaires). Je souligne aussi qu’il avait été admissible (admis seulement à l’écrit) dans les 10 premiers de l’École Nationale Supérieure de la rue d’Ulm (la plus haute instance d’enseignement de la nation française). Mais il fut malheureusement recalé à l’écrit à cause d’une mauvaise note en chimie. L’examinateur fut contrarié de mal noter Jean-Claude à l’oral, mais il ne pouvait pas faire autrement. Sa déception le poussa à lui dire je suis d’autant plus déçu que c’est vous qui aviez obtenu la meilleure note à l’écrit en sciences naturelles (17/20).
Recalé à Normale Supérieure, il entra donc à l’E.N.S.IA., école située à Massy (Essonne). Après quelques mois, je voulus tout de même savoir où allait le conduire cette école. Il obtiendrait certainement le diplôme d’ingénieur, mais je ne voyais pas mon fils, que savais être un grand timide, dans une entreprise où il faudrait peut-être trancher des conflits entre patronat et classe ouvrière. Je le voyais plutôt travailler dans un laboratoire de recherches. Mais pourrait-il y accéder par l’E.N.S.I.A., école dépendant du Ministère de l’Agriculture ?
A la faveur d’un voyage à Paris, je rencontrai le directeur de l’E.N.S.I.A. et je demandai également audience à un chef de service du Ministère [Il s'agissait de Roland DARVES-BORNOZ, alors ingénieur-en-chef du Génie Rural, ami de longue date de Marius AUTRAN, sa famille habité La Seyne, l'immeuble en face du nôtre, dans les années 50], qui m’informa qu’une option pour la recherche était possible, en fonction du classement de l’élève. L’année se passa dans de bonnes conditions, Jean-Claude ayant posé sa candidature pour accéder au premier grade de la recherche à l’I.N.R.A., celui d’Agent Contractuel Scientifique et son classement lui permit d’intégrer cet institut et d’être ainsi salarié, au 1er janvier 1968, au cours de sa 3e année à l’I.N.R.A.
Avec ses premiers sous, il put ainsi s’installer dans un appartement pour étudiants mariés de la Résidence Universitaire d’Antony. Quelques mois plus tard, le 16 octobre 1968, naquit Rémy, à Antony. Naturellement Louise et moi, ainsi que Mémé GAUTIER avons pris immédiatement le train pour découvrir ce premier petit-fils, à la clinique d’Antony, proche de la Résidence Universitaire. En écrivant cela, je suis quelque peu ébranlé à la pensée que mon premier petit-fils va maintenant sur ses 35 ans [texte écrit vers 2002].
Revenons quelque peu en arrière sur la carrière de Jean-Claude, dont je veux seulement effleurer les sommets.
En fin de 3e année à l’E.N.S.I.A., il effectua son stage d’ingénieur aux Grands Moulins de Paris. Après quelques mois passés dans les laboratoires I.N.R.A. de l’E.N.S.I.A., sa première affectation fut l’École Française de Meunerie, dans le 13e arrondissement de Paris. C’est là qu’il commença à gravir les premiers échelons de sa carrière de chercheur scientifique : Assistant de recherches, puis Chargé de recherches. Plus tard, il sera Maître de recherches et enfin Directeur de recherches. Il avait fallu pour cela qu’il présente une thèse doctorat à l’Université de paris, puis pour chaque changement de catégorie, des études, des rapports, des publications, des communications à l’Académie des Sciences,… Que de travail ! Que de patience ! Que de courage ! Merci, Jean-Claude pour toutes les satisfactions que tu as données à tes parents. Merci pour l’exemple magnifique que tu auras donné à tes enfants !

|
| Jean-Claude
à son bureau,
École Française de Meunerie, 1973 |
Un détail dans mon histoire. Nous sommes en 1969. Le 9 octobre, je fis l’acquisition d’une 204 Peugeot pour remplacer ma vieille 403. Cette petite voiture, plus économique, nous permit des voyages plus importants avec plus de sécurité. La 403 avait alors 22 ans et avait dépassé les 130 000 km. Elle nous avait permis des voyages dans presque toute la France et permit à Mémé GAUTIER de connaître les plus belles régions de notre pays : La Bretagne, l’Auvergne, les Alpes et, bien sûr, la région parisienne.
Et nous voici en 1970, année marquée par la naissance de mon second petit-fils, Nicolas, le 21 décembre. Nous partîmes à Paris, Louise et moi, voir ce superbe bébé, né, lui, à la clinique de Châtenay-Malabry et nous restâmes ainsi quelques jours à Paris. Le cercle de la famille s’agrandissait, ce que j’appréciais beaucoup.
Rentré à La Seyne, je repris mes activités à l’hôtel de ville, à la maison, à la campagne de Bastian, au jardin de Châteaubanne, et dans une vie associative de plus en plus prenante.
 |
 |
| Marius AUTRAN
cultive sa campagne de Bastian : semis des fèves, taille des vignes |
A signaler dans cette période deux dates mémorables qui honorèrent notre famille AUTRAN.
Le 14 juin 1973, Jean-Claude fut reçu 3e sur 15 candidats au concours de Chargés de recherche de l’I.N.R.A. La semaine suivante, le 20 juin, il soutint sa thèse de doctorat ès-sciences qu’il obtint ave la mention “très honorable”. Pour Louise et pour moi, ce fut journée palpitante d’entendre notre fils, si timide à l’origine, développer son sujet avec une éloquence et une persuasion que nous étions loin de soupçonner. Ce succès fut fêté avec ferveur avec ses collègues de l’I.N.R.A.
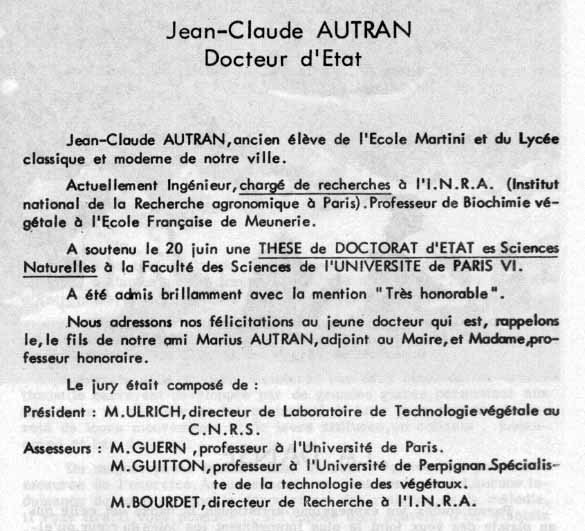 |
| Extrait de la
revue Étraves, automne
1973,
n° 27 |
De retour à La Seyne, nos amis, les camarades de Jean-Claude, furent informés de ce succès qui fit honneur à toute la famille. J’éprouvai tout de même une certaine amertume à la pensée que mon père aurait été si fier de répandre autour de lui, à ses nombreux amis, cette nouvelle retentissante : « Mon petit-fils est docteur ès-sciences ».
L’année suivante fut également une succession d’évènements dans ma vie courante. Elle fut marquée par un deuil, avec le décès de celle que nous appelions familièrement “Tante Louise”, la neuvième et dernière de la fratrie des MARTINENQ, retraitée de l’hôpital de La Seyne où elle exerçait sa profession de lingère [après avoir été patronne d'un atelier de couture]. Elle était l’une des sœurs de “Grand-mère Mathieu”, la grand-mère de Louise. Elle fut d’un grand secours à nos familles Mathieu, GAUTIER, MEUNIER, AUTRAN. Veuve depuis très longtemps de son époux Marius PISANY, appelé familièrement “Tonton Tambour”, vocable qu’il tenait de son appartenance aux Philharmoniques locales, La Seynoise et L’Avenir Seynois. Elle aida financièrement son frère Alexandre MARTINENQ dans l’agrandissement de la maison familiale de Touffany, ainsi que sa sœur Madeleine MARTINENQ, durement touchée par les malheurs de la vie. Elle encouragea Joséphine GAUTIER fille à faire de Louise une étudiante, puis une normalienne, puis une institutrice, puis un professeur. Nous l’avions assistée ostensiblement durant les dernières années de son existence et elle mourut à l’hôpital de La Seyne le 19 août 1974. J’ai organisé personnellement ses obsèques.
 |
| Joséphine
GAUTIER, 80 ans Son arrière petit-fils, Rémy AUTRAN Tante Louise PISANY, née MARTINENQ, 90 ans (tante de Joséphine GAUTIER) Dans le jardin de Châteaubanne, août 1969 |
Changement de décor : à la fin du mois de septembre de la même année, je fus désigné par le Conseil municipal pour participer à un voyage en U.R.S.S. dans le cadre des cérémonies de jumelage de notre ville de La Seyne avec le port de Berdiansk situé sur les bords de la mer Noire, non loin de la mer d’Azov. Inutile de raconter par le menu ce voyage qui dura du 27 septembre au 3 octobre. Mes archives contiennent des articles de presse relatifs aux détails de toutes les visites d’écoles, d’usines, de tous les spectacles qui nous furent offerts par les autorités municipales de Berdiansk.
 |
| Réception de la
délégation de La Seyne à Bardiansk : M. KORNEV, Maire, et Marius AUTRAN |
Je fus impressionné au plus haut point par les réalisations du peuple soviétique, surtout au plan industriel, artistique, sportif. Avec mes camarades de voyage, nous étions loin d’imaginer la chute du système soviétique, qui avait tout de même sorti la vieille Russie des tsars de la féodalité du Moyen Âge. Ce sujet mériterait de longs développements qui n’ont pas leur place dans cette autobiographie.
Il me souvient d’avoir écrit un compte-rendu de ce voyage en U.R.S.S. dans une revue qui s’intitulait Études Soviétiques, que l’on peut retrouver dans un dossier de mes archives : Jumelage La Seyne-Berdiank, émaillé de plusieurs photos (avec M. KORNEV, le Maire de l’époque, et M. ANTONOV, son premier adjoint).
A titre réciproque, notre ville de La Seyne reçut (l’année suivante ?) la visite du Maire KORNEV, qui ne fut pas insensible aux réalisations de notre municipalité.
 |
| Réception
du Maire de Berdiansk, M. KORNEV, sur un parc à moules de la
baie de Tamaris. De gauche à droite : Marius AUTRAN, M. KORNEV
observant un praire ouvert, Jean PASSAGLIA |
Les années passant, l’équipe municipale à laquelle j’appartenais vieillissait. Le Maire GIOVANNINI donnait des signes d’inquiétude à ses camarades à cause de son état de santé. Il dut subir toute une série d’interventions médicales en raison de problèmes circulatoires. Il fut soigné en Allemagne, en Russie même. Ses activités municipales en furent ralenties. Malgré son lourd handicap, il fut élu député en 1978. Il ne siégea qu’une seule fois à l’Assemblée Nationale. Il ne siégea pas une seule fois au Conseil Régional, dont il était membre de droit en tant que député. A ce même Conseil Régional, assemblée instituée en 1974, j’avais été élu par le Conseil municipal par 25 voix sur 25 présents (le Conseil Régional n’était pas encore élu au suffrage universel comme il le sera par la suite). J’indique en passant que, dans la répartition des responsabilités, j’avais été nommé dans le Bureau comme secrétaire et, plus particulièrement, secrétaire de la Commission de l’Éducation Nationale présidée par Mme BÉGHIN-LE BELLEGOU, dont j’ai gardé le meilleur souvenir.
Qu’il me soit permis de dire au passage que j’obtins quelques satisfactions personnelles par l’attribution d’importantes subventions, notamment pour la réalisation du Musée de Balaguier, le démarrage de la Clinique mutualiste d’Ollioules (établissement régional), le soutien au mouvement occitan,…
Ma participation au Conseil régional, qui dura 3 ans, m’obligeait à me rendre à Marseille au moins une fois par semaine, sans compter les réunions de commissions et les assemblées générales. Ma participation à cette assemblée cessa avec la fin de mon mandat municipal, en 1977.
 |
| Marche sur Toulon en 1975 des élus de La Seyne pour la défense des Chantiers. Marius AUTRAN est au centre |
 |
| Discours de Marius AUTRAN
lors des obsèques d'Alex PEIRÉ |
Le 1er janvier 1975, je fus désigné président d’honneur de l’A.N.A.C.R. (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance) - association à laquelle j’appartenais depuis plus de 25 ans – distinction qui sera suivie par plusieurs autres.
Pour ne pas y revenir plus loin, ce fut seulement en 1976 que me fut décerné le titre de “Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques” (le ruban violet). J’avais alors 68 ans. Je tiens à signaler que j’avais été proposé pour la première fois par M. MALSERT, directeur de l’École Martini, quelques années après la Libération ! Par deux fois, les propositions faites par M. SIMON, inspecteur primaire, et M. MORY, inspecteur d’académie, furent refusées par la Préfecture. En 1976, M. HENRICART, inspecteur primaire, eut plus de chance. Il s’imposa aux autorités qui, pendant des années, me tinrent rigueur de mes opinions politiques. Et, 13 ans plus tard (voir ci-dessous), me fut décerné le grade supérieur, celui d’“Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques” (la rosette violette).
Les années passant, les distinctions honorifiques allaient alors se succéder à mon avantage et cela dans les domaines les plus divers de la vie associative, dont je fus sans doute un animateur apprécié de tous. En 1976, j’avais déjà obtenu la médaille d’honneur départementale et communale, médaille d’argent, attribuée pour mon dévouement au service des collectivités locales (Conseil municipal et Conseil régional). On verra ci-dessous que le 12 décembre 1986 je reçus une médaille d’honneur de l’A.R.A.C., à laquelle j’appartenais depuis plus de 40 ans, étape qui me conduisit à en devenir l’un des Présidents d’honneur quelques années plus tard. On verra également ci-dessous, qu’après avoir écrit en 1984 l’Histoire de la philharmonique La Seynoise, me fut attribuée (2 mai 1987) la médaille d’honneur (médaille en or) de la Confédération Musicale de France.
Toutes ces distinctions prouvent abondamment combien je fus lié, pendant des décennies, à l’administration et à la vie associative de ma ville natale.
A ce propos, l’année 1977 fut très significative : j’avais décidé de ne pas renouveler ma candidature aux élections municipales. D’autres candidats potentiels se manifestaient en coulisse. D’autres élus envisageaient leur accession au poste d’adjoint. J’avais sollicité de la direction municipale d’autres activités que les œuvres périscolaires. Satisfaction ne me fut pas donnée, surtout avec l’opposition de l’adjoint PM, pour qui le poste d’adjoint aux travaux permettait de soigner sa propagande personnelle. Pauvre diable qui se rengorgeait à la moindre réalisation dont il se disait l’auteur avec fracas.
J’aspirai de plus en plus à une liberté totale dans ma vie de tous les jours. Alors que j’assistai aux intrigues des arrivistes, des profiteurs, à la recherche d’emplois pour leurs enfants. Moi qui avait œuvré tant d’années pour le Parti, à titre absolument bénévole, je ne me sentis plus en mesure de supporter les passe-droits, les intrigues, que le Parti communiste tolérait ! Les deux tiers des élus de l’époque casèrent leurs enfants dans des structures municipales. La municipalité (...) devenait un fromage pour les communistes. Des familles entières de militants tirèrent des avantages personnels non négligeables. Les Corses ne furent pas les derniers. Le vieux proverbe : « Venir pour servir et non pour se servir » fut complètement oublié. L’ambiance générale se dégradait. Alors, ce fut sans regret* que le 21 février 1977, je pris, si j’ose dire, ma retraite municipale.
* Ce
passage n'est pas en accord avec d'autres sources. En particulier, lors
des obsèques de Marius AUTRAN, Francisque LUMINET déclara
: « Il fut
décidé de réaliser cette union [de la gauche] pour
les élections municipales de 1977. Des anciens durent se retirer
; démarche douloureuse ; Marius le fit ; pour avoir
été l'intermédiaire entre les instances
dirigeantes (dont Ph. GIOVANNINI) et celles et ceux invités
à « laisser leur place », je dois dire que cela fut
effectivement douloureux ; Marius
le ressentit mal
; il me l'a dit ; il me l'a écrit ; mais il s'exécuta ;
son activité ne tarit pas pour autant ; elle se déploya
toujours principalement au service de ses concitoyens ».
Je pense, de mon côté, que mon père - qui avait
vécu les conflits et la haine réciproque entre anciens
communistes et S.F.I.O à La Seyne et dans le Var -
n'était pas très chaud pour siéger aux
côtés de certains responsables socialistes. Bien qu'il ait
toujours gardé des rapports cordiaux et souvent amicaux avec
quelques autres membres du PS.
A cette occasion, au cours d’une cérémonie “intérieure”, je reçus des mains du Maire la « Médaille d’honneur de la ville de La Seyne ». Quelques semaines plus tard, reçus le titre d’« adjoint honoraire », après 25 ans de bons et loyaux services rendus à ma ville natale, concrétisés par un diplôme.
 |
| Jean SPRECHER,
Marius AUTRAN et Jean PASSAGLIA |
Quelques semaines plus tard, dans un domaine tout différent, je fus nommé vice-président de la philharmonique « La Seynoise », association musicale que j’ai soutenue toute ma vie durant, et dont je deviendrai plus tard « Président d’honneur ».
L’année 1977 m’apporta aussi des satisfactions d’un caractère tout différent. Notre maison de Châteaubanne fut agrandie, côté nord : un petit appartement de 40 m2 environ avec cuisine équipée d’une machine à laver la vaisselle, salle de bain, chambre, dépendances. Cet agrandissement permit alors aux enfants une meilleure installation pour leurs vacances.
Précisément, en août 1977, Jean-Claude (avec sa famille) rentra des U.S.A. où il était parti pour une durée de 11 mois (date de départ : 13-9-1976). Il en revient avec des souvenirs particulièrement attachants après avoir fait la connaissance de 11 états de cet immense continent, après avoir parcouru des centaines de kilomètres de la côte du Pacifique, après s’être lié d’amitié avec de nombreux chercheurs de la même spécialité que la sienne, après avoir obtenu des distinctions honorifiques de très haut niveau. Louise et moi furent tout de même heureux de le voir rentrer en France avec ses enfants. Les autorités américaines auraient sans doute préféré, compte tenu de ses capacités, le garder à leur service.
Jean-Claude et sa famille réintégrèrent donc la France, la région parisienne d’abord (à Massy), mais pour très peu de temps puisque mi-septembre 1977, Jean-Claude fut affecté, comme prévu, au Laboratoire de Technologie des Céréales de l’I.N.R.A. à Montpellier, laboratoire dont il deviendra, deux ans plus tard, le directeur (voir le dossier sur la carrière scientifique de Jean-Claude dans mes archives).
Plusieurs faits d’inégale importance sont encore à rapporter pour cette période 1977-1978. La seconde épouse de mon père étant décédée quelques années auparavant, je pus envisager la vente de la petite maison “ Leï Gari” de Mar-Vivo. Ma “marâtre”, dont je crois avoir dit le peu d’estime que j’avais pour elle, et qui prétendait avoir des droits sur ma propriété, ne pouvait plus être désormais un obstacle à mes projets. “Lei Gari”, où mon père avait vécu sa retraite, furent mis en vente en 1978. Je souffris beaucoup en prenant cette décision. Il est vrai que cette construction se détériorait, que les enfants (après y avoir passé presque toutes leurs vacances d’été, de Noël et de Pâques depuis 1967) y venaient moins souvent, préférant (surtout ma belle-fille) des séjours à la montagne. Nous-mêmes ne pouvions plus guère y venir en raison du handicap de Mémé GAUTIER. J’ajoute que, lorsqu’ils venaient en vacances à La Seyne, ils pouvaient désormais s’installer dans l’extension de la maison de Châteaubanne que nous venions de terminer en 1978, rendant moins indispensable cette “résidence secondaire” des “Gari”. Il nous fallait bien vendre aussi, car Jean-Claude, désormais installé à Montpellier et que nous encouragions à faire construire plutôt que de payer un loyer d’appartement pendant encore des années, avait besoin de l’argent de cette vente.
 |
| La Maison
“Leï Gari”, à Mar-Vivo, peu avant sa vente |
Deux ou trois acheteurs se présentèrent, sans trop de conviction. Enfin, au bout de quelques semaines, le 27 juillet 1978, un compromis de vente fut passé avec un certain M. TISSOT [à vérifier, cf. vente du Bocage ?], artisan-maçon de son état, devant le notaire Me PORCEL. La vente se fit sans difficultés pou le prix de 231 000 ou 233 000 F (je ne sais plus très bien). Cet argent dut donc donné intégralement à Jean-Claude pour la construction de sa première maison à Montpellier, au quartier Aiguelongues.
Quelques semaines auparavant (mars 1978), dans un tout autre domaine, je pris l’initiative de faire transférer les reste mortels de Louis GAUTIER, père de Louise, depuis le caveau du Souvenir Français de La Seyne, où il reposait depuis le 3 octobre 1911 après sa mort dans la catastrophe du cuirassé Liberté, le 25 septembre précédent (voir mon récit dans le tome I des “Images de la vie seynoise d’antan”).
Mais l’opération ne fut pas si simple. Depuis peu, la loi autorisait les familles à reprendre les restes mortels des victimes se trouvant dans des tombes du Souvenir Français. Mais me voilà alors en conflit avec le conservateur du cimetière de La Seyne qui doutait de l’existence d’un caveau sous la stèle du Souvenir Français ! J’exigeai alors que des fouilles fussent exécutées pour retrouver l’ouverture du caveau, qui devait se situer au-dessous du niveau du sol, donc invisible. Il fallut deux jours de travaux pour découvrir enfin le cercueil de plomb de Louis GAUTIER. Mais hélas ! Ce ne fut pas tout car le cercueil ne portait pas le nom de la victime. On l’ouvrit tout de même et les fossoyeurs retrouvèrent un maxillaire inférieur parfaitement conservé auquel il manquait une prémolaire Une enquête fut faite auprès de la famille et, heureusement, Fernande MEUNIER, qui était toujours vivante et qui avait connu Louis GAUTIER, son beau-frère, se rappela que celui-ci s’était effectivement fait arracher une dent quelque temps avant sa mort. Le doute étant levé, les quelques ossements qui restaient et le crâne défoncé du fait de l’explosion du cuirassé Liberté, furent rangés dans un petit cercueil et transférés dans notre tombe familiale. Je fus le seul membre de la famille à y assister. Mémé GAUTIER pourrait ainsi retrouver, si l’on peut dire, l’époux qu’elle avait perdu dramatiquement depuis 67 ans !
Ma participation à la vie associative se poursuivit durant quelques années encore. Je commençais à ressentir les premiers effets de la sénescence mais le désir de conquérir une liberté totale le gagnait de plus en plus. Libéré depuis 1977 de mon mandat municipal, de la présidence de la Caisse des Écoles, je fréquentais néanmoins encore ces milieux sans y avoir de responsabilité contraignante. Plusieurs présidences d’honneur me furent attribués, par exemple celle de la Société Nautique de la Petite Mer, dont j’avais été le co-fondateur (avec Gilbert MARRO et Loulou MEUNIER) quelque 20 ans auparavant ; celle de la section locale de l’A.R.A.C. (Association Républicaine des Anciens Combattants) à laquelle j’avais adhéré depuis sa fondation tout de suite après la guerre ; également celle de l’A.N.A.C.R. (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance).
 |
| Marius AUTRAN, à une célébration de l'A.N.A.C.R. en 1990 |
Enfin, après être devenu “Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques” sur la proposition de M. HENRICART, comme je l’ai expliqué précédemment, cette nomination fut suivie, 13 ans plus tard, par le grade supérieur d’“Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques”, cette fois sur la proposition de M. FULPIN, Inspecteur de l’Éducation Nationale, qui fut le successeur de M. HENRICART.
Ma retraite municipale acquise, n’allait-elle pas connaître une période d’inactivités ? Loin de là, car j’avais toujours plusieurs cordes à mon arc ! Bastian me prenait toujours beaucoup de temps. Le potager de Châteaubanne aussi.
 |
| Marius AUTRAN et
Joséphine GAUTIER, dans le potager de Châteaubanne (avril 1980) |
Sans compter la pêche, qui m’occupa presque toute ma vie de retraité. J’avais finalement vendu le Rémy, le pointu que j’avais à La Verne sur la cale utilisée pour la Joséphine, propriété de mon grand-père AUBERT et plus anciennement celle de l’oncle Hermitte, frère de ma grand-mère. Je rappelle que le Rémy avait, sur cette cale, pris la place du Pax, modeste bette ayant appartenu à mon oncle Paul AUBERT, que j’avais alors transférée à Saint-Elme, sur la Petite Mer, la baie du Lazaret m’offrant alors coquillages et poissons en abondance. Cette opération s’était faite en janvier 1968. J’ajoute, pour ne plus avoir à revenir sur le sujet de la pêche, que le Pax fut détruit par des malandrins de la mer. Je le remplaçai alors par un tout petit pointu appelé You-You, que je vendis vers 1990 à un Aixois en vacances à La Seyne. Ce dernier bateau me permit de jouir des joies de la pêche jusqu’à l’âge de 80 ans. De toutes mes activités de loisirs, c’est probablement la pêche qui m’a laissé les meilleurs souvenirs.
 |
| Marius AUTRAN,
Président d'honneur de la Société Nautique de la
Petite Mer et son petit bateau, le You-You, en 1990, à la Petite Mer |
Je ne quitterai pas les années 1980-81 sans mentionner quelques autres évènements notables. Le 12 janvier 1980, les enfants s’installèrent dans leur propre maison au quartier Aiguelongues à Montpellier, habitation confortable, avec garage, petite pinède et jardin potager exploité admirablement par Jean-Claude. Il y vécut heureux quelques années, jusqu’au moment de la discorde dans son ménage se produisit, quelque 10 ans plus tard – ce que nous ressentîmes, Louise et moi, comme un événement heureux.
Autre fait notable, très satisfaisant pour la carrière de Jean-Claude : ce fut le 15 mars de cette même année 1980 qu’il décrocha son titre de “Maître de Recherches”.
L’année suivante, précisément le 16 octobre 1981, je fus amené par le fait du hasard, à participer à une émission de télévision sur France 2 à l’occasion d’un « Avis de recherches » lancé par Henri TISOT, enfant de La Seyne, ancien élève de l’École Martini (Henri avait été mon élève dans une classe de 6ème). Il s’agissait pour lui de retrouver les camarades de sa classe vivant encore à La Seyneou dans les environs, de les réunir à Paris sur un plateau de télévision, de rappeler les temps lointains de “Martini”. Ce fut Patrick SABATIER qui les reçut, et qui interrogea également le professeur de 6ème moderne de l’époque, qui n’était autre que Marius AUTRAN, ainsi que le Maire de La Seyne des années 1980, Maurice BLANC (le successeur de Philippe GIOVANNINI), et lui aussi ancien élève de l’École Martini.
 |
| Publication de l'Avis de recherches d'Henri TISOT
dans Télé 7 Jours |
La préparation de cette émission m’occupa une quinzaine de jours avant de pouvoir retrouver la trentaine de camarades de la classe d’Henri. La grande majorité accepta le déplacement effectué en autocar jusqu’à Marignane, puis en avion jusqu’à Paris. (Aucun participant ne paya de frais de voyage ou de séjour). Cette manifestation de sympathie fut annoncée dans la presse locale plusieurs jours auparavant. Les Seynois, par milliers, regardèrent la télévision le soir du 16 octobre 1968. Pensez donc ! Les anciens élèves de l’“École Martini” sur un plateau de télévision ! Il ne fallait pas manquer le spectacle. La plupart des commerçants avaient même fermé leur boutique une heure avant l’heure habituelle pour ne pas manquer l’émission de Patrick SABATIER. Nous fûmes accueillis chaleureusement et les Provençaux que nous sommes amusèrent des millions de Français.
 |
| Départ de La Seyne des anciens camarades de classe d'Henri TISOT, avec leur maître, Marius AUTRAN et le Maire de La Seyne, Maurice BLANC |
Après l’émission, Henri TISOT, au comble de la joie, nous accueillit chez lui, dans son appartement luxueux, riche en meubles précieux et en objets rares. Puis, il nous invita dans l’un des plus célèbres restaurants de Paris (au Pré Catelan), puis ce fut une visite nocturne des environs de la place de l’Étoile à Paris. Le lendemain, nous reprîmes la direction de La Seyne. Et voilà qu’à l’aéroport, les Parisiens nous reconnurent et des cris retentirent dans la foule : Voilà les gars de la télé ! ». Une dame fort sympathique me déclara dans son enthousiasme : « C’était bien vous le professeur ! ». Le même accueil nous fut réservé en gare de Toulon. On pourrait presque affirmer que cette journée passée à Paris fut une véritable journée historique. A La Seyne, pendant plusieurs jours, je fus interviewé sur le fonctionnement des studios de France 2. Les camarades d’Henri conserveront de ce voyage un souvenir inoubliable, d’autant que le plupart d’entre eux ne connaissaient même pas la capitale.
L’année suivante, en 1982, je fus confronté à des tâches les plus inattendues, toutefois en liaison avec les problèmes municipaux dont je m’étais pourtant écarté depuis 1977. Il me faut, pour bien en faire comprendre l’origine, retourner à l’année 1976, date de la destruction de la vieille, très vieille, École Martini, première école d’enseignement public de La Seyne, née en 1833 sous le règne de Louis-Philippe. On sait qu’à l’emplacement de cette école fut édifié un grand parking. Quant à l’enseignement, les classes de lycée de l’ancienne école furent installées au nouveau Lycée Beaussier, les classes de collège à l’ancien collège Curie et les classes de primaire, dans une nouvelle structure de 10 classes, la “nouvelle École Martini”, construite sur une partie de l’emplacement de l’ancienne, à côté du parking qui porte également le nom de Martini, premier directeur de l’école, au XIXe siècle.
La “nouvelle École Martini » fut inaugurée le 8 mars 1980 par Maurice BLANC, alors Maire de La Seyne. Quelques jours avant la cérémonie, ce dernier me fit appeler pour la rédaction de son discours. « Je ne sais rien de l’histoire de l’École Martini, me dit-il, alors que de ton côté, tu es certainement documenté. Veux-tu m’aider à préparer mon intervention ? ». Naturellement, j’acceptai de la faire, et le même jour j’apportai à Maurice BLANC les éléments de son discours. En les écrivant, j’éprouvai cependant des difficultés à résumer les 176 ans de la vieille école disparue, pour une allocution qui ne durerait même pas un quart d’heure. J’y parvins toutefois, mais je déclarai à Louise, à qui je lus mon texte : « Cette vieille école détruite mériterait une véritable histoire eu égard aux services éminents qu’elle a rendus à tant de générations de petits Seynois, dont elle a fait des ouvriers spécialisés, des contremaîtres, des enseignants, des travailleurs en tous genres, manuels ou intellectuels.. Il serait passionnant de rappeler que les plus doués sont devenus des médecins, des hauts fonctionnaires, des officiers de haut rang,… ».
Bref, quand je remis au Maire le fruit de mes recherches et surtout mes souvenirs personnels, je ne lui cachai pas l’idée qui germait dans ma tête. A partir de ce jour, j’accumulai les documents, les témoignages, dans le perspective d’écrire un ouvrage intitulé « Histoire de l’École Martini (1833-1976) – L’Enseignement à La Seyne de 1789 à 1980 ».
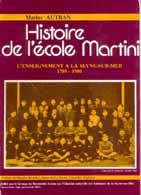 |
La finalisation de cet ouvrage de plus de 500 pages dura presque deux anénes. Auparavant, avec quelques membres du service culturel municipal, dont Bremondy et Bonnacorsi, une structure à caractère historique fut imaginée qu’on appela G.R.A.I.C.H.S., sigle signifiant « Groupement de Recherche-Action sur l'Identité Culturelle des Habitants de La Seyne-sur-Mer ». Elle était composée d’une dizaine de membres, dont René MERLE et moi-même. Nous espérions par ce moyen obtenir des aides financières des collectivités locales, mais nos interventions demeurèrent sans effet. Alors, nous lançâmes une souscription publique qui nous rapporta en quelques semaines plusieurs dizaines de milliers de francs et alors l’impression du livre put commencer, mais dans des conditions tout de même difficiles en raison du mauvais fonctionnement du Groupe d’édition, lequel ne dura seulement que quelques années. Ses principaux responsables municipaux négligèrent les problèmes financiers à un point qu’à partir de 1988, pour mes ouvrages suivants, je décidai de faire cavalier seul, n’hésitant pas à engager mes ressources personnelles, solution qui me permit de réussir une “carrière” littéraire personnelle sans l’aide d’aucun organisme, mais par contre avec l’aide de milliers de souscripteurs passionnés par l’Histoire de leur ville natale.
Le 22 mai de l’année 1982, une présentation de l’ouvrage eut lieu publiquement dans les jardins de l’ancien Orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, où, d’après les journalistes, un millier de Seynois étaient venus pour écouter mes commentaires sur tous les aspects de la vieille école de nos ancêtres. Certains affirmèrent même que cette journée du 22 mai 1982 avait été une date historique pour la population seynoise.
 |
| Marius AUTRAN
simule une leçon de sciences naturelles lors de la
présentation au public seynois de son premier ouvrage : «
Histoire de l'École Martini », 22 mai 1982 |
L’ouvrage « Histoire de l’École Martini » fut vendu à 750 exemplaires en quelques semaines. Je ne m’attendais pas à un tel succès et, je dois l’avouer, à partir de ce jour, d’autres perspectives allaient bousculer ma vieille mémoire. A partir de l’histoire d’une école qui avait duré 176 ans, une multitude d’autres sujets allaient forcément apparaître, aspects auxquels les Seynoises et les Seynois ne seraient pas insensibles.
L’histoire d’une école m’avait conduit à parler des enseignants. Mais comment oublier les ouvriers ? Ceux des chantiers navals surtout ? Les paysans, dont La Seyne connut des centaines de familles, mériteraient bien qu’on parlât des tâches si ingrates de la terre. Les pêcheurs, si nombreux depuis les XVIIIe et XIXe siècles, eux aussi avaient été à l’origine de notre communauté. Alors, l’histoire de l’École Martini ne resterait pas sans lendemain.
L’année suivante, donc en 1983, le hasard voulut qu’au siège de notre philharmonique La Seynoise, j’eus la curiosité de consulter les archives de la société pour écrire sans doute un article de presse concernant l’art musical à La Seyne. Dans un placard, auquel personne ne semblait s’être intéressé depuis longtemps, je fis une découverte que l’on peut qualifier de sensationnelle : soigneusement alignés sur des étagères poussiéreuses se trouvaient des documents datant de plus d’un siècle, à savoir : les comptes-rendus de réunions de la Philharmonique, les programmes des concerts, les discours et correspondances des Présidents, la liste des exécutants musicaux, la composition des Bureaux, les relations avec les diverses formations musicales du département, etc.
Ayant effectué ses premiers balbutiements à partir des années 1830, sous la direction d’un passionné de la musique, Marius GAUDEMARD, pourquoi ne pas raconter la naissance de l’art musical à La Seyne, activité ô combien bénéfique, qui allait faire de La Seynoise la première structure artistique du Var et qui se manifesta même au plan national par sa place de 3e plus ancienne philharmonique de France ! Après avoir parcouru les documents d’archives de l’association, je pris aussitôt la décision d’écrire un second livre d’histoire locale qui s’intitulerait « Cent cinquante ans d’art musical – Histoire de La Seynoise ».
 |
J’éprouverais certainement moins de difficultés que pour le premier ouvrage pour la simple raison que j’étais en possession de documents écrits. Et aussi, n’avais-je pas connu plusieurs des Présidents et Chefs de musique : SILVY, AILLAUD, CASTEL, TALIANI,… La rédaction de cet ouvrage m’occupa pendant 3 mois seulement. Son succès dans la population fut tel qu’il fallut procéder à une seconde édition. Au total, 2 500 ouvrages furent vendus.
J’en avais offert un exemplaire à chacune des quarante philharmoniques varoises réunies en congrès départemental, également au Président de la Confédération Musicale de France, lequel ne fut pas insensible à ce modeste cadeau car, le 6 décembre 1987 [ou le 2 mai 1987 ?], je reçus en reconnaissance la médaille d’or de la Confédération Musicale, une distinction rarement accordée, paraît-il.
Les succès obtenus par ces premiers ouvrages d’histoire locale en appelèrent d’autres, très divers, qui composant une série dénommée “Images de la vie seynoise d’antan”, où seraient traités des récits à caractères bien locaux, des portraits de personnalités locales ayant œuvré avec profit pour la communauté seynoise, des souvenirs vivaces heureux, mais aussi douloureux, ayant jalonné l’histoire de notre cité depuis 1657, année de sa fondation officielle. Les sujets abondaient, et pendant les vingt années suivantes de ma retraite, la majeure partie de mes activités se focalisèrent sur la multitude des évènements, dont la plupart furent vécus par deux générations de mes anciens, et surtout la mienne, essentiellement au cours du XXe siècle.
L’année 1987 fut ainsi remarquable par la publication du premier tome de cette série “Images de la vie seynoise d’antan”, qui sera suivie, dès 1988 par la parution du second tome (voir ci-dessous).
Par la suite, Jean-Claude s’associa à cette tâche en faisant figurer les textes et les images de ma dizaine d’ouvrages sur le site internet qu'il créa à mon intention. Il faudra revenir sur la grande publicité que ce site m’apporta.
 |
| Mise en ligne
des 10 ouvrages de Marius AUTRAN sur le site internet dédié à Marius Autran |
En attendant, il me faut revenir sur la fin du XXe siècle, achevé depuis peu lorsque j’écris ces lignes, pour rappeler divers évènements de notre vie de retraité dont l’importance n’est pas négligeable.
Qu’on en juge !
En 1982 [vérifier], Louise fut opérée d’un cancer du sein : une tumeur importante, qu’elle avait dû négliger pendant trop longtemps de faire examiner, prit des proportions inquiétantes en quelques jours. Le Docteur Perrot, de la clinique du Cap d’Or, dut alors procéder à l’ablation du sein gauche. Malgré cette dure épreuve – sa quatrième opération chirurgicale – Louise surmonta une fois de plus le mal. Sa santé demeura encore robuste, mais, d’une année à l’autre, elle commença tout de même ) donner des signes de faiblesse.
Le 9 mars 1985, c’est moi qui dus subir l’opération de la prostate que m’avait conseillée le Docteur BALLATORE, l‘un de mes anciens élèves de l’École Martini. Ce fut le Dr MICHELON, spécialiste des voies urinaires, qui en fut chargé, un homme très affable, assisté de Mlle MASSON. C’était, pour moi aussi, la quatrième opération ! Je ressentis à peine quelques brûlures. Une semaine plus tard, je quittai la Clinique Mutualiste d’Ollioules et je pus aller cueillir des bottes d’asperges dans la forêt de Janas. Cet incident de parcours ne me causa aucun désagrément fâcheux.
C’est cette année-là, quelques mois plus tard, que je fis l’acquisition du joli petit bateau baptisé You-You, qui me procura des joies indicibles dans cette baie du Lazaret, encore riche en poissons blancs, rouquiers, mollusques et oursins. (Lire à ce propos mes articles parus dans la revue Posidonie, organe de liaison des membres de la S.N.P.M. (Société Nautique de la Petite Mer).
Ces journées de bonheur passées sur l’eau calme à récolter toutes les espèces comestibles furent tout de même contrariées par un événement dramatique, la disparition de Mémé GAUTIER (ma belle-mère), une femme adorable, au dévouement sans limite pour tous les siens. Veuve à 22 ans, son cher mari massacré dans la catastrophe du cuirassé Liberté le 25 septembre 1911, elle fit face courageusement au malheur, travailla d’arrache-pied pour élever sa fille Louise et lui donner une situation dans l’enseignement. Elle n’hésita pas pour cela à s’embaucher à la Pyrotechnie pour nettoyer les douilles d’obus qui revenaient du front de la guerre de 14-18, puis ç devenir couturière pour la Marine.
 |
| Louis GAUTIER
(1886-1911) et Mémé GAUTIER (1889-1986) |
Sa fille devenant mon épouse 20 ans plus tard, c’est elle qui éleva nos enfants, assura toutes les charges de notre famille (courses, cuisine, vaisselle, ménage, lavage du linge, entretien de la maison, etc.). Je ne dirai jamais assez tout le bien qu’elle nous rendit pendant 54 ans.
Sa disparition nous fit beaucoup souffrir. Depuis plusieurs années, allé était handicapée par sa mauvaise circulation sanguine, qui lui avait causé une plaie variqueuse, jusqu’au jour où se déclencha une hémorragie génératrice de la gangrène. D’urgence, il fallut la transporter à la Clinique Mutualiste d’Ollioules. Mais sa jambe ne put être sauvée, hélas ! Après l’amputation, elle survécut encore une quinzaine de jours, mais l’anurie se produisit. Elle expira au soir du 15 septembre 1986. Elle allait avoir 97 ans ! Et elle avait même vu son arrière petit-fils Rémy obtenir son baccalauréat ! Ses obsèques furent célébrées très dignement. Le Président de l’A.R.A.C. (Association Républicaine des Anciens Combattants) lui fit l’honneur de couvrir son cercueil du drapeau tricolore (Mémé GAUTIER, en tant que veuve de guerre, appartenait à l’Association et en était d’ailleurs la doyenne).
Une page des plus douloureuses de notre histoire familiale venait de se tourner.
Deux ans plus tard, Fernande MEUNIER, sœur de Mémé GAUTIER, disparut à son tour dans des conditions tout de même moins dramatiques. Elle aussi avait connu, comme sa sœur, les conditions d’une enfance et d’une jeunesse difficiles. Elle aussi avait travaillé à la fameuse Pyrotechnie pendant la guerre de 14-18 à nettoyer des douilles d’obus à l’acide. Jusqu’au jour où elle connut Louis MEUNIER qu’elle épousa. Louis, un ouvrier vigoureux, intelligent, entreprenant, dont il est nécessaire de rappeler le parcours glorieux.
Louis décéda le 13 mai 1970, alors qu’il rentrait de la pêche à Saint-Elme. Il mourut sur son bateau qu’il venait tout juste d’amarrer d’un infarctus du myocarde, dont il avait déjà reçu deux avertissements quelques années auparavant. Il était né à Béziers, issu d’une famille ouvrière qui avait en fait ses origines à La Charité-sur-Loire (Nièvre). Citoyen attachant par son caractère jovial, sa générosité, son dévouement aux autres, il souffrit beaucoup de la misère dans sa jeunesse et son adolescence.
Mobilisé en 1914, il fit la guerre en Champagne, puis envoyé au Moyen-Orient, il participa aux combats de la Macédoine, y contracta la dysenterie comme beaucoup de ses camarades, mal causé par des conditions d’hygiène épouvantables qui obligea le commandement à rapatrier de nombreux soldats.
La guerre finie, il entra comme chaudronnier aux chantiers de construction navale de La Seyne, puis de La Ciotat, puis dans certaines entreprises de Marseille. Dans sa vie professionnelle, il devint un grand spécialiste du chauffage central, de sorte que ce fut lui qui fut désigné par une grosse entreprise pour diriger l’installation du chauffage central du paquebot Normandie, alors en construction à Saint-Nazaire, une référence hors du commun.
Syndicaliste acharné de la C.G.T., militant communiste, il fut un animateur incomparable de la vie associative seynoise, fonda le Moto Club Seynois où son fils “Loulou” se distingua brillamment en devenant un champion international. Louis participa également à la Résistance locale et fut même conseiller municipal à titre transitoire dans la municipalité d’après la Libération présidée alors par le Docteur Sauvet.
J’ai gardé de Louis MEUNIER le meilleur souvenir des années vécues ensemble dans la même maison du quartier Touffany entre 1938 et 1944 ; souvenirs inoubliables des parties de pêche dont Louis ne revenait jamais bredouille ; souvenirs des matches de moto-ball à la Canourgue, ou autres spectacles d’animation qui faisaient la joie de la population seynoise.
 |
| Louis MEUNIER
père (1892-1970) Président-fondateur du Moto-Club Seynois |
Revenons à ma vie personnelle dont je me suis passablement écarté.
Mes opinions politiques n’avaient pas changé, mais il fallait bien se rendre à l’évidence : les hommes politiques que je défendis autrefois avec ferveur me décevaient de plus en plus. A mon avis, je les vis évoluer dangereusement vers l’opportunisme. La nouvelle génération du Parti communiste recherchait avant tout des avantages personnels. Les communistes seynois, depuis l’hôtel de ville, pourtant conquis de haute lutte contre des gens méprisables, faisaient de plus en plus de mal à leur Parti ; les syndicalistes surtout, toujours à la recherche de revendications démagogiques. Et, de plus, le bon exemple ne venait plus des pays de l’Est, où le népotisme commençait à décevoir profondément les masses. La Russie elle-même (ce n’était plus l’Union soviétique) donnait des signes de décadence économique. Alors que STALINE amena ce pays au peuple si courageux à nous débarrasser de l’hitlérisme, ses successeurs finirent par conduire à la défaite le noble idéal qui avait tout de même triomphé pendant 70 ans.
A mon avis, le P.C.F. fut trahi par ses principes mêmes. Mais je ne veux pas me livrer ici à des analyses politiques, un volume entier serait nécessaire.
J’avais abandonné la municipalité en 1977 mais j’attendis tout de même 1985 pour quitter le Parti communiste qui allait vers une perte certaine. Ce qui arriva dans cette période néfaste où la municipalité fut prise par les partis de la Réaction.
 |
| Les
dernières cartes de membre du Parti communiste de Marius AUTRAN La série s'arrête en 1984. On note que sur celle de 1979, il avait déjà écrit : “la dernière” |
Mais, dans cette période, toutes mes activités se ralentissaient aussi en raison de l’âge qui m’incitait à me mettre de plus en plus “sur la touche” avec toutefois quelque amertume car, pour reprendre une expression d’Athalie, j’avais beau essayer « de réparer des ans l’irréparable outrage », j’y parvenais de moins en moins. Certes, mes multiples passages dans les cliniques ou hôpitaux (appendicite en 1950, hernies inguinales en 1952 et 1956, prostate en 1985) ne m’avaient jamais beaucoup affectés car, à chaque fois mes séjours avaient été de courte durée. Mais ma santé allait maintenant s’altérer en raison de problèmes de rhumatismes, d’arthrose, de lombago et, pendant les années qui vont suivre, il m’aura fallu subir des séries de piqûres, de massages, avaler de nombreux médicaments, bien peu efficaces d’ailleurs ! Mais, comme on dit : « Il faut faire avec ».
 |
| En 1989, Marius AUTRAN fait encore des conférences dans les écoles sur le bicentenaire de la Révolution française |
 |
| Marius AUTRAN
vers 1990, rue Cyrus HUGUES |
Dernière décennie du XXe siècle
La vie s’était bien simplifiée pour moi. La vie associative ne m’occupait plus guère. Louise et moi menions une vie quasi monastique. Je signale en passant que me fut remise le 3 mars 1990 par l’Office Municipal des Sports une médaille d’or en récompense de l’initiative que j’avais prise par la fondation de la Société Nautique de la Petite Mer (S.N.P.M.). J’en étais le Président d’Honneur et pendant une quinzaine d’années, je fus l’auteur de nombreux articles de la revue Posidonie.
L’année suivante, le 18 septembre 1991, j’avais contribué à la création d’une association nouvelle : “L’Amicale des Anciens Élèves de l’École Martini” (A.A.E.E.M.). J’avais refusé des responsabilités en raison de mon âge, mais accepté tot de même la présidence d’honneur. Cette amicale, dirigée par d’anciens élèves, dont Gilbert MARRO, REVERTEGAT, PELEGRIN, Robert GIL et bien d’autres, fut à l’origine de l’organisation de nombreux voyages, à l’étranger surtout. Elle eut surtout des activités de loisirs.
 |
| Marius AUTRAN, Président d'honneur de l’Amicale des Anciens Élèves de l’École Martini |
L’année 1990, le 1er mai, fut marqué par un événement capital dans ma vie familiale : la venue au monde de mon troisième petit-fils, Jean-Robert AUTRAN, fils de Jean-Claude et de Yolande MASSOL, ma seconde belle-fille, qui nous apporta de grandes satisfactions à tous égards, et dont je reparlerai abondamment plus loin.
La dernière décennie de ce XXe siècle agonisant fut marquée surtout par des questions familiales, les unes réjouissantes, les autres dramatiques.
Le 28 mars 1992, nous décidâmes, Louise et moi, de célébrer nos 60 ans de vie commune ; nos invités furent conviés à un banquet imposant commandé au Novotel à la limite La Seyne – Ollioules. Un document à ce sujet a été rédigé, abondamment illustré de photos, de poèmes, de la liste de tous les participants. On chanta, on récita, on rit beaucoup. Aux familles AUTRAN, MEUNIER, LOTTO, MASSOL, BAGLIOTTO, GANZIN, se joignirent nos amis les plus chers : PASSAGLIA, PONS, ARÈSE, BALLATORE, JOUVHOMME, JOUVENCEAU, CIAMPI, SÉNÈS (et j’en oublie peut-être). Une formation musicale composée uniquement de jeunes saxos de La Seynoise se distingua particulièrement par l’exécution de pas redoublés de musique classique sous la direction du professeur de saxos, M. GAY.
 |
 |
| Noces de Diamant de Marius et Louise AUTRAN, 28 mars 1992 |
 |
| Marius AUTRAN en
1992 |
Nous reçûmes en cadeaux des fleurs, des arbustes, des objets d’art, bref, nous fûmes comblés de toutes les façons. Hélas ! Il y manquait des êtres chers disparus.
Le compte-rendu de cette cérémonie à caractère essentiellement familial fut par la suite adressé à toutes les familles ayant participé à ces agapes. Nos descendants, et ils seront nombreux, seront heureux de monter aux générations montantes un bel exemple de ce qui fut pour nous une vie familiale solide et durable. Il me faut dire pour être objectif que celle de Jean-Claude a été quelque peu tumultueuse puisqu’il lui a fallu se séparer de sa première épouse pour des raisons que je n’évoquerai pas dans ce texte.
Quelques années auparavant, Jean-Claude s’était lié d’amitié avec une nouvelle secrétaire de son laboratoire de l’I.N.R.A. à Montpellier, dénommée Yolande MASSOL et issue d’une famille très honorable dont le père travaillait lui-même au service de l’AGRO de Montpellier comme jardinier professionnel.
Cette amitié avec
Yolande se concrétisa le 1er mai 1990 avec la naissance à
Montpellier de mon troisième petit-fils, Jean-Robert,
mentionné plus haut, naissance suivie quatre ans plus tard, le 8
janvier 1994, par celle de Pierre-Olivier.
 |
| Robert MASSOL et
Marius AUTRAN, les deux grands-pères, le jour du baptême de leur petit-fils Jean-Robert à Montpellier (août 1990) |
Il était temps de régulariser leur situation d’union libre. C’est pourquoi, après la naissance de leur deuxième enfant, ils décidèrent de se marier. Cette cérémonie eut lieu à Lédergues (Aveyron) le 15 juillet 1994, à proximité du hameau des Vialettes, où Jean-Claude et sa famille passaient la majeure partie de leurs vacances dans la maison de campagne de la famille MASSOL. Yolande veille jalousement à l’entretien de cette propriété, dont elle espère un jour devenir propriétaire, à la condition, naturellement d’avoir pu conclure un arrangement de famille avec notamment sa sœur et son frère.

|
| Mariage de
Jean-Claude et
Yolande à Lédergues, 15 juillet 1994 De gauche à droite, Robert et Georgette MASSOL, Jean-Claude AUTRAN, Yolande MASSOL, Marius et Louise AUTRAN |
Autrement dit, Jean-Claude avait réussi à reconstruire sa famille après quelques années d’incertitude. Ses fils aînés ont réussi à se faire aussi leur place au soleil, Rémy comme biologiste dans la région parisienne, Nicolas dans des entreprises d’informatique, I.B.M. et autres, à Toulon, Paris, puis dans les Deux Sèvres.
Après les heures de liesse de l’année 1992 commencèrent des années dramatiques, sans doute les plus douloureuses de toute mon existence.
Le 4 mai de cette même année, à la Clinique du Cap d’Or, Louise fut opérée d’une varice énorme, qui nécessita aussi la suppression d’une veine cave inférieure. Tout se passa normalement car elle fut immobilisée quelques jours seulement. Le chirurgien lui avait recommandé de marcher le plus possible. Elle n’en fit rien, s’obstinant à rester à la maison, dans son fauteuil où elle ne souffrait pas. Elle vivotait, heureusement bien secourue par Josiane CIAMPI, notre jeune femme de ménage, à notre service depuis près de 10 ans. Elle trottait un peu dans la maison, d’où elle ne voulut plus du tout sortir, de sorte que ses problèmes circulatoires ne pouvaient guère s’améliorer.
Le samedi 9 décembre de l’année 1995, elle fit une chute dans le couloir, alors que je m’étais absenté pour une simple demi-heure [pour assister aux obsèques du docteur Sauvet*. Elle avait en plus commis la maladresse de s’enfermer à double tour de clé. A mon retour, je l’entendis gémir, sans pouvoir lui porter secours, n’ayant pas de clé pour ouvrir la maison. Je sautai chez mon voisin Jouvhomme pour téléphoner aux pompiers de la ville, qui brisèrent un carreau pour pouvoir entrer dans l’appartement. On la remit sur pied et on l’installa dans son fauteuil. Le Docteur Ballatore fut heureusement chez nous en quelques minutes, mais il conclut à une fracture de l’épaule droite. On devine la suite : hospitalisation, radios, qui conclurent à un déboîtement de l’épaule et fracture de l’humérus droit.
* Erreur.
Il ne s'était pas absenté pour cette raison. Il assistera
aux obsèques du Docteur SAUVET (décédé le
19 décembre), le 21 décembre, le jour où
précisément Louise sort de l'hôpital. Il la laisse
seule le temps des obsèques, ne voulant à aucun prix
manquer à ce devoir, en reconnaissance de ce que ce Docteur
avait fait pour notre famille [dans les conditions
particulièrement difficiles de l'accouchement de Louise en 1944,
Jean-Claude n'aurait pas survécu sans l'intervention hardie du
jeune Docteur SAUVET].
Elle ne put quitter l’hôpital que le 21 décembre et reprit un petit train-train à la maison. Mais, le plâtrage de l’humérus n’ayant pas été possible dans sa partie supérieure, elle vivait avec une attelle et demeurait fortement handicapée. Fort heureusement, je disposais de beaucoup de temps pour m’occuper d’elle, ayant cessé presque complètement toutes mes activités d’autrefois.
Mais, le 26 janvier 1996, la maladie avait pris un tel empire sur Louise, qu’elle commença à s’étouffer dans la nuit et qu’il fallut de nouveau la transporter d’urgence à l’hôpital de la Seyne, à 4 heures du matin* sur les instances du docteur BALLATORE, notre voisin du quartier Châteaubanne.
Des soins intensifs lui furent prodigués, en vain. L’œdème du poumon, retardé grâce à l’oxygène, faisait tout de même son œuvre et ma chère Louise expira le 6 février 1996 vers 21 heures. Appelé d’urgence à l’hôpital, j’arrivai à son chevet alors qu’elle avait perdu son âme quelques minutes avant mon arrivée, alors que je ne l’avais pratiquement jamais quittée depuis le 26 janvier.
Inutile de décrire les moments terribles que l’on traverse en présence de malheurs de cette taille – des malheurs déjà éprouvés dans ma vie, certes, mais toujours aussi douloureux quand ils se renouvèlent.
Son corps ne me fut rendu que le lendemain après une nuit passée à l’Athanée, car les hôpitaux d’aujourd’hui ne gardent plus les cadavres, n’étant plus équipés de chambres froides.
Au matin du 7 février, Louise reposait dans on lit de la maison de Châteaubanne, où elle allait passer ses deux dernières nuits. Toutes les formalités accomplies, nous reçûmes Jean-Claude, Yolande et de nombreuses visites. Mon ami OUSTRIÈRES mentionna dans la presse locale son décès, exprima à la famille ses condoléances sincères.
Les obsèques eurent lieu le 9 février, où Louise alla retrouver son père, sa mère, son fils aîné Robert, mon père et ma mère.
 |
| Tombe de la
famille AUTRAN-GAUTIER, allée 29 sud au cimetière de La Seyne |
Et voilà comment disparut la compagne de toute une vie, une orpheline qui ne connut pas son père, enterré le 3 octobre 1911, alors qu’elle naquit le 5 octobre. Louise fut élevée avec le plus grand soin par sa mère, qui lui donna une solide instruction, lui permit de devenir institutrice, puis professeur, une mère qu’elle ne quitta jamais toute sa vie durant ; une fille qui devint mon épouse en 1932 et fut la compagne pendant 64 ans de ma vie, une fille incomparable par son dévouement et sa vive intelligence, une enseignante de haute qualité dont les élèves, garçons et filles, ont gardé d’elle un souvenir des plus attachants.
Le lendemain de ce terrible 9 février, je me retrouvai seul, ou presque, car j’eus tout de même le réconfort de Josiane, ma femme de ménage au dévouement inlassable et dont je ne dirai jamais assez les services éminents qu’elle m’a rendus, ce qu’elle continue à faire de nos jours, sept ans après la disparition de Louise.
Louise avait tout de même apprécié une retraite qui dura plus de 32 années. Elle avait éprouvé de grande joies en voyant son fils refaire sa vie avec une épouse équilibrée qui lui donna deux autres fils adorables : Jean-Robert, qui naquit le 1er mai 1990 et Pierre-Olivier, le 8 janvier 1994, tous deux robustes et se révélant aujourd’hui comme des enfants intelligents, capables d’assurer leur avenir.
Il fallut par la suite, l’administration ne perdant jamais ses droits, procéder à la succession de nos biens : actes notariés, certificats de propriété, partage de l’épargne,…
La chose fut bien simplifiée par le fait que l’argent des livrets de Caisse d’Epargne de Louise (…) fut distribué par mes soins à tous mes héritiers, à savoir Jean-Claude, Yolande, Rémy, Nicolas, Jean-Robert et Pierre-Olivier. Jean-Claude hérita aussi de la part de sa mère de la maison de Châteaubanne et je fis deux ans plus tard le nécessaire pour lui attribuer la mienne, n’en conservant que l’usufruit. En effectuant tous ces dons, j’eus une immense satisfaction intérieure en me disant sans cesse : « Si Louise savait tout ça, comme elle serait satisfaite ! ».
L’année suivante, le 14 août 1997, fut réglé le sort de la propriété de Bastian. Par acte notarié rédigé chez Me Porcel, je fis don à Jean-Claude des 3 000 m2 de cette terre, devenue peu à peu inculte, mais ayant acquis avec le temps, surtout avec l’accroissement des valeurs immobilières, une valeur très estimables de nos jours.
L’avantage de toutes ces opérations effectuées sciemment serait pour mon unique héritier de n’avoir plus à payer de droits de succession. Rappelons au passage que la succession de Louise m’avait imposé de plus de 22 millions d’anciens francs et que la donation de Bastian - à mon fils - m’avait encore coûté une taxe d’une dizaine de millions d’anciens francs, ce qui m’a donné souvent l’occasion de dire que les gouvernements de la République sont dirigés par des voleurs.
Pour changer de sujet, mais sûrement pas en compensation des désagréments que je viens d’évoquer, je reçus le 17 janvier 1997 la médaille d’honneur de la ville de La Seyne pour avoir servi, à titre bénévole, les intérêts de ma ville natale pendant près de 30 ans (une médaille représentant le “coq gaulois” est attribuée aux élus ayant accompli au moins 25 ans au service d’une collectivité territoriale). Un honneur supplémentaire ! Passons !
Après le deuil de 1996, j’allai connaître une joie nouvelle : la naissance d’un cinquième petit-fils, Jean-Victor, le 3 novembre 1998, et que Louise n’aura donc pas connu. Lui aussi, comme ses deux frères aînés, né à Montpellier.
 |
| Marius AUTRAN et
ses trois derniers petits-fils |
La dernière année du XXe siècle fut encore une année douloureuse avec la disparition de Loulou MEUNIER (cousin germain de Louise), fils de Louis MEUNIER, décédé près de 20 ans auparavant, et de Fernande MEUNIER, née MATHIEU. Pendant une grande partie de sa vie, Loulou souffrit du diabète, et fut obligé de se piquer à l’insuline durant des dizaines d’années. L’on s’est toujours demandé pourquoi, car ce mal n’avait jamais été constaté, même chez ses ancêtres les plus lointains.
 |
| Loulou MEUNIER
(1918-1999) |
Loulou, fils unique, fut choyé par ses parents et sa grand-mère Madeleine Mathieu, née MARTINENQ. De bonne heure, il fréquenta l’École François Durand (Émile MALSERT aujourd’hui), puis l’École Martini qu’il quitta après la classe de 3e pour affronter un concours d’apprentis à l’Arsenal de Toulon. Militant actif du Parti communiste et de la C.G.T., il fut arrêté le 17 mars 1942 par la police toulonnaise avec 16 autres militants. Je fus le 17e de la fournée, pour la simple raison que j’habitais dans la même demeure que Loulou au quartier Touffany. J’ai raconté mon séjour à la prison maritime, tandis que Loulou fut transféré à la centrale d’Eysses (Lot et Garonne) sous la surveillance étroite des Allemands. Il faillit être déporté en Allemagne quand, fort heureusement, la guerre prit fin. Il avait participé à la fameuse mutinerie de la centrale d’Eysses après laquelle plusieurs détenus furent fusillés. Libéré, il retrouva son poste de chaudronnier à l’Arsenal de Toulon et reprit ses activités politiques et syndicales. Il devint ensuite conseiller municipal dans les municipalités de Toussaint MERLE et de Philippe GIOVANNINI, ainsi que membre du comité directeur de l’Office H.L.M.
Durant les deux années avant sa mort, le diabète avait pris un tel empire sur lui qu’il perdait peu à peu la vue. Puis, des complications internes le contraignirent à garder la chambre, puis des abcès le firent terriblement souffrir. Le 2 avril 1999, il expira dans des souffrances atroces et, suivant sa volonté, il fut incinéré et ses cendres reposent aujourd’hui sur le cercueil de sa mère Fernande dans notre cimetière communal.
L’an 2000 s’ouvrit donc sous de sombres auspices. Je contractai une broncho-pneumonie sans avoir commis la moindre imprudence. Ce mal, qui se manifesta par une fièvre légère et une fatigue générale, m’obligea à garder la chambre 18 jours. Je crois bien que ce fut la première maladie sérieuse de ma vie. Même la grippe espagnole de 1918 ne m’avait éprouvé que seulement une semaine. Les radios à la clinique ne donnèrent que des résultats négatifs. La dose d’antibiotiques que l’on m’avait administré n’avait-elle pas été excessive ? Je le crois sincèrement. Depuis, la médecine n’est-elle pas plus perplexe en matière d’antibiotiques ? Enfin, cela n’est plus qu’un mauvais souvenir.
A partir du mois de février, je repris mes activités habituelles, en ralentissant toutefois leur cadence, surtout celles relatives à la vie associative.
J’allais de moins en moins aux réunions d’associations. C’étaient parfois leurs représentants qui venaient chez moi enregistrer des cassettes sur des sujets d’histoire locale. Je fus ainsi filmé deux ou trois fois pour la télévision dans le cadre de l’émission “Vaqui”.
 |
| Retrouvailles entre Henri
TISOT et son vieux maître Marius AUTRAN, après 20 ans
où ils ne s'étaient plus revus (Sanary, 21 août 2001) |
En 2001 et aussi 2002, j’entretenais encore mon petit potager de Châteaubanne avec des récoltes de pommes de terre, de tomates, de haricots verts, de fèves, d’artichauts, de salades, etc. Qu’en sera-t-il en 2003 ? Je commence à en douter.
J’ai tout de même encore participé à une vingtaine de manifestations ou de rencontres à caractère historique. J’ai reçu des élèves, des étudiants désireux de présenter des thèses ou des mémoires sur des sujets forts divers (parcs à moules, anciens lavoirs, grues de chantiers,…).
Ma vie intellectuelle avait été relativement intense avec la publication, depuis 1987, des 8 tomes de ma série “Images de la vie seynoise d’antan”. Le 8e et dernier fut édité en 2001. J’avais 91 ans ! Comme les précédents, il traitait de sujets diversifiés tels que les biographies de personnalités seynoises disparues, les problèmes de l’immigration, l’artisanat seynois, etc.
Pour
mes 90 ans, le 2
décembre 2000, je fus invité chez Jean-Claude et Yolande
à Montpellier, et un repas d'anniversaire eut lieu à La
Grande Motte en présence de mes 5 petits-fils.
 |
| Les 90 ans de
Marius AUTRAN à Montpellier Avec son fils et ses 5 petits-fils (7 AUTRAN sur la même photo) De gauche à droite : Jean-Victor, Jean-Claude, Nicolas, Pierre-Olivier, Marius, Jean-Robert, Rémy |
A cette occasion, parmi les nombreux cadeaux que je reçus, Jean-Claude s’était mis en tête de créer un site internet consacré principalement à mon œuvre littéraire et historique. Il y a parfaitement réussi. En voici le plan, dont les visiteurs s’accordent à dire qu’il est fort bien fait.
Tous ces ouvrages ont été réalisés grâce à des souscriptions publiques et je me dois de remercier les milliers de mes concitoyens, de mes amis nombreux, de mes anciens élèves, qui ont eu le vif désir de les posséder dans leur bibliothèque personnelle.
Les deux associations à caractère culturel avec lesquelles j’entretiens encore aujourd’hui des relations régulières sont, d’une part, Histoire et Patrimoine Seynois, présidée par Yolande Le Gallo, professeur au lycée Beaussier et, d’autre part, l’association Les Relais de la Mémoire, fondée par Paule Giloux, institutrice retraitée.
 |
| Marius AUTRAN,
photo de l'interview par l'association Histoire et Patrimoine Seynois |
J’ai reçu plusieurs fois la visite de la nouvelle responsable du Service Culturel Municipal appelée Carole GRAGEZ (remplaçante de François MATTÉOLI, mutée à Clermont-Ferrand).
A différentes reprises, j’ai eu des contacts avec les responsables de l’association Contrat de Baie (Paul PIGNON).
Jusqu'à ce jour, ma présence a été effective à tous les concerts de la philharmonique La Seynoise, dont je suis Président d’honneur, à une conférence de Jean Sprecher à Tamaris et à l’exposition sur “La Résistance varoise”.
 |
| Marius AUTRAN,
Président d'honneur de La
Seynoise
pendant son allocution, 2 décembre 1990 (le jour de ses 80 ans
!), à l'issue du concert de Sainte-Cécile et des
fêtes ddu 150e anniversaire de la philharmonique |
En 2002, j’ai rédigé une biographie de mon grand-père Auguste AUTRAN, suivie de celle de mon père, Simon AUTRAN, lesquelles seront jointes à ce document final : Biographie de Marius AUTRAN.
Nos descendants s’y intéresseront-ils ? Je le souhaite, bien sûr.
Depuis mars 2002, Jean-Claude se préoccupe de préparer sa retraite, qu’il compte prendre dans sa propriété de Bastian, dont je lui ai fait donation. Je crois avoir expliqué précédemment que mon désir était de lui éviter d’avoir à payer des droits de succession après ma disparition.
Le permis de construire d’une importante maison a été déposé a été déposé en Mairie et obtenu quelques mois plus tard. Un grand mur de clôture en bordure du chemin de La Seyne à Bastian a été édifié de manière à limiter les bruits de la route, devenus de plus en plus intenses. Puis, il fallut se préoccuper d’installer un grand portail, d’effectuer les branchements de l’eau, de l’assainissement, une boite aux lettres, etc. Jean-Claude a aussi jugé bon de faire effectuer un forage au milieu du terrain pour avoir de l’eau à lui pour l’arrosage de son futur potager et n’avoir pas à payer l’eau nécessaire à la construction de sa maison d’habitation.
La construction du mur avait nécessité l’arrachage des 100 cyprès que j’avais plantés en 1942 - arbres devenus énormes, faute de taille et d’entretien depuis de nombreuses années – travail qui a duré plusieurs semaines. Jean-Claude, aidé de son voisin Grisoul, a réalisé un travail énorme, grâce à sa robuste constitution. Avant la fin de cette année, la construction de cet immeuble devrait démarrer.
 |
| Jean-Victor,
Pierre-Olivier, Yolande et Marius AUTRAN à Bastian, en 2003, avant la construction de la nouvelle maison |
Et nous voici en 2003. A vrai dire, à partir de l’an 2000, que j’ai appelée pour moi l’année de mon déclin, explicable par mon handicap qui s’aggrave de jour en jour, je ne pouvais plus attendre grand-chose de positif de la vie.
Me trouvant seul devant mon assiette, il me fallut tout de même réagir pour vaincre l’adversité. Je pense y avoir réussi en multipliant les activités à la fois physiques et intellectuelles. Mes efforts se sont portés vers le jardin de Châteaubanne, duquel je continuais à tirer quelques récoltes de légumes et de fruits aussi. On pourra retrouver dans mes agendas quotidiens, dans mes “Cahiers du retraité” aussi, des statistiques significatives relatives à mes récoltes, certes bien modestes par rapport à celles des années soixante à quatre-vingts. Mais la sagesse m’avait appris à me satisfaire de peu de choses, à réduire le niveau de mes ressources agricoles, à apprécier les choses les plus simples. Car mes problèmes de santé ne s’arrangent pas. Aux rhumatismes et à l’arthrose s’ajoutent maintenant des difficultés à me déplacer : mes jambes ne me portent plus. Toutes les séries de massages ou de cures de drogues diverses s’avèrent bien peu efficaces. Et mes journées et mes semaines passent néanmoins, inexorablement.
La lecture me prend beaucoup plus de temps qu’autrefois. Je m’efforce de faire chaque jour un mot croisé et je parviens à écrire encore à peu près correctement. Je ne suis pas à plaindre, loin s’en faut. Que puis-je souhaiter ? Ma santé chancelante, il est vrai, me permet tout de même d’apprécier un apéritif, une cigarette, alors que la plupart de mes camarades d’enfance, hélas ! ont pris le chemin du cimetière.
| 95e anniversaire
de Marius AUTRAN, aevc son fils et ses trois plus jeunes petits-fils |
Je sais fort bien que mon tour viendra. Mais après avoir tout de même profité d’une retraite depuis bientôt trente-sept ans… Bien sûr, j’éprouve toujours quelque amertume à la pensée que Louise n’est plus à mes côtés. Son destin en a décidé autrement et, plus cruellement encore, l’idée que notre fils Robert nous a quittés il y aura bientôt 67 ans, m’est difficilement acceptable. Nous ne pouvons que supporter les rigueurs du destin et il en est ainsi pour tous les êtres humains.
L’année 2003 ne nous laisse présager rien de bon pour le proche avenir. Ce n’est certes pas pour moi un sujet d’inquiétude. Mais que deviendront mon fils, sa femme, leurs enfants Jean-Robert, Pierre-Olivier et Jean-Victor dans ce monde fou menacé des pires catastrophes ? Et Rémy ? et Nicolas ?
Conclusions
Puis-je tirer des conclusions après la rédaction de cette autobiographie ? Oui, certes, pour dire que ma longue vie a été jalonnée d’évènements heureux et d’autres aussi, très douloureux. Ces derniers ont pris des formes très diverses mais les plus marquants ont été les deuils de familles les disparitions parfois brutales comme celle de mon fils Robert et de ma mère accidentée mortellement, de mon père atteint d’un mal incurable. Parmi les pertes cruelles auxquelles nous étions tout de même avertis, j’ai vu mourir mes grands-parents, mes oncles, des cousins, dont les disparitions laissèrent toujours un grand vide. Mais on doit à la vérité de dire que ce grand maître qui est le temps, et aussi l’égoïsme dont nous sommes pétris, nous ont toujours permis de surmonter les épreuves les plus dures. Rappelons au passage Victor Hugo : « L’un n’a-t-il pas sa barque et l’autre sa charrue ? ».
Je me résume. Les volets de mon existence ont pris les formes les plus inattendues.
Mon enfance de fils unique, gâté, dorloté, à qui rien n’a jamais manqué : nourriture, distractions, jouets, amusements, voyages.
Je fus élevé dans le respect des valeurs morales. Je fus instruit correctement dans ma vie scolaire, à l’École Laïque, École de la République, qui a fait de moi un citoyen averti, un patriote qui a fait tout son devoir sur les champs de bataille, un défenseur efficace de l’idéal de justice sociale, de liberté et de fraternité humaine, un élu républicain au service de ses concitoyens, un éducateur d’élite aux dires de ses anciens élèves.
Sans avoir été un héros, ma vie professionnelle a été sans reproche, les distinctions honorifiques que j’ai reçues l’ont prouvé.
 |
| Le
médaillier de Marius
AUTRAN 1 - Croix de Guerre (1939-1945), 2 - Palmes Académiques (officier) ; 3 - Médaille de combattant volontaire de la Résistance ; 4 - Médaille des évadés ; 5 - Médaille des Collectivités Locales ; 6 - Croix du combattant ; 7 - Médaille d'honneur de la Confédération des Musiques de France ; 8 - Palmes Académiques (chevalier) ; 9 - Médaille de l'Association Républicaines des Anciens Combattants ; 11 - Médaille de la Guerre 1939-1945. [NB. La 10 correspond aux Palmes Académiques de Louise AUTRAN et la 12, à la médaille Maroc 1909 de Louis GAUTIER] |
Ma vie familiale a été équilibrée et le foyer fondé en 1932 est resté sans faille pendant plus de 60 années.
Ma vie politique a duré 30 années au service de mes concitoyens, à titre absolument bénévole, soit comme conseiller municipal, soit comme adjoint au Maire, soit comme conseiller régional.
Ma vie associative m’a conduit à une multitude de présidences d’honneur (Philharmonique La Seynoise, Amicale des Anciens Élèves de l’École Martini (A.A.E.E.M.), Association Républicaines des Anciens Combattants (A.R.A.C.), Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance (A.N.A.C.R.), Société Nautique de la Petite Mer (S.N.P.M.), Office Municipal de l’Action Sociale et Educative (O.M.A.S.E.), Groupe de Recherche-Action sur l’Identité des Habitants de La Seyne-sur-Mer (G.R.A.I.C.H.S.).
 |
| Dernière
sortie publique de Marius
AUTRAN, avec le Dr Arthur PAECHT, Maire de La Seyne-sur-Mer, lors de la
remise de la Médaille d'Honneur de la ville à Gilbert
MARRO, Président de la Société Nautique de la
Petite Mer (Hôtel de ville de La Seyne, 12 mai 2006) |
Et je pourrais aussi évoquer un volet militaire (officier de réserve, sous-lieutenant, lieutenant), avec plusieurs périodes dans les Alpes-Maritimes avant la Seconde Guerre Mondiale.
Cette énumération peut-être fastidieuse ne doit pas faire oublier que je n’ai jamais cessé de cultiver mon jardin potager de Châteaubanne, mon verger et ma vigne du quartier Bastian, ni mes innombrables parties de pêche dans la baie du Lazaret ou vers le Cap Sicié.
S’il y a des gens qui s’ennuient à la retraite, ce ne fut certainement pas mon cas !
Si ma vie professionnelle a été une réussite, ma vie de retraité m’a apporté des joies indicibles, des joies d’autant plus vives que j’ai su joindre à l’agréable un aspect lucratif non négligeable (voir mes “Cahiers du retraité”). Le temps libre m’a permis de récolter, de conserver, de consommer, je dirais presque à discrétion, des légumes, des fruits, des produits de la pêche et de la chasse. Les statistiques de mes archives l’attestent. Que de repas gratuits, de grillades, d’entrées, de rôtis, de desserts sont venus sur la table à peu de frais, nous permettant des économies substantielles. Ça s’appelait joindre l’utile à l’agréable.
Il me faut terminer mes bavardages, dont j’espère que mes descendants tireront quelques leçons. Jean-Claude suivra sans doute l’exemple que je lui ai donné et qu’il saura tirer le meilleur parti de mes lopins de terre dont il a hérité avant ma disparition de la vie terrestre.
Reste quand même dans mes conclusions des points sombres que je ne veux pas noircir, mais l’humanité est pour moi de plus en plus décevante à plusieurs titres. Les pires dangers persistent dans les rapports entre les individus, entre les races humaines, les nationalités, les civilisations, les religions qui n’arrangent rien dans ces problèmes, où la violence, l’intolérance ne font que croître et embellir. La guerre, les guerres restent toujours les plus grands fléaux de l’humanité. L’être humain a effectué des progrès spectaculaires dans les domaines de la science et de la culture, mais il faut bien constater que les progrès réalisés sont toujours au service du mal, de l’égoïsme, des profiteurs, des aventuriers, des arrivistes, des grands possédants, des puissances d’argent, tous capables de déclencher des conflits locaux ou généralisés.
Il n’est pas inutile de relire des documents écrits depuis des siècles par de grands visionnaires comme Marx, Engels, Jaurès, Guesde, Lénine et bien d’autres, pour s’apercevoir que leurs idéaux sont toujours d’actualité et ce ne sont pas les théories sur la mondialisation dont on nous abreuve qui régleront les fringales du capitalisme d’aujourd’hui. Rappelons la célèbre phrase de Jaurès : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ».
Une superpuissance, les U.S.A., dont les dirigeants sont richissimes, s’arroge maintenant tous les droits au mépris des grandes instances internationales comme l’O.N.U. Elle déclenche des guerres, conquiert des bases stratégiques où bon lui semble. Exemples récents : la guerre du Golfe, la guerre au Moyen-Orient, la guerre d’Afghanistan, peut-être demain une guerre d’Irak.
Les peuples sont manipulés, méprisés. Les problèmes de l’immigration demeurent sans solution. Les religions n’apportent aucun remède à ces maux dont souffre l’humanité entière. Au lendemain de la guerre de 14-18, on avait décidé la création de la S.D.N. (Société des Nations). Vingt ans plus tard, la seconde guerre mondiale éclata dans toutes ses horreurs, camps de concentration, déportation, fours crématoires. Et depuis, les guerres se sont multipliées (Algérie, Indochine, Iran-Irak, Malouines, Kosovo, etc.).
Les états capitalistes se disputent les richesses du monde, à commencer par le pétrole, puis l’uranium. Les pays d’Afrique riches en minerais font l’objet de toutes les convoitises, qui s’ajoutent aux problèmes raciaux. L’O.N.U., comme la S.D.N. d’autrefois reste impuissante devant toutes les difficultés.
Des millions de gens souffrent encore de la faim et même parfois de la soif. Tout cela est bien lamentable au regard du progrès des sciences et des techniques. Nos anciens vainquirent le choléra et la peste. Aujourd’hui, c’est au fléau du Sida qu’il faut s’attaquer. Pauvre humanité !
La
dégradation des
mœurs politiques va de pair avec la dégradation des
mœurs tout court. Au niveau familial, l’autorité du
pater familias est bafouée. Le respect pour les anciens
s’amenuise. A l’école, l’autorité des
maîtres et maîtresses subit elle aussi de rudes atteintes.
Que de classes se font dans le chahut des élèves ! Et
hélas ! les enseignants eux-mêmes ne sont-ils pas
confrontés à des problèmes d’agression
physique ?
L’ambiance au laisser-aller s’aggrave un peu partout. Et, malgré cela, il s’est trouvé des autorités de l’Éducation nationale pour décréter que l’enseignement de la morale et aussi de l’instruction civique n’aurait plus cours. Quelle aberration !
Toutes les valeurs morales auxquelles ma génération a été soumise sont paraît-il dépassées aujourd’hui. La discipline à l’école, à la maison et partout ailleurs est la base d’une société équilibrée. Sans discipline, c’est l’anarchie partout.
Il faut tout de même se garder de généraliser. Il y a encore de bons enfants et de bons parents. Mais les bonnes mœurs d’autrefois sont tout de même en recul.
 |
| Dernière
photo de Marius
AUTRAN (1er janvier 2007) |
Accès à la page d'accueil des archives et souvenirs de Marius Autran
Retour à la page d'accueil du site
jcautran.free.fr
|
Jean-Claude Autran 2016