|
|
|
|
Après la publication de ses 10 ouvrages d'histoire locale (entrre 1982 et 2001), Marius AUTRAN, tant qu'il a pu écrire, c'est-à-dire jusque vers 2005 (95 ans), s'est consacré à diverses rédactions, notamment à des biographies de ses ancêtres, et à son autobiographie. En réalité, il avait déjà esquissé les biographies de son père Simon AUTRAN et de son grand-père paternel Auguste AUTRAN dans un cahier datant de la fin des années 60, et il les a simplement complétées et remaniées vers 2001-2002. Il avait également écrit un texte À la mémoire de Louis GAUTIER, le père de son épouse (qui aurait été son beau-père s'il n'avait été tué en 1911 lors de l'explosion du cuirassé Liberté). Par contre, son Autobiographie (200 pages manuscrites) a été rédigée pour la première fois, en 2002-2003, essentiellement de mémoire, sauf pour quelques dates précises qu'il a dû aller rechercher dans ses “Agendas” et ses “Cahiers du retraité”, dans lequel, depuis son départ à la retraite en 1966, il consignait, au jour le jour, puis dans des bilans annuels, de nombreuses informations.
Pour mettre en ligne sur internet les
biographies de Simon AUTRAN (mon grand-père paternel), de Louis
GAUTIER (mon grand-père maternel) et d'Auguste AUTRAN (mon
arrière grand-père), j'ai donc repris les textes de mon
père en les complétant parfois avec mes propres souvenirs
(textes en bleu) et en les illustrant de photographies. Par la suite,
je pense rajouter les biographies de tous mes autres ancêtres
(voir arbre ci-dessous).
Jean-Claude AUTRAN
Pour bien situer les filiations entre les
différents
ancêtres dont la vie est racontée ci-dessous, il convient
tout d'abord de rappeler l'arbre
généalogique imagé de la famille AUTRAN :















Origine géographique de notre branche AUTRAN
Au XXe siècle, nos parents et grands-parents ont habité La Seyne-sur-Mer (Var) après être venus de Marseille au début du XXe siècle. On savait cependant qu'ils n'avaient pas leur origine à Marseille, mais qu'ils venaient du Var puisqu'on les retrouve à Barjols entre 1850 et 1870 environ, et plus anciennement au Cannet-du-Luc (actuellement Le Cannet-des-Maures) entre 1816 et 1850 environ). Ce n'est qu'au début de 2007 (avec la mise en ligne des archives de l'état-civil du Var, quelques jours après le décès de Marius AUTRAN, qui ne l'aura donc jamais su) que nous avons découvert que la génération ayant précédé nos ancêtres du Cannet-du-Luc avait déjà son origine à Marseille à la fin du XVIIIe siècle.
Que savons-nous de nos ascendants AUTRAN les plus
lointains
?
Notre plus lointain ancêtre AUTRAN connu est AUTRAN François, né vers 1760, décédé avant 1816, qui épousa PAUL Elisabeth (également née vers 1760 et décédée avant 1816).
Ils eurent un fils (peut-être eurent-ils d'autres enfants, mais nous ne les avons pas actuellement identifiés) : AUTRAN Louis Pascal, né le 24 mars 1788 à Marseille.
Il est donc possible que AUTRAN François soit lui-même né à Marseille où les AUTRAN étaient déjà nombreux, mais nous n'en avons pas encore trouvé la preuve. (Nous n'avons pour l'instant découvert aucun lien de parenté entre nos ancêtres et certains AUTRAN célèbres de Marseille, tels le poète et académicien Joseph AUTRAN ou le juge Amédée AUTRAN...).
AUTRAN Louis Pascal exerça la profession de maréchal-ferrant et s'établit au Cannet-du-Luc (Var) (actuellement Le Cannet-des-Maures) où il épousa (le 25 mai 1816) MAURON Cécile Magdelaine. Il mourut le 20 septembre 1840 au Cannet-du-Luc.
AUTRAN Louis Pascal et MAURON Cécile Magdelaine eurent 7 enfants : AUTRAN Louis Adolphe, notre ancêtre direct, né le 17 avril 1825 au Cannet-du-Luc (date et lieu de décès non encore retrouvés) et six autres frères et sœurs, tous nés au Cannet-du-Luc : AUTRAN Marie Magdeleine Honorine ("Maxime") née le 15 décembre 1817, AUTRAN Mathieu Louis César né le 21 septembre 1819, AUTRAN Marie Magdeleine Victorine née le 4 août 1821, AUTRAN Jean Auguste Césaire né le 5 février 1830, AUTRAN Claire Elisabeth née le 22 juin 1833, et AUTRAN Symphorien Barthélemy Désiré né le 10 mai 1835.
AUTRAN Louis Adolphe exerça la profession de forgeron et s'établit à Barjols (Var), où il épousa (le 10 novembre 1852) CARMAGNOLLE Désirée Zoë Magdelaine. On ne connaît pas la date exacte ni le lieu de son décès.
AUTRAN Louis Adolphe et CARMAGNOLLE Désirée Zoë
Magdelaine eurent quatre fils : AUTRAN
Auguste, notre ancêtre direct (né à
Barjols le 26 septembre 1853, mort à Marseille le 27
décembre 1918) ; AUTRAN Marie Jules Joseph (né
à Barjols le 3 février 1855, mort au Luc le 28 juillet
1855), AUTRAN Edouard Philippe Clément (né
à Toulon le 19 décembre 1856, et mort après
1916, on ne sait pas où) qui sera le père de AUTRAN
Edouard Marius (plus connu sous son nom d'artiste d'Edouard
DELMONT, ou de DELMONT), et AUTRAN Germain Désiré (né le 4 mai 1862 à Marseille et mort le 1er septembre 1865 à Marseille.
Page en travaux

Grands-parents :
Arrière-grands-parents
AUTRAN Simon (père de AUTRAN Marius) : 1887-1962
Fils de AUTRAN Auguste, né le 26-9-1853 à Barjols et de Marie Louise PIOLET née à Paris le 11-12-1859.
Né à Marseille le 5 décembre 1887 - Décédé à La Seyne-sur-Mer le 30 Mars 1962.
Je suis en mesure de retracer sa vie de façon précise d'autant qu'à de rares exceptions près j'ai vécu l'essentiel de mon existence à ses côtés ou en des lieux très proches de lui.
De son enfance, je ne sais évidemment que ce qu'il m'en a dit ou ce que j'ai retenu des conversations familiales. Quand sa mère mourut en 1891, il n'avait pas 4 ans. Il connut jusque-là le véritable amour maternel, mais la famille vécut dans des conditions bien précaires dans un appartement, disons plutôt un taudis, rue de l'abbé Féraud à Marseille : logement insalubre, humide et froid.
Le salaire du chef de famille suffisait à peine à faire vivre le foyer. A ces calamités s'ajoutaient souvent les périodes de chômage et la répression patronale, car AUTRAN Auguste, comme cela a été dit précédemment, fut un ardent défenseur des causes ouvrières.
Mon père se trouva donc orphelin de mère de très bonne heure. Auguste, veuf, fut dans l'obligation de prendre une bonne à son service, laquelle était fille-mère. Il ne tarda pas à l'épouser et à reconnaître l'enfant dénommé Gabriel, né en 1892, qui prit alors également le nom de AUTRAN. Le ménage avait dont 4 enfants à charge.
Ayant trouvé du travail dans les chantiers de construction navale seynois, la famille vient se fixer dans ma ville natale au quartier Cavaillon d'abord (La Calade), puis dans la rue Parmentier.
La marâtre, excellente ménagère, paraît-il, avait un caractère particulièrement autoritaire et menait la vie très dure aux enfants de son mari (Désiré, Simon et Henri), et réservait toutes ses faveurs à son propre fils. On devine les conflits que son comportement devait engendrer, surtout quand le père était absent du foyer.
AUTRAN Auguste, révolutionnaire, s'occupait activement du syndicalisme ouvrier et du parti ouvrier (P.S. de Jules Guesde).
Mon père a gardé un mauvais souvenir de son enfance. Il ressentit avec beaucoup d'amertume les injustices dont sa marâtre se rendait coupable.
Dès leur adolescence, les vrais AUTRAN songèrent à quitter le foyer familial le plus tôt possible, les conflits internes devenant de plus en plus fréquents.
Mon grand-père ayant eu tendance à soutenir sa femme, il ne sut pas s'attirer l'amour de ses propres enfants, qu'il éleva peut-être avec trop de rigueur. Henri, coupable de fugues, contracta à 14 ans une congestion pulmonaire après avoir passé une nuit sur les bancs du marché du cours Louis Blanc. Sa congestion dégénéra en tuberculose et il mourut peu après. Simon également, de nature assez chétive, aggravée par les conditions de vie insalubres, eut très tôt des problèmes pulmonaires. Suite à une sorte de pleurésie, dès l'enfance, il avait dû subir des ponctions de la plèvres, sans anesthésie bien sûr. Il se souvenait des douleurs occasionnées. Cette fragilité au niveau des poumons, aggravée par le fait qu'il n'ait cessé d'être un gros fumeur, ce qui causa sa fin.
Mon père Simon, de nature paisible, assista souvent à des scènes de violence. C'était l'époque où les enfants étaient battus et quelquefois enchaînés.
Cependant, mon grand-père eut le souci de leur donner de l'instruction, qu'ils reçurent à l'école Martini.
A l'âge de 11 ans, mon père obtint son certificat d'études sans difficultés, préparé d'ailleurs dans des conditions excellentes par Monsieur AILLAUD, instituteur d'élite, que je connus de 1920 à 1921 et qui, lui aussi me fit admettre à mon certificat avec succès. J'ai raconté dans « l'histoire de l'Ecole Martini » comment l'inflexible Monsieur AILLAUD préparait ses élèves. Je n'y reviendrai pas. Le jeune Simon, intelligent, réfléchi, soigneux, apprit à travailler avec goût.
 |
| Résultats du Certificat
d'Etudes Primaires à La Seyne (Le Petit Var, 18 juin 1899),
où figurent les noms de Simon AUTRAN et de son frère
aîné Désiré AUTRAN |
Son souci de bien faire a persisté toute sa vie durant. Son écriture penchée était belle, ses problèmes toujours exacts, son orthographe impeccable.
Nanti de son certificat d'études primaires, il quitta l'école, et ce fut dommage car ses aptitudes à poursuivre ses études étaient certaines, comme on le verra dans la suite de ce récit.
Vers la fin du siècle dernier, et même longtemps après, les enfants de 12 ans étaient admis dans les usines. La nécessité où se trouvait mon grand-père de vois quelques sous de plus pour alimenter le budget familial, fit que le jeune Simon entra dans le chantier naval, ainsi que son frère aîné Désiré. Dès l'enfance, mon père connut donc la vie rude des forgerons, des tôliers, des riveurs.
En ce temps-là, il fallait une bonne journée pour fixer une seule tôle sur la coque d'un navire en construction. Chaque rivet était d'abord chauffé au rouge incandescent, puis introduit dans les tôles à réunir. Il fallait alors écraser l'extrémité pour lui donner la forme de la tête : on disait que l'ouvrier opposé au frappeur devait « tenir l'abattage ». A 12 ans, mon père faisait chauffer les rivets dans les foyers, dont la chaleur était difficilement supportable.
Plusieurs années de cette existence pénible l'incitèrent à améliorer sa formation. Les ouvriers de son entourage lui conseillèrent de se spécialiser et de se perfectionner. Ils avaient constaté, en connaissance de ses qualités, qu'il était apte à faire autre chose que de servir de manœuvre. Il apprit donc le métier de charpentier-tôlier qui le destina à la construction navale.
Adolescent, il suivit des cours d'adultes gratuits que la municipalité de l'époque avait organisés à la Bourse du travail : mathématiques, dessin industriel. Certains dessins de lui, conservés dans mes archives, attestent de sa haute qualité d'exécution. Je demande à mes descendants de les conserver précieusement. Ces ouvrages sont d'autant plus louables que les instruments de travail de l'époque étaient des plus rudimentaires. On trouvera des diplômes que Simon obtiendra à la Bourse du travail en parfait état de conservation, dans une enveloppes où sont réunies les distinction de la famille (certificats d'études, brevets, etc.).
A 18 ans 1/2, il contracta un engagement volontaire de 3 ans dans la Marine nationale. Son livret de solde indique une arrivée au dépôt de Toulon le 23 Mai de l'année 1906.
Photo en marin.
Caractère têtu, il n'appréciait pas certaines brutalités : refus d'apprendre à nager. Il se laissait couler. Il ne sut jamais nager.
Affecté alors à ce qu'on appelait « L'Atelier de la Flotte », il prépara patiemment son entrée à l'école de la « Maistrance » qui devait lui donner quelques années plus tard le titre d'« Agent technique de la Marine nationale ».
 |
|
 |
|
 |
|
Il avait quitté les F.C.M. de La Seyne pour entrer à l'Arsenal de Toulon, où il gagnait 4 francs par jour seulement. Il disait toujours, et il avait raison, que dans l'entreprise privée il n'aurait eu aucun avenir malgré toutes ses qualités. Son mérite fut immense de réussir un concours difficile, alors qu'il n'avait pour tout diplôme que son certificat d'études primaires.
Il lui fallut étudier les mathématiques, d'un niveau élémentaire, il est vrai (arithmétique théorique, algèbre, géométrie plane, géométrie descriptive), sans parler de la mécanique et du dessin industriel. [Fei de matematico, l'a qu'aco que te tirera d'affaire ! lui disait un ami]. Depuis son certificat d'études primaires, il avait un écart considérable à combler, alors que la plupart de ses concurrents étaient au moins titulaires du B.E.P.S. (Brevet d'Enseignement Primaire Supérieur) que l'on obtenait d'ordinaire vers 15 ou 16 ans.
Deux officiers d'administration seynois que j'ai bien connus (MM. Roux et Magnino) lui donnèrent quelques leçons particulières contre rémunération bien entendu, ce qui veut dire qu'il se privait de bien des choses étant donnée la modicité de son salaire, sans parler du loyer à payer au propriétaire de son logement. Avant tout, il fallait payer les professeurs.
Ses succès, ce fut surtout à lui-même, à son travail courageux, à sa persévérance, qu'il les devait.
Le 30 Janvier 1909, il épousa Victorine Laurence Charlotte AUBERT, ma mère, qui exerçait alors la profession de modiste. Elle était fille d'un Premier maître de la Marine, retraité, et de Joséphine Hermitte, famille de bouchers et charcutiers seynois.
De cette union, je fus l'enfant unique, le 2 Décembre 1910. Cette union solide dura 33 ans, jusqu'au jour dramatique où ma mère périt dans un accident de la route, au quartier de La Maurelle. Cela dans des circonstances qui seront racontées plus loin.
Mes parents habitèrent successivement à Marseille, puis à La Seyne (rue Cavaillon, rue Philippine Daumas) où je naquis (voir acte de naissance).
Les années qui s'écoulèrent entre 1910, année de ma naissance, et 1914, année du début de la 1ère Guerre mondiale, furent pour eux, comme pour tout le monde, des années d'inquiétude. Le spectre de la guerre planait sur les têtes. Les chantiers de construction navale lançaient chaque année, et cela sous la haute Direction de M. Lagane, de nombreux navires de guerre (cuirassés, croiseurs, torpilleurs,…). La France possédait alors la flotte la plus importante d'Europe, en concurrence avec la Grande-Bretagne, ces deux nations s'étant taillé des empires coloniaux immenses qu'il fallait surveiller de près.
L'année 1911 fut marquée par une multitude d'accidents maritimes, des explosions meurtrières responsables de centaines de morts (Liberté, Iéna,…), dont j'ai beaucoup parlé dans un ouvrage précédent, sans parler de la fameuse catastrophe de la Pyrotechnie, explosion qui fit une centaine de victimes.
De 1912 à 1914, mes parents demeurèrent à la rue Carvin, au 3e étage de la boulangerie Mabily, un cousin de ma grand-mère Hermitte, face à la pâtisserie Tisot, dont j'ai connu le père, la mère, et même l'arrière grand-mère Mme Marro.
Plus anciennement, cette maison avait été le siège de la Mairie de La Seyne. Il me souvient d'avoir lu sur sa façade délavée : « Liberté, Egalité, Fraternité ».
J'ai gardé de ces années de mon enfance chez les Mabily des souvenirs précis. Vers 3 ans 1/2 - 4 ans, je m'exprimais bien, montait et descendait les escaliers abrupts. Pour les remonter et voir le pétrin en action, j'appelais souvent ma jeune mère en ces termes : « Victorine, tu n'entends pas ton petit qui t'appelle ! ». J'allais presque tous les jours acheter 4 sous de saucisson pour le déjeuner et interpellait le marchand nommé Delaud en ces termes : « Je voudrais 4 sous de saucissesson ! », ce qui ne manquait pas de provoquer l'hilarité du patron et des clients. Je connus de cette boucherie M. Delaud, puis M. Autard, puis M. Villedieu, dernier propriétaire. Ce magasin jouxtait la pâtisserie Tisot où jacassait un perroquet dans sa cage, tout à côté de l'entrée de ce magasin.
Je vois encore, s'agitant dans cette rue Carvin, un tripier, au autre boucher, M. Cheyland, le bijoutier Cauvière, entre Mabily et la pharmacie Armand « créée en 1853), et passons sur tous les personnages dont quelques-uns m'amusaient beaucoup : Jourdan (appelé Djordan), Gérome (Dgéromé) le débardeur, le trafic des fascines, des livreurs de sacs de farine de 100 kgs, etc.
Je me revois encore sur ma chaise haute, devant la table de la cuisine, éclairée par une lampe à pétrole. Comme je la trouvais belle cette lampe, avec sa belle flamme parfois fuligineuse. Je fus même tenté un soir, malgré les recommandations de mon père, de saisir à pleine main le verre de la lampe. Je poussai un cri douloureux et pleurai à chaudes larmes. Ma sainte mère me trempa les mains dans l'eau froide, alors que Simon, l'inflexible, s'écriait : « C'est bien fait ! ». Le lendemain soir, mon père, donneur de leçons toujours efficaces, me dit : « touche le verre, touche-le ! ». Vous pensez bien que je n'étais pas près d'oublier ma douleur de la veille.
Dans l'arrière-boutique de la boulangerie Mabily, celui que j'appelais « Tonton Victor ! » (parrain de ma mère) me permettait d'assister à la fabrication de ses pains, appelés alors « navettes ». C'était d'abord l'introduction des fascines (de pins de Janas), le four n'étant pas encore chauffé au mazout ou à l'électricité. Je revois la porte du four, faite d'une énorme pierre équarrie, tourner sur ses gonds, tandis que l'oncle Mabily, ruisselant de sueur, le torse nu, engouffrait les fagots de pins pour obtenir la chaleur souhaitable à la cuisson des « navettes ». Après avoir retiré les cendres de la veille, il manipulait avec une rare dextérité une longue pelle plate qui déposait délicatement les pains de pâte fraîche qu'un ouvrier préparait au pétrin du 1er étage. Naturellement, les artisans boulangers de cette époque pétrissaient encore la pâte à la main. Mais le Tonton Mabily fut sans doute, par la suite, parmi les premiers boulangers disposant d'un four électrique, engin rare pour l'époque.
De nature paisible, je n'étais pas un enfant espiègle et ma présence ne gênait nullement les va-et-vient du tonton et de son ouvrier. Cuits à point, les pains, retirés adroitement, remplissaient des corbeilles immenses. Comme il sentait bon ce pain tout chaud, doré, croustillant, cuit aux fascines de notre forêt de Janas.
Mes parents demeurèrent dans la maison Mabily jusqu'en 1914, année de la Première Guerre mondiale.
Quelques jours avant la Mobilisation générale du 2 Août, mon père Simon, rentrant un soir de son travail, demanda à son épouse de lui préparer du linge et quelques objets de voyage. Très étonnée, ma mère s'exclama : « Mais où vas-tu partir ? ». « C'est tout simple, l'Arsenal demande des spécialistes de la construction navale pour la Tunisie et je me suis déclaré volontaire, avec d'autres camarades, bien sûr ». « Et moi, et le petit ? Que deviendrons-nous ? ». « Ne te fais aucun souci ! Tu me rejoindras dans quelques semaines, quand je serai logé à Ferryville, proche de l'Arsenal de Sidi-Abdallah, aménagé pour les réparations et les approvisionnements de la Marine nationale ». (La Tunisie était alors un protectorat français, apparemment d'ailleurs. J'y reviendra dans ma propre biographie).
Mon père prit ce jour-là, en ce début de l'année 1914, l'une des décisions les plus heureuses de sa vie. Il partit donc en compagnie d'autres Seynois et Toulonnais, en qualité d'affecté spécial, et esquiva ainsi une mobilisation sur les navires de guerre, ce qui aurait été bien plus dangereux pour sa vie. Contrairement à ceux appelés sur les fronts de la guerre terrestre ou maritime, ils eurent une chance inouïe de vivre 6 années, qui furent sans doute les plus belles de leur existence. Le hasard leur fut bien favorable, alors que tant d'autres familles connurent des années terribles de souffrances et de deuils. Ils ne connurent pas de danger immédiat, à l'exception des traversées de la Méditerranée, infestée par les sous-marins du barbare Von Tirpiz. J'y reviendrai longuement. La vie à Ferryville était beaucoup plus sûre, le coût de la vie peu élevé sur les marchés tunisiens, les distractions diversifiées (spectacles, chasse, pêche, etc.).
Quelques semaines après le départ de mon père, ma mère et moi embarquions de Marseille pour rejoindre Simon, impatient de retrouver son épouse et son fils. Le paquebot « Ville d'Alger », partant du quai de la Joliette, prit donc la direction de la Tunisie. Cette première traversée de la Méditerranée faillit tourner à la catastrophe à cause d'une tempête hors du commun.
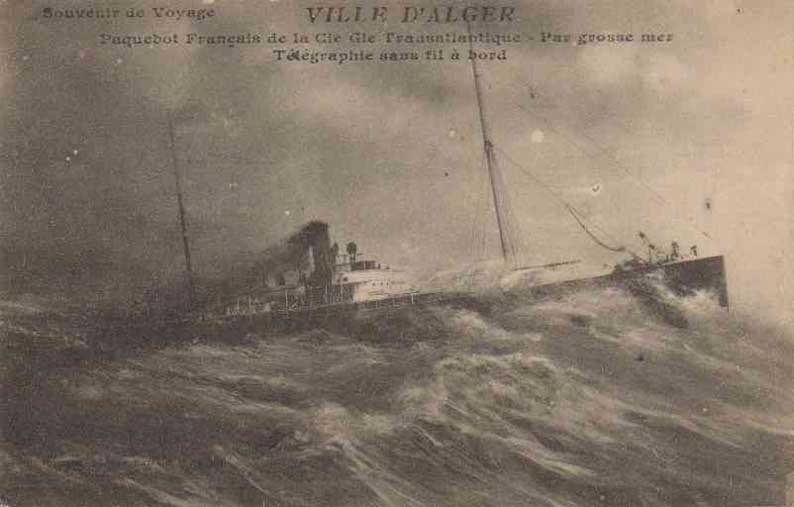 |
|
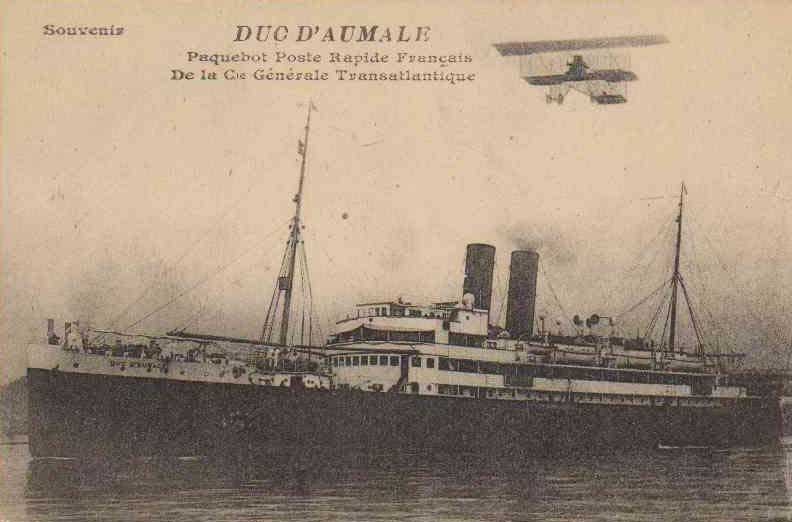 |
|
 |
|
J'avais donc quatre ans quand mes parents s'installèrent à Ferryville. Dans une chambre d'hôtel d'abord, avant de trouver un petit logement à Tindja, hameau situé à quelques kilomètres de Ferryville. Ils se fixèrent peu après dans la rue Franklin, dans une copropriété superbe, habitée aussi par un médecin appelé Canac.
Au hasard de la plume, je pourrais citer une multitude de noms seynois toulonnais, bretons, corses, dont très peu de descendants vivent encore aujourd'hui, en ce mois de Janvier 2002 où j'écris ces lignes.
Ma mère s'était liée d'amitié avec beaucoup de méridionaux, provençaux surtout. Très économe, elle eut tôt fait d'acquérir du mobilier de cuisine, de la literie, et aussi des bicyclettes, ce qui permit à mes parents de nombreuses sorties à la campagne, à la pêche, à la chasse, enfin à tous les plaisirs de la campagne avec ses oliveraies si nombreuses ! Il me souvient que, dans une cour intérieure, mon père avait même aménagé une volière où il faisait vivre un perdreau blessé au cours d'une partie de chasse.
La vie à Ferryville était facile, avec des logements confortables, réservés surtout aux Européens colonisateurs (lire à ce propos le Tome VIII des Images de la vie seynoise d'antan).
Les distractions extrêmement diverses nous offraient même un cinéma dans la rue Franklin (muet, il est vrai, mais, pour l'époque, il nous procurait des joies certaines).
Le grand marché, à proximité de notre logement, regorgeait de marchandises de toutes sortes à des prix modiques : fruits, légumes, viande, gibier à profusion. Tout cela à des prix que nous trouvions dérisoires par rapport à ceux de la métropole.
La plupart des commerces étaient tenus par des indigènes, Arabes ou Juifs. Dès la pointe du jour, les petits marchands se manifestaient dans les rues, vantant à haute voix la qualité de leurs marchandises : charbon, gibier, aromates, peaux d'animaux, sans oublier les porteurs d'eau, à la saison d'été surtout. Ils portaient en bandoulière les peaux de bouc gonflées et cousues, d'une contenance de 50 litres d'une eau grandement appréciée dans l'immense majorité des habitations qui en étaient dépourvues.
 |
|
|
 |
|
Les plus grandes distractions, mes parents les trouvaient au bord de la mer, dans les oliveraies grouillantes de grives, à l'automne surtout, dans les campagnes et les bosquets ; ils récoltaient tout ce qui état comestible : salade sauvage, champignons à la saison des pluies, asperges au printemps. A proximité des rares sources, c'était la capture des petits oiseaux par des brins de jonc englués.
Mon père avait réalisé quelques économies sur son salaire pour l'achat de bicyclettes. Sur le cadre de la sienne, il avait fixé une petite selle en bois et il m'emmenait surtout à la chasse avec lui. Il lui arriva d'approcher des vanneaux pataugeant dans les mares et de les tirer par dessus ma tête, sans descendre de bicyclette. Puis, ôtant mes chaussures, il me chargeait d'aller ramasser les victimes. Déjà, j'étais mis à l'épreuve de sensations fortes. Comment oublier dans mes souvenirs d'enfance ses coups de fusil meurtriers contre des najas, serpents redoutables à tête plate, qui se dressaient bien haut au milieu de la route, barrant notre passage ?
Simon était devenu un chasseur adroit, un braconnier malin qui ne rentrait jamais bredouille. Aussi, ma mère n'arrêtait pas, dans la semaine qui suivait les sorties de pêche ou de chasse, de plumer, de dépouiller poissons et grenouilles, dont les bords de la mer et les rares oueds étaient riches.
Quand ma mère posséda aussi sa bicyclette, il nous fut possible d'exploiter les richesses de la mer à « Bord Joli », une anse située au fond de la rade de Bizerte. Mon père m'apprit à « clouer » des seiches avec une simple fourchette. A six ans, je savais reconnaître l'emplacement des trous de siphon des clovisses abondantes, le contour de sable fin signalant aussi la présence des crabes.
Au retour du dimanche, la table de la cuisine de notre appartement de la rue Franklin se couvrait de toutes sortes de plantes ou d'animaux comestibles. Si, à leur retour, mes parents avaient pu s'approcher des « gourbis », habitations quasi préhistoriques des indigènes, ils avaient pu alors se procurer des œufs et de la volaille, pour quelques sous (nous avions alors des grosses pièces de 1 sou et de 2 sous en bronze). Nous avions alors des victuailles pour plusieurs jours.
Il me revient maintenant à l'esprit de revoir ma mère marchander un lièvre énorme à un braconnier indigène qui avait abattu le gibier au moyen d'une matraque en bois d'olivier. La chasse à l'affût était la seule possible pour les Arabes, à qui les armes à feu étaient interdites. Sortant de sa poche une poignée de gros sous, et ne sachant pas parler la langue arabe, elle demanda au vendeur de se servir. Ce dernier prit 15 pièces dans la main généreuse de ma mère. De telles occasions se renouvelèrent par la suite.
Mais revenons à Simon et à sa vie professionnelle qu'il devait assurer durablement.
Ce fut, je crois, vers 1917 qu'il obtint son titre d'Agent technique de la Marine. Tr ès estimé de ses chefs, il accomplissait ses fonctions avec le plus grand dévouement et ses initiatives furent grandement appréciées. Animé d'une conscience professionnelle rare, il forçait l'admiration de ses subordonnés et de ses chefs, et ne tarda pas à bénéficier d'importants avancements, à telle enseigne qu'avant la fin de la guerre, le Ministère de la Marine lui confia une tâche importante. En haut lieu, il fut décidé de créer à Ferryville une base aéronavale. On y édifié des hangars immenses pour la construction d'hydravions. C'est alors que mon père fut désigné pour une mission à Paris en visite d'une usine aménagée sur les bords de la Seine, fleuve paisible sur lequel on pouvait procéder à des essais d'hydravion [NB. Le premier vol d'un hydravion français avait eu lieu le 28 Mars 1910 sur l'étang de Berre].
Il fallait pourvoir la Marine de ces engins volants et naviguant sur des eaux parfois agitées. Le problème de la résistance des coques et des flotteurs se posait et Simon Autran était justement spécialiste des coques marines. Comme il avait fait à Toulon les essais des premières coques de sous-marins, il allait bientôt faire à Ferryville l'essai des premiers engins de l'aéronavale.
Il apprit beaucoup de choses à Paris où il découvrit le métro, la tour Eiffel, la grande roue, le Louvre et autres merveilles de la capitale. Son séjour dura un mois et il en revint avec un bagage professionnel enrichissant. Il me décrivit, croquis à l'appui, le passage des voies ferrées du métro sous la Seine, chose inimaginable pour moi, qui ne voyait le franchissement d'un cours d'eau par le seul moyen d'un pont aérien.
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
|
Revenons à Ferryville, dans les fameux hangars où l'on montait les carlingues et leurs flotteurs, où l'on fixait solidement les moteurs Hispano-Suiza, le tout pesant à peine 2 tonnes sur une envergure de 10 à 15 mètres, ce qui faisait quand même l'admiration de tout le monde. Ces engins terminés, montés sur un chariot, on les poussait jusqu'au rivage et on procédait aux premiers essais.
Manque de chance ! Au cours du premier vol auquel participa mon père, le moteur s'arrêta net bien au-dessus de la rade de Bizerte. Je vois d'ici la physionomie de Simon, inquiet par nature. Le pilote (ils n'étaient que deux à bord), ne perdant nullement son sang-froid, fit planer son engin en une descente spiralée jusqu'à l'amerrissage, toutefois loin du point de départ. Le soir tombait et Simon tardait à rentrer à la maison. Il fallut bien du temps pour remorquer l'hydravion jusqu'au port. Inutile d'ajouter que ma mère se démena pour connaître les causes de la rentrée tardive de mon père. On devine aisément que le lendemain, ce fut avec une fierté légitime que je racontais à mes camarades de classe les péripéties de la journée de la veille. Il m'arriva aussi de raconter les premiers essais de plongée des sous-marins auxquels mon père avait participé : les déformations de la coque, le jeu des rivets, d'où résultaient des infiltrations à l'intérieur du sous-marin sous l'effet de la pression grandissante.
Mon père m'enseignait tout ce qu'il savait. Il avait le souci constant de m'expliquer la raison des choses, la cause de tel ou tel phénomène, les dangers à éviter, cela dans un langage expressif, une mimique impressionnante, des exemples concrets. Il m'emmena visiter tout ce qui présentait un intérêt pour moi.
A Ferryville particulièrement, j'ai pu assister au carénage des bateaux dans les grands bassins, opérations délicates, qu'il me montra de nouveau, plus tard, dans ceux de la Joliette à Marseille. Il m'apprit les opérations de renflouement des sous-marins, le fonctionnement des torpilles meurtrières. Indépendamment des hangars où l'on construisait les hydravions, il me fit visiter les ateliers de menuiserie, d'ajustage, de fonderie. Je vois encore, quatre vingts ans plus tard, comment on débouchait le haut-fourneau, d'où jaillissait la fonte liquide, le ruban incandescent du métal s'allongeant dans les rigoles de sable pour aller remplir les moules de terre réfractaire. Et je pourrais parler aussi des cisailles géantes, du marteau-pilon impressionnant.
 |
|
|
Je ne quitterai pas l'arsenal de Ferryville et ses annexes sans rappeler peut-être le meilleur de mes souvenirs d'enfance, ce jour où, dans l'un des immenses hangars, mon père m'apprit à monter sur un ebicyclette, un vélo pour enfant qu'il avait équipé lui-même, avec un cadre et des roues achetés au rabais au grand marché, qu'on n'appelait pas encore marché aux puces. L'endroit était idéal, le parquet du hangar étant carrelé. « Pédale tout de suite dès que j'aurai poussé la selle », me dit-il. « Sois sans crainte, je te tiendrai ! ». Au bout de quelques mètres, je m'aperçus qu'il n'était plus derrière moi : je savais monter à vélo.
Pensez à l'immense joie que j'éprouvai en arrivant dans la rue Franklin où jouaient mes camarades, mon père ne me quittant des yeux. Ma mère, ravie de mes aptitudes sportives, me fit cette recommandation : « Tu ne prendras le vélo qu'au cours de nos sorties du dimanche. A partir de ce jour, la selle en bois fixée au vélo paternel disparut. Dans mon autobiographie, je reparlerai des années de mon enfance passées à Ferryville et des écoles maternelles et primaires où je reçus la première instruction publique (maternelle en 1915 et 1916, primaire en 1919 et 1920).
J'avais 9 ans quand il fut question, pour mes parents, de retourner en France. J'écoutais attentivement leurs conversations. Mon père ne voulait pas quitter la Tunisie qui lui apportait de grandes satisfactions avec ses distractions favorites : la pêche, la chasse, la fréquentation de vieux amis seynois et toulonnais, un travail intéressant pour lui, surtout depuis la création de la base aéronavale, les sorties et même des randonnées à vélo. Ferryville était une ville très animée avec son grand marché, aux produits d'une extrême variété, ses revues militaires fréquentes, ses fantasias prestigieuses, ses spectacles d'acrobaties de plein air. Simon était très estimé de ses amis et de ses camarades de travail qu'il retrouvait aux heures de l'apéritif au « Café de France » qui les accueillait. Apéros suivis généralement de parties de jacquet, de poker ou de billard. Et tout cela se déroulait dans la plus grande convivialité, où l'on se prenait souvent à rappeler les souvenirs nostalgiques de Janas, de Sicié, du quartier Beaussier, de Besagne aussi, pour les Toulonnais, du Mourillon, de Bon Rencontre, de la Pyro, etc.
Si mon père s'était parfaitement adapté à la vie tunisienne, par contre, ma mère, sollicitée par ses parents désireux de revoir leur fille aînée, son époux et leur petit-fils Marius qu'ils trouveraient bien changé, ma mère s'efforçait patiemment de gagner Simon à sa cause.
Un facteur important et même déterminant dut jouer sans nul doute pour inciter mes parents à retourner en métropole et surtout dans notre belle Provence : la naissance et le renforcement du mouvement d'indépendance de la Tunisie : le Néo Destour, animé par le vaillant Bourguiba. Des conflits avec les Européens ne tarderaient pas à se produire et les Seynois et les Toulonnais, petits colonialistes, il est vrai, risqueraient d'en faire les frais.
Bref, dans l'été de l'année 1920, mon père demanda sa réintégration à l'Arsenal de Toulon, ce qu'il obtint sans difficulté.
L'agent technique que mon père était devenu, fut autorisé à faire la traversée à bord du croiseur cuirassé « Jules Michelet ». Nous y fumes accueillis dans les mêmes structures que les officiers de l'équipage.
J'ai gardé de ce voyage un souvenir impérissable. Le temps se prêtait à des observations curieuses : marsouins nageant dans le sillage du navire, à la recherche de quelque provende, oiseaux de mer épuisés venant prendre quelque repos dans les mâtures, vigie signalant la présence d'une baleine à quelques encablures du cuirassé.
Parti de Bizerte en fin d'un après-midi splendide, nous découvrîmes le lendemain matin la silhouette embrumée de la presqu'île de Saint-Mandrier. Mon père sollicita d'un gradé du pont avant de visiter une tourelle d'artillerie de calibre 240, si mes souvenirs sont exacts. A l'intérieur, les servants de la pièce nous expliquèrent comment les obus en provenance des entrailles du navire venaient se présenter devant l'âme du canon au moyen d'une noria et recevoir la gargousse de poudre dont la mise à feu projetterait le projectile vers son objectif. Cette leçon de balistique, je ne l'ai jamais oubliée. Après cette démonstration, le cuirassé se présenta à l'entrée de la rade de Toulon par ce qu'on appelle la « grande passe ».
A ce moment précis, sur la plage arrière du navire, on vit surgir les matelots de l'équipage en tenue de cérémonie, équipés de leur mousqueton. Ils saluèrent les couleurs de la nation que l'on hissait dans la plus grande mâture, mais aussi un immense cordon argenté au bout duquel scintillait une croix d'or, symbolisant la fin de carrière de cette unité de la Marine nationale. Sur une tribune officielle, un amiral et ses officiers saluaient, dans un garde-à-vous impeccable, le grand drapeau tricolore, et aussi celui portant la marque de l'Amiral, parvenu lui aussi à la fin de sa carrière. Les maniements d'armes, les discours officiels furent dominés par une vibrante Marseillaise.
Pensez si je fus impressionné par les péripéties de cette cérémonie émouvante, d'autant qu'au franchissement de la « grande passe », le fort de Balaguier salua le navire d'une salve de 21 coups de canon, à laquelle répondit de même l'équipage en signe de remerciement. Après quoi la marche sur Toulon fut ralentie, permettant aux remorqueurs de l'Arsenal de prendre en charge le glorieux navire qui hélas ! après tant de services rendus, irait finir ses jours dans les chantiers de démolition des rivages de Brégaillon.
Dès son retour à l'Arsenal de Toulon, mon père fut désigné pour exercer ses fonctions d'agent technique dans les ateliers du Mourillon où se construisaient les sous-marins, là même où il avait été affecté à sa sortie de l'École de la Maistrance.
Peu de temps après, il demanda à l'administration une mutation pour l'Arsenal principal, pour la simple raison que l'éloignement du Mourillon depuis La Seyne ne lui permettait pas de prendre à sa maison, et aussi, il faut bien le dire, parce qu'il ne trouvait pas autour des cales de construction exposées à tous les vents, des conditions de travail très agréables. Son ancienneté, ses aptitudes reconnues de ses supérieurs, lui permirent d'obtenir satisfaction. Un ami particulièrement influent lui proposa une mutation pour le Bureau des Marchés de la Marine. Il hésita quelque temps, redoutant un travail administratif auquel il n'était guère familiarisé. Rapidement, il se documenta, et sut admirablement se convertir à des fonctions d'agent administratif chargé des achats de toutes les fournitures dont la Marine avait besoin, autant dire une tâche énorme et particulièrement ingrate. Il s'y adapta si bien qu'en peu de temps ses supérieurs le désignèrent comme chef du service principal des achats et l'on peut imaginer sans peine l'extrême diversité des marchandises rentrant dans une entreprise comme l'Arsenal, qui comptait alors près de 20 000 emplois.
Mon père faisait partager ses soucis à ses nombreux amis, commis de marine, officiers subalternes et supérieurs, mais aussi à la maison où ma mère écoutait attentivement les explications, souvent obscures pour elle,, les difficultés, les satisfactions éprouvées par son époux, qui lui parlait aussi souvent de ses collaboratrices, dactylos, secrétaires, et il y en avait une vingtaine dans le grand bureau supervisé par le « père Autran ». Parmi les supérieurs du bureau des marchés, j'ai connu l'officier d'administration Pascal, qui venait quelquefois à la maison.
Souvent, dans la conversation, les noms de plusieurs ingénieurs du Génie maritime revenaient, comme Favre, Varnaud, Mattei. Ce dernier était ingénieur général, ce qui correspondait au grade d'amiral. C'est lui qui présidait les réunions les plus importantes où se discutaient les adjudications pour les plus grandes acquisitions. Des conflits inattendus surgissaient parfois. Et il ne fut pas rare que Simon soit consulté pour éplucher les dossiers les plus épineux jusqu'à épuisement de la moindre contestation. [Quand le groupe d'ingénieurs était dans l'impasse, on entendait Monsieur Mattei dire : « Bon, allez me chercher Monsieur Autran…].
Mon père était plein d'admiration pour ses supérieurs hiérarchiques dont, la plupart, anciens polytechniciens étaient passés par la suite à l'école du Génie maritime. Il estimait à juste titre être bien inférieur au niveau de leurs études, de leur capacité, de leur culture. Néanmoins, ces ingénieurs de haut niveau appréciaient les qualités de bon administrateur que fut Simon Autran, à la tête d'une équipe d'une trentaine de dactylos qui avaient pour lui la plus grande estime malgré ses accents autoritaires inflexibles. Exigeant du travail bien fait, mon père payait beaucoup de sa personne.
Pendant plus de 15 années, il s'occupa donc de problèmes administratifs pour lesquels il n'avait reçu aucune formation et qu'il réussit tout de même à maîtriser admirablement, à la grande satisfaction de ses supérieurs.
 |
| |
1933 : 7 novembre. Premier tirage de la loterie nationale. Simon et Victorine avaient acheté un billet (un "dixième"). Le soir, ils écoutent le résultat du tirage à la radio. Jusqu'au dernier moment, ils crurent être les gagnants du grot lot de cinq millions : l'un après l'autre, les chiffres tirés étaient ceux qu'ils avaient. Leur cœur battait à se rompre. Mais leur dernier chiffre n'était pas le bon. Ils n'avaient rien gagné.
J'en arrive ici à parler des années 1934-1936 qui virent se dérouler des évènements aux conséquences troublantes pour sa vie professionnelle.
La menace du fascisme en France s'aggravait dangereusement dans cette période. Les évènements relatés ici, je les ai vécus intensément malgré mon isolement dans le village de Montmeyan, dans le haut Var, où j'enseignais avec Louise, mon épouse, depuis deux ans. Nous étions au courant des évènements nationaux après l'acquisition d'un poste de radio, le second du village.
Le 6 février 1934, une tentative de coup d'état fasciste se produisit à Paris, le colonel de la Roque en étant le principal animateur. Il s'agissait d'un véritable complot visant à remplacer la IIIe République par un pouvoir autoritaire de type mussolinien ou hitlérien. On sait que la tentative des comploteurs échoua face à la réaction populaire des partis de la gauche républicaine ; partis socialiste, communiste, radical, des syndicats de la grande CGT, des enseignants, etc. Le parti communiste, alors en pleine ascension, organisa une manifestation parisienne le 9 février. Les insurgés n'avaient pas réussi à s'emparer du Parlement, comme ils en avaient l'intention. Cette première manifestation fut suivie d'un mot d'ordre de grève générale pour le 12 février. Cette journée, qu'on peut qualifier d'historique, fut une immense réaction républicaine. Répondant à l'appel de la grande CGT d'alors, de tous les syndicats, toutes tendances confondues, des enseignants unanimes, des travailleurs de l'État et du privé, on pouvait parler d'un véritable raz-de-marée de la France républicaine, prête à s'opposer bec et ongles à la tentative fasciste d'assassiner la République. Les forces politiques de gauche allaient estomper leurs divergences et favoriser l'arrivée du Front populaire l'année suivante. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet mais évoquer seulement les répercussions à caractère local pour Simon Autran, fils d'un révolutionnaire authentique qui se battit courageusement au moment de la Commune.
Les ouvriers de l'Arsenal répondirent massivement aux appels de la grève du 12 février 1934. Il n'en fut pas de même pour les cadres moyens, les agents techniques en particulier. En bon syndiqué qu'il était, Simon fut parmi les grévistes, avec deux autres techniciens de sa catégorie. Les grands patrons du Bureau des Marchés de la Marine n'apprécièrent pas du tout l'attitude de mon père. L'amiral Mattei lui-même lui en fit reproche, courtoisement sans doute, mais en lui laissant entendre que ses chances d'avancement en seraient compromises.
Ayant conquis le titre d'agent technique principal de 1ère classe depuis quelques années, mon père pouvait prétendre au titre d'officier d'administration pour lequel il avait réuni toutes les conditions. Hélas ! sa carrière allait s'arrêter là, au lendemain du 12 février 1934.
Au cours de la conversation décisive qu'il eut avec son supérieur hiérarchique le plus élevé, Simon lui expliqua tranquillement que ses origines prolétariennes lui avaient fait un devoir de ne jamais rien faire contre le mouvement ouvrier et qu'il ne se sentait pas fautif vis-à-vis de sa conscience de classe. Sans nul doute, l'amiral Mattei ne fut pas convaincu par un tel argument.
Après mûres réflexions, mon père expliqua à son épouse, avec le grand bon sens dont il était prodigieusement doué :
- « Ceux qui ont voulu me punir de ma conduite de gréviste ont fait mon bonheur sans le savoir ».
- « Comment expliques-tu cela », répliqua ma mère.
- « C'est tout simple, j'ai fait le compte de mes annuités pour le calcul de ma retraite et je me suis aperçu que le montant, calculé sur le dernier échelon des agents techniques principaux serait plus élevé que celui du 1er échelon des cadres d'officiers d'administration. Dans ces conditions, je me fous pas mal des galons qui m'apporteraient certainement d'autres responsabilités et de nouveaux ennuis ».
Pour le calcul de sa retraite, mon père bénéficiait en effet d'importantes annuités, ayant passé 6 années dans un pays considéré comme une colonie : la Tunisie.
De sa retraite, il en rêvait depuis plusieurs années, surtout depuis que mon grand-père AUBERT lui avait vendu quelque 700 m2 de pinède de sa propriété de Mar-Vivo (« Le Bocage »), cela dans les années 1926-28.
In n'y avait sur ce terrain très boisé qu'une construction délabrée qu'il faudrait réparer et surtout agrandir et équiper pour en faire un lieu habitable, pas très luxueux. Il envisagerait plus tard de le rendre confortable. Situé à proximité de la mer, il rêvait aussi de faire l'acquisition d'une barque pour la pêche.
La tête pleine de projets de toutes sortes, il envisageait sans peine l'éventail de ses activités : la pêche, la chasse, le bricolage, pourquoi pas la culture après un défrichement partiel de la pinède riche de 70 pins de dimensions respectables ?
Revenons quelque peu en arrière pour dire qu'à leur retour de Tunisie, mes parents louèrent un appartement sur le cours Louis Blanc (le marché provençal actuel), chez une famille de vieux Seynois, les Besson Guillaume, ce dernier étant alors Président du club nautique.
Ce logement manquait plutôt de confort, avec une cuisine étroite avec évier sans eau courante. Une pompe à bras immense y amenait tout de même une eau saumâtre imbuvable, phénomène qui s'expliquait par le fait que cette partie du cours Louis Blanc avait été conquise sur la mer. L'eau potable, il fallait la trouver à une fontaine de la rue d'Alsace. L'appartement comportait une petite salle à manger dont la fenêtre s'ouvrait sur le cours Louis Blanc, face au courtier GIL où les marchands détaillants venaient s'approvisionner dès potron-minet, cela dans le brouhaha indescriptible du marché « à la criée ». Il n'était guère possible de dormir à partir de 4 heures du matin.
L'unique salle qui jouxtait la petite salle à manger, avait tout de même permis l'aménagement d'une alcôve qui me fut destinée.
L'assainissement n'existant pas à La Seyne, le coin toilette consistait en un réduit obscur qui contenait balais et « toupines », récipients légendaires que les Seynois utilisèrent pendant encore cinquante ans. Ces récipients en terre, il fallait les descendre avant cinq heures du matin sur les trottoirs de la rue d'Alsace, en attendant le passage du vidangeur « Finette », qui conduisait le véhicule pestilentiel qu'on appelait alors le « torpilleur ».
Dans de telles conditions malsaines, mes parents envisagèrent une autre location. Ils s'installèrent alors à la rue Hoche, au 3e étage de la maison Delaud. Ils trouvèrent là un espace agréable, de l'eau courante à l'évier et des W.-C. Mais on ignorait encore l'usage d'une salle de bains, même dans la classe moyenne.
Nous étions en 1928, année où je quittai le foyer familial pour entrer à l'Ecole Normale d'Instituteurs de Draguignan. Mon père se trouvait bien en ces lieux, à quelques minutes des petits bateaux à vapeur qui l'emmenaient à l'Arsenal de Toulon en une demi-heure. Il pouvait rentrer à la maison le midi, et ma mère, de sa fenêtre, pouvait voir le bateau entrer dans le port, ce qui était pour elle le signal de mettre la table.
Les évènements incitèrent tout de même mes parents à quitter ce logement. Une nouvelle propriétaire, Madame Guillaume, augmentait fréquemment le loyer, ce qui Simon n'appréciait guère. C'est dans cette période que mes parents acquirent la petite pinède de Mar-Vivo, qu'ils envisagèrent d'aménager comme future maison de retraite.
On a vu que les complications de sa vie professionnelle incitèrent mon père à quitter l'Arsenal. Il n'avait alors que 48 ans ! Il fut bien inspiré en prenant ce chemin de la liberté, qui lui permit de jouir des plaisirs de la nature, des bois et des rivages dont il sut exploiter toutes les richesses. Sa retraite paisible, il avait su la préparer en fonction de ses goûts, au demeurant très modestes. Il avait acquis une petite voiture (Peugeot 201) pour laquelle il construisit un garage dans sa propriété. Il perfectionna son réseau d'eau par l'aménagement d'une pompe électrique pour remonter l'eau de son puits profond de 17 mètres, et d'un réservoir alimentant la maison et les bassins du lavoir extérieur (qu'il fallait auparavant remplir en tirant des seaux d'eau du puits). Il clôtura la propriété d'un mur surmonté d'une barrière en fer forgé, confectionnée de ses mais de charpentier-tôlier.
Grâce à l'aide d'un ami, il construisit un petit bateau de pêche à fond plat (une « bette ») qu'il appela la « Noune » (ma chérie), prénom marseillais qui lui rappelait les années de sa jeunesse amoureuse, car c'était ainsi qu'il appelait sa future épouse Victorine.
Il acheta un fusil de chasse, une forge, des marteaux de forme diverse, une masse, une bigorne (enclume), une « loube » (longue scie) pour tronçonner les nombreux pins qu'il faudrait abattre.
J'avais apporté à mes parents de grandes joies par mon succès à l'Ecole Normale d'Instituteurs en 1928, par mon entrée à l'Ecole Militaire de Saint-Maixent en 1931, d'où je sortis sous-lieutenant en mars 1932, par mon mariage avec Louise Gautier, institutrice, le 26 mars 1932. Ils furent au comble de la joie le 7 septembre 1933 quand naquit notre premier fils Robert. Quand nous venions passer nos vacances à Mar-Vivo, c'était, pour toute la famille, les Autran, mes grands-parents AUBERT, des joies indicibles.
 |
| |
 |
| |
Hélas ! ce bonheur ne devait pas durer longtemps. Pendant une période de 10 ans, les plus grands malheurs allaient s'abattre sur notre famille et mon père fut rudement secoué par certains d'entre eux qui le touchèrent de très près.
En 1934, il vit mourir mon grand-père AUBERT, emporté par une congestion pulmonaire après 9 jours de maladie. Il avait pour mon Pépé AUBERT la plus grande vénération. J'étais présent quand on procéda à la mise en bière et, pour la première fois de ma vie, je vis mon père, aguerri pourtant à toutes les épreuves de l'existence humaine, je vis Simon verser des larmes sur le cercueil de celui qu'il aima comme son propre père. « Pépé AUBERT, adoré de tous les siens pour sa bonté divine, sa gentillesse, son amour incomparable, les sacrifices qu'il consentit pour sa famille, ses amis, ses voisins ».
Deux ans plus tard, ce fut sans doute le deuil le plus cruel de tous, mon cher Robert qui allait sur ses 3 ans, nous quittait après une opération sans succès (occlusion intestinale) dont je relaterai les péripéties dans ma propre biographie. Il nous fallut bien longtemps, à Louise, à moi, à tous les grands-parents, pour nous remettre d'une telle douleur.
Puis, le spectre de la guerre se leva deux ans plus tard. Je n'en fus pas ému, persuadé, quoiqu'il put se produire, que je n'éprouverai jamais de semblables douleurs après la mort de notre cher Robert.
Et la guerre arriva en 1939, avec tout son cortège de désastres en tous genres. Fait prisonnier le 19 juin 1940, je réussis à m'évader du camp de Pithiviers pour arriver à La Seyne le 19 juillet au quartier Touffany, puis à Mar-Vivo. Inutile de vous décrire la joie des retrouvailles dans la famille. Simon et Victorine reprirent confiance en la vie… et, naturellement, Louise et les siens, rassurés néanmoins depuis quelques jours après la réception d'une carte les informant que j'étais prisonnier à Pithiviers.
Ayant repris mon poste d'enseignant à l'école Martini, il semblait bien qu'une vie normale allait nous sourire. Hélas ! à partir de 1940, avec l'arrivée des Vichyssois au pouvoir, après la débâcle de l'armée française, trahie par les plus hautes instances nationales, la répression allait s'abattre sur les partis politiques de gauche, les organisations démocratiques, etc. A partir de là, d'autres dangers, d'autres malheurs s'abattirent sur les populations pacifiques. Simon AUTRAN allait connaître, lui aussi, d'autres désagréments, et non des moindres.
Le 17 mars 1942, j'étais arrêté, après mon cousin Loulou Meunier, militant actif du Parti communiste à l'Arsenal de Toulon. Cela à titre préventif, pour la simple raison que je demeurais dans le même immeuble au quartier Touffany. Naturellement, tous les miens furent au comble de la détresse. La disette avait contraint mes parents dans cette période à se retirer pendant quelques mois dans un village des Basses-Alpes, Peyruis-les-Mées, logés chez des paysans où ils purent s'alimenter correctement et y faire quelques provisions de bouche.
Après deux mois de cachot à la prison maritime, la police et la justice me relâchèrent et un jugement me fit bénéficier d'un non-lieu (5 mai 1942).
Alors que l'espoir d'une vie sans histoire renaissait dans la maison paternelle, quelques mois plus tard, le 17 octobre, ma mère Victorine fut victime d'un terrible accident qui devait lui coûter la vie. Alors qu'elle rentrait de La Seyne à bicyclette, un camion l'accrocha sur la route des Sablettes (La Maurelle). Transportée à l'hôpital, amputée d'une jambe,elle devait décéder 24 heures plus tard. De cette catastrophe, mon père eut beaucoup de peine à se remettre et à reprendre confiance en la vie. Il éprouva alors de grands moments de découragement. Je fis de mon mieux pour l'aider à vaincre l'adversité. Dans cette période dramatique, il eut aussi à faire pace à des procès : l'un avec son voisin, le fasciste R…, qui lui avait pris une partie de sa propriété pour abattre plusieurs chênes qui, paraît-il faisaient de l'ombrage à quelques-unes de ses vignes ; l'autre avec le propriétaire du camion qui avait tué ma mère.
+ Sa chienne blessée par un soldat italien. Il dut l'achever lui-même.
[Examens à l'hôpital Sainte-Anne : dis-y qu'il a rien ! Il prit son chapeau et s'en alla. On ne le revit jamais à Sainte-Anne].
Ces deux procès, il les perdit et, dans els deux cas, c'est lui qui avait raison, comme cela fut prouvé par la suite. Isolé, sans connaissance efficace qui aurait pu lui apporter quelque secours, face à des affairistes disposant de beaucoup d'argent, il paya, comme on dit, les pots cassés. Il se jura de ne plus jamais avoir recours à la justice française.
Voilà donc un résumé succinct des épreuves cruelles auxquelles Simon AUTRAN eut à faire face pendant plus de 10 années. Et ce ne fut pas tout.
Ayant maigri de façon inquiétante, il ne pouvait même plus penser aux ressources de la mer avec la venue des hordes fascistes de Mussolini sur notre sol, il fut obligé, comme tous les plaisanciers de la côte de ramener son bateau à la maison [à Bastian].
En 1943, ma grand-mère AUBERT, qui habitait encore face à sa maison (« Le Bocage ») mourut, emportée par un cancer du sein. Elle s'était retirée là, avec son fils Paul, veuf depuis de longues années. Cela devait ajouter aux années de malheur qui s'abattaient sur notre famille depuis 10 ans. Les Italiens partirent pour laisser occuper notre beau pays par les hordes hitlériennes.
L'ordre d'évacuer la côte arriva. Mon père fut dans l'obligation d'abandonner sa maison, qu'il avait rendue confortable après des années d travail. Il trouva refuge pendant les quelques mois précédant la Libération à la rue de Lodi, dans un appartement de l'instituteur Arène. Mais il quitta sa maison de Mar-Vivo la rage au cœur comme on pense, non sans avoir pris toutes les précautions pour la rendre inhabitable. Il démonta toute l'installation électrique, les canalisations d'eau potable, et le maximum d'objets utiles furent rassemblés dans mon cabanon de Bastian, où fut également remisée le bateau la « Noune ». Je lui fus d'un grand secours pour sauver ses affaires. A force de réclamations auprès d'un service municipal des évacuations, je finis par obtenir un camion de la Marine servi par une équipe de matelots tous dévoués à la cause des habitants expulsés de chez eux. Tout cela en prévision d'un débarquement des armées alliées sur Les Sablettes et Fabrégas. Le camion de la Marine nous permit de sauver tout le mobilier vers La Seyne.
La voiture (Peugeot 201), il l'avait vendue précédemment peu après la mort de ma mère.
De mon côté, je connus les effets désastreux du bombardement du 29 avril 1944, qui nous mit dans l'obligation de quitter le quartier Touffany. Louise entra à la clinique Malartic évacuée à Montrieux pour accoucher de notre second fils Jean-Claude (24 mai 1944). A sa sortie de clinique, nous trouvâmes refuge à Montmeyan (haut Var), dans une maison très confortable prêtée par une cousine de mon grand-père AUBERT, Geneviève Sicard, née Blanc, à Six-Fours.
Ces évènements nous séparèrent de mon père pendant plusieurs mois. Il avait tout de même échappé aux bombardements du 29 avril. Dans le courant du mois de juin, il réussit, malgré les difficultés de communication, à venir à Montmeyan pour connaître son petit-fils Jean-Claude.
Au mois d'août 1944, nous fûmes au comble de la joie en voyant arriver à Montmeyan des chars d'assaut américains. Nous fûmes alors informés qu'une armée française (De Lattre de Tassigny) était chargée de libérer Toulon et ses environs. Nous étions alors au 25 août. Qu'était devenu Simon ? J'étais dans la plus grande inquiétude, ne sachant rien sur les évènements seynois.
Mon père s'était refusé à quitter sa maison où il avait pu sauver quelques affaires personnelles. La majorité de la population avait fui les pires dangers. Simon avait renoncé à partir. Il était résigné depuis les épreuves cruelles qu'il avait subies et les dangers le laissaient indifférent.
Je raconterai par la suite comment, le 25 août, je quittai Montmeyan pour le Luc, avec les Sicard, en direction de Toulon et La Seyne. Après des spectacles d'horreur sur lesquels je reviendrai dans mon autobiographie, j'arrivai à La Seyne en fin d'après-midi devant la demeure de mon père [rue de Lodi]. Aux coups de poings nerveux assénés sur la porte, j'entendis s'ouvrir timidement les volets du 1er étage. Simon me sourit et vint ouvrir une porte bien verrouillée. Quel soulagement ! Il n'avait rien vu ! Il avait certes entendu les canonnades de l'Arsenal, repris par les Français. Il n'en savait pas davantage. Et pourtant La Seyne n'était pas tout à fait libérée. On se battait encore au fort Napoléon et le fort du Peyras n'était pas encore tombé.
Durant les quelques jours passés avec lui, il me fit part, non sans émotion, de se mettre en ménage avec une veuve qu'il connaissait depuis peu de temps. Il lui importait de savoir ce que je pensais de ce projet.
Je lui fis remarquer qu'il était seul maître de ses décisions, mais je trouvais ses intentions tout à fait normales.
Il fut rassuré par mon propos et me fit part de ses projets immédiats : rendre la maison de Mar-Vivo habitable, remettre en place tout ce qu'il avait démonté, remeubler. Mais il ne souhaitait pourtant pas y retourner y habiter de sitôt, car, disait-il : J'y aurais trop de souvenirs de la vie heureuse vécue avec Victorine ».
La maison de Mar-Vivo, « Lei Gari », fut en effet remise en état, ce qui me permit de l'occuper pour la rentrée des classes au mois d'octobre 1944 en rentrant de Montmeyan. Ceci car notre appartement au 1er étage de la maison du quartier Touffany, gravement sinistré lors du bombardement du 29 avril, exigeait des réparations sérieuses. Et puis, à la vérité, je n'avais pas l'intention d'y retourner, car la cohabitation avec les Meunier présentait tout de même des inconvénients. Il fallait bien sûr utiliser les crédits des sinistres auxquels j'avais droit : Touffany, maison de Cavaillon (immeuble de 2 étages, ancienne possession de l'oncle Victor Hermitte, dont j'avais hérité de ma grand-mère, qui fut entièrement pulvérisé le 29 avril). En échange, j'obtins par la suite, un logement neuf au boulevard Staline.
Après son remariage avec Joséphine Guimberty [le 4 octobre 1944, à La Seyne], mon père préféra louer une maison aux Sablettes, le « chalet René » (impasse René), non loin de son bateau qu'il avait pu sauver des désastres de la guerre et qu'il avait pu remettre à l'eau. Il demeura près de 6 ans dans ce quartier alors tranquille et nous passions souvent les journées du dimanche ensemble. Remarquons au passage que c'est nous qui apportions les victuailles, sa seconde femme, que nous appelions Phi-Phi, n'avait jamais rien à nous offrir, tenaillée qu'elle était par une avarice sordide.
Il n'est pas inutile de m'arrêter quelques instants sur cette veuve Gay, née Guimberty, que je peux appeler ma marâtre, entièrement soumise à l'autorité inflexible de Simon, qu'elle respectait surtout parce qu'il avait acquis une retraite de la Marine substantielle. En épousant Simon, elle avait assuré son avenir.
Elle lui rendait les petits services qu'une épouse doit rendre à son mari : faire son lit, balayer l'appartement, laver son linge. Mais le travail ne l'épuisait guère. Elle ignorait les grands nettoyages, les grandes lessives. Elle faisait peu de cuisine pour la simple raison qu'elle ne savait pas la faire. Elle ne possédait aucune qualité d'une femme de ménage ou d'une maîtresse de maison. Elle ne sortait guère de chez elle et c'est mon père qui tenait les finances et qui assurait le ravitaillement du ménage. Lui seul, d'ailleurs, savait faire des calculs. Ignorante, bavarde, malpropre, ce n'est pas ce que Simon fit de mieux dans sa vie en épousant une telle créature. Il me confia plusieurs fois sa déception : « Elle ne vaut pas ta mère, loin s'en faut ! ». Il fallut faire avec. Toutefois, elle n'osa jamais se rebeller contre les réflexions parfois acerbes de son mari. Elle obéissait servilement et avalait souvent des couleuvres.
On pourrait écrire un roman sur cette femme, son avarice et sa stupidité. La stupidité faisait qu'elle croyait que son avarice passerait inaperçue. Quelques anecdotes évocatrices, parmi beaucoup d'autres :
- A la fin des années 40, le vrai café était diificile à trouver et très cher. Les gens se contentaient souvent de café de pois chiches. Lorsque certains dimanches, nous allions déjeuner chez mon grand-père au Chalet René, mes parents se procuraient exceptionnellement quelques grammes de poudre de vrai café pour ce jour de fête. Que faisait Phi-Phi ? Incroyable mais vrai : elle gardait le vrai café pour elle dans la semaine et servait le dimanche à mes parents et à ma grand-mère Gautier son café de pois-chiches, croyant les rouler sans qu'ils s'en aperçoivent... Simon devait bien s'en apercevoir aussi, mais il ne disait rien, du moins sur le moment.
- Elle savait que ma mère, plutôt fragile du foie, ne mangeait pas certains aliments genre gibier. Une fois, elle avait calculé au plus juste les parts d'un lapin en sauce, comptant que ma mère n'en mangerait pas. Et elle demanda à ma mère avant de servir : « Vous, je crois que vous n'en mangez pas de ça ? ». Mais, comme il n'y avait rien d'autre, ma mère répondit que oui, elle en mangerait. Alors Phi-Phi lui répondit avec cette phrase sublime : « Mais si vous en prenez, il n'y en aura pas pour tout le monde ! ».
- Une fois par an, environ, les cousins de Marseille (toute la famille Lieutaud) s'invitaient chez mon grand-père. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque et il arriva qu'ils débarquent à l'improviste en disant : « On a voulu vous faire la surprise ! » Ce n'était pas forcément une très bonne idée car il y avait rarement de quoi nourrir tout ce monde. Un dimanche, nous étions invités chez mon grand-père, nous étions donc une table de 6, et Phi-Phi il y avait encore du lapin au menu. Et les Marseillais débarquent ! A huit ! Peut-être avaient-ils apporté un petit accompagnement, mais le plat principal restait le lapin, qui, prévu pour 6, avait dû servir pour 14 le midi, et encore pour les 10 restant le soir. On avait appris par la suite par certaines indiscrétions que, le soir « ils se regardaient », comme on dit chez nous.
- Ma grand-mère Gautier, souffrant de rhumatismes à l'époque, lui avait demandé un après-midi de lui prêter sa chaise longue. Avarice ? Malentendu ? Phi-Phi lui répondit : « Elle est cassée ! ». Ma grand-mère prit très mal ce refus, bien que mon grand-père Simon avait aussitôt rectifié en disant : « Je vais vous la chercher, moi, la chaise longue » - qui n'était d'ailleurs pas cassée. Ce fait divers fut à l'origine de bien des plaisanteries et de fou-rires en famille, à chaque fois que, pour une raison ou pour une autre, la phrase « Elle est cassée ! » fut entendue. Et ma grand-mère Gautier voua à partir de ce jour une haine. Mais quand on allait chez mon grand-père, et que chacun devait se faire la bise en arrivant, ma grand-mère disait en elle-même : » la mordriou ! ».
Oou Fifiguette ! Qu'est-ce qu'il dit de la bicyclette ?
Dans ses rapports avec nous (Louise et sa mère), elle se révéla souvent comme une personne détestable, surtout à cause de son avarice outrancière. Elle avait pour moi une certaine considération, surtout quand j'apportais régulièrement le jeudi des produits de ma propriété de Bastian : fruits, bonbonnes de vin, légumes, etc. Par contre, elle eut avec Mémé Gautier et Louise des rapports plus distendus, celles-ci lui reprochant avec franchise son avarice sordide.
Mon père trouvait tout de même les moyens de se procurer des plaisirs variés : il chassait, il pêchait, il bricolait dans un petit atelier qu'il s'était fabriqué avec des cornières et des tôles ondulées.
Il revenait du petit port des Sablettes, établi du temps de Michel Pacha, avec des corbeilles de coquillages (moules, surtout des moules rouges qu'il affectionnait, praires, violets, bigorneaux,…) , des soupes de poissons (gobis, rouquiers), des fritures de rougets dont il était particulièrement friand.
Il passait son temps à bricoler car il savait travailler le bois, le fer, le ciment. On pouvait dire de lui qu'il avait des mains.
Il s'appliquait à fignoler tout ce qu'il faisait : rideaux en roseaux et perles, tables de jardins, engins de pêche, etc. Il aimait le travail bien fait et ne mesurait jamais ni son temps ni sa peine, mais s'arrêtait souvent pour « rouler » une cigarette. Ah ! ce tabac maudit qui lui coûta prématurément la vie.
Il apprit aussi à cultiver un lopin de terre dans une partie de sa pinède débroussaillée. Il récoltait à souhait fèves salades, tomates : il attrapait aussi du menu gibier.
Les années qui suivirent la Libération furent fertiles en évènements de toutes sortes. S'intéressant de près aux questions politiques, il suivait attentivement l'évolution de la situation en France et dans le monde, et surtout à La Seyne, plus particulièrement à partir du moment où je fis partie de la Municipalité sous la direction de T. Merle. Il assistait souvent aux réunions publiques, aux séances de cinéma de l'association France-URSS, aux fêtes du Parti communiste.
Politiquement, il ne faisait plus guère confiance au Parti socialiste qu'il avait soutenu avant guerre pendant plus de 20 ans. Au fil des années, après la scission socialiste de 1935, il désapprouva Renaudel avec la création du Parti Socialiste de France. Il reprochait au Parti Communiste d'alors son langage excessif, mais les évènements, la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie, l'incitèrent à se rallier aux positions défendues par Maurice Thorez.
Il abandonna complètement ses amis socialistes, se brouilla même avec certains et devint un sympathisant communiste. Il soutint le P.C.F. dans toutes es campagnes électorales, de 1945 à 1962, année de son décès. Il ne voulut jamais être encarté, car il tenait trop à sa liberté, ne voulant être astreint à aucune obligation. Il accepta tout de même de faire figurer son nom dans les comités de soutien aux candidatures communistes.
Je lui rendais visite au moins une fois par semaine et là, autour d'un pastis léger, je lui rendais compte de toutes les affaires municipales en cours. Il fut tout heureux, des années durant, des succès de la Municipalité T. Merle, et donc des échecs de ses anciens amis socialistes. Il ne cachait pas sa fierté de me voir participer au Conseil municipal. Il le fut bien davantage lorsqu'en 1959 je devins adjoint au Maire, spécialisé dans les problèmes de l'éducation nationale et la question des œuvres péri- et post-scolaires. Il lisait avec avidité les articles de presse locale que j'écrivais, surtout dans « Le Petit Varois - La Marseillaise ».
Vers 1960, il se plaignit de divers malaises (vertiges, manque d'appétit, fatigue générale). Il renonça même à la pêche et vendit sa petite barque qui lui avait apporté tant de joies pures. Il sortit de moins en moins de chez lui. Un mal inconnu, sournois, faisait lentement son chemin.
Vers le mois de juillet de l'année 1961, il se plaignit de violentes douleurs au thorax, du côté droit, au sommet du poumon. Un jour, n'y tenant plus, il m'envoya quérir un calmant. Je pris d'abord contact avec le Docteur Raybaud du Centre Médico-Social, lequel me fit une ordonnance pour obtenir du « palfium ». Quelques jours après, une radio révélait le mal véritable : il s'agissait d'un « néo », c'est-à-dire d'un cancer du poumon.
Raybaud vint le voir à la maison et lui expliqua qu'il souffrait d'une grande décalcification. Simon ne fut pas totalement convaincu.
En dépit des soins, des remèdes aux vagues matricules, le mal prenait de plus en plus d'empire sur un corps devenu squelettique. Il avait pour la première fois cessé de fumer.
Mon père luttait courageusement. Il ne s'alimentait presque plus, mais il ne resta jamais alité, il se rasait chaque matin, lisait le journal et faisait son mot croisé, sauf le jour de sa mort. Une toux insupportable le faisait crier de douleur. Quand le docteur Richard vint, sa tension était tombée à 5 et bien évidemment, le cœur s'arrêta.
Le 30 mars, vers 11 h du soir, il s'éteignit, sans m'avoir reconnu dans ses derniers instants. J'avais seulement pu le voir le matin même de cette journée fatale, malgré une forte grippe qui m'avait mis à mal. Il avait esquissé un sourire et au moment de quitter sa chambre, il prononça ces mots « mon petiot », et fit un geste de sa main tremblante pour me signifier qu'il allait « partir ».
Comme il l'avait souhaité, ses obsèques se déroulèrent très simplement : ni fleurs, ni couronnes, ni prêtres, pas de condoléances.
Une foule nombreuse l'accompagna à sa dernière demeure, celle où il alla retrouver sa chère « Noune » qui l'attendait là depuis 20 ans, son cher petit-fils Robert, enseveli depuis 1936. Une foule d'amis, de voisins, de retraités, de membres de l'enseignement, de la Municipalité, avaient tenu à lui rendre un dernier hommage. Le maire T. Merle était présent, de nombreux professeurs de l'école Martini, le proviseur A. Bertrand, des représentantes du collège Curie, par amitiés pour Louise, avaient tenu à s'associer à notre peine.
Au moment de quitter la petite maison de Mar-Vivo « Lei Gari »), nous eûmes même la surprise de voir se mêler au cortège un vieil ami de Ferryville, Paul Descombes, informé par la presse de la disparition de son camarade Simon. J'invitai ce brave homme à prendre place parmi les membres de la famille derrière le cercueil funèbre.
Deux heures plus tard, la cérémonie terminée, nous rentrions à Mar-Vivo (ou étaient restées Joséphine Gautier qui toutes deux auraient eu de la peine à marcher pour suivre le cortège). Lei gari seraient désormais occupés par la seconde épouse de Simon, préoccupée dès l'instant de savoir quel serait le montant de sa pension de réversion.
J'avais fait, avec l'aide des miens, tout ce qui était humainement possible pour faire soigner mon père. Malheureusement, le mal fut plus fort que la science des médecins, surtout qu'il s'agissait de l'un des cancers les plus redoutables et les lus redoutés (et cela reste vrai 50 ans après !). D'ailleurs, les premières radios effectuées par le Dr Raybaud avaient été significatives.
Voilà, brièvement résumée, la vie de cet homme simple, courtois, d'une rectitude exemplaire, un homme à l'enfance rude qui sut s'élever dans la société, s'instruire, se faire une situation honorable et s'acquitter de ses obligations familiales, paternelles, sociales, dans une parfaite dignité. Je ne vois pas les reproches sérieux qu'on aurait pu lui faire. Son caractère était parfois rude, marqué souvent par l'inquiétude et le doute. Il reconnaissait lui-même les moqueries que lui adressaient ses plus vieux copains qui l'appelaient souvent « Simon l'inquiet ». Mais sa franchise en imposait à son entourage. Il avait rêvé de se retirer du monde du travail pour se livrer en toute liberté à ses occupations favorites : le bricolage, la chasse, la pêche, le travail de la terre, l'exploitation de la nature, en forêt surtout.
Il parvint admirablement à satisfaire ses goûts. Il vécut sans doute en égoïste, mais après avoir vu et ressenti tant de choses désagréables dans sa jeunesse, on peut comprendre ce désir légitime de repos, de tranquillité, d'une vie paisible dont il a su profiter de longues années.
Il avait seulement 74 as et 4 mois quand il mourut. Ce n'était certes pas un grand âge et il était encore dans la plénitude de ses moyens physiques et intellectuels quand le mal s'abattit sur lui. Il nr méritait pas de mourir dans des souffrances atroces comme hélas ! ce fut le cas. Mais est-il permis aux petites natures que nous sommes de formuler des jugements et des espoirs face à l'insondable éternité ?
Cette biographie est certes bien incomplète. Les grandes lignes seulement en sont tracées. On trouvera par la suite dans l'autobiographie qui va suivre d'autres récits et faits auquel mon père fut mêlé et qui permettront au lecteur de se faire une idée plus juste de l'homme qu'il fut, de ses idées, de ses opinions, de son comportement vis-à-vis des siens et plus généralement vis-à-vis des autres.
Avant de terminer ce récit, il m'a paru nécessaire d montrer, en quelques phrases, les difficultés qui ont surgi, après sa disparition, entre sa seconde épouse (ma marâtre) et ma propre famille.
Cette dernière, dont j'ai évoqué succinctement dans ce qui précède, la cupidité et la stupidité, intrigua pour me faire perdre l'héritage paternel - que je possédais déjà à 50 % depuis le mort de ma mère.
Mon père mourant, son épouse tenta de se faire attribuer la succession, opération à laquelle mon père ne se prêta point. Il lui rétorqua que son fils étant déjà propriétaire de la moitié, il serait en droit d'exiger une vente pour lui permettre de récupérer sa part d'héritage, et qu'après sa mort il aurait droit à la plus grande part du bien restant.
Renseignements pris chez deux notaires différents, les choses devaient se passer ainsi : la veuve Guimberty pourrait bénéficier seulement d'un huitième de la propriété, en jouissance.
Pour récupérer quelque chose, elle me proposa de vendre la propriété, opération à laquelle je m'opposais. Je lui garantissais quand tout de même le logement. Jamais je n'aurais osé mettre la veuve à la porte, laquelle se sentait d'ailleurs terriblement seule : le seul voisin qu'elle avait alors était mon oncle Paul AUBERT, affaibli par la maladie, et qui fut hospitalisé peu après à La Seyne.
Les intrigues de la veuve n'avaient pas abouti. Sa conduite odieuse était la réponse aux services pourtant appréciables que je lui avais rendus. Un mois après la mort de son mari, j'avais pu obtenir par un ami que la pension de réversion lui soit accordée le plus tôt possible.
Je crois me rappeler qu'un an ou deux après son veuvage, madame AUTRAN Simon (pas la vraie) se résolut à quitter Mar-Vivo pour vivre à Toulon à proximité d'une nièce qui lui conseilla par la suite d'entrer dans une maison de retraite à Hyères, où elle mourut le 16 avril 1974 à l'âge de 83 ans.
Cette dernière partie du récit ne concernait pas directement mon père, mais je voulais que mes descendants sachent la vérité. Cette personne odieuse que fut « Phi-Phi » a vécu pendant 20 ans sur ma part d'héritage et je n'ai jamais rien demandé en contrepartie. Et en remerciement de ma générosité, elle avait tenté de me déshériter, ce que Simon AUTRAN refusa de faire, ce qui fut tout à son honneur.
La maison de Mar-Vivo, devenue libre, je me mis en devoir d'y faire les réparations urgentes. Elle nous permit d'y passer de nombreuses journées, surtout à partir des années 65 et 66 où Louise et moi commencions notre retraite. Mais « Lei Gari » vieillissaient. L'ombre de Simon persistait. Les enfants, de loin en loin, venaient y passer quelques jours de vacances, mais les dégradations s'y accumulaient. Ne pouvant plus entretenir mes propriétés de Mar-Vivo, de Bastian, de Châteaubanne, je me résolus à vendre « Lei Gari », non sans un pincement au cœur.
L'acquéreur, M. Tissot, résolut de reconstruire sur le même emplacement. Ainsi se termine la biographie de Simon AUTRAN, dont il me reste les outils de travail, de nombreux objets qu'il confectionna avec sa minutie coutumière, et aussi un flot de souvenirs inépuisable que ma vieille tête conserve encore un peu.
La Seyne-sur-Mer, le 21 février 2002
A la mémoire de Louis GAUTIER
Il eut été inconcevable que parmi les multitudes d’écrits qui resteront dans les archives de nos familles AUTRAN-GAUTIER, rien n’ait été écrit sur Louis GAUTIER, le père de Louise.
Arraché à l’affection des siens, alors âgé de 25 ans, sa courte existence a laissé suffisamment de souvenirs pour que je me fasse un devoir d’apprendre à nos enfants et petits-enfants ce qu’il fut et comment sa disparition tragique plongea tous les siens et toute une population dans la consternation.
Louis GAUTIER est né le 13 août 1886 à Toulon. Son père, Etienne Gautier, était né en 1844 à La Bollène-Vésubie (Alpes-Maritimes – A l’époque, « province du Piémont »). Sa mère était d’origine inconnue et avait été à la charge de l’Assistance publique.
Ses parents étaient déjà “vieux” quand il naquit. Avant sa naissance, ses parents avaient perdu trois enfants en bas âge. Son enfance ne fut pas très heureuse et, aux dires de Mémé GAUTIER, il était souvent battu injustement.
Il fut apprenti mécanicien de bonne heure. Il avait obtenu son Certificat d’Études le 18 juin 1897 alors qu’il n’avait pas 11 ans. Un ami de mon père disait l’avoir connu à l’apprentissage et avoir été frappé par sa vive intelligence.
A l’époque, il n’était pas question de donner aux enfants une éducation solide. D’abord, les parents n’en avaient pas les moyens ; et puis, les équipements scolaires étaient inexistants, ou presque. Louis était le fils d’un ouvrier de l’Arsenal et on ne pouvait alors imaginer qu’un fils d’ouvrier puisse entreprendre des études de longue durée.
L’école primaire n’en était qu’à ses débuts, puisque les lois sur la laïcité datent de 1886.
En 1897, c’est donc pour l’enseignement primaire une période d’organisation.
Dans la partie de mes archives familiales intitulée « Distinctions honorifiques », on pourra retrouver le diplôme du C.E.P. daté du 18 juin 1897 attribué à Louis GAUTIER.
Mémé GAUTIER, que j’ai interrogée sur l’enfance et l’adolescence de son mari, n’a pas pu me rapporter grand-chose. Elle savait seulement qu’après avoir quitté l’école, nanti de son Certificat d’Études, Louis avait travaillé aux Forges et Chantiers de La Seyne et qu’il s’engagea dans la Marine Nationale vers 1905 ou 1906, c’est-à-dire vers 19 ou 20 ans. La précision se trouve certainement dans ses papiers militaires conservés comme des reliques (« Livret de solde »).
Engagé pour 3 ans, il devient rapidement matelot mécanicien diplômé, puis, très vite, quartier-maître.
C’est alors qu’il navigua sur des navires de guerre. A l’un de ses portraits conservés dans la collection de photos de famille, on trouve fixée une médaille commémorative d’une campagne qu’il fit au Maroc. L’inscription « Casablanca » y figure.
Il effectua plusieurs missions sur des bateaux de la Marine Nationale, entre autres à Madagascar, sur le Descartes et le D’Entrecasteaux. Son admissibilité au grade de second maître était acquise après ces campagnes. Sans doute aurait-il eu une brillante carrière d’officier marinier.
Mais, craignant de repartir vers des contrées lointaines, pour des voyages fort longs, alors qu’il avait fait la connaissance de sa future épouse, il renonça à la Marine militaire et préféra entrer dans le corps des Vétérans, catégorie de mariniers affectée au port militaire de Toulon (1910) et chargée d’activités propres à l’intérieur du port et de la rade.
Louis GAUTIER et Joséphine MATHIEU firent connaissance à La Seyne. Les parents GAUTIER habitaient au 45 de la rue Denfert-Rochereau. Retraité de l’Arsenal, le père de Louis, déjà âgé de 66 ans, n’avait pas un caractère facile. Louis avait hâte de quitter la maison familiale.
Joséphine MATHIEU habitait alors au 28 rue Beaussier, avec sa mère, Madeleine, née MARTINENQ, ainsi qu’avec sa sœur Fernande, née en 1892 et son frère Marius, né en 1895, qui mourra à 20 ans (1915) de la tuberculose.
En 1910, Louis GAUTIER demanda Joséphine MATHIEU en mariage. Grand-mère MATHIEU, veuve depuis 1908, ne s’opposa pas à cette union, d’autant que son futur beau-fils avait une solide réputation de garçon sérieux, travailleur et intelligent.
Le mariage se fit en janvier 1911. Cette union promettait un ménage heureux, car, de son côté, Joséphine GAUTIER, âgée de seulement 22 ans, d’une santé robuste, savait tout faire de ses mains. Excellente ménagère, couturière, elle aurait pu rendre son mari heureux, toute une vie durant.
Hélas ! Ce bonheur fut de courte durée. Installés au Pont du Las*, Louis était à proximité de son travail. Et Joséphine se trouva enceinte très peu de temps après le mariage.
*
On n'a jamais retrouvé leur
adresse exacte dans nos archives familiales, ni dans le recensement de
Toulon
Quelques mois plus tard, un incendie ravagea en partie la maison qu’habitaient les jeunes époux. Il fallut remettre l’appartement en état, renouveler certaines pièces de mobilier. Mais cela ne fut pas le plus grave.
Cage avec les deux canaris retrouvés brûlés.
Seaux d’eaux jetés par les cheminées.
Occupé à réorganiser son foyer, Louis demanda à l’un de ses camarades de travail de le remplacer pendant quelques jours à son poste et il fut convenu que Louis lui rendrait ces jours de travail à une prochaine occasion.
Hélas ! L’occasion se présenta le 25 septembre. Louis GAUTIER était de service ce matin là au port de Toulon. A 5 heures du matin, quittant le domicile pour aller prendre son poste au port de Toulon, tout proche, on imagine qu’il dut embrasser sa jeune épouse, alors enceinte de 8 mois et demi – pour la dernière fois. Elle ne le reverra plus jamais.
A 5 heures 30 un incendie se déclara à bord du cuirassé Liberté mouillé au milieu de la rade de Toulon, entouré d’ailleurs d’autres navires car la flotte de guerre du premier port de guerre de la France était alors très nombreuse.
Je ne raconterai pas le détail de cette sinistre journée. Des coupures de journaux de nos archives de famille expliquent longuement comment les faits se sont déroulés.
Le 25 septembre 1911 était un lundi. Une partie importante de l’équipage de la Liberté était en permission. Le commandant lui-même n’était pas à bord. La plupart des officiers supérieurs également. Néanmoins l’équipage s’efforçait de contenir le sinistre. Le feu s’était déclaré dans les soutes à gargousses avant. L’ordre de noyer les soutes ne fut pas donné tout de suite. Les responsabilités ne furent jamais totalement définies.
Ce dont on est sûr aujourd’hui, c’est que cet incendie faisait partie d’une série d’accidents graves qui endeuillèrent la population de Toulon et de sa région de 1900 à 1911 (poudrière de Lagoubran, incendie du Iéna en cale sèche,…). Il a été dit aussi que, l’Allemagne qui se préparait activement à la guerre (l’affaire d’Agadir en est une preuve concrète), elle envoyait des espions partout, de sorte que l’incendie de notre cuirassé Liberté aurait pu être un maillon de la chaine infernale visant à affaiblir nos défenses…
A bord de la Liberté, l’incendie prenant de l’ampleur, le “Sauve qui peut” fut lancé et, soit par embarcations, soit à la nage, quelques hommes d’équipage purent commencer à s’éloigner du navire en feu.
Puis, une accalmie s’étant manifestée, un officier de service fit sonner le rappel à bord par un clairon. Décision maladroite s’il en fût et qui fut sans doute jugée avec la plus extrême sévérité par la suite. L’équipage reprenait possession du navire.
C’est alors que Louis GAUTIER monté sur une chaloupe, en remplacement du camarade qui lui avait rendu service quelque temps auparavant, s’approchait avec quatre autres vétérans du sinistre cuirassé, par ordre de la Direction du port. Saura-t-on jamais la mission dévolue à cette frêle embarcation qui ne pouvait rien contre un tel sinistre ?
Il y avait eu depuis le début de l’incendie plusieurs explosions (il faudrait dire aujourd’hui implosion) qui avaient causé des dommages matériels à l’intérieur du cuirassé. Mais une accalmie s’était produite.
C’est alors, à 5 h 55 préisément, que la formidable explosion se produisit qui fit trembler les êtres et les choses à des kilomètres à la ronde. Des habitations les plus proches, des carreaux volèrent en éclats, les meubles furent déplacés. Certains crurent à moment qu’il s’agissait d’un séisme.
Une moitié du cuirassé sortit de l’eau et se replia sur l’autre dans un fracas indescriptible de tôles tordues, de charpentes fumantes, d’embarcations broyées, de ferrailles de toutes sortes projetées à la ronde. Une épaisse fumée noire, chargée de gaz toxique, cachait momentanément ce spectacle effrayant, terrifiant. Spectacle épouvantable qui devait se graver à jamais dans la mémoire des témoins.
Les cris déchirants des blessés accrochés à l’épave, la plupart affreusement mutilés, parvenaient aux alentours. Cris de ceux, dont les corps avaient été projetés, qui se débattant dans l’eau et qui furent noyés faute de secours immédiats. Certains qui s’affairaient dans les entreponts furent noyés presque instantanément. Les scaphandriers qui explorèrent les derniers fragments de l’épave trouvèrent encore des squelettes dans les compartiments inférieurs du navire.
Des corps ne seront jamais retrouvés. On a parlé de 22’ victimes. Il faut y ajouter, je crois, celles des navires voisins mouillés à proximité de la Liberté. Le nombre des victimes devait donc voisiner les 300. Quel désastre ! Quelle désolation !
Bien évidemment, beaucoup de navires ou embarcations de secours comme la chaloupe de Louis GAUTIER et ses camarades furent défoncées, coulées ou projetées. Oui ! C’est ce matin terrible du 25 septembre que périt celui que je n’ai pas connu et dont j’ai épousé la fille 21 ans plus tard.
Louis GAUTIER savait qu’il allait être père. Comme nous l’avons dit, Joséphine GAUTIER était enceinte et sur le point d’accoucher. Ce matin du 25 septembre, elle ne pouvait se douter de l’immense douleur qui l’attendait, ne sachant pas encore que son mari s’était porté au secours du navire en flammes.
La population seynoise, rassemblée sur le port, concentrée vers le môle dit “La Caisse”, observait de loin cet amas de ferrailles tordues, épave tragique qui renfermait dans ses entrailles, des jeunes gens, des pères de famille, dont on ignorait encore l’identité.
Mais il fallait aussi retrouver les morts qui flottaient dans les eaux de la rade, il fallait secourir les blessés qui furent atteints sur les navires mouillés à proximité de la Liberté.
Toutes les embarcations disponibles fouillaient les abords de l’épave, cherchaient à repêcher des corps que la vie ne semblait pas avoir quitté tout à fait. Ce ne fut que vers le soir que l’on apprit que Louis GAUTIER avait péri dans ce cataclysme.
Sur les quelque trois cents victimes, il n’y avait eu qu’un seul Seynois, ce fut l’infortuné père de Louise.
Inutile de décrire l’immense douleur de Joséphine GAUTIER, de sa mère (grand-mère MATHIEU), des parents GAUTIER. Que de fois il m’a été donné d’entendre l’immensité de la douleur des uns et des autres.
Le corps de Louis GAUTIER ne fut retrouvé que le jeudi 28 septembre. Des témoins affirmèrent qu’il avait été gravement atteint à la tête.
[Que de fois, j’entendis ma grand-mère redire cette phrase à des amies, dans les années 50, donc quarante ans après le drame : « Il l’ont retrouvé deux jours après, au fond de l’eau. Il avait une « côte sortie » et un « gros trou à la tête » »
Son corps fut transporté à Saint-Mandrier, probablement à l’Hôpital militaire où une chapelle ardente avait été aménagée. Ce fut grand-mère MATHIEU, elle qui avait déjà éprouvé tant de malheurs avec la disparition de son mari en 1908, d’une fillette de 4 ans qui mourut de la diphtérie – une maladie que l’on ne savait pas soigner à l’époque (elle qui devait encore voir disparaître un fils de 20 ans quelques années plus tard), ce fut elle qui alla reconnaître le corps de son beau-fils à Saint-Mandrier. Elle ramena de ce spectacle d’apouvante un pompon rouge et une boucle blonde.
Dans les jours qui suivirent, tous les ferblantiers de la région furent mobilisés pour souder les cercueils en plomb. Parmi les victimes, il y eut de nombreux Bretons dont les corps devaient retrouver leur pays d’origine.
Les obsèques nationales des victimes furent organisées le 3 octobre, car il fallait parer au plus vite à la décomposition des corps, d’autant que nombre d’entre eux étaient atrocement mutilés.
Je crois bien que ce fut seulement vers 1925 que la partie immergée de l’épave put être décollée du fond de la rade, pour être finalement remorquée à terre et être découpée au chalumeau. Et là, j’en appelle à des souvenirs personnels puisque la presse locale avait donné cette information qui n’avait pas manqué de répandre une profonde émotion dans la population, à savoir que l’un des scaphandriers avait été aux prises avec une pieuvre énorme qui avait élu domicile dans l’épave, tandis qu’un autre s’était trouvé en tête à tête avec un cadavre humain qui flottait encore dans un compartiment presque hermétiquement fermé.
Revenons-en aux heures tragiques de ce début d’octobre 1911. Je ne raconterai pas par le détail les obsèques des victimes, obsèques nationales qui se déroulèrent le 3 octobre en présence du Président de la République Armand FALLIÈRES.
On trouvera, joint à ce document, un compte-rendu de presse qui résume cet évènement qui fit accourir des foules innombrables de Toulon, de La Seyne et de tous les environs. Maintes fois, dans ma famille, j’ai entendu raconter cet événement qui fit date dans l’histoire locale et nationale. Mes parents en furent les témoins.
Le témoignage le plus concret me fut porté par ma mère, qui se rendit à Toulon en me portant sur son bras. Elle avait 21 ans à peine. Quelle imprudence ! S’en aller assister et participer à un tel rassemblement avec un enfant de 10 mois sur les bras ! Car cet enfant, c’était bien moi, moi qui faillit périr ce jour-là en prenant mon premier bain de foule.
Voilà la première aventure de ma vie, dont je n’ai bien sûr aucune souvenance et que ma mère m’a relatée à peu près dans ces termes :
Le long cortège de militaires, de cavaliers, de prolonges d’artillerie emportant les cercueils plombés, que suivaient des familles éplorées, les personnalités,… cette foule s’avançait sur le boulevard de Strasbourg, en provenance sans doute de l’Arsenal pour s’acheminer vers la gare, entre des milliers de curieux accumulés sur les trottoirs. Cette foule silencieuse allait, tout à coup, connaître une panique effroyable, une désolation, qui vint s’ajouter aux souffrances indicibles des familles dont certaines étaient venues de l’autre bout de la France.
A un certain moment, le bruit d’une explosion, minime certes, mais suffisante pour émouvoir la foule, se fit entendre. Les témoignages les plus sérieux affirment qu’elle se serait produite à cause des fermentations dans l’un des cercueils plombés. La chose est très plausible si l’on pense que les cadavres du 25 septembre ne furent enterrés que le 3 octobre et même plus tard pour certains autres.
Cette explosion aurait effrayé des chevaux (il y en avait des centaines) lesquels auraient reculé, se seraient cabrés, et des mouvements de foule s’ensuivirent. Des individus louches, de ceux qu’on appelait alors des apaches, lancèrent le cri de “Sauve qui peut”. Le cortège fut donc disloqué, les gens fuyaient sous l’effet d’une panique indescriptible. Et des centaines de personnes se trouvèrent dépouillées de leurs affaires et de leur argent.
Ma mère pouvait parler savamment de ces évènements. Quand le cortège commença à refluer, la bousculade la jeta à terre. Elle était alors sur le boulevard de Strasbourg, à hauteur du magasin Les Dames de France. Elle n’eut que le temps de se mettre “à quatre pattes”, de me placer sous son corps, alors que sur son dos dévalaient des inconnus dans une fuite éperdue. Meurtrie des pieds à la tête, elle put cependant se relever et trouver refuge dans une rue transversale,… jurant, mais un peu tard, de ne plus se mêler ainsi à la foule. Elle avait 21 ans ! Et sa curiosité faillit nous coûter la vie à tous les deux.
| Obsèques des victimes du
cuirassé Liberté La panique |
Dans ce désordre indescriptible, cette manifestation perdit vraiment son caractère de solennité.
Les comptes-rendus de presse indiquent que le Président de la République fut retrouvé tout seul, à un moment, devant le Grand Théâtre, sans aucune escorte. Le service d’ordre n’existait plus. Les Ministres de la Marine (Delcassé) et des Finances (Caillaux), et bien d’autres, avaient complètement perdu le contact avec les officiels du cortège. Spectacle lamentable qui devait encore aggraver la dureté du malheur.
Le corps de l’infortuné Louis GAUTIER, seul Seynois qui périt sur la chaloupe de la Direction du Port alors qu’il se portait au secours de la Liberté en feu, enfermé dans son cercueil de plomb, avait été détaché du cortège dès le départ pour être acheminé vers le port de La Seyne par une chaloupe de la Marine.
On fit pour lui seul, à La Seyne, des obsèques grandioses. La population profondément remuée, surtout en sachant qu’il devait être père quelques jours plus tard, assista massivement à son enterrement.
Son corps fut déposé dans le caveau du Souvenir Français. Caveau qui fut auparavant un tombeau communal et qui renfermait déjà les corps des victimes de l’explosion du cuirassé Magenta (1869) et de la poudrière de Lagoubran (1900).
C’était le 3 octobre 1911. Louise naquit le 5.
Cruauté du sort qui aura voulu que ce jeune garçon ne puisse ressentir les joies de la paternité.
Cruauté du sort qui aura voulu que Louise ne puisse jamais connaître l’affection d’un père.
Cruauté du sort qui aura voulu que Mémé GAUTIER eut sa vie brisée alors qu’elle avait 22 ans.
La naissance de Louise, 2 jours après les obsèques de son père, ne fut pas l’événement heureux qu’il aurait dû être. Les souffrances de l’accouchement, suivies de la délivrance, auraient pu être un dérivatif pour Mémé GAUTIER. Elles le furent momentanément, mais la dureté et la réalité de la vie étaient là et il fallait les vaincre.
Certes, les sympathies affluaient de toutes parts. Un comité de personnalités locales se constitua. Une grande fête fut organisée dont le bénéfice fut réservé à Louise et à sa mère. Des poèmes furent écrits et déclamés pour inciter la population à s’associer à une œuvre de solidarité locale.
Il faut certes remercier toutes les bonnes volontés qui apportèrent leur aide à la mère et à l’enfant. Mais rien ne pouvait remplacer ce jeune père de 25 ans, disparu dans des conditions tragiques.
Mémé GAUTIER affronta son calvaire courageusement. Elle n’eut plus qu’une pensée : élever sa petite fille, parfaire son éducation et lui préparer un avenir heureux.
Nous sommes en 1978. Plus de 66 années ont passé et, quand on mesure le chemin parcouru, quand on sait la somme de travail, de soucis et de peines que Mémé à connue, il faut dire en toute justice qu’elle a eu beaucoup de mérites.
Elle ne fut pas abandonnée par l’Administration maritime qui lui procura du travail. Excellente couturière, elle travailla pendant des années à confectionner des uniformes de marin en drap bleu marine. Pendant des années, plusieurs heures par jour, elle dut actionner sa machine à coudre infatigablement et rapporter chaque semaine à l’Arsenal un contingent important de pantalons ou de “cabans”.
Pendant la guerre de 14-18, elle fut même embauchée, avec sa sœur Fernande, à la Pyrotechnie, à nettoyer les douilles d’obus en cuivre, c’est-à-dire à les décaper à l’acide, ce qui impliquait la respiration de gaz toxiques.
Louise grandissait et, malgré son tempérament craintif, elle apprenait fort bien à l’école. A l’âge de 11 ans, elle aussi passa son Certificat d’études primaires. Comme son père, elle était douée et promettait des études fructueuses. Comme il aurait été heureux ce papa de voir grandir sa fille et de la voir affronter un jour le concours d’entrée à l’École normale, devenir institutrice et finir sa carrière d’enseignant comme professeur de mathématiques. Comme il aurait été fier de connaître un jour son petit-fils devenir un étudiant brillant, réussir à des concours difficiles, devenir ingénieur dans la recherche scientifique et obtenir un doctorat ès-sciences.
Ces joies, qu’un sort injuste ne lui a pas permis de connaître, Mémé GAUTIER les a connues et appréciées.
Le temps a passé. C’est vrai qu’il est un grand maître. Mais le souvenir de Louis GAUTIER n’a pas disparu. Soixante-six ans après sa mort, hommage lui est rendu chaque année au Souvenir français. Sa tombe a toujours été fleurie. Dans la famille, son souvenir a toujours été évoqué. Jean-Claude, enfant, a appris qui il fut et comment il périt, et je souhaite qu’il enseigne à son tour à ses fils le culte du souvenir.
Pendant des dizaines d’années, nous nous contentions d’apporter des fleurs sur la tombe commune du Souvenir Français, tombe surmontée d’une stèle qui fut vraisemblablement édifiée après la guerre de 14-18. Il faut quand même dire que nous avions parfois la désagréable surprise de constater, au moment du 1er novembre, que le vase de chrysanthèmes ou autres fleurs déposé par nos soins avait été confisqué ou volé. Chose difficile à imaginer et pourtant vraie. Il y a des voleurs dans les cimetières, des gens qui fleurissent leurs tombes avec les fleurs des autres ou qui revendent les pots de fleurs volés. C’est à peine croyable que de tels forfaits puissent se commettre en des lieux si respectables, parce qu’ils sont le point de rencontre de tant de souffrances humaines.
Durant ces dernières années, Mémé GAUTIER avait exprimé le désir de pouvoir transférer les restes mortels de son mari dan notre tombeau de famille. Je ne sais à quelle autorité elle s’était adressée, mais il lui fut répondu que le Souvenir Français était une institution nationale et qu’il n’était pas possible de toucher à ses sépultures.
Mémé GAUTIER va sur ses 89 ans. Ayant exprimé il y a quelques mois encore ce désir de retrouver dans la tombe celui qu’elle avait aimé dans sa jeunesse. J’ai pensé de mon devoir de m’informer d’abord et de tenter ensuite des démarches dans la perspective de lui donner satisfaction.
Vers la fin de l’année dernière, j’avais appris qu’un directeur d’école, Victor PONEL, retraité à Hyères, s’occupait là-bas du Souvenir Français. Je connaissais depuis Longtemps Victor PONEL, qui était Seynois d’origine.
Je lui écrivis donc au début de cette année. Il me répondit très aimablement que le transfert des restes mortels de Louis GAUTIER était possible, et que, d’ailleurs, il avait eu à s’occuper d’affaires semblables pour les habitants d’Hyères.
Comme il me l’avait conseillé, je m’adressai donc au Secrétariat des Anciens Combattants, Direction des Statuts et des Services Médicaux, Sous-Direction des Statuts de Combattants et des Victimes de la Guerre, 4e Bureau, Nécropoles nationales et restitution de corps, 139, rue de Bercy, Paris XIIe.
La demande de transfert fut signée par Mémé GAUTIER à l’adresse susmentionnée, début janvier.
La réponse nous parvint 2 mois plus tard. Le Ministre nous fit savoir que Louis GAUTIER n’étant pas décédé en temps de guerre, le problème du transfert n’était pas de son ressort, mais qu’il pouvait se faire en accord avec la Municipalité et le Souvenir Français.
L’accord de la Municipalité, nous l’avions, puisque la demande avait été faite sous couvert de M. le Député-Maire GIOVANNINI et transmis avec avis favorable.
Je rendis donc visite au Conservateur du cimetière, M. CHAUVIER, le 13 mars. Il est, lui, Président du Souvenir Français. Il me donna son accord tout de suite, mais, me dit-il, il faut savoir où est le corps.
Je lui répondis tout naturellement qu’il se trouvait dans le caveau central du Souvenir Français. A quoi il me répondit qu’il n’y avait pas de caveau au Souvenir Français, mais seulement une stèle élevée à la mémoire des victimes dont les tombes se situent de part et d’autre de la stèle.
Désarçonné par son attitude persuasive,, je consentis à passer en revue toutes les inscriptions portées sur les croix de la partie de terrain réservée au Souvenir Français. Là se trouvaient, pour la plupart, des morts de la guerre de 14-18, Allemands, Russes, Nord-Africains, Yougoslaves,.., des morts des suites de guerre dans l’établissement des Maristes transformé en hôpital militaire. Aucune inscription ne remontait à 1911.
Le Conservateur m’emmena alors dans son bureau pour consulter les archives. Il existait bien une liste de noms (une douzaine environ) figurant dans une rubrique “tombeau communal”. J’appris par la suite que ce tombeau communal devint celui du Souvenir Français. Mais le nom de Louis GAUTIER ne figurait pas dans cette liste. Ce qui voulait dire que les archives n’étaient pas à jour.
Par contre, en queue de liste, figurait un certain Edmond DOUVRY, mort en 1914, ce qui voulait dire que, dans le caveau du Souvenir Français, on avait probablement ajouté un corps. Mais CHAUVIER persistait à croire qu’il n’y avait pas de caveau à l’emplacement de la stèle.
Nous retournâmes devant le monument pour essayer de découvrir l’énigme. Il me sembla alors comprendre que les petites bornes reliées par des chaines aux quatre coins de la stèle devaient marquer les limites du sépulcre. Mais où donc se trouvait son entrée ? La pierre tombale inclinée portait une douzaine de noms, le dernier étant celui de Louis GAUTIER.
CHAUVIER me certifiait que ces noms avaient été gravés seulement pour mémoire. Je protestais en lui disant que, depuis 66 ans, la veuve de Louis GAUTIER et sa fille apportaient des fleurs à cet endroit, et que le corps ne pouvait pas être ailleurs que sous cette pierre tombale. Puis, un pressentiment me fit aller vers la haut de la plaque de marbre portant les inscriptions. Tout en haut se trouvait un vase à fleurs de forme oblongue. J’eus alors l’idée de déplacer ce vase. Surprise ! Il cachait ces mots : « Ci gisent ».
Alors, CHAUVIER convint de l’existence du caveau.
Nous convînmes donc que, les jours suivants, il ferait creuser devant la pierre tombale pour essayer de trouver une entrée.
Rentré à la maison, je racontai tout cela à Louise et à sa mère, indignées de l’ignorance du Conservateur. Le malheureux fonctionnaire communal n’était pas tellement à incriminer car son prédécesseur avait dû lui laisser des documents incomplets.
J’appris alors (car j’avais aussi alerté Fernande MEUNIER, sœur de Joséphine GAUTIER, qui avait été un témoin de l’époque) que la tombe du Souvenir Français avait été rouverte en 1914 pour y ensevelir le dénommé DOUVRY, cité plus haut, et qui avait été le premier Seynois victime de la guerre de 14-18.
Je retournai au cimetière le 20 mars dans l’après-midi. Le Conservateur avait fait creuser un trou très profond qui avait permis de découvrir l’entrée du caveau, à près d’un mètre au-dessous du niveau du sol. IL avait attendu ma présence pour procéder à l’ouverture.
Un ouvrier maghrébin fut désigné pour desceller la dalle d’obturation. Épaisse de 20 cm, elle pesait sans doute très lourd car il fallut quérir un engin de levage pour la monter sur le terre-plein de la voirie.
Au fur et à meure que s’ouvrait cette tombe, mon regard se figeait sur l’ouverture et mon cœur battait à grands coups. Ma gorge se serrait. De funestes images se succédaient dans ma tête, pleine de souvenirs, non vécus certes, mais racontés si souvent. Je revoyais l’explosion terrifiante du cuirassé, les cadavres, les obsèques, la panique, les visages éplorés, l’enfantement de Joséphine GAUTIER, les coutumes de deuil et puis la réalité brutale : la pierre d’obturation enlevée, la lumière du jour éclairant le sépulcre fermé depuis plus de 60 années, une lumière qui se projeta sur un squelette complet reposant sur une masse sombre ayant bien la forme d’un cercueil.
Selon toute probabilité, ce squelette était celui du soldat DOUVRY, dont le cercueil avait dû être posé sur celui de Louis GAUTIER.
Mais alors, me fit observer le conservateur, puisque DOUVRY était un mort de la guerre, il aurait dû être placé lui aussi dans un cercueil en plomb. Quel était donc celui que je cherchais ? Délicatement, un fossoyeur rassembla les ossements et trouva une plaque avec une inscription illisible. Il fallut laver le morceau de cuivre pour lire distinctement : « Edmond DOUVRY ». Mais cette plaque retrouvée sur le cercueil en plomb ne constituait pas une preuve absolue d’identification. Il fallait trouver la plaque « GAUTIER ». On eut beau la chercher, on ne la trouva pas.
Alors, le Conservateur ordonna que l’on ouvrit le cercueil en plomb. Ce cercueil avait été placé en 1911 dans un cercueil en bois, lui même enserré dans des cadres de fer. Le bois avait totalement disparu. Les cadres de fer existaient encore. Je n’eus pas le courage de m’approcher pour voir le contenu que je pouvais naturellement imaginer. Les fossoyeurs ne trouvèrent point de plaque, mais l’un d’eux me montra une mâchoire inférieure à laquelle une seule dent manquait. Il fallait savoir si Louis GAUTIER avait une mâchoire incomplète.
Je demandai alors au Conservateur de ne plus rien toucher et que j’allais m’informer pour avoir de nouvelles précisions afin que l’identification puisse se faire sans aucun doute. Rentré à la maison, je téléphonai à Fernande qui m’apprit deux choses décisives : la première, c’est que DOUVRY n’était pas mort sur le front de la guerre, mais qu’il mourut à La Seyne, chez les Maristes, alors qu’il était en convalescence. Il est évident qu’on ne l’avait pas enterré dans un cercueil en plomb pour le transporte de l’établissement des Maristes vers le cimetière. Le cercueil en plomb était bien celui de Louis GAUTIER. La seconde, c’est que Louis GAUTIER avait bien une mâchoire inférieure incomplète : il lui manquait une seule dent, ce que j’avais bien constaté de visu l’après-midi.
Le lendemain matin, 21 mars 1978, je téléphonai au Conservateur pour lui transmettre toutes ces précisions. Je lui dis même que Mémé GAUTIER avait connu la mère de DOUVRY, qui venait porter des fleurs, elle aussi, au Souvenir Français.
CHAUVIER me demanda de venir l’après-midi de ce 21 mars pour recueillir les restes mortels de Louis GAUTIER.
Deux fossoyeurs gantés placèrent tous les ossements dans un petit cercueil de bois, pour le placer ensuite dans notre caveau familial. Ce ne fut évidemment pas sans émotion que je revis le cercueil de mon père, enfermé depuis 1962, ainsi que les petits cercueils de Robert et de ma mère. Un troisième petit cercueil a pris place aux côtés des deux autres. C’est celui de Louis GAUTIER.
Je rentrai, cette opération terminée, visiblement ému, mais satisfait d’avoir accompli un devoir.
C’est seulement à mon retour que j’annonçai la nouvelle du transfert. Mémé n’avait pas été prévenue du but de ma sortie ce jour-là.
Naturellement, elle se mit à pleurer, me remercia pour ce que j’avais fait et dit simplement : « Comma ça, nous serons tous ensemble ».
Je termine ici ce document qui a résumé la vie, hélas ! bien courte du père de Louise. Il était difficile de le faire plus complet avec les rares témoins existants.
Il était nécessaire de rendre hommage à sa mémoire. C’était un devoir de le faire et je demande à nos enfants et petits-enfants qui liront ce texte tout simple d’essayer de comprendre ce que peut être une grande épreuve dans la vie des pauvres humains que nous sommes.
Marius AUTRAN
1978
AUTRAN Auguste (grand-père paternel de Marius AUTRAN : 1853-1918

[Copies du livret de famille, de l'acte de mariage de 1880, des actes de naissance et décès des enfants, du 2e livret de famille, de la tombe au cimetière du Cannet.]
Né le 26 septembre 1853 à Barjols (Var).
Profession : forgeron
Domicilié à Marseille (1909 ?), puis à La Seyne vers la fin du XIXe siècle, puis retiré à Marseille vers la fin de sa vie.
Fils de Louis Adolphe AUTRAN et de Désirée Zoé Magdeleine Carmagnole et petit-fils de Louis Pascal AUTRAN établi au Cannet-du-Luc.
Je ne suis en possession d'aucun document écrit qui le concerne, exception faite du livret de famille que mon père m'a transmis. On peut y lire les noms des six enfants qu'il eut de sa première épouse, née Piolet
En 1910, quand je suis né, il était âgé de 57 ans. Aucun souvenir visuel ne me reste de lui. Par contre, lui m'avait connu bébé et m'avait embrassé avant le départ de mes parents que j'ai suivi naturellement vers la Tunisie, à l'arsenal de Sidi Abdallah où mon père avait choisi sa mutation dès le mois d'août 1914 quand la Première Guerre mondiale éclata.
Quand mes parents retrouvèrent la métropole en 1920, AUTRAN Auguste, mon grand-père, était décédé. Ce fut en 1918.
Tout ce que je sais de lui m'a été conté par mon père : sa vie rude, les épreuves sévères de son parcours, son travail aux Forges et Chantiers de La Seyne, son remariage avec sa bonne. Enfin, j'ai retenu les plus grandes lignes de son existence, résumées à grands traits dans cette biographie.
A l'âge de 11 ans, le jeune AUTRAN Auguste quitta son village de naissance, Barjols, avec le consentement du père, en compagnie de son frère Edouard, pour gagner Marseille, où ils espéraient trouver une vie meilleure. Leur père Adolphe, forgeron de son métier, sans doute maréchal-ferrant, n'assurait à sa famille qu'une vie précaire. Les enfants n'ayant reçu qu'un minimum d'instruction, espéraient trouver dans la grande ville du travail rémunérateur et des conditions de vie meilleures.
Déjà, en ce milieu du XIXe siècle, la jeunesse se sentait attirée par la grande ville, prometteuse d'activités lucratives, de distractions nouvelles et fortes. J'indique au passage que Edouard AUTRAN fut le père d'un AUTRAN Edouard Marius, métallo à ses origines, qui devint comique troupier, puis artiste de cinéma sous le nom de DELMONT, acteur dans une multitude de films et de pièces de théâtre dont le grand animateur fut Marcel PAGNOL. (Lettres de mon moulin, Le secret de Maître Cornille, La femme du boulanger, Angèle, etc.). DELMONT (dont Marcel Pagnol dira de lui : « Il n'était pas le plus grande vedette, mais il fut tout de même un bon artiste ».
Voilà donc les deux AUTRAN, Auguste et Edouard, compagnons de misère qui passèrent des nuits à la belle étoile, avant de trouver une chambre à peine meublée, sans hygiène ni confort. Le travail ne manquait pas à Menpenti. Ils apprirent leur métier de métallo sur le tas, mais leur père Adolphe les avait tout de même familiarisés avec la forge et l'enclume.
A cette époque, les enfants, dès l'âge de 8 ans, travaillaient dans les usines. Ils étaient l'objet de l'exploitation la plus éhontée d'un patronat rapace. Les apprentis métallos comme les AUTRAN durent recrutés sans difficultés dans les chantiers de construction ou de réparation navale comme : La Provençale à Marseille, à La Ciotat, à La Seyne, où les constructions mécaniques avaient progressé de façon spectaculaire dès le début du XIXe siècle.
Vers la fin de ce même siècle, la classe ouvrière devint de plus en plus nombreuse. Durement exploités, les travailleurs organisèrent des syndicats et le « Parti Ouvrier », embryon du « Parti Socialiste », où l'on parlait beaucoup de Jules GUESDE, de Jean JAURÈS. La classe ouvrière s'organisait et luttait pour le repos hebdomadaire, pour une réglementation humaine du travail des femmes et des enfants, pour le droit de grève, pour de meilleurs salaires, en somme pour de meilleures conditions de vie.
Les jeunes AUTRAN, pris dans le mouvement progressiste révolutionnaire, s'engagèrent dans les batailles politiques et syndicales. Auguste, mon grand-père, devint un militant du parti socialiste de Jules GUESDE, en même temps qu'un militant syndicaliste.
On sait qu'après le désastre de la guerre de 1870, un gouvernement provisoire remplaça Napoléon III en fuite vers l'Angleterre. Mais ce gouvernement, composé d'éléments de la haute bourgeoisie (dont le sinistre THIERS), pactisa avec les Allemands victorieux, pour mieux écraser la Commune de Paris issue du mouvement révolutionnaire que les Parisiens s'étaient donné après la capitulation de Sedan et la trahison du maréchal BAZAINE.
Cette première expérience révolutionnaire à caractère communiste dura seulement 3 mois. Pour survivre au siège des Versaillais, avec THIERS à leur tête, la Commune de Paris, essaya d'étendre son influence sur les plus grandes villes de France (Lyon, Bordeaux, Marseille). Ce fut un échec, le gouvernement révolutionnaire n'étant pas mûr pour la grande majorité des Français. Isolée des autres villes, et surtout de la paysannerie, elle devait succomber sous les coups de la bourgeoisie qui ne recula pas devant le massacre (mur des Fédérés).
Le jeune Auguste AUTRAN, qui avait alors 18 ans, participa à l'élaboration des barricades dans Marseille. Il se plaisait à raconter un fait dont il avait été le témoin à ce moment-là : l'œil rivé au créneau d'une barricade, il vit surgir dans l'une des grandes rues marseillaises un ivrogne titubant. Des coups de feu partirent des deux bouts de la rue. L'ivrogne se trouvait pris dans les trajectoires qui se recoupaient. « Incroyable, mais vrai, disait mon grand-père, et l'homme parvint tout de même à traverser la rue sans la moindre égratignure ». Depuis ce jour-là, il s'en allait répétant qu'il y avait sûrement un bon dieu pour les ivrognes.
Après l'échec de la Commune, on sait que la répression s'abattit sur les travailleurs avec une violence inouïe. Toute manifestation, toute protestation contre le patronat fut sévèrement réprimée. C'est à cette époque qu'Auguste AUTRAN effectua son service militaire, qui durait alors 3 ans. Il fut affecté chez les zouaves, dans un régiment d'occupation de l'Algérie, comme en témoigne cette photo prise à Alger [la seule photo d'Auguste AUTRAN qui ait jamais été retrouvée]. On pense que cette affectation aurait constitué une mesure disciplinaire à la suite de sa participation à la Commune de Marseille. Nous ne savons rien de plus précis.
 |
|
|
assuma les responsabilités de premier trésorier de la Bourse du Travail, et la première Mutuelle des Forges et Chantiers de la Méditerranée
Auguste AUTRAN fut plusieurs fois renvoyé des entreprises où il travaillait à cause de son action militante dans les syndicats, lesquels, après des années de lutte, furent finalement reconnus en 1884. Il fut même licencié pour avoir célébré le 1er Mai, fête des travailleurs. C'est ce qui explique que, renvoyé des ateliers marseillais, il devint travailleur aux Forges et Chantiers de La Seyne (F.C.M.). Il fut parmi les fondateurs de la Bourse du Travail en 1904-1905, et également responsable de la première Mutuelle ouvrière. Son nom figure sur les procès-verbaux des réunions syndicales qui se tenaient à la Bourse du Travail, devenue une véritable ruche ouvrière à partir de 1905.
Auguste Autran était à La Seyne lors de la venue à La Seyne de la célèbre militante révolutionnaire Louise Michel. Il raconta d'avoir été très fier de défiler à ses côtés. Mais on n'a jamais trouvé de document photographique de cette manifestation. On ne sait pas trop en quelle année se situa ce passage à La Seyne de Louise Michel.
Comme plusieurs de ses camarades, Auguste Autran fut licencié de l'entreprises à plusieurs reprises au lendemain du 1er Mai. En effet, les syndicalistes chômaient volontairement en toute illégalité le 1er Mai (le 1er Mai ne fut reconnu comme jour chômé qu'en -----]. Ils prenaient la diligence à plusieurs, en arborant le drapeau rouge, allaient faire un banquet chez ? à Carqueiranne. Le lendemain matin, ils se présentaient au chantier où on leur signifiait leur renvoi. Alors, ils partaient avec femme et enfants se faire embaucher quelque part ailleurs. Quel courage ! C'est ainsi qu'il y eut plusieurs allers et retours entre des ateliers de Marseille (Menpenti, La Provençale) et les chantiers de La Seyne. Parfois aussi, comme c'étaient d'excellents ouvriers, c'est leur ancien patron qui, ayant besoin de main d'œuvre qualifiée, les rappelaient...
On peut retrouver son nom sur les vieux registres qui rappellent la fondation de la Société de Gymnastique. Aux dires de mon père, il fut un athlète distingué, d'une grande souplesse, et défila très souvent avec ses camarades gymnastes en direction du terrain de La Gatonne où, clairons en tête, ils allaient offrir aux Seynois des spectacles à caractère sportif. Mon grand-père Simon demandait, lorsque j'avais une dizaine d'années, si je savais déjà « marcher sur les mains ». En effet, il se souvenait que son père Auguste, qui avait alors plus de 40 ans, parcourait ainsi leur appartement, d'une pièce à l'autre, en équilibre sur les mains.
Avant la guerre de 1914-1918, Auguste AUTRAN demeura dans la rue Parmentier. Il avait aussi occupé précédemment un appartement au quartier Cavaillon, l'un des quartiers les plus anciens de la ville, dont la rue principale se nommait « La Calade ».
Sa vie fut très rude. D'après le livret de famille en ma possession, il fut marié en premières noces avec Marie Louise PIOLET (née à Paris le 11 décembre 1859), le 29 juillet 1880. Il en eut 6 enfants : Laurent, Louise, Louis Adolphe, Désiré, Simon, Henri. Laurent ne vécut guère plus d'un an, Louise ne vécut que deux ans, et Louis Adolphe 1 an et demi.
Désiré, que j'ai bien connu, né en 1885, est mort en 1918 des suites de la grippe espagnole à Sorgues. Il avait à peine plus de 30 ans.
Henri, né en 1889, mourut en 1903 à l'âge de 14 ans, des suites d'une fluxion de poitrine.
Seul mon père Simon connut une vie d'homme à peu près normale et mourut à 74 ans, alors qu'on aurait pu espérer pour lui de vieillir plus longtemps. Je reviendrai sur ce sujet dans sa biographie qui suit.
Deux ans après la naissance de son dernier fils Henri, ma grand-mère PIOLET mourut le 16 février 1891. Elle avait seulement 32 ans.
On imagine sans peine le désastre familial : mon grand-père Auguste, veuf à 38 ans avec 3 enfants à charge : Désiré, Simon, Henri, âgés respectivement de 6 ans, 4 ans et 2 ans.
Auguste éprouva donc les plus grandes difficultés pour sauver la petite famille. Contraint de prendre à son service une bonne, dénommée Marie Louise CAILLOL, qu'il épousa par la suite en 1894. Un jeune garçon nommé Gabriel Léonard, né en 1892, fut reconnu par mon grand-père en 1894, porta alors aussi le nom d'AUTRAN, mais fut familièrement appelé "AUTRANET".
Ils eurent par la suite des jumeaux (AUTRAN Berthe Clémentine et AUTRAN Esprit Marius), mais qui ne vécurent respectivement que 2 ans et 2 semaines.
Les 3 premiers enfants d'Auguste furent souvent maltraités par la marâtre CAILLOL, au caractère autoritaire, et qui avait des attentions seulement pour leur dernier fils Gabriel. Mon père m'a souvent raconté des scènes d'injustice dont ses deux frères et lui furent victimes pendant des années. [Il arriva que Henri, qui ne supportait pas sa marâtre, ne rentra pas à la maison le soir et coucha dans la rue. C'est à la suite de ça, qu'il serait mort d'une fluxion de poitrine]. Inversement, mon grand-père avait peu d'estime pour l'enfant qu'il avait reconnu, lequel avait contracté la variole vers la fin du XIXe siècle. Des suites de la variole, Gabriel avait gardé le visage grêlé, et une surdité persistante, ce qui l'avait grandement désavantagé pour son instruction et son apprentissage. Gabriel est décédé en 1934, âgé de 41 ans environ.
Mon grand-père Auguste n'eut pas beaucoup de satisfaction avec ses propres enfants maltraités par la marâtre CAILLOL, son épouse. Il eut la douleur de perdre Henri, âgé seulement de 14 ans.
A l'âge de 18 ans, Désiré quitta la maison familiale et gagna sa vie tant bien que mal comme métallurgiste, épousa une marseillaise, Antoinette MOULENAC. Mobilisé pendant la guerre de 1914-1918, son père ne devait plus le revoir. Tous les deux moururent la même année, en 1918.
Ainsi, à l'âge de 65 ans, Auguste AUTRAN avait enterré sa première épouse et 7 de ses 9 enfants.
Retour de Simon AUTRAN de Tunisie en 1920, il se rend aussitôt à Marseille sur la tombe de son père, il se trouve nez à nez avec sa marâtre ! Mi siou rompu lou nas mè la maratro !
Parvenu à l'âge de 18 ans, mon père, lui aussi quitta la famille, s'engagea pour 3 ans dans la Marine pour y préparer l'école de Maistrance.
Quand la guerre de 14 éclata, il vit son père pour la dernière fois avant de partir pour l'arsenal de Sidi Abdallah (Tunisie).
Dans cette période, Auguste AUTRAN se fixa définitivement à Marseille, dans un petit appartement au 48 boulevard Oddo, à proximité des chantiers maritimes où il avait travaillé si durement pendant de longues années.
Plusieurs séjours alternés entre Marseille et La Seyne (cf. les dates et les lieux des actes de naissance et de décès de ses enfants).
Il mourut en 1918 [au 48 boulevard Oddo, à Marseille], assisté de sa deuxième épouse et de Gabriel. Mes parents disaient qu'il était mort d'épuisement physique, et aussi de chagrin car ses propres enfants s'étaient plus ou moins détournés de lui depuis son remariage.
[L'appartement du 48 boulevard Oddo est ensuite resté la propriété des descendants d'Auguste AUTRAN et de Marie Louise CAILLOL. L'acteur Edouard AUTRAN, dit "DELMONT" y dormit parfois lors de certaines tournées à Marseille. Marius AUTRAN et sa jeune épouse Louise GAUTIER y dormirent au moins une nuit pendant leur voyage de noces en avril 1932. A l'époque, c'est Gabriel AUTRAN et son épouse Anna MICHEL qui y habitaient avec leur fils unique Louis AUTRAN dit "Louiset". Simon AUTRAN y vint régulièrement de 1920 jusqu'au début des années 30, surtout lorsque son jeune frère Gabriel fut malade et qu'il ne put plus travailler : Simon venait en train à Marseille lui apporter de l'argent prélevé sur son salaire pour lui venir en aide, jusqu'à sa mort, en 1934. L'appartement fut alors occupé par la veuve de Gabriel jusqu'en 1978, par son fils Louis et sa famille : sa femme Gabrielle AUTRAN, née IACOPINI - qui l'occupe encore actuellement - et leur fils Alain AUTRAN].
Mon père Simon resta donc le seul survivant de la famille. Il n'aimait guère parler de son passé familial. C'est pourquoi je sais peu de choses sur mes ascendants paternels.
Pour tout héritage, mon père eut des livres et une photo de son père Auguste AUTRAN, photo prise pendant son service militaire qui dura 3 années. Il porte un uniforme de zouave, dans un régiment d'occupation de l'Algérie. Je ne sais rien de plus précis.
Son regard révèle un caractère énergique, courageux. Il l'était en effet, aux dires de mon père, car il fut un dirigeant syndicaliste combatif à une époque extrêmement difficile (7 adhérents seulement au premier syndicat des Métaux des Forges et Chantiers de La Méditerranée (F.C.M.)). Il prenait souvent la parole dans les réunions syndicales et défendait ses idées avec beaucoup de conviction.
Revenons un instant à l'héritage qu'il laissa à mon père : des ouvrages à caractère idéologique : « Les Corbeaux », diatribe contre le Clergé, « Force et Matière », de L. BUCHNER, préfiguration de l'idéal communiste (1906), « Cent chansons nouvelles », de Jean-Baptiste Clément, ancien communard (1898).
Auguste AUTRAN eut un idéal révolutionnaire, empreint d'un anticléricalisme, qu'il transmit à ses enfants durablement.
Il fut un travailleur honnête, dévoué à l'extrême à la cause ouvrière. Ses luttes syndicales, surtout, préparèrent les futurs succès des travailleurs : construction de la Bourse du Travail de La Seyne, réduction du temps de travail, avancées positives de la Mutualité. Il a contribué à faire du mouvement ouvrier une force d'opposition au patronat, tant à La Seyne qu'à Marseille.
Dans l'histoire de ma famille, les générations futures devront se souvenir avec respect de l'œuvre modeste, mais combien efficace, de cet homme de bien que fut Auguste AUTRAN.
Marius AUTRAN et Jean-Claude AUTRAN
A suivre...
Page en travaux 
Retour à la page d'accueil du site
 |
jcautran.free.fr
|
 |
© Jean-Claude Autran 2016