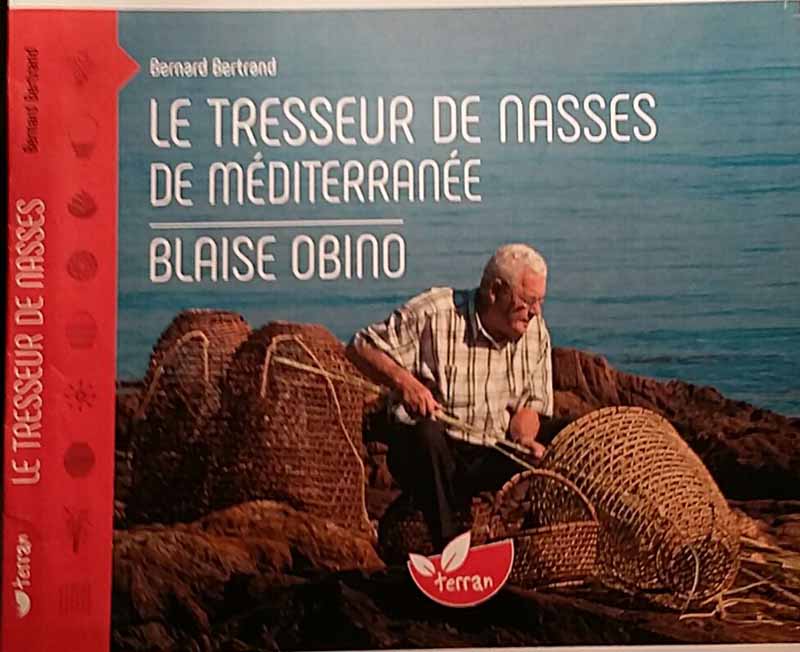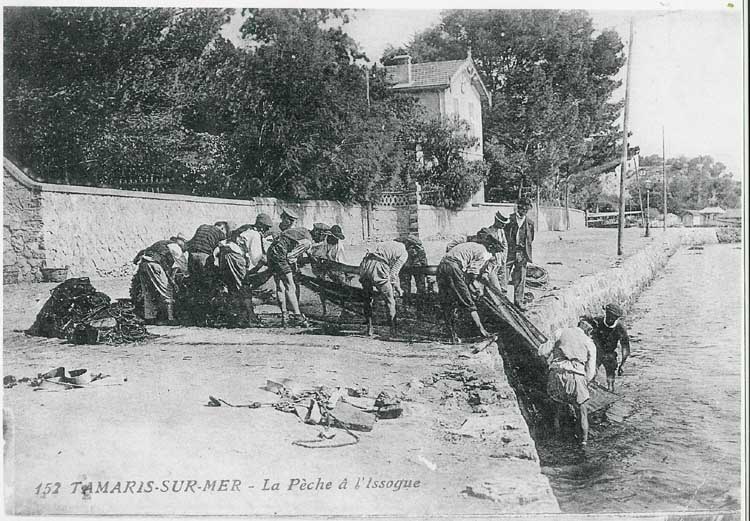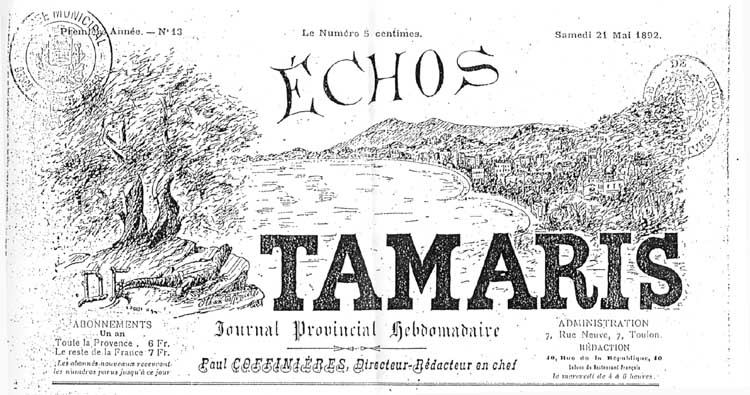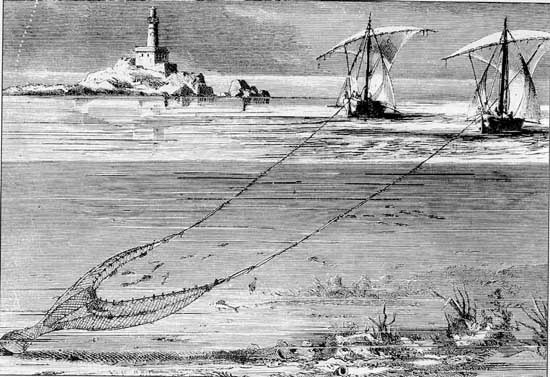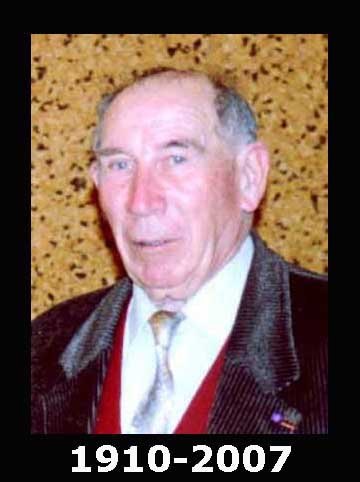La
Seyne-sur-Mer (Var) La
Seyne-sur-Mer (Var)
-
Questions
relatives à la pêche en mer, aux engins de pêche,
aux poissons et aux coquillages
|
-
 Après
15 ans d'existence (2001-2015), la section "Forum" de ce site internet
n'est plus désormais alimentée
Après
15 ans d'existence (2001-2015), la section "Forum" de ce site internet
n'est plus désormais alimentée 
 Les
informations précédemment rassemblées resteront en
ligne, mais il ne pourra être répondu à aucune
nouvelle question
Les
informations précédemment rassemblées resteront en
ligne, mais il ne pourra être répondu à aucune
nouvelle question 
-
Jean-Claude
Autran
- Pour des
explications plus détaillées, se rendre à la page
d'accueil du forum
Rappel des
échanges de messages à propos de :
- A
propos du gangui
- Cales
à
bateau de Fabrégas et de la Verne
- Confection
des
gireliers
- Confection
de rusquets
- Faire connaitre les articles d'Aquo d'Aqui sur le patrimoine des
pêcheurs
- Gravure de la «
pêche au bœuf »
- Histoire
des parcs
à moules et à huîtres dans la rade de Toulon
- L'étoile
des pointus ?
- Le concombre de mer
- Pêche
à l'issogue
- Qu'est-ce que désigne
le mot Sirouquette ?
- Termes
employés dans la construction des pointus et barquettes
- Termes
provençaux relatifs à la pêche et aux poissons de
mer
22
avril - 3 mai 2014 : Qu'est-ce que désigne le mot
sirouquette ?
Q1.
- Cher Monsieur Autran,
- J'ai
lu avec intérêt vos recherches sur les termes, en provençal, employés
par les pêcheurs professionnels. Aussi je me permet de vous interroger
sur le nom d'une étoile : sirouquette ou cirouquette.
- Lorsque
j''aidais mon père à la pêche souvent il disait : on va attendre le
levé (ou le couché) de la sirouquette pour caler les filets (aux
sardines ou aux anchois). J'habite Cros de cagnes prés de Nice.
- J'ai cherché dans des dictionnaires
provençaux et sur l'internet sans résultat.
- Est ce que vous avez quelques connaissances sur
cette sirouquette ?
- Merci beaucoup.
- AS
R1.
Bonsoir,
Je n’ai malheureusement pas la
réponse à vos interrogations. Aucun document en ma possession ne
mentionne cette sirouquette ou cirouquette.
La seule idée qui me vienne c’est
que, s’agissant d’une étoile dont les pêcheurs pouvaient observer le
lever ou le coucher, il s’agit sans doute d’une étoile particulièrement
visible. Alors, pourquoi pas Sirius (devenu “Sir-ouquette” en ajoutant
une terminaison affective), l’étoile du berger, l’étoile la plus
brillante du ciel, dans la constellation du Grand Chien, Canis major, qui se lève en effet avec le soleil
en été, correspondant à l’époque des canicules.
C’est tout ce que je puis vous
dire.
Cordialement.
Jean-Claude Autran
26-28 novembre 2013 : Gravure de la « pêche au bœuf
»
Q1.
Bonsoir Monsieur,
J'ai trouvé sur votre site
(jcautran.free.fr), fort instructif par ailleurs, la gravure
suivante dont j'aurais bien aimé trouver la
référence d'origine.
Je suis un biologiste des pêches
à la retraite et passionné par les ouvrages anciens sur
les techniques de pêche d'autrefois.
Je vous remercie d'avance pour toutes
informations que vous pourriez me communiquer sur cette gravure
et l'ouvrage d'origine.
Dans l'attente de votre réponse,
je vous prie de recevoir cher Monsieur, l'expression de mes
sincères salutations.
JS
R1.
Bonsoir Monsieur,
La gravure « pêche au
bœuf » m’avait été fournie par un
internaute (YAL) à la suite de plusieurs échanges que
j’avais eus avec lui « à propos du
gangui » [voir ci-dessous], il y a de ça une dizaine
d’années :
Le message qui l’accompagnait
était le suivant :
« hello à vous tous,
voici quelques images de la Cette sur l'étang de Thau le 17 mai
et à quai au Grau du Roi ce week-end. En plus une jolie gravure
de pêche au boeuf et le noeud indispensable au nom savant et
pourtant si simple à faire (à condition d'avoir un
cabillot et un oeil où le passer). Ce noeud permet d'attacher la
maille (ou fune, ou liban bref la grande ficelle) qui remorque le
gangui, son avantage énorme est de pouvoir être
larguée immédiatement. (...) »
Je vous joins les 4 images
annoncées dans le message.
Mais c’est malheureusement
tout ce qu’il m’avait donné comme indications et
j’ignore la source de la gravure.
Par contre, en recherchant
“peche au bœuf” sur google, on aboutit à un
certain nombre d’images, dont cette même gravure, dans le
site :
Le
fichier de cette gravure s’intitule : « France sete peche
boeuf bateaux » et le texte qui l’accompagne est : «
Le bateau bœuf à voile, l’ancêtre du chalutier
à moteur - Au XVIIIe siècle, les pêcheurs catalans
pratiquaient la pêche au boeuf, technique de capture qui a
précédé la pêche au chalut... - La
pêche au bœuf consiste à traîner le filet
à deux bateaux, on disait aussi que les bateaux pêchaient
en conserve. - Cette technique fut inventée par les Catalans
vers 1720, qui pratiquaient cette pêche sur les côtes du
Languedoc, avec des barques Catalanes, particulièrement à
Sète, car elle était interdite en Espagne. - Ensuite les
tartanes, bateaux de commerce à voile, ont été
utilisées comme modèles pour construire les bateaux
bœuf. La forme de la poupe large, permettait aux pêcheur de
remonter le filet vers l’avant. »
La gravure a donc quelque chance
de provenir de Sète ou de sa région. Mais je ne peux rien
vous indiquer de plus précis sur son ouvrage d’origine.
Vous pourriez évidemment
essayer de contacter mon ancien internaute (...), mais je ne suis pas
certain qu’il soit encore accessible à l’adresse
qu’il avait il y a plus de 10 ans.
Bien cordialement,
Jean-Claude Autran
Q2.
Bonsoir Monsieur,
Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse et son
contenu si détaillé. je vais selon vos conseils tenter de
joindre M. Lienard en espérant qu'il soit encore joignable
à cette adresse. Quoi qu'il en soit je vous remercie encore pour
votre obligeance et votre disponibilité.
Bien cordialement
JS
26-28 septembre 2013 : Le concombre de mer ou « vié-marin »
Q.
(Discussion sur Facebook, à laquelle plusieurs Seynois ont
participé)
Le concombre de mer
démasqué - Le Manger www.lemanger.fr
De leur pêche aux
Philippines à leur vente dans les pharmacies traditionnelles de
Hong Kong, les concombres de mer vous livrent tous leurs secrets.
3 personnes aiment ça.
HG : Comment appelle-t-on
ça à La Seyne ?
GL : Un stron de mer... Ou un boudin...
YD : Henri j' ai parcouru le
site et pour repondre a ta question difficile et apres reflection il y
a telement de concombres a la seyne il faudra continuer l' appelation
des concombres seynois.........
JCA : En provençal,
c'est tout simplement Lou vié
maré (en
français, Le vier marin...). Voir à : http://jcautran.free.fr/.../lexique_u_v_z.html
MD : Un vier marin !
HG : Exact Jean Claude. On
appelait ça "viés marins"
RG : Plus connu sous le nom
de chichi de mer.
JCA : Et ce terme existe
dans le dictionnaire de Frédéric MISTRAL (Prix Nobel de
littérature...) : « VIÉ-MARIN : Holothurie,
cornichon de mer, Holothuria
phantopus (Lin.), zoophyte marin. Syn. : vichas »
23
septembre : Faire connaitre les articles d'Aquo d'Aqui sur le patrimoine des
pêcheurs
Q1.
Braveis amics
Encara un còp mercé per vòstreis ajudas.
J’arrive au bout de mon travail de restitution de votre
exposition consacrée à l’univers de la pêche.
Il sera mis en ligne demain soir sur www.aquodaqui.info.
J’y
ai ajouté un lexique de mots provençaux de la mer,
tiré d’une liste que m’avait fourni voici quelques
années Jean-Claude Autran [poissons
et engins
de pêche],
que j’ai mis en copie de ce message (et que je remercie encore
pour cette pièce bien utile). Reinat Toscano a revu ces termes
et mes définitions pour les normaliser un tant soit peu en
graphie classique.
Mercredi matin la Letra setmanièra avertira nos 1200
abonnés de la mise à jour du site.
Je
serai très heureux si le nombre de destinataires augmentait un
peu d’abonnés Seynois, et autres habitants de la baie, qui
pourraient être intéressés par ces articles. Le
reportage est en français, le film vidéo joint fait
largement appel à l’occitan parlé, la
présentation du vocabulaire marin est lui en occitan.
Un
peu plus tard, je mettrai également en ligne l’article
publié en juillet dans Le Seynois sur le même sujet, car
vous le savez www.aquodaqui.info
est en partenariat avec la commune. Enfin, l’enregistrement du
témoignage du pêcheur Roger Imbert, que vous avez
déjà fait entendre à la Maison du Patrimoine, sera
disponible sur le site en regard de ce dernier article.
Bref, il y en aura pour tous les gouts, en occitan ou en
français, et j’aimerais bien que vous fassiez passer ce
message à ceux qui, dans votre répertoire, sont
susceptibles de se trouver intéressés par ce travail.
Comme vous savez l’abonnement est gratuit, il suffit de
s’inscrire sur la page d’accueil. Mais il est essentiel
pour le “développement durable” d’Aquò
d’Aquí qu’il remplisse son rôle en suscitant
l’envie de lire et entendre du provençal au plus grand
nombre, en inscrivant la langue d’oc dans l’univers de
l’information d’actualité. Savoir faire c’est
bien, mais faire savoir est indispensable.
Merci de m’y aider.
A ben leu
MN
R1.
Cher ami,
Message bien reçu. Merci
beaucoup et bravo pour ce nouvel article.
Je l’ai fait suivre
notamment à Serge Malcor, qui a lui aussi écrit un
ouvrage sur les termes provençaux et « les mots
d’ici » (Les maux des mots,
2007), avec une attention particulière portée au
vocabulaire de la mer, poissons, pêche, engins de pêche)
qu’il connaît d’autant mieux qu’il a
plongé et dirigé un club de plongée pendant 40 ans.
Amitiés,
Jean-Claude Autran
Q2.
Cher Jean Claude
Je retournerai voir Serge Malcor, sachant
désormais qu’il avait cette corde là à son
bastingage ! Merci pour l’information.
MN
30
septembre - 5 octobre 2012 : Confection de rusquets
Q1.
BONJOUR MONSIEUR AUTRAN..
JE SUIS DOMICILIE EN CORSE DU
SUD... ET VOILA PAS MAL DE TEMPS QUE JE VISITE VOTRE SITE QUI ME DONNE
SOUVENT PAS MAL DE REPONSESA MES QUESTIONS DIVERSES.
JE SUIS A LA RECHERCHE DE
FLOTTEURS BLANCS EN PVC SOUPLE... QUE VOUS AVEZ CERTAINEMENT CONNUS...
POUR LA PECHE AU RUSQUET. DONC LA PECHE A L OBLADE ET AU MULET.
IL EXISTAIT UN MAGASIN DANS
LE MIDI... VERS BEAULIEU JE CROIS QUI LES VENDAIT...
VOUS SERIEZ BIEN AIMABLE...
DE ME COMMUNIQUER UNE ADRESSE POUR EN ACHETER...
DANS L'ATTENTE DE VOTRE
REPONSE... AGREEZ, MONSIEUR AUTRAN, L EXPRESSION DE MES MEILLEURS
SENTIMENTS.
AM
Q2.
(à SM)
(...) Sur un tout
autre sujet : connais-tu, dans la région, un fabricant ou un
vendeur de rusquets ??
Merci par avance si tu as une idée.
Claudet Autran
R2.
Je ne connais ni fabricant ni
marchand de rusquets. Il faut dire que fixer une ligne d'une trentaine
de centimètres avec un hameçon d'un côté et
un flotteur de l'autre, c'est à la portée de n'importe
qui.
SM
R3a. (à
SM)
Ave Pif,
Merci pour ta réponse sur les rusquets. Effectivement,
j’ai encore une partie de ceux, en liège, de mon
grand-père et de mon arrière grand-père et tous
avaient été faits “maison” à
l’époque. Le monsieur qui me pose la question, qui se
trouve en Corse, pensait que de nos jours, on pouvait en trouver de
tout faits, en polystyrène. Je vais lui répondre que je
n’ai pas d’idée sur l’existence d’un tel
fabricant dans notre secteur.
(...) A un de
ces jours
Ton ami Fox
R3b. (à
AM)
Bonjour,
Je suis
vraiment désolé, mais, malgré mes recherches,
ainsi qu’en demandant à quelques amis qui connaissent bien
les matériels de pêche, je n’ai pu retrouver aucun
vendeur ou fabriquant de rusquets dans la région que nous
connaissons (autour de Toulon – La Seyne). Tout ceux qui
pratiquent cette pêche m’ont dit les avoir fabriqués
eux-mêmes à partir d’un cylindre de liège, et
de 30 cm de fil de pêche. Moi-même, j’en
possède encore quelques-uns, (fabriqués par mon
arrière grand-père !) et qui, en y mettant un
hameçon neuf, sont encore en parfait état
d’utilisation.
Ceci dit, il
est fort possible qu’il existe un vendeur quelque part,
peut-être encore à Beaulieu dans les Alpes-Maritimes ??
Mais c’est loin de chez nous et nous n’en connaissons pas
l’adresse.
Désolé
de ne pas pouvoir vous aider.
Bien
cordialement,
Jean-Claude
Autran
17 janvier 2010
: Vocabulaire des chantiers navals et des travailleurs de la
mer
Q1.
Bonjour et bonne
année, M. Autran, quelle vous apporte santé, et puis
aussi un brave moulon d'études historiques à mener !
J'envisage d'écrire dans Le
Seynois ce mois ci sur le vocabulaire provençal des chantiers
navals, ou plus généralement sur le vocabulaire des
travailleurs de la mer. L'ancien responsable du bureau d'études
des Chantiers, qui est provençalophone, M. Jean Gérin,
voudra peut-être me recevoir pour m'en dire un peu là
dessus. Mais n'auriez vous pas dans vos divers travaux quelques chose
sur le sujet ? Je furette volontiers sur votre site internet, mais le
lexique provençal étant présenté par ordre
alphabétique, j'ai un peu peur d'avoir à le parcourir de
A à Z pour trouver de quoi nourrir mon article.
Merci de votre aide
MN
R1a.
Bonjour,
Concernant le
vocabulaire provençal (ou de "mots d'ici") des chantiers navals,
je n'ai qu'un nombre de termes très limité. Je n'ai pas
eu, dans mon enfance, de membre de la famille travaillant au chantier
et qui ait pu me transmettre ce vocabulaire. Et mon père a bien
écrit un volume sur la construction navale, mais il ne s'y
trouve que très peu d'expression provençales.
Tout ce que j'ai pu
noter c'est :
- - le "chantou"
pour le Chantier
- - les "M'an fa
tort" : ouvriers retraités assis sur l'actuel quai de la Marine
(la Banque des M'an fa tort) qui se racontaient leur vie de travail et
qui se plaignaient d'avoir été brimés ou
lésés pour leur avancement, ou les récompenses aux
quelles ils pouvaient prétendre. Ils trouvaient qu'on leur avait
fait du tort et ils disaient "M'an fa tort"
- - les "matelots"
: vocable utilisé pour désigner les manœuvres,
quasi-domestiques, qui étaient mis à la disposition des
ouvriers qualifiés
- - "se lever le
maffre" : Le "maffre" est un Terme d'origine obscure qui désigne
le postérieur dans l'expression : se lever le maffre. «
Mon père, y s'est levé le maffre toute sa vie aux
Chantiers ».
- - "mater les
rivets" : écraser les rivets au marteau ou à la masse
(mais le terme n'est peut-être pas provençal)
Il faudrait
peut-être voir avec des anciens des Chantiers qui ont
enregistré et écrit beaucoup de souvenirs, comme Francis
LYON.
J'ai, en revanche,
davantage de termes concernant la pêche, les métiers (ou
l'artisanat local) de la pêche, et les engins de pêche. Ils
ont fait l'objet d'une page spéciale dans mes archives
familiales sur internet:
http://jcautran.free.fr/archives_familiales/loisirs/engins_de_peche.html
Vous trouverez
ci-joint le fichier correspondant sous Word. La graphie est
provençale, locale, plus ou moins personnalisée...
Veuillez m'en excuser.
|
Termes locaux de pêche ou d'engins de pêche
Aube : Le travail d'aube (prov. aubo) : C'est la
pêche à vue, celle qui se pratique en vue du fond. Deux
moments forts : l'aubo (aube) et la primo (crépuscule). A
l'aube, la mer est généralement bouanasse (= bonace,
calme plat), mais le vent se lève vite. Le vent qui vient de
terre se nomme le ventadin, ou le levagnòu (qui souffle de
l'est). Il crée la risée (raïsso) et lève
aussi l'andaillon (andaioun = clapot) ; on voit alors plus mal le fond.
L'aubijaïré (pêcheur de l'aube) ne peut travailler
dans ces conditions. Il use alors de moyens efficaces : l'huile qui
donne alors des plaques lisses sur l'eau et une meilleure transparence
; il utilise aussi un bouiòu (seau) [= mire-fond] dont le fond
est vitré, qui fait office de lunette sous-marine.
Aubijade : Pêche à faible profondeur,
à l'aube (à l'heure où la mer n'est pas encore
agitée par les vents et à la condition expresse d'une
parfaite limpidité des eaux).
Aubijaïre : Pêcheur qui exerce son
activité à l'aube ; pêcheur qui pratique une
variété de pêche appelée aubijade, qui
collecte tous les animaux comestibles des mates ou des vaïres. Les
engins utilisés par l'aubijaïre sont : la balance, le
céouclé, la fachouire, le gantchou, la grapette, le
mire-fond, l'oursinière, le salabre.
Il les confectionne souvent lui-même :
- - la balance : filet monté sur deux cercles
superposés
- - le céouclé (cieucle = cercle) : cercle
avec filet monté en cône pour la capture des esquinades
(esquinado = araignée de mer, ou chèvre de mer)
- - la fachouire (= foëne ou fouine) qui permet de
clouer (clavar) les seiches, les poulpes ou des poissons
- - le ganchou : crochet métallique qui sert
à se tenir à une épave, à ramener une
amarre ou un gros poisson
- - la grapette : engin métallique à dents
recourbées en forme de main, fixé à
l'extrémité d'une perche en bois qui permet un grand
nombre de prises à la surface des fonds ou même en
profondeur
- - le mire-fond : utilisé en cas de risée
provoquée par le levagnòu. Il s'agit d'une caisse (ou
d'un seau, le bouiòu ) dont le fond est vitré et qui fait
office de lunette sous-marine
- - l'oursinière : canne fendue en trois brins et
tenue ouverte par une pierre
- - le salabre (= épuisette)
Balarguer : Mot construit sur balancer et larguer qui
signifie lancer très vigoureusement. « Allez, balargue !
», dit-on à propos d'une ligne de pêche, d'une ancre
de bateau, d'une bouée, etc.
Bas de ligne : Partie terminale de la ligne de pêche
à laquelle sont attachés les plombs et les
hameçons. Le terme français est l'empile.
Basséler, bacéler : Battre avec un battoir
(prov. bacela, de bacèu, battoir). Se dit notamment pour battre
un poulpe (bacela lou poupre) pour l'attendrir.
Bastardéou : Nasse en forme de globe, à
armature métallique et grillage, faite pour prendre le poisson
blanc.
Bette : Bateau à fond plat, servant à la
pêche (prov. bèto).
Bouanasse, bouanasso, bouenaço, bounaço :
Calme plat, temps doux et chaud, bonace (mer calme). « Es
bouanasso ! E se lou mistraou si levo pas, anan si regala ! ».
Bouleguès pas lou batèu : Expression de
pêcheurs en mer qui s'applique, au sens figuré, pour
demander de ne plus bouger ou de ne plus faire bouger lorsqu'on est
dans une situation d'équilibre précaire
(échafaudage, échelle, etc.).
Brassijer : Gesticuler avec les bras, faire des grands
gestes ou des efforts des bras (prov. brasseja). (Voir de loin un
pêcher à la palangrotte brassijer, c'est le signe qu'il
est tombé sur un endroit poissonneux, qu'il est en train de
faire pille).
Brassole : Bas de ligne d'un zigou-zigou.
Bronde : Terme local de navigation. Désigne
l'endroit où le fond marin descend brutalement, causant des
turbulences au bateau qui y passe (du prov. bronda, de branda, branler,
remuer, tanguer).
Broumé, broumet : Sorte de pâte à base
de mie de pain et de fromage fort, ou de marmelade de viande ou de
poisson (sardines en état de putréfaction),
utilisée pour attirer le poisson.
Brouméjer : (Prov. broumeja) Attirer le poisson en
jetant à la mer du broumé, une sorte de pâte
à base de mie de pain et de fromage fort, ou de marmelade de
viande ou de poisson. S'emploie aussi pour exprimer l'action de vomir
par-dessus bord.
Brusquer : Esque brusquée : esque passée sur
un feu de bois allumé au bord de la mer. Le goût et
l'odeur de l'appât en étaient renforcés. Brusquer
vient de bruyère, appelée brusc en provençal. Au
siècle dernier, les barques peintes au goudron étaient
décapées avant d'être repeintes, grâce
à des fagots de bruyères flambant. Le spectacle
était fréquent sur les rivages du Brusc (le nom du
village viendrait de là).
Cale : Long plan incliné en bois, renforcé
de cornières de fer, construit dans les criques rocheuses (on en
trouve encore à La Verne et à Fabrégas) où
un mouillage permanent n'est pas envisageable, sur lequel on hisse les
bateaux de pêche, les pointus, à l'aide d'un treuil, pour
les mettre à l'abri des vagues déferlantes. Pendant la
saison de pêche, les bateaux ne sont remontés que de
quelques mètres, alors qu'en période de tempêtes,
le bateau est tiré « en terre » et sanglé
autour de la cale, tout à fait en haut de celle-ci. [Ce sens de
cale, en Provence maritime, est différent de celui de la langue
française pour laquelle une cale désigne un plan
incliné sur lequel on construit les navires (on se rappelle des
cales de nos anciens chantiers de construction navale)].
Calée : Action de tendre les filets, de placer une
ligne de pêche. Une calée de nuit (du prov. cala, caler,
baisser, jeter dans la mer, tendre les filets).
Canestèu : Corbeille en cannes refendues ou en
osier, utilisée par exemple par les pêcheurs pour leurs
coquillages ou pour le rangement de leur palangre (canestèu de
palangre).
Cenche : (Prov. cencho : ceinture, enclos de filets que
l'on forme dans la mer pour bloquer le poisson). Mode de pêche
qui consiste à encercler un lieu de pêche avec un filet.
En agitant la mer au centre, le poisson s'enfuit et s'emmaille.
Con à la voile : Expression insultante qualifiant
les premiers immigrés italiens arrivés sur nos
côtes au moyen de leur bateau de pêche :
- - como sei venuto ?
- - con la vela (avec la voile).
Volontairement mal entendue, l'expression con la vela
! a donné : con à la voile ! qui qualifie un abruti
complet.
Désesquer : En termes de pêche, on est
désesqué, ou on se fait désesquer (enlever
l'esque) lorsque le poisson ne fait que mordiller, endommager ou
enlever l'appât, sans se faire prendre à l'hameçon.
Eisserò : Vent de mer qui souffle du sud-est, sorte
de sirocco (cf. largade, pounent, labé, miéjour, etc.).
Embornier : Panier oblong de 1 m de haut, structure
cylindrique de 1 m de diamètre, fait pour capturer les congres
et les murènes, esqué à la supi (seiche) ou au
poupre (poulpe). Pasfois les esques étaient brusquées.
Épine : Arête de poisson. Ce poisson est
plein d'épines.
Enragué : Se dit d'une ligne de pêche
coincée dans une faille rocheuse.
Escavène : Esche, arénicole des
pêcheurs, ver annélide utilisé comme appât
par les pêcheurs (cf. esque) (prov. escaveno, escareno, de
escava, creuser des galeries).
Escavenier : Ancien gagne-petit de la mer, l'escavenier se
livrait à la capture des vers marins qu'il vendait aux
pêcheurs. Sur les bords vaseux de la baie du Lazaret, ils
creusaient profondément au moyen d'une pelle-pioche à
large ferrure, renversaient les mottes de lise croulantes et les
fouillaient de leurs dix doigts à la recherche des
escavènes fugitives. D'autres escaveniers mieux nantis
disposaient d'un bateau qu'ils mouillaient au-dessus des mates avec des
amarrages serrés à des partègues.
Escombrière : Filet semblable à la
tounaille, mais plus réduit, destiné à prendre les
pélamides (bonites à dos rayé : Pelamis sarda).
Esque : Esche, annélidé, ver de vase (genre
Hesione) utilisé comme appât par les pêcheurs
provençaux (prov. esco). (cf. escavène,
néréis ; mouredu, arénicole des pêcheurs ;
cf. esquer, se faire désesquer).
Esquer : Enfiler une esque, un ver de vase, ou un autre
type d'appât (moule, limaçon, etc.) sur l'hameçon.
Estrop : Cordelette ou lanière de cuir servant
à attacher l'aviron à son tolet.
Fachouire : Foëne (ou fouine), sorte de harpon
à plusieurs pointes qui permet de claver (clouer) les seiches,
les poulpes ou les poissons.
Faoucado : Groupe de personnes, famille, se
déplaçant ensemble, le plus souvent pour une partie
d'agrément au bord de mer. Le soir, les faoucado reprenaient le
chemin de la maison. Du prov. foucado, baignade de famille, partie de
pêche en famille.
Filets (ou arrêts) : Les filets traînants :
- - le gangui : poche d'environ 8 mètres de long
avec une ouverture prolongée vers l'avant par des bandes de
filets appelées les ailes. L'écartement des ailes est
maintenu par une barre de bois appelée le badaï (badayar =
bâiller), de 4 à 6 mètres, qui râcle le fond.
Engin interdit par la suite en raison des dégâts
considérables causés dans les frayères des fonds
d'algues.
- - l'issaugue : grand filet calé à 200 ou
300 mètres du bord d'une plage, halé par 10 à 12
hommes, le patron commandant le réï (de l'arabe raïs),
équipe de tous les miséreux d'une commune.
- - le braguin et le tartanon : variantes du
précédent.
- - les dragues :
- - drague à crevettes (rateau)
- - drague à oursins et poissons de soupe (se fait
de nuit, car les soirs de beau temps les oursins montent au sommet des
algues.
- - arceau et pièce en bois au bas de l'arceau
pour la pêche au cambaròu (= crevette d'herbier).
Les filets flottants :
- le sardinal, ou sardignau : 4 pièces de
100 mètres de long chacune, 12 mètres de haut. On
pêche à l'aubo ou à la primo.
Les filets de fond :
- - l'entremaou (1,20 m), filet à bouillabaisse.
- - les claires : filets à langoustes.
- - le batudon - les arrêts (blancs)
- - le filet à rougets (3 m de haut)
- - les arrêts blancs non teints (filets à
merlans)
Les filets de poste :
- filets calés en des points précis
où le poisson passe toujours : en forme de points
d'interrogations (ouverts vers l'est car le poisson vient de l'orient).
Fourgon : (De fourgonner = farfouiller). Là aussi,
on encerclait les poisson avec un filet, mais on répandait de la
chaux dans l'espace cerné. Les poissons s'enfuyaient et
s'emmaillaient.
Fustier : Pêche à la lumière (le
poisson est attiré la nuit par des sources lumineuses.
Aujourd'hui, on connaît le lamparo (lumière
électrique). Autrefois, on pratiquait la pêche au
lumé (lume = lumière). On attirait le poisson autour d'un
brasier promené à la surface de l'eau. On entourait le
cercle lumineux d'un filet, puis le feu était noyé. Le
poisson effrayé s'enfuyait et s'emmaillait dans toutes les
directions. Fustier vient de fustes (fusta = bûchettes). On
promenait aussi les bûchettes de bois gras rougi (par le trou
d'homme du bâteau) tandis qu'un autre pêcher surveillait,
muni de sa fouine. La fumée incommodait tout de même les
pêcheurs. Plus tard, on remplaça les buchettes par le
carbure.
Ganchou, gantchou : Ustensile de pêche ou de
navigation : gaffe, simple crochet métallique fixé au
bout d'une perche pour s'accrocher ou tirer à soi une
épave.
Gangui : Pêche au gangui : ancien mode de
pêche, dévastateur des fonds marins : un filet volumineux.
La pêche au gangui consistait à draguer les fonds
d'herbiers non pas en poussant (comme le pousse-avant) mais en
traînant un filet volumineux (le gangui) en forme de sac conique
dont l'embouchure était tenue béante par une armature de
fer et au fond duquel s'entassaient poissons, langoustes, poulpes,
crabes, etc.
Garbelle : Grand panier en cannes fendues, même
forme que l'embornier (1,30 à 1,50 m de profondeur), fait pour
prendre les langoustes.
Girelié, girelier, girellier : Sorte de nasse
d'osier et de brins de myrte, adaptée à la prise des
girelles. Diamètre : 50 cm. On y utilise des moules
écrasées comme appât pour les girelles.
Gobier, panier à gobis : Nasse de forme oblongue
(0,50 m x 0,20 m), conçue pour prendre les gobis ou les baboites
(blennies).
Grapette : Le plus précieux de tous les engins de
l'aubijaïre : c'est un engin métallique à dents
recourbées en forme de main, fixé à
l'extrémité d'une perche en bois qui permet un grand
nombre de prises à la surface des fonds ou même en
profondeur.
Grégaou, grégal : Vent agréable qui
vient d'Est à Nord-Est et dure parfois plusieurs jours, ainsi
nommé ainsi parce qu'il souffle en Provence du côté
de la Grèce. On le nomme aussi galerne. (cf. montagnero,
tramontano).
Labé, labech : Vent du Sud-Ouest pouvant parfois
rouler des vagues très fortes (du grec libos : vent venant de
Lybie, pour les Grecs) (cf. eissero, largade, miejour, pounent).
Labéchade : Coup de vent du Sud-Ouest. Si la
largade devient mistralade ou, pire, labéchade, alors une houle
profonde creuse la mer, avec de lourdes lames que le vent fait
déferler en moutonnements infinis.
Lamparo : Pêche au lamparo : Pêche qui
consiste à attirer les sardines avec de grosses lampes
montées sur une barque. Le banc de sardines est enfermé
dans un gros filet formant une poche quand le treuil puissant le
remonte. Il peut prendre jusqu'à 10 tonnes de sardines.
Larg : Vent larg (vent largue, en terme de marine) : vent
de mer venant de l'Ouest, plus fort que le mistralet, mais moins
violent que la largade.
Largade : (Prov. largado) : Vent du large, très
violent, qui vient du golfe du Lion : « Ça serait
déjà les largades de septembre ? ». La mer perd
alors immédiatement ses miroitements que remplacent de courtes
vagues rageuses.
Lencis : (Lenci = ligne) : la palangrotte ou la
traîne qui remorque un leurre (plume de gabian, cuillère
métallique, peau de tambour, peau de chamois, ou vif).
Lenci mouarte : ligne morte.
Ligne lestée : ligne lestée avec boulantin
qui sert de signal et de flotteur.
Levagnòu, levagnoou : Vent du matin, qui vient de
l'Est et accompagne le soleil du levant.
Madrague : Grand filet de chanvre, pour la pêche aux
thon.
Marquer : Outre le sens d'avoir le point au jeu de boules,
marquer s'utilise pour : réussir, avoir de la réussite. A
la pêche, on a marqué signifie on a un début de
journée prometteur.
Mate, matte : (Du prov. mato, touffe ; mato d'augo :
touffe d'herbe). Fond marin sablo-vaseux, stabilisé par le lacis
de rhizomes et de racines des posidonies, légèrement
surélevé par rapport au fond de la mer, et qui
constituait autrefois l'habitat une riche faune de coquillages (cf.
vaïre).
Mire-fond : Instrument utilisé par
l'aubijaïré (pêcheur de l'aube) en cas de
risée (cf. raissa) provoquée par le vent de l'est
(levagnaou). Il s'agit d'une caisse (ou d'un seau, le bouiòu)
dont le fond est vitré et qui fait office de lunette sous-marine.
Mujolière : Pour prendre les mulets ou muges (prov.
mujorièro).
Musclaou, mousclau, amessoun : Hameçon (du bas lat.
mosclaris). « Serai countènt coume un roucau - Que
vèn d'escapa dóu musclau » (P. Bellot, poète
marseillais).
Nasse : Les pêcheurs professionnels disent que ce
n'est pas un terme de pescadou : ils disent les paniers. Les paniers
sont faits avec de l'osier, des blettes de brugas (repousses de
bruyère), des brins de myrte et des cannes fendues, tenus avec
du fil de fer zingué ou du fil de laiton.
Nato : Natte pour les flotteurs en liège des filets
de pêche.
Oursinière : Instrument ancêtre de la
grapette, confectionné avec une canne (roseau) fendue en trois
brins à l'extrémité, tenus écartés
par une pierre ou une pomme de pin.
Palangre : Ligne pour la pêche en mer
constituée d'une corde le long de laquelles sont
attachées des empiles munies d'hameçons. [NB. Le terme
est du genre féminin dans la langue française ; il est
souvent employé au masculin en Provence maritime]. Il aurait
été introduit en Provence par les Catalans venus
s'installer à Marseille dans l'anse portant leur nom,
après la peste de 1721. La ligne principale appelée la
mère porte un signal à chaque extrémité.
Toutes les deux ou trois brasses sont fixés des morceaux de
ligne longs également d'une brasse (1,62 m) et terminés
par un musclau (hameçon). La ligne est appelée aussi
brassolade.
Palangre à congres : 30 hameçons
autorisés aujourd'hui.
Palangre à sars : On y utilise la graisse du
vié maré (phallus marin, nom scientifique : holothurie).
Palangre de fond : Palangre que l'on range dans un panier
en osier aux parois à claire-voie et qui porte à la
partie supérieure une guirlande de liège (la couffe). A
mesure qu'on sarpe (sarpar = tirer), on love la mère dans la
couffe et on enfonce les musclaous un à un dans le liège
(gare à ne pas croiser les brassolades). Le nylon est aujurd'hui
bien préférable au chanvre. Les esques peuvent être
des crevettes, des poissons vivants (gobis ou bogues), des mouredus.
Palangrotte : Ligne plombée pour la pêche en
mer, enroulée autour d'une plaque de liège et
manoeuvrée à la main (prov. palangrotto) (cf.
lènci).
Partègue : (Prov. partego, perche, gaffe). Long
piquet planté au fond de l'eau, à l'avant et à
l'arrière du bateau du pêcheur de mouredus, lui assurant
une meilleure stabilité.
Payoù : Paillot, caillebotis, plancher d'une bette.
Pendis : Dans les parcs à moules, les pendis sont
des cordes régulièrement espacées, suspendues
à l'armature en bois du parc, sur lesquelles on accroche le
naissain grâce à des morceaux de filets et autour
desquelles se développent les moules. Du prov. pendis, pendant,
penchant, en pente. Cala lou palangre en pendis, manière de
tendre cet engin entre deux eaux. Désigne aussi un palangre
entre deux eaux.
Pescadou : Pêcheur professionnel.
Pescaire : Pêcheur amateur (légèrement
péjoratif) (cf. également aubijaire).
Pescarié : Poissonnerie, halle aux poissons.
Piadier : Nasse à prendre les bernard-l'ermite
(piades), généralement amorcée avec des tripes et
des têtes de poissons.
Pille : Faire pille (prov. piho, pilho, capture, butin,
prise) : réussir une belle capture, une belle pêche.
Pitée : Touche, sensation que l'on a lorsque le
poisson mord à l'hameçon.
Piter : Mordre à l'hameçon (prov. pita).
Pointu : Embarcation de pêche et de promenade
utilisée en Méditerranée.
Pous : « Pescan dins un pous ! » (Nous
pêchons dans un puits ! »), disent les pêcheurs en
mer, lorsqu'on ne ressent aucune pitée, ou qu'on n'a même
pas la consolation d'être désesqué.
Pousse-avant : Ancien mode de pêche,
dévastateur des fonds marins. Le pousse-avant était
constitué d'une armature de bois trapézoïdale, tenue
par un manche où s'accrochait un filet en forme de poche. En
poussant le manche devant soi, l'engin draguait à faible
profondeur, se remplissait d'algues, de poissons, de crabes, de
crevettes, de bigorneaux.
Primo : Pesca de primo, cala de primo : pêcher au
coucher du soleil ou dans la nuit. Sardino de primo, pèis de
primo.
Radet : Petite rade, petit port. Le premier port de La
Sagno était vraisemblablement situé à
l'emplacement actuel de la place Martel Esprit. Le nom primitif de
cette place (place Bourradet) viendrait peut-être (?) de lou
radet, la petite rade.
Raisse : (Prov. raisso) Averse, ondée de pluie. En
terme de marine, désigne également un coup de vent, une
rafale. Sur nos rivages, c'est aussi la risée
créée par le levagnoou, vent du matin venant de l'Est.
Ravageur : Sur nos rivages, ce vocable désignait
autrefois des braconniers de la mer, qui vivaient de petits larcins et
qui avaient le goût de ce qui est défendu. Ils ramassaient
du bois rejeté par la mer pour se chauffer, des débris de
ferraille ou d'étoffes pour en faire commerce, mais, ils
n'hésitaient pas à visiter nuitamment les parcs à
moules, à vider de leur contenu les nasses calées par
d'autres. La gendarmerie maritime et la douane avaient fort à
faire avec ces coquins dont certains s'étaient fait une
auréole de gloire par leurs exploits.
Riai : Epervier : filet de forme circulaire quand il est
déployé, portant des bagues de plomb à la
périphérie. On le projette sur les bancs de poissons (par
ex. de saupes) pour les capeler (capelar = coiffer). En tirant sur une
corde médiane, l'épervier prend alors une forme de poire
où le banc de poissons se trouve emprisonné.
Risée : Légères ondulations de la mer
créées par le levagnòu, vent du matin venant de
l'Est, qui gênent le travail de l'aubijaïre. (cf. raisso).
Rissole : Filet qui peut prendre les ciouclets (?) ou
mange-tout.
Roumagnole : Ustensile de pêche : faisceau
d'hameçons soudés autour d'un axe (cf.
tóuténière).
Rusque : Écorce de pin pilée, riche en
tanin, dont on faisait un bouillon pour imprégner le coton, le
chanvre des filets de pêche, et même le liège des
flotteurs (prov. rusco).
Rusquet : Ustensile de pêche : flotteur
constitué d'un morceau de liège taillé en cylindre
court et portant au dessous un fil muni d'un hameçon.
Appâté avec un simple morceau de pain, le rusquet permet
de pêcher des blades.
Sague : Pour les pêcheurs, la sague est une brume ou
un brouillard qui arrive ou qui se forme sur la mer (du prov. sago,
brouillard, amas de nuages).
Salabre : Épuisette, filet rond attaché
à un manche utilisé pour prendre le poisson dans les
grands filets ou les viviers, ou pour ramener à bord du bateau,
sans risque de le perdre, un poisson de grand de taille pris à
l'hameçon.
Sarper, serper : (Prov. sarpa) Lever l'ancre à bras
ou au moyen de palans. Tirer la corde d'un engin de pêche qu'on
avait calé, par exemple un palangre.
Simaillon, simailloun : Scion, brin terminal d'une canne
à pêcher.
Sous-cul : Sorte de coussin, de dessus de chaise
rembourré, notamment utilisé pour s'asseoir plus
confortablement sur les planches ou les plats-bords en bois des petits
bateaux de pêche.
Tencho : Teinte, teinture : Faire la tencho : tremper les
filets de pêche dans une dissolution d'écorce de pin
broyée (rusco) pour les préserver de l'action corrosive
de la mer. Moulin à tencho, cf. moulin à rusco.
Tounaille : Filet à thons (grosses mailles) :
longueur : 250 à 300 m., hauteur : 20 m., placé à
un poste tenu 6 jours. Si le thon coule, il faut le harponner avec le
foumé (harpon lesté).
Touténière : Calamarette, engin conçu
pour prendre les calmars (toùtèno) ou autres
céphalopodes : poire en plomb peinte en rouge ou en blanc,
fixée par le sommet à un filin, tandis que la base est
armée de crochets acérés, comme un faisceau de
gros hameçons réunis par leur partie droite (cf.
roumagnole). On l'utilise en lui imprimant des mouvements de bas en
haut et de haut en bas.
Vaïre : Clairière de sable au milieu d'un fond
marin couvert d'algues (cf. mate).
Ventadin : Vent léger qui se met à souffler
de la terre vers dix heures du matin.
Quelques noms locaux d'animaux marins ayant un
caractère humoristique
Bibi : Gros ver blanc grisâtre de grande
taille utilisé comme appât de pêche et dont les
poissons sont très friands. Sorte de mouredu de grande taille
(cf. mouredu, mouron, escavène, esque). Un bibi ayant la taille
d'un doigt, il serait ainsi nommé par analogie supposée
avec le sexe d'un garçonnet (?).
Esque : Esche, annélidé, ver de vase (genre
Hesione) utilisé comme appât par les pêcheurs
provençaux (prov. esco). (cf. escavène,
néréis ; mouredu, arénicole des pêcheurs,
mouron, bibi ; cf. esquer, se faire désesquer). L'expression :
« Va te faire une soupe d'esques ! » est employée
pour se débarrasser d'un gêneur, pour l'envoyer se
promener. (Ce serait le plat de résistance d'un pêcheur
rentré bredouille : il ne lui reste plus qu'à
confectionner son repas avec le reste de ses appâts...). Un
chapeau « pour aller faire les esques » est un vieux
chapeau déformé et à fond arrondi, semblable au
récipient souple utilisé par les pêcheurs d'esques.
Gobi : En français gobie (n.m.), petit poisson du
littoral marin, sorte de goujon de mer, pouvant se fixer aux rochers
par ses nageoires ventrales formant ventouse (genre Gobius, famille des
Gobiidés). Comme il est immobile et mord très facilement
à l'appât, on l'appelle aussi le poisson-couillon. Dans un
tout autre registre, le gobi de brailles, c'est (très
vulgairement) le membre viril (cf. aucèu, chichette, quico,
quiquette, vié, vier).
Masque : (Du prov. enmasca : ensorceler) Nom d'un poisson
de mer brun violacé (genre Blennius ? ou Nettastoma ? ou
Heliastes ??) dont on dit, lorsqu'on en attrape un dès le
début, qu'il présage une matinée de pêche
catastrophique.
Piade : (Prov. piado) Bernard-l'ermite, espèce de
crustacé appelé pagure (genres Pagurus, Anapagurus,
Clibanarius, etc.), qui protège son abdomen dans une coquille de
gastéropode vide et se déplace en emportant celle-ci,
très recherché comme appât pour la pêche (cf.
biòu-arpu).
Pito-moufo : Petit poisson de mer (Crenilabrus melops),
qui ne mord pas franchement à l'hameçon, qui
désesque facilement les pêcheurs (cf. peissaille).
Vier marin : « Phallus marin » (prov.
vié mare), holothurie, concombre de mer, genre d'animal
échinoderme à corps cylindrique et à parois
épaisses (Holothuria Forskali).
|
Bien que cela vous
intéresse sans doute moins, j'ai aussi une rubrique sur les noms
locaux de poissons et autres animaux marins :
http://jcautran.free.fr/archives_familiales/loisirs/poissons.html
Et j'en ai extrait
quelques-uns dont les noms ont un caractère plus ou moins
humoristique, susceptibles de vous intéresser (cf. À la
fin du même fichier Word).
Peut-être
cela est-il "hors sujet" pour votre prochain article, mais cela pourra
peut-être vous servir pour une autre fois...
Enfin, j'ai un DVD
d'interviews de mon père (et de bien d'autres personnages
seynois), dont certains passages sont en provençal. Il s'agit
d'interviews réalisées en 1994 par FR3 Provence. Il s'y
trouve de-ci de-là des termes provençaux de la
construction navale ou des métiers de la mer. Attention, le DVD
contient des sujets divers et variés. Pour ce qui concerne la
construction navale et la mer il faut aller directement au "TITLE-#8"
et plus particulièrement dans les chapitres 4 à 6 et 24
à 30.
J'en ai fait une
copie que je peux vous en envoyer par la poste (mais il faudrait que
vous m'indiquiez votre adresse, que je ne crois pas avoir), à
moins que vous ne passiez à La Seyne un de ces prochains jours
(pour la récupérer chez moi ou à une autre adresse
comme le service Communication ?).
Restant à
votre disposition.
Cordialement,
Jean-Claude Autran
R1b. (7 mars
2010)
Bonjour,
En janvier dernier,
vous m'aviez demandé si j'avais quelque chose sur le vocabulaire
des travailleurs de la mer en vue d'une page dans Le Seynois. Quelques
jours plus tard, je vous avais envoyé quelques
éléments [copie du message ci-dessous], mais, sans
nouvelles depuis, je ne sais pas finalement si vous l'aviez reçu
ou si cela a pu vous être utile.
Très
récemment, j'ai pu obtenir (de la part de mon ami Serge Malcor)
un nouveau lexique très complet des termes provençaux de
la petite construction navale et de la pêche artisanale.
Je vous l'adresse
ci-joint en fichier Word. Même si cela arrive trop tard pour
votre article, cela pourra vous servir à une prochaine occasion.
Cordialement,
Jean-Claude Autran
- Agrupe :
Aiguillot, partie mâle de la penture de gouvernail
- Aisso :
Herminette, hache des charpentiers
- Amadièro
: Espace entre varangues, maille
- Anguilié:
Orifices pratiqués dans le bas de la varangue pour permettre la
circulation de l'eau dans tous les compartiments de la cale.
- Anguilié
de faouco : Dalots, orifices pratiqués dans la falque pour
évacuer les eaux stagnant entre pont et falque
- Anteno :
Antenne, grande vergue supportant le tier-pount
- Apoundoun :
Allonge
- Arboura:
Mettre le mât en place
- Arjoù
: Barre de gouvernail
- Aubre :
Autre nom du mât
- Augivèù
: Drisse de foc (fixation en haut du mât)
- Banc
d'apé : Renfort du bordé
- Banc
d'arboura : Renfort du bordé prés du mât
- Barbeto :
Amarre
- Battudo :
Filet de 3 brasses de hauteur et 80 brasses de long, pour les
scombridés
- Beto de
traine : Bette servant à la pêche à la
traîne, barque de 26 pans
- Biòu
: Tartane chalutant en couple
- Bordàgi
: Bordé (parfois utilisé pour bauquière)
- Boòude
: Corps-mort, mouillage
- Bourcé
: Voile au tiers
- Bourgin,
brégin : Filet traînant à mailles étroites
formé de deux ailes aboutissant à une manche
- Bréganeù
: Plat-bord
- Brouméja
: Brouméger, appâter avec la boette... s'emploie
plutôt pour exprimer l'action de vomir par dessus bord, se dit
aussi "appeler Raoul"
- Cabrì
: Croix de Saint-André, dispositif de levage
- Calesoun :
Tirant d'eau
- Caleù
: Filet utilisé "au Martigue", carrelet servant à
piéger le muge (mulet)
- Caneto :
Canne à pêche
- Carbaloun :
Équerrage, angle d'équerrage
- Carcagnoù
: Petit pont arrière, tillac de poupe
- Carenaù:
Quille
- Catalano :
Barque catalane, surtout utilisée en Languedoc
- Chòulamén
: Tonture, se dit aussi fué
- Claveù
: Clou, pointe de charpentier
- Counassièro
: Partie femelle de la panture d'étambot
- Courantiho :
Pêche du thon en haute mer, par opposition à la seincho
- Cuberto :
Pont
- Dourmento :
Palangre
- Eissaugo :
Long filet de pêche formé d'une grande poche et de deux
ailes, désigne aussi le bateau qui traîne ce filet
- Emploumba :
Épissurer
- Enbon :
Virure alternant avec le fil
- Ensencho :
Préceinte
- Escaumié
: Tolet
- Escaumièro
: Toletière
- Escoa:
Membrure (Toulon)
- Escoldo :
Membrure (Marseille)
- Escoto :
Écoute
- Estamanaire
: Allonge
- Estivo :
Fond de cale
- Estrop :
Cordelette servant à attacher l'aviron à son tolet
- Falouco,
felouco : Felouque, barque aux façons effilées et
menée à la rame
- Fauco :
Fargue, falque
- Femelot :
Autre nom de la counassièro
- Ferre,
Ferrì : Ancre, grappin
- Fièu,
fil : Bordage alternant avec l'enbon
- Fisco :
Vieux filet que l'on joint au bas des tounaio
- Floun:
Itague, cordage qui sert à hisser l'antenne
- Gànchou
: Gaffe
- Gangui :
Petit chalut, désigne aussi le " bateau qui le traîne
- Garbé
: Gabarit
- Gardo-banc :
Renfort de banc
- Gaùbi
: Savoir-faire, maîtrise, aisance
- Issoun :
Drisse de l'antenne
- Lahut : Gros
gangui, désigne aussi le bateau qui le traîne
|
- Latto-baou :
Eau, barrot
- Laveù
: Hameçon
- Lènci
: Palangrotte
- Lèvo-pei
: Épaississement du plat-bord arrière gauche, protection
de la falque
- Ligno-maire
: Palangre
- Ligno morto
: Palangre de fond
- Longo :
Autre nom de la palangrotte
- Loubo :
Loube, scie à dents de loup utilisée en va-et-vient par
deux scieurs de long
- Madié
: Madrier, grosse pièce de bois, .bâti-moteur, barrot
- Madrago :
Pêche au thon au filet fixe et près des côtes
- Manjo-vent :
Petit foc
- Man-tenen :
Poignée de l'aviron
- Mar de
Marsiho : Mer des marseillais, partie de la rade de Marseille
située en-deçà du Frioul
- Mar
d'amotlnt : Partie nord de la rade de Marseille
- Mar
délieuro . : Haute mer, large
- Mar
d'avaù : Partie sud de la rade de Marseille
- Marinié
: Barque de 26 pans pour la traîne d'été
- Martégaù
: Filet (voir bourgin, brégin)
- Matafioun :
Cordon pour attacher la voile
- àl'antenne
- Mestre d'
aisso : Charpentier de Marine (à Marseille)
- Mestro :
Grand voile
- Mousclaù
: Hameçon
- Murado :
Intérieur de la coque
- Naufe, :
Sorte de petit foc
- Palangrin :
Long palangre
- Pan : Empan,
mesure d'environ 25 cm
- Papefigo :
Voile d'étai
- Payoù
: Paillol, plancher de la barquette
- Peno : Coin
du bas d'une voile latine, partie postérieure de l'antenne
- Pescadou :
Pêcheur professionnel
- Pescaire :
Pêcheur amateur (légèrement péjoratif)
- Pitalo :
Baupré
- Plan : Fond
du bateau
- Piano :
Pièce de fond du bateau
- Poulacro :
Générique pour foc, désigne aussi le bateau
possédant un foc
- Quitran :
Goudron
- Radasso :
Radasse, vieux filet usagé servant à la pêche des
oursins
- Rafiau :
Pointu toulonnais
- Récampadis
: Litt. réfugiés. Terme gentiment moqueur pour "touriste"
- Rem : Aviron
- Rodo de
poupo : Étambot
- Salabre :
Les étrangers l'appellent "épuisette"
- Saltarelo :
Sauterelle, fausse-équerre
- Sarreto :
Bauquière
- Sardinaù
: Filet à mailles serrées dédié à la
sardine, désigne aussi le bateau
- Sarpa :
Lever l'ancre
- Seincho :
Pêche au thon à la senne, dans des filets fixes
- Serra :
Vaigrage
- Sorro : Lest
- Talounoù
: Armement de la quille
- Taùmé
: Tillac
- Tasseiroun :
Voile d'étai de mauvais temps
- Tier-pount :
Voile latine
- Timoun :
Safran de gouvernail
- Toulounenco
: Canne à pêche longue et flexible pour pêcher dans
les trous de rochers
- Tounaio :
Filet dérivant dédié au thon
- Trencarén
: Trinquenin, partie latérale du pontage
- Trépadou
: Place du timonier
- Trinqué
: Mât incliné vers l'avant des catalanes, mât
d'artimon
- Trinquetin :
Foc de trinqué
- Vaco :
Tartane chalutant seule
- Véleto
: Petite voile latine gréée sur la vergue de mestre
- Véradié
: Filet dérivant
- Véruno
: Tarière
- Viluro,
viruro : Virure, bordage entier
|
Q2.
Bonsoir
Jean-Claude
Vous avez
sacrément bien fait de me renvoyer ce lexique, car le dernier
mail que j'ai gardé de vous date de juillet 2009. Noyé
sous deux à trois cents mails quotidiens ai je mis celui ci
à la corbeille sans bien regarder ? a t'il été
zigouillé par mon antispam ? envoyé à une autre
adresse ? ...
J'avais pris
contact avec un ancien du bureau d'études des chantiers,
provençalisant, M. Gérin, et pensais travailler sur ses
souvenirs, mais il s'avère que la langue d'oc n'entrait pas dans
les bureaux... du moins le pense t'il. Puis Miquèu Tournan m'a
mis en rapport avec Gérard Tautil, qui m'a envoyé le
texte d'une chanson sur le thème des chantiers, et il semble que
la chanteuse Nicola, dans les années 70 s'y soit essayée
aussi. Je recherche son texte. Tournan doit me tenir au courant.
Bref, il y a
quelques chances pour que, dès ce mois ci, si toutefois mon
sujet est accepté, j'ai à me servir de votre vocabulaire.
Il serait
intéressant ausi de savoir si votre ami Serge Malcor avait un
rapport professionnel avec les chantiers. De toutes manières
s'il réside à La Seyne, c'est quelqu'un qu'il me serait
utile de rencontrer.
Ces temps ci on a
tendance à me proposer des sujets
provenço-provençalistes alors que je
préfèrerais m'intéresser simplement à
l'actualité locale, mais en provençal, par exemple
à propos de l'économie navale locale. Et le lexique de M.
Malcor pourrait me donner quelques idées.
Merci
MN
R2.
Bonjour
Michel,
Je suis heureux que
ce lexique puisse vous intéresser.
En fait, il me faut
rectifier un point sur lequel je n'ai pas été très
clair. C'est bien Serge Malcor qui m'a passé ce lexique, il y a
déjà quelques mois. Mais, il n'en est pas lui-même
l'auteur. Il s'agit d'un "glossaire des termes provençaux" qui
figure à la fin d'un ouvrage consacré à la
construction des petits bateaux de pêche (...).
Mais Serge Malcor
est aussi l'auteur d'un lexique de termes locaux (dont une partie a
été empruntée au lexique provençal de mon
site internet), qu'il a intitulé « Les maux des mots
», à compte d'auteur, 2007. Et comme Serge Malcor est un
grand connaisseur de la mer, de la pêche, de la faune
sous-marine, un grand nombre des termes qu'il a traités sont
relatifs à ces sujets. (...).
Naturellement, ce
serait très utile qu'à l'occasion vous rencontriez Serge
Malcor. Que ce soit sur les sujets ci-dessus, ou sur tout autre relatif
à La Seyne qu'il n'a pratiquement jamais quittée depuis
qu'il y est né, en 1943. Il est très disponible,
pharmacien retraité, et joignable à : (...).
Amicalement,
Jean-Claude Autran
Q3.
Cher J-Claude
Merci pour toutes
ces précisions. Il est possible que j'utilise dès ce mois
ci quelques uns des items de ce lexique car je consacre mon article
mensuel aux chantiers navals dans la chanson d'auteur. J'ai
connaissance de trois textes sur le sujet, écrits à
l'occasion de leur fermeture ou en commémoration de celle ci,
par trois auteurs d'expression occitane.
Je prendrai contact
avec Serge Malcor à l'occasion d'une prochaine visite, (...)
pourquoi ne pas envisager un portrait de groupe ? D'autant que vous
n'êtes pas seuls sur place, je viens de commenter le dernier
ouvrage de René Merle, sur l'enquête impériale
menée vers 1806 pour mieux connaître les idiomes
régionaux, prélude à leur éradication alors
souhaitée ! Mais rené Merle est il toujours Seynois ?
bien à vous
MN
R3.
Bonsoir
Michel,
Je ne sais pas quel
est votre calendrier. Ce que je sais c'est que Serge Malcor est en ce
moment absent de La Seyne (je crois jusqu'au 24 mars). (...) mais il
n'y aurait certainement pas de problème à faire un
portrait de groupe si vous le jugiez utile. Tout est question de
calendrier et de disponibilité un même jour des uns et des
autres. J'en parle à Serge Malcor dès son retour.
Quant à
René Merle, il n'est plus seynois depuis une dizaine
d'années. Il habite Toulon. Il est joignable par son site
internet http://rene.merle.charles.antonin.over-blog.com.
Bien à vous,
Jean-Claude Autran
Q4.
Je suis en
contact avec Merle (je viens de faire la critique de son dernier
ouvrage) et il lui arrive de collaborer avec le mensuel Aquò d'Aqui, que j'anime.
Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés !
Pour une rencontre,
on se tient au courant des possibilités pratiques si vous voulez
bien. J'attendrai que vous me donniez des nouvelles.
merci et à +
tard
MN
17 février
2007 - 11 décembre 2016 : Confection des
gireliers et de nasses
Q1.
Bonjour
Voici, sur mon blog un petit
article sur LE MYRTE
Vos observations et suggestions
sont les bienvenues
Toutes mes amitiés
JPB
R1.
Bonjour,
Merci de m'avoir
indiqué votre article sur le Myrte : http://lubalpi.free.fr/Lycos/Myrte-blog
Il est très
bien fait et les photos sont très belles.
A noter qu'un autre
intérêt du myrte, en dehors des usages vous citez
(phytothérapie, liqueur), est l'emploi des rameaux dans la
confection des nasses appelées gireliers, qui sont
conçues pour la pêche des girelles. Ces gireliers sont
fabriqués en osier, mais l'ouverture en entonnoir, dont les
détails de fabrication sont très importants pour que les
poissons y entrent, est en principe faite de brins de myrte. Les
pêcheurs prétendent que si on utilise un autre bois que le
myrte, le girellier ne « pêche » pas, ou beaucoup
moins. Et encore, je crois que les brins de myrte doivent être
cueillis dans certaines conditions et à une saison bien
précise.
Amitiés,
Jean-Claude Autran
Q2a.
Merci pour votre
réponse et les précisions sur les gireliers.
Me permettez vous d'en faire
état dans l'article du blog en citant l'auteur et en mettant un
lien vers votre site.
Je le communique déjà
à mes amis
Auriez vous par hasard une photo de
girellier
Merci
Toutes mes amitiés
JPB
Q2b. (à
SM)
Salut Serge,
En mai dernier,
lorsque tu tenais à Janas le stand sur les plantes
médicinales, je crois que tu avais une fiche sur les
propriétés et usages du Myrte.
Pourrais-tu me
renseigner (pour que je puisse répondre à l'un de mes
correspondants) sur :
- 1) la recette de
la liqueur de myrte (si ce n'est pas ultra secret ?)
- 2) l'utilisation
des tiges de myrte pour la fabrication des gireliers
(utilise-t-on le
myrte pour confectionner uniquement la bouche d'entrée ? Ou
peut-on l'utiliser pour confectionner la totalité du girelier
à la place de l'osier ou d'un autre bois ? Et n'y a-t-il pas une
saison précise pour cueillir les tiges de myrte si l'on veut que
le girelier "pêche" ?
Merci par avance.
Amitiés.
Claudet
R2a. (de SM)
Salut Claudet,
En ce qui concerne les gireliers et
leur fabrication je suis loin d'être un spécialiste mais
je sais que les gireliers tout comme les gobiers "qui font pêche"
sont uniquement fabriqués à partir du myrte.
Le "ventre" avec de longues tiges
et la "pachole" avec des sous-rameaux plus fins. On doit couper les
branches de myrte à la nouvelle lune et quand la sève est
descendue (durant les mois d'hiver).
Je ne crois pas que des gireliers
soient fabriqués à partir d'osier ou d'autre bois dans la
région. Par contre, beaucoup de gens croient que c'est de
l'osier parce que c'est tressé.
J'avais rencontré la fille
d'un ancien pêcheur de Saint Mandrier qui m'avait raconté
tout ça.
Je vais essayer de reprendre
contact début mars, au cours de la réunion du bureau des
amis des Janas. Je te tiendrai au courant.
Pour la liqueur de myrte, ce n'est
pas bien compliqué mais ma recette est empirique :
Cueillir les fruits après
les premières gelées (ordinairement au cours du mois de
décembre) et les mettre à macérer dans l'alcool
à 90 durant trois mois. (Environ 1 kilo de baies pour 3 litres
d'alcool)
Filtrer afin de
récupérer le liquide.
Faire un sirop de sucre avec 500 g
de sucre pour un litre d'eau et l'ajouter progressivement afin
d'obtenir la douceur désirée.
Pour rabaisser le degré
alcoolique, il est possible d'ajouter alors la quantité d'eau
désirée à partir de ce moment-là.
Certains procèdent
directement avec de "l'aïgo ardent" mais l'extraction des saveurs
est, à mon avis, moins subtile. De plus, en fonction de la
climatologie de l'automne, on risque d'obtenir un trop faible
degré alcoolique après adjonction du sirop.
Selon les années, il est
possible de procéder à deux macérations
successives des baies. La seconde devant alors durer plus longtemps.
Cette année (2006), les
myrtes n'ont pas subi de gelée dans la forêt des Janas.
Elles donneront certainement une liqueur quelconque.
Personnellement je n'en ai pas
ramassé mais avec ce que j'avais récupéré
en 2005, je suis paré pour au moins deux années.
Tu en as dégusté, il
me semble, à La Désirée, au printemps dernier !
(...) Adessias.
Pif
R2b.
Bonjour,
Pas de
problème, vous pouvez faire état de tous nos
échanges sur le myrte et les gireliers dans votre blog.
Pour
compléter la discussion sur ces sujets, je vous communique
d'ailleurs ci-dessous quelques précisions que je viens de
recevoir de mon ami Serge Malcor, ancien pharmacien de Toulon, qui
possède une fiche sur les propriétés et les usages
du myrte. Voici ce qu'il vient de m'écrire :
- 1) En ce qui
concerne les gireliers et leur fabrication je suis loin d'être un
spécialiste mais je sais que les gireliers tout comme les
gobiers "qui font pêche" sont uniquement fabriqués
à partir du myrte.
- Le "ventre" avec
de longues tiges et la "pachole" avec des sous-rameaux plus fins. On
doit couper les branches de myrte à la nouvelle lune et quand la
sève est descendue (durant les mois d'hiver).
- Je ne crois pas
que des gireliers soient fabriqués à partir d'osier ou
d'autre bois dans la région. Par contre, beaucoup de gens
croient que c'est de l'osier parce que c'est tressé.
- J'avais
rencontré la fille d'un ancien pêcheur de Saint Mandrier
qui m'avait raconté tout ça.
- Je vais essayer de
reprendre contact début mars, au cours de la réunion du
bureau des amis des Janas. Je te tiendrai au courant.
- 2) Pour la liqueur
de myrte, ce n'est pas bien compliqué mais ma recette est
empirique :
- Cueillir les
fruits après les premières gelées (ordinairement
au cours du mois de décembre) et les mettre à
macérer dans l'alcool à 90 durant trois mois. (Environ 1
kilo de baies pour 3 litres d'alcool)
- Filtrer afin de
récupérer le liquide.
- Faire un sirop de
sucre avec 500 g de sucre pour un litre d'eau et l'ajouter
progressivement afin d'obtenir la douceur désirée.
- Pour rabaisser le
degré alcoolique, il est possible d'ajouter alors la
quantité d'eau désirée à partir de ce
moment-là.
- Certains
procèdent directement avec de "l'aïgo ardent" mais
l'extraction des saveurs est, à mon avis, moins subtile. De
plus, en fonction de la climatologie de l'automne, on risque d'obtenir
un trop faible degré alcoolique après adjonction du sirop.
- Selon les
années, il est possible de procéder à deux
macérations successives des baies. La seconde devant alors durer
plus longtemps.
- Cette année
(2006), les myrtes n'ont pas subi de gelée dans la forêt
des Janas. Elles donneront certainement une liqueur quelconque.
A bientôt,
Amitiés,
Jean-Claude Autran
R2c.
Re bonjour,
J'ai oublié,
hier, de vous envoyer des photos de gireliers.
En voici deux pour
votre information : girelier_1.jpg et girelier_2.jpg
Mais je ne sais pas
si vous avez le droit de les faire figurer sur votre blog car ces
photos ont été respectivement copiées à
partir de deux sites internet suivants : http://pieds-noirs.info/pni/article.php3?id_article=223 et http://www.peche-guilfish.com/shop/index.php?id=2331
Amitiés,
Jean-Claude Autran
Q3a. (27 juin
2007)
Bonjour
Monsieur AUTRAN,
Objectif:
pérenniser par l'image la fabrication d'engins de pêche
méditerranéens en vannerie.
Dans le domaine
"pêche et engins de pêche" je suis à la recherche
d'informations sur la fabrication artisanale des gireliers, nasses,
garbelles en osier, myrte etc ...
Outre le
côté documentaire, mon souhait serait de pouvoir
réaliser un film vidéo amateur sur cette technique de
vannerie.
En
conséquence je suis à la recherche d'une personne sachant
encore pratiquer cette technique ancestrale dans le Var.
Auriez-vous
l'amabilité de m'indiquer une piste ?
Par avance merci.
Cordialement.
AG
Q3b.
Bonjour
Monsieur AUTRAN,
Dans le
prolongement de mon projet concernant la "pérennisation" de la
fabrication de gireliers ou autres nasses en myrte,
Je viens d'explorer
deux sites internet où il est question de "techniques de
fabrication" :
corsicanostra.free.fr/travaux
de la mer.htm
ajaccio.fr
Bien que
relativement succint le detail est cependant intéressant.
Je ne manquerai pas
de vous communiquer ultérieurement d'autres éventuelles
"trouvailles".
Cordialement.
AG
Q3c.
(à SM)
Salut Serge,
Comment va ?
L'un de mes
correspondants cherche une personne qui pratiquerait encore dans le Var
la fabrication artisanale de gireliers, nasses, garbelles en osier,
myrte. (Je crois que c'est pour en faire une video).
Aurais-tu des
informations à ce sujet ? Merci par avance.
Fox
R3a.
Adiou
Claudet,
Je vais
tâcher de retrouver le nom du fabricant de gireliers. Il habite
vers le fort Napoléon mais j'ai oublié de marquer son nom
et son adresse...
(...) Le bonjour
à toute ta tribu.
Adessias.
Pif
R3b.
Bonsoir,
Pardon pour le
retard à vous répondre. Je ne connais personne qui
pratique la technique de fabrication des gireliers, mais, en
interrogeant autour de moi, j'ai trouvé un ami qui pourrait
avoir une piste, à La Seyne sur Mer, d'un fabricant artisanal de
gireliers et qui, à son avis, accepterait d'être
filmé. Mais il n'a plus l'adresse exacte en tête et me
demande quelques jours de délai pour interroger quelqu'un de son
entourage qui doit pouvoir la lui retrouver.
Je vous tiens au
courant.
A bientôt,
dès que j'ai du nouveau.
Cordialement,
Jean-Claude Autran
Q4a.
Bonjour
Monsieur AUTRAN,
Merci pour votre
aimable réponse: rien ne presse car je ne puis être libre
pour la réalisation du "projet gireliers" que pendant le mois
d'octobre prochain.
En attendant je
continue mes recherches et ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Cordialement.
AG
Q4b. (30
août 2007)
Je viens
d'avoir un coup de fil au sujet de la personne qui fabrique les
gireliers.
Il s'agit de
monsieur AV qui habite (...).
Mais il
paraîtrait que vous vous connaissez déjà !
Pif
R4.
Merci, Pif,
pour l'adresse du fabricant seynois de gireliers.
Je l'ai transmise
à mon correspondant qui souhaitait faire une sorte de reportage
sur les gireliers en lui demandant de prendre contact directement avec
M. V.
Je connais en effet
la famille V. J'ai dû les rencontrer 1-2 fois à une
inauguration ou à une journée Histoire et Patrimoine.
Mais c'est surtout
avec MV que j'ai eu des échanges. Son mari, physiquement, je ne
m'en souviens guère. Sa famille connaissait bien mon
père, comme le montre un de ses messages ci-dessous
Fox
Q5.
Bonsoir,
J'ai pu avoir
l'adresse de la personne qui, à La Seyne-sur-Mer, fabrique
encore des gireliers. Il s'agit de :
Monsieur AV (...)
Vous pouvez prendre
contact avec lui de ma part (mon père le connaissait bien) ou de
mon ami Serge Malcor, qui le connaît aussi.
Cordialement,
Jean-Claude Autran
R5.
Bonjour,
Merci d'avoir
mené à bien les recherches concernant la fabrication des
gireliers.
Pour l'instant je
suis encore en Savoie où je passe tous mes étés et
une partie de l'automne.
Dès mon
retour dans le Midi vers le 15 octobre je m'empresserai de prendre
contact avec Mr AV et ne manquerai pas de vous tenir informé.
Cordialement.
AG
Q6. (11
janvier 2008) à AG et à SM
Bonsoir,
Je ne sais pas si
vous avez réussi à faire votre reportage sur la
fabrication de gireliers auprès de M. AV.
Mais
peut-être serez-vous intéressé par les
coordonnées d'une seconde personne qui, à La
Seyne-sur-Mer, fabrique des gireliers. Il s'agit de M. PP, capitaine du
port de Saint-Elme.
Voir la copie
ci-jointe d'un article paru hier dans Var-Matin
Cordialement,
Jean-Claude Autran
R6a.
Bonjour,
Merci pour cette
seconde piste à propos des "créateurs de gireliers".
C'est très aimable à vous et encore merci.
Dans quelques jours
je vais m'organiser pour rencontrer MM. AV et PP ainsi que
vous-mêmes si vous le permettez.
Cordialement.
AG
R6b.
Salut Fox,
(...) Merci pour
l'article sur le nouveau capitaine de port de Saint Elme que je ne
connais que de vue. Au printemps dernier, il a remplacé Julien,
un petit gars que j'ai vu naître mais qui actuellement s'est
rapproché de son domicile en prenant la direction du port de La
Madrague de Giens.
En tant que
capitaine de port, il aurait tout de même pu ajouter qu'il est
interdit d'avoir à bord d'une embarcation plus de deux
gireliers.
C'est la raison
pour laquelle quand nous faisons une pêche aux gireliers, nous
prenons deux ou trois kayaks en remorque et autant de personnes que de
bateaux...
Je ne connaissais
pas l'usage du lentisque à la place du myrte, mais il est vrai
que c'est un bois aux caractéristiques semblables.
(...) Grosses bises
à toute la maisonnée et à bientôt.
Adessias.
Pif
Q7.
Bousoir Pif,
(...) A propos des
gireliers, j'ai aussi été surpris de voir citer le
lentisque pour leur fabrication. Mais je me demande si le capitaine du
port connaît suffisamment nos arbustes de la garrigue ou du
maquis. Il prétend que nos anciens appelaient le lentisque "daladéou".
Or, à ma connaissance, et à celle de
Frédéric Mistral, le daladèu (ou daradèu,
daladèr, daradèr, daradèl, aladèr,
alavèr, etc. etc.), c'est le filaria, ou philaria, ou
filaire (avec ses espèces bien connues : aladèr mascle,
filaria à feuilles étroites ; gros aladèr,
filaria à large feuilles). Le lentisque (Pistachier Lentisque),
en provençal, tout le monde s'accorde pour dire que c'est lou
lentiscle. Filarias et lentisques se côtoient souvent dans
nos bois, mais les premiers sont des oléacées, les
seconds des térébinthacées. Rien à voir
entre eux, ni avec le myrte, ni avec l'osier. Alors, finalement, lequel
des deux utilise-t-il en réalité ? Et lequel est un bois
fait pour la mer ? Je n'en sais rien. Il faudra lui demander. (...)
Claudet
Q8. (9 février 2013)
A noter aussi la page
de Var-Matin datée du 9 février 2013,
consacrée à : « BO, le dernier des
tresseurs de nasses » - A 79 ans, le pêcheur du Lavandou
veut transmettre son savoir faire. Alors, il va donner des cours, de la
cueillette du myrte et du jonc, jusqu'à la pêche, en passant
par le façonnage... ».
JCA
Q9. (17 juillet 2013)
A noter
enfin deux autres articles retrouvés dans Var-Matin,
l'un à la page de Bandol, le 6 juin 2011 : « HS,
tresseur de gireliers », qui utilise « le
mélandrier, originaire d'Amérique du nord » et
« cuilli de lune ». Dans un autre ariticle, paru dans
l'édition de Var-Matin
du 17 juillet 2013 : « Girelier, une passion en voie de
disparition », avec la photo du même Henri Suquet, avec
« l'un de ses gireliers fabriqués à partir de myrte
», là il est question d'utiliser un partage entre «
la gineste, la myrte et le mélancier ; et non pas l'osier
». Alors, faut-il lire mélandrier ou mélancier ??
(Mélancier semble être une forme vieillie de
l'Amélanchier, tandis que Gineste semble correspondre à
notre Spartier à tiges de Jonc (ou Genêt d'Espagne)).
JCA
Q10. (18 octobre 2015)
Cher J.Claude,
(...) Tu
trouveras ci-joint quelques photos de girellier (l’orthographe 1
l ou 2 l !) que fait mon mari Baby, il y a fort longtemps nous en
avions discuté au temps où ton père était
vivant, actuellement il les confectionne en myrtes et en tamaris qui
demeure un bois imputrescible .
Bien à toi et
bon dimanche.
A bientôt
MV
R10.
Bonjour Michèle,
Pardon pour le retard avec lequel je réponds à ton dernier message.
Merci pour les photos de gireliers. Je savais que ton mari en
fabriquait. Il y a quelques années déjà, lors
d’échanges avec différentes personnes
intéressées par les gireliers, son nom m’avait
été communiqué par mon ami Serge Malcor.
A la suite de quoi, plusieurs autres fabricants de gireliers varois
avaient été identifiés : l’un (PP, de Saint-Elme) utilisait myrte et
lentisque (ou filaire ?). Un
autre (HS, de Bandol) utilisait myrte, «
mélandrier » (ou « mélancier ») et
« gineste ». On n’a pas trop su à quoi
correspondaient les noms de ces deux derniers végétaux.
« Mélandrier » aurait pu peut-être
correspondre à l’amélanchier et « gineste
» au genêt d’Espagne (?). Un autre (BO, du
Lavandou), utilisait myrte et jonc...
Tous ces échanges d’informations avaient été
mis dans le “forum” de mon site à la page :
http://jcautran.free.fr/forum/peche.html#8
Mais je ne connaissais pas encore l’usage du tamaris que fait ton mari.
Avec amitiés.
Jean-Claude
R11. (11 décembre 2016)
J'ai encore trouvé la référence à cet ouvrage de Bernard Bertrand : « Le tresseur de nasses de Méditerranée - Blaise Obino »
5 septembre 2006
- 10 novembre 2012 : Pêche à l'issogue
Q1.
Salut jeune homme,
Ta photo du pin de Grune, c'est la
photo que j'avais vue à la Seyne.
J'ai trouvé une carte
postale (en photocopie) mentionnant la pêche à l'issogue.
La photo est prise sur la
corniche de Tamaris (on discerne le port du Manteau dans le fond),
certainement à côté du casino.
Ça ressemble à la
pêche à la seince mais je n'avais jamais entendu ce terme.
Adessias
Pif
R1a.
Salut Serge,
J'avais vu, en
effet, passer cette photo parmi les nombreuses cartes postales de La
Seyne et de Tamaris (...).
Le terme issogue
m'avait aussi interpellé.
Que dit le
dictionnaire de Frédéric Mistral ?
1) Le
provençal isso ! correspond à l'interjection
hisse ! tire ! pousse ! en avant ! etc. et oh isso ! est le
« cri d'ensemble que poussent les pêcheurs pour haler un
câble ou lever les filets ».
2) On trouve le
provençal issogo ou eissaga, mais il n'y a pas
de rapport avec la pêche.
3) On trouve aussi
la famille de mots eissaugo, eissago, issago, etc. (qui a pu
être francisé en issogue), qui signifie : «
long filet de pêche formé d'une grande poche et de deux
ailes ; nom du bateau qui traîne ce filet ». Un eissauguié
est celui qui pêche à l'eissaugo.
Apparemment il
s'agit d'une pêche au moyen d'un filet qu'on tire, qui
s'apparenterait à une senne (tournante ou coulissante) qui
permet d'encercler les bancs de poissons. Je n'ai pas inclus pêche
à la seince dans mon lexique. Cela correspond-il bien
à une senne ou seine, telle qu'on la décrit dans les
dictionnaires ?
D'ailleurs il y a
plusieurs autres cartes postales de Tamaris ou de Balaguier, sur le
même site internet, qui montrent (sans parler d'issogue) des
groupes de pêcheurs en train de tirer, de la même
façon, leurs filets sur le chemin qui n'était pas encore
l'actuelle corniche goudronnée.
A bientôt.
Bon séjour
à La Faurie.
Claudet
R1b.
Salut Pif,
Encore une carte
postale des pêcheurs à l'issogue, qui sont cette fois
orthographiés issauguos.
Mais peux-tu
reconnaître l'endroit ? Anse de Balaguier? Eguillette ? Ou un
autre lieu ?
A bientôt.
Claudet
Q2.
Salut
Claudet,
(…) Ta
photographie de la pêche à l'issaugue est très
belle. Après avoir bien examiné ses détails, je
pense qu'elle a été prise entre neuf et dix heures du
matin et que ce rivage pourrait être celui du Pin de Grune,
à cause du grand mur. Personnellement je pencherai plus pour la
pointe du Canon, à Saint-Mandrier. Le grand baraquement à
dû disparaître mais le toit que l'on discerne
derrière pourrait être celui d'un bâtiment de
l'hôpital. Quant au musoir de la jetée qui dépasse
du muret, il pourrait figurer l'estacade qui marque la fin des pistes
d'envol de la BAN. Les collines qui se devinent dans le lointain
pouvant être celles de la Terre Promise...
Voilà pour
aujourd'hui !
Bisous à tous
Pif
Q3. (3
août 2010)
Bonjour Jean
Claude, en regardant de vieilles photos sur Tamaris, j'ai trouvé
une carte postale représentant des pêcheurs tirant un
filet depuis la route de la corniche.
Pêcheurs
à l'ISSOGUE. Quesaco ?
Amitiés
HG
R3.
Bonjour
Henri,
J'avais aussi
découvert ce terme sur de vieilles cartes postales de Tamaris ou
de Balaguier et j'avais fait une petite recherche à ce sujet :
Que dit le
dictionnaire de Frédéric Mistral ?
- 1) Le
provençal isso ! correspond à l'interjection hisse ! tire
! pousse ! en avant ! etc. et oh isso ! est le « cri d'ensemble
que poussent les pêcheurs pour haler un câble ou lever les
filets ».
- 2) On trouve le
provençal issogo ou eissaga, mais il n'y a pas de rapport avec
la pêche.
- 3) On trouve aussi
la famille de mots eissaugo, eissago, issago, etc. (qui a pu être
francisé en issogue), qui signifie : « long filet de
pêche formé d'une grande poche et de deux ailes ; nom du
bateau qui traîne ce filet ». Un eissauguié est
celui qui pêche à l'eissaugo.
Tu trouveras
d'ailleurs dans la section Pêche et et engins de pêche du
forum de mon site le détail des échanges que j'avais eus
avec Serge Malcor à propos de cette pêche à
l'issogue. Voir à :
http://jcautran.free.fr/forum/peche.html#7
Merci, par
ailleurs, pour la référence du superbe site Solimages qui
a si bien illustré tes textes.
Amitiés,
à un de ces jours sans doute.
Jean-Claude
PS. Je travaille
d'arrache-pied pour finir la mise à jour de l'Histoire de la
philharmonique La Seynoise qui doit paraître en octobre.
Q4. (27 décembre 2011)
Monsieur,
C'est encore moi ! A propos donc du sens du terme " issaugue",
qui intrigue certains familiers de votre site.
Cela
veut dire tout simplement " hisse-algues". Car si le filet en question
permettait de pêcher du poisson, il ramenait aussi à
terre beaucoup d'algues. L'explication se trouve dans l'ouvrage
suivant, consultable sur " Googlelivres" : Sabin Berthelot.
Études sur les pêches maritimes dans la
Méditerranée et l'océan - Page 150. 1868.
Le
nom d'eissaugue provient du provençal ; il est formé du
verbe hisso (hisser ) et du substantif aougo (algue), parce que le
filet, en draguant le fond herbeux, emporte avec lui beaucoup d'algues
marines ; de là l'expression ...
Bien à vous.
JH
R4. (2 janvier 2011)
Bonjour Monsieur,
(...) Merci également pour l’explication du mot Issaugue.
Je n’avais pas réalisé le lien avec
“hisse-algues”, qui est parfaitement expliqué dans
l’ouvrage sur les Pêches maritimes dont vous m’avez
communiqué la référence. Je vais faire suivre
cette explication aux personnes intriguées par cette
“pêche à l’Issaugue”.
Bien cordialement à vous, et tous mes vœux
également pour la nouvelle année
Jean-Claude Autran
Q5. (6 novembre
2012)
Bonjour Jean Claude,
J'ai revu l'illustration représentant de vieux pêcheurs
seynois qui pêchent à l'Issogue.
Je ne connaissais pas cette méthode, par contre dans ma
jeunesse, avec mon père et surtout Mr Gallian on pêchait
avec un filet d'une dizaine de mètres environ que l'on
déployait autour des rochers.
Ensuite on remuait les pierres afin d'attaper les gobis et les
rouquiers puis on allait un peu plus loin et on recommençait
l'opération.
Mr Gallian était le gardien du fort de l'Eguillette et nous
pratiquions cette pêche bien à l'abri.
Cette forme de pêche était pratiquet à l'aide de ce
fameux filet qu'on appellait ENTREMAILLON.
Le fort de l'Eguillette, que de souvenirs. Nous étions
trés amis avec les Gallian et Serge le fils.
Il y a en haut, une terrasse immense avec une vue magnifique sur la
rade et des souterrains ou l'on jouait à se planquer.
Bon je préfère arrêter là car j'aurai tant
de choses à dire et te ferai perdre ton temps.
A la prochaine.
Salut Jean Claude
R5.
Salut Henri,
Moi non plus, je ne connaissais pas cette « pêche à
l’issogue » jusqu’à ce que je la
découvre sur de vieilles cartes postales des rivages de la
corniche de Tamaris ou de Balaguier.
D’après le dictionnaire de Frédéric Mistral,
le mot issogue semble venir du provençal EISSAUGO (ou EISSANGO,
EISSAIGO, EISSAGO,...) qui désigne « un long filet de
pêche, formé d’une grande poche et de deux ailes
». Apparemment, il pouvait être tiré soit par des
pêcheurs depuis le rivage, soit par un bateau que l’on
appelait aussi l’EISSAUGO. Il y a des mots synonymes en
provençal qui sont NASSO (nasse) et SÈINO (senne).
Je ne me souvenais pas non plus de ce filet appelé ENTREMAILLON.
Mais lui aussi dérive d’un mot provençal ENTREMAI
(ou ENTRAMAI, ENTREMAU, TRAMAU,...), le tramail, en français,
qui désigne « un filet composé de trois nappes ou
de trois rangs de mailles, que l’on peut tendre par exemple en
travers d’une rivière ».
A noter que le fort de l’Eguillette est aujourd’hui
accessible plusieurs fois par an, pour différentes expositions
et particulièrement au moment des Journées du Patrimoine.
Je suis déjà allé sur la terrasse et la vue sur la
rade est en effet exceptionnelle (photos ci-jointes).
Merci enfin pour cette photo de la brouette de cèpes. Je
n’ai jamais vu ça. Tout ce que j’ai ramassé
ces temps-ci, faute de safranés, c’était des
pissacans. Quoi qu’il y aurait eu pas mal de safranés dans
les Maures cette année. Mais rien qu’à
l’idée qu’il faut traverser Toulon...
A la prochaine.
Jean-Claude
21 août -
1er septembre 2006 : Histoire des parcs à moules et à
huîtres dans la rade de Toulon
Q1.
mon pére et surtout
mon grand pére avait crée en 1890 les premiers parcs
à coquillages au Lazaret et à Tamaris. Dans le journal
"Echos de Tamaris" du 21 mai 1892, il y a un article à ce
sujet.....
Habitant depuis toujours Toulon, je
m'intéresse à la vie locale......
Merci pour tout vos livres et
articles sur ce sujet.
YDJ
R1.
Bonjour
Monsieur,
Merci pour votre
aimable message, que j'ai communiqué à mon père,
Marius Autran (96 ans !).
Mon père se
souvient bien d'avoir cité votre famille, et notamment RDJ, dans
l'histoire des parcs à moules, qui se retrouve dans 3 de ses
chapitres : La Baie du Lazaret (tome III), Vie maritime (Tome VII) et
Artisanat seynois (Tome VIII). Il vous transmet son meilleur souvenir.
Nous ne connaissons
pas l'article que vous mentionnez dans les Echos de Tamaris. Si cela
vous était possible de le scanner et de nous en envoyer une
copie, je pourrais, avec votre permission, le rajouter comme une
illustration complémentaire dans l'histoire des parcs à
coquillages seynois sur notre site internet.
Merci par avance,
Cordialement,
Jean-Claude Autran
Q2.
Merci de
votre réponse, je vais vous envoyer une photocopie du journal
"l'Echo de Tamaris" car il est trop grand pour être
scanné. Pourriez vous m'envoyer l'adresse où
l'expédier...
Sincéres
salutations.
YDJ
R2.
Bonjour,
Merci par avance
pour le photocopie du journal.
Voici mon adresse
complète : (...)
Très
cordialement,
Jean-Claude AUTRAN
Q3.
Monsieur,
Ci-inclus la
photocopie en question.
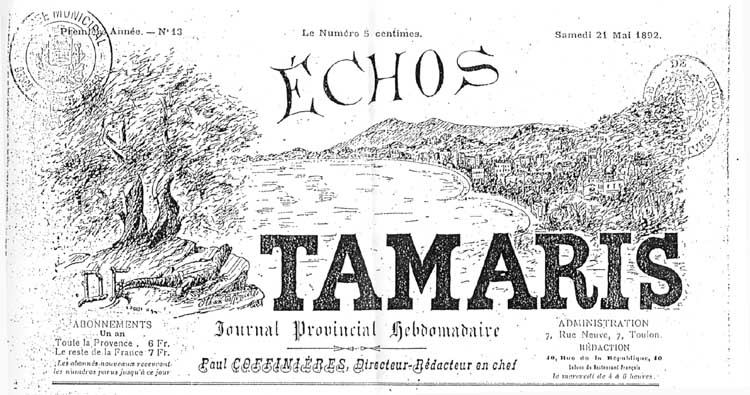
|
|
L'OSTREICULTURE DANS LA RADE DE TOULON
-------------
En attendant que l'Institut biologique, de Tamaris, soit en
plein fonctionnement - ce qui, malheureusement, ne semble pas
près d'arriver, malgré la tenace et infatigable
persévérance de son fondateur, le savant professeur
Dubois, par suite de l'inertie, et, il faut l'avouer, de la
lésinerie de l'État et des particuliers, - un
ostréiculteur a installé, depuis trois ans dans le golfe
de La Seyne, à Mouissèques, un établissement de
culture des huîtres et des moules qui mérite de fixer
notre attention.
Malgré les affirmations du célèbre M.
Coste, l'éminent créateur de l'ostréiculture en
France, de M. Renard, envoyé en mission spéciale sur les
côtes françaises pour faire un rapport sur l'état
de cette nouvelle production maritime et de divers savants et
particuliers qui, après de nombreux essais d'ensemencement
d'huîtres, ont tous déclaré et reconnu
l'impossibilité de produire des huîtres dans la
Méditerranée, M. de Jouette, pénétré
des avantages qui résulteraient pour la région et pour
ceux qui l'entreprendraient, de la création de parcs sur nos
côtes méridionales, a eu le courage de créer de
toutes pièces cette industrie en pleine mer latine, en se
servant, seulement, des données de la science sur l'histoire de
l'huître. Il avait remarqué que, dans toutes les
tentatives qui ont été faites à ce sujet, on
mettait en pratique les procédés qui réussissent
si bien dans l'Océan. Il les a profondément modifier et
le succès est venu couronner ses patients et
persévérants efforts.
Il a créé à Bonifacio, un banc
reproducteur, qui donne, actuellement, une quantité
d'huîtres limitée seulement par le nombre des collecteurs
immergés.
M. de Jouette s'est, dès les premiers jours,
préoccupé surtout de la question économique. Il
semble avoir pris pour devise les paroles de M. Bouchon-Brandely,
inspecteur des pêches maritimes de France, dans son premier
rapport au Ministre de la Marine : « J'invite, d'une façon
très pressante, tous les ostréiculteurs français
à réaliser dans leur outillage des améliorations
indispensables ; il faut arriver à fournir à meilleur
marché les précieux mollusques, si l'on veut lutter
contre la concurrence étrangère qui devient chaque
année plus menaçante. » Les fameuses huîtres
d'Ostende proviennent en majeure partie des Sables d'Olonnes ; les
parqueurs belges les immergent dans les bassins d'Ostende et les
revendent ensuite sous ce nom (encore une contrefaçon belge)
jusque sur les marchés français aux prix que l'on sait.
La Hollande fournit actuellement pour le seul marché de Paris,
cinq millions de kilogrammes de moules !
Qui croirait qu'un pays aussi favorisé que le
nôtre au point de vue de l'étendue des côtes et de
la multiplicité des endroits favorables à
l'élevage des animaux marins, est et reste tributaire de
l'étranger pour une production que la nature nous donnerait en
si grande abondance si nous voulions prendre la peine de la cultiver
intelligemment.
Pour ne parler que de la rade de Toulon, il n'y a certainement
nulle part une source aussi inépuisable de coquillages de toute
espèce, et dont la réputation est européenne. Et
pourtant, il n'existait jusqu'à ces dernières
années que le parc aux huîtres de Brégaillon,
aujourd'hui presque abandonné, par suite de luttes judiciaires
entre son concessionnaire et celui qui lui a succédé.
Aussi, devons-nous de chaleureux encouragements à M. de
Jouette, qui, seul, sans appui pour lutter contre tous les obstacles,
et surtout les tracasseries administratives, est venu installer, de
toutes pièces, un parc flottant pour l'élevage et la
culture des petites huîtres nées à Bonifacio, parc
qu'il perfectionne chaque jour dans son ensemble et dans ses moindres
détails.
J'en suis, depuis quelque temps, avec un vif
intérêt, le fonctionnement et les modifications presque
quotidiennes, car il est situé dans les eaux de la Rouve. Il se
compose d'un radeau de 30 mètres de long sur 15 mètres de
large, formé de madriers laissant entre eux 128 compartiments
dont 634 sont destinés aux huîtres et 64 aux moules. Des
fûts vides, disséminés également dans le
parc, lui donnent la force nécessaire pour supporter les cadres
mobiles à grillages, superposés, qui sont successivement
retirés au-dessus de l'eau au moyen d'un treuil à
manivelle.
Je consacrerai prochainement une étude plus
complète et plus approfondie à l'ensemble de cette grande
exploitation, si ingénieusement combinée, qui est
appelée à un immense avenir, par suite de l'installation
d'un troisième établissement de 400 mètres sur 50
à Port-Miou.
Il me suffit aujourd'hui de constater les résultats
déjà obtenus par M. de Jouette, qui livre, à la
consommation, des huîtres excellentes, uniques dans leur
espèce, au prix de 0 fr. 30, 0 fr. 50 et 0 fr. 60 centimes la
douzaine, et d'appeler l'attention du public et de l'État sur
une tentative qui aura certaienement des imitateurs, encouragés
par son exemple, car elle est pleine de promesse pour la richesse et la
prospérité de notre pays.
Paul COFFINIÈRES
|
Il s'agit de
mon grand-père HDJ, dit "René", né en 1847, mort
à Toulon en 1933.
Salutations
amicales.
YDJ
R3.
Bonjour
Monsieur,
Votre photocopie du
journal "Échos de Tamaris" du 21 mai 1892 m'est bien parvenue et
je vous en remercie sincèrement.
Je vais pouvoir
rajouter ce document complémentaire dans le chapitre
traitant de l'histoire des parcs à coquillages seynois dans le
site internet jcautran.free.fr.
Très
cordialement,
Jean-Claude Autran
11-14 juillet
2006 : L'étoile des pointus ?
Q.
Salut
Claudet,
Une brave dame qui
fut l'institutrice de mon fils, et qui s'en est remis, me pose une
question saugrenue à laquelle je ne trouve pas de réponse.
Sur les pointus, il
y a souvent une étoile de chaque côté du capian,
sur le dernier bordé. Elle voudrait savoir si ces symboles,
qu'on ne trouve pas systématiquement sur tous les
modèles, ont une valeur de porte bonheur ou autre.
Rien ne m'est
encore apparu sur le net ni sur mes livres, mais effectivement il y a
bien des pointus qui arborent ces étoiles.
Si tu as une
explication à cette énigme, merci de m'en faire profiter.
Adéssias.
Pif
R.
Salut Pif,
(...) Toujours rien
trouvé sur l'étoile des pointus.
A bientôt,
Amitiés,
Claudet
9 avril 2005 :
Lexique des termes employés dans la construction des pointus
et barquettes
Q1.
Salut Foxygène !
Je viens de terminer un bouquin sur
les pointus et les barquettes, très intéressant par
ailleurs, et j'y ai trouvé un petit lexique des termes
employés dans la construction et la pratique du petit
métier.
Je te le fais passer par fichier
joint, mais si ta bécane ne veut pas l'intégrer, je reste
en possession du livre encore quelques jours.
Amitiés et Adessias !
Pif
R1.
Ave, Grand
Chef,
Merci pour ton
message. Mais ton fichier m'a donné quelques soucis. Je n'ai pas
compris pourquoi il était compressé et occupait 2 x 12 Mo
après décompression, alors que ce n'était qu'une
liste de mots de quelques pages. Bref, l'énormité du
fichier word (.rtf) m'a effacé toutes mes menus
déroulants et mes préférences word (mais j'ai pu
les reconstituer, car j'ai l'habitude des incidents). Mais le document
récupéré, après élimination de
fichiers images bizarres, n'avait plus que 2 pages de textes, de gancho
à viluro. Il doit manquer les lettres de A à G,
qui ont disparu quelque part.
Mais merci quand
même, c'est un glossaire qui m'intéresse beaucoup.
Peut-être ferai-je une nouvelle tentative de
récupération de ce curieux fichier.
JCA
- Gànchou :
Gaffe
- Gangui : Petit
chalut, désigne aussi le " bateau qui le traîne
- Garbé :
Gabarit
- Gardo-banc :
Renfort de banc
- Gaùbi :
Savoir-faire, maîtrise, aisance
- Issoun : Drisse
de l'antenne
- Lahut : Gros
gangui, désigne aussi le bateau qui le traîne
- Latto-baou :
Eau, barrot
- Laveù :
Hameçon
- Lènci :
Palangrotte
- Lèvo-pei
: Épaississement du plat-bord arrière gauche, protection
de la falque
- Ligno-maire :
Palangre
- Ligno morto :
Palangre de fond
- Longo : Autre
nom de la palangrotte
- Loubo : Loube,
scie à dents de loup utilisée en va-et-vient par deux
scieurs de long
- Madié :
Madrier, grosse pièce de bois, .bâti-moteur, barrot
- Madrago :
Pêche au thon au filet fixe et près des côtes
- Manjo-vent :
Petit foc
- Man-tenen :
Poignée de l'aviron
- Mar de Marsiho :
Mer des marseillais, partie de la rade de Marseille située
en-deçà du Frioul
- Mar d'amotlnt :
Partie nord de la rade de Marseille
- Mar
délieuro . : Haute mer, large
- Mar
d'avaù : Partie sud de la rade de Marseille
- Marinié :
Barque de 26 pans pour la traîne d'été
- Martégaù
: Filet (voir bourgin, brégin)
- Matafioun :
Cordon pour attacher la voile
- àl'antenne
- Mestre d' aisso
: Charpentier de Marine (à Marseille)
- Mestro : Grand
voile
- Mousclaù
: Hameçon
- Murado :
Intérieur de la coque
- Naufe, : Sorte
de petit foc
- Palangrin : Long
palangre
- Pan : Empan,
mesure d'environ 25 cm
- Papefigo : Voile
d'étai
- Payoù :
Paillol, plancher de la barquette
- Peno : Coin du
bas d'une voile latine, partie postérieure de l'antenne
- Pescadou :
Pêcheur professionnel
- Pescaire :
Pêcheur amateur (légèrement péjoratif)
- Pitalo :
Baupré
- Plan : Fond du
bateau
- Piano :
Pièce de fond du bateau
- Poulacro :
Générique pour foc, désigne aussi le bateau
possédant un foc
- Quitran :
Goudron
- Radasso :
Radasse, vieux filet usagé servant à la pêche des
oursins
- Rafiau : Pointu
toulonnais
- Récampadis
: Litt. réfugiés. Terme gentiment moqueur pour "touriste"
- Rem : Aviron
- Rodo de poupo :
Étambot
- Salabre : Les
étrangers l'appellent "épuisette"
- Saltarelo :
Sauterelle, fausse-équerre
- Sarreto :
Bauquière
- Sardinaù
: Filet à mailles serrées dédié à la
sardine, désigne aussi le bateau
- Sarpa : Lever
l'ancre
- Seincho :
Pêche au thon à la senne, dans des filets fixes
- Serra : Vaigrage
- Sorro : Lest
- Talounoù
: Armement de la quille
- Taùmé
: Tillac
- Tasseiroun :
Voile d'étai de mauvais temps
- Tier-pount :
Voile latine
- Timoun : Safran
de gouvernail
- Toulounenco :
Canne à pêche longue et flexible pour pêcher dans
les trous de rochers
- Tounaio : Filet
dérivant dédié au thon
- Trencarén
: Trinquenin, partie latérale du pontage
- Trépadou
: Place du timonier
- Trinqué :
Mât incliné vers l'avant des catalanes, mât
d'artimon
- Trinquetin : Foc
de trinqué
- Vaco : Tartane
chalutant seule
- Véleto :
Petite voile latine gréée sur la vergue de mestre
- Véradié
: Filet dérivant
- Véruno :
Tarière
- Viluro, viruro :
Virure, bordage entier
Première
partie du fichier, récupérée par la suite :
- Agrupe :
Aiguillot, partie mâle de la penture de gouvernail
- Aisso :
Herminette, hache des charpentiers
- Amadièro
: Espace entre varangues, maille
- Anguilié:
Orifices pratiqués dans le bas de la varangue pour permettre la
circulation de l'eau dans tous les compartiments de la cale.
- Anguilié
de faouco : Dalots, orifices pratiqués dans la falque pour
évacuer les eaux stagnant entre pont et falque
- Anteno :
Antenne, grande vergue supportant le tier-pount
- Apoundoun :
Allonge
- Arboura: Mettre
le mât en place
- Arjoù :
Barre de gouvernail
- Aubre : Autre
nom du mât
- Augivèù
: Drisse de foc (fixation en haut du mât)
- Banc
d'apé : Renfort du bordé
- Banc d'arboura :
Renfort du bordé prés du mât
- Barbeto : Amarre
- Battudo : Filet
de 3 brasses de hauteur et 80 brasses de long, pour les
scombridés
- Beto de traine :
Bette servant à la pêche à la traîne, barque
de 26 pans
- Biòu :
Tartane chalutant en couple
- Bordàgi :
Bordé (parfois utilisé pour bauquière)
- Boòude :
Corps-mort, mouillage
- Bourcé :
Voile au tiers
- Bourgin,
brégin : Filet traînant à mailles étroites
formé de deux ailes aboutissant à une manche
- Bréganeù
: Plat-bord
- Brouméja
: Brouméger, appâter avec la boette... s'emploie
plutôt pour exprimer l'action de vomir par dessus bord, se dit
aussi "appeler Raoul"
- Cabrì :
Croix de Saint-André, dispositif de levage
- Calesoun :
Tirant d'eau
- Caleù :
Filet utilisé "au Martigue", carrelet servant à
piéger le muge (mulet)
- Caneto : Canne
à pêche
- Carbaloun :
Équerrage, angle d'équerrage
- Carcagnoù
: Petit pont arrière, tillac de poupe
- Carenaù:
Quille
- Catalano :
Barque catalane, surtout utilisée en Languedoc
- Chòulamén
: Tonture, se dit aussi fué
- Claveù :
Clou, pointe de charpentier
- Counassièro
: Partie femelle de la panture d'étambot
- Courantiho :
Pêche du thon en haute mer, par opposition à la seincho
- Cuberto : Pont
- Dourmento :
Palangre
- Eissaugo : Long
filet de pêche formé d'une grande poche et de deux ailes,
désigne aussi le bateau qui traîne ce filet
- Emploumba :
Épissurer
- Enbon : Virure
alternant avec le fil
- Ensencho :
Préceinte
- Escaumié
: Tolet
- Escaumièro
: Toletière
- Escoa: Membrure
(Toulon)
- Escoldo :
Membrure (Marseille)
- Escoto :
Écoute
- Estamanaire :
Allonge
- Estivo : Fond de
cale
- Estrop :
Cordelette servant à attacher l'aviron à son tolet
- Falouco, felouco
: Felouque, barque aux façons effilées et menée
à la rame
- Fauco : Fargue,
falque
- Femelot : Autre
nom de la counassièro
- Ferre,
Ferrì : Ancre, grappin
- Fièu, fil
: Bordage alternant avec l'enbon
- Fisco : Vieux
filet que l'on joint au bas des tounaio
- Floun: Itague,
cordage qui sert à hisser l'antenne
-
9-10 mars 2005 :
Cales à bateau de Fabrégas et de la
Verne
Q1.
Salut Claudet,
Aurais tu dans tes archives des
photographies représentant les cales à bateau de
Fabrégas et de la Verne ?
C'est pour l'association qui a pour
but de restaurer ces vestiges de notre patrimoine et qui tiendra un
stand sur le port de Sainte Elme pour la fête de la Saint Pierre,
à la fin du mois de juin.
Ce sont des amis à moi et
d'ailleurs je serais présent sur le stand avec mon livre sur
Sicié.
De toute façon ce qui est le
plus important pour l'instant c'est de savoir si tu es en possession de
quelques documents sur ces plans inclinés et s'il serait
possible de les prêter ou de les photocopier pour la
manifestation. (Cartes postales, coupures de presse, photos
personnelles, anecdotes, etc.)
En te priant de m'excuser pour ce
dérangement.
Je monte dans les Alpes samedi et
si tout va bien j'y séjourne durant une semaine.
Adessias.
Pif
R1a.
Salut Pif,
Bien reçu ta
question. Je fais des recherches, mais c'est moins simple qu'il n'y
paraît. Bien que mes ancêtres aient eu une cale à La
Verne pendant 75 ans, je ne retrouve aucune photo de cette cale. Je
vais voir si je retrouve quelque ancienne photo ou carte postale et je
te l'envoie dès que possible.
En attendant, on
peut trouver sur le site :
http://laseyne.fr.st.free.fr/
au chapitre
"plages", quelques photos récentes de ces cales de
Fabrégas et de La Verne. Je t'en adresse des copies ci-jointes.
A
bientôt,
Claudet.
R1b.
Salut Pif,
J'ai de la peine
à retrouver de belles photos sur les cales de La Verne ou
Fabrégas.
En voici cependant
deux ci-jointes :
- - une en couleur
(mais de médiocre qualité) sur La Verne, d'après
une brochure de l'Office du Tourisme de 1998
- - une en noir et
blanc, montrant le bas d'une cale, avec 3 enfants qui posent :
Jean-Claude Autran, Michèle Meunier et Michèle Masselo.
C'était vers 1949 à Fabrégas.
-
A
bientôt si j'en retrouve d'autres. Bon séjour dans les
Alpes en attendant.
Claudet
Q2. (12 juin
2006)
Salut à toi, jeune
homme !
Après un week end de plage
et de kayak, j'adoucis mes rougeurs devant l'écran de la
bécane.
Il faut dire que le retour à
Fabrégas avec ce labé forcissant, ça
commençait à tirer sur les bras.
Je suis en train de préparer
un jeu de photos destiné à être plastifié
pour orner notre stand des fêtes de la Saint Pierre, à Ste
Elme, du 24 & 25 juin.
J'aimerais que tu puisses me
renvoyer une photo de toi, déjà dragueur, sur une cale de
la Verne. Je l'avais dans mes fichiers mais elle a disparu au cours de
la régénération des paramètres de l'automne
dernier. L'une des deux filles est la soeur de Roland Meunier, mais qui
est l'autre ?
Il existait un site sur les plages
de La Verne et de Fabrégas où j'avais trouvé
quelques photos intéressantes mais je ne le retrouve plus.
Est-ce que tu autrais plus de
chance que moi ?
Si tu le trouve, passes-moi les
coordonnées, merci !
Amitiés et gros bisous
à toute la famille.
Adessias.
Pif.
R2.
Salut-à-toi,
Ô Pif !
Je te renvoie
ci-joint la photo noir et blanc de la cale où je me trouve, vers
1949, avec Michèle Meunier et Michèle Massello (devenue
Madame Rière) - la famille Massello était très
amie de la famille Meunier et le père de Michèle (Georges
Massello (1918-1992)) fit partie dans les années 50 de
l'équipe de moto-ball.
En fait, la
cale où nous sommes, ne se situait pas à La Verne mais
à Fabrégas. J'avais toujours eu un doute à ce
sujet, mais ma cousine Michèle, qui a revu la photo dans mon
album il y a quelques jours, m'a affirmé que ça ne
pouvait être qu'à Fabrégas où son grand
père Louis (le père de Loulou) avait sa cale et son
bateau à cette époque.
Quant au site
où tu as vu les photos des plages de La Verne et de
Fabrégas, je pense qu'il s'agit du site officiellement
non-officiel de La Seyne-sur-Mer : http://laseyne.fr.st.free.fr/
Tu peux aller
directement aux photos de ces pages en cliquant sur : http://laseyne.fr.st.free.fr/laverneg.htm
et : http://laseyne.fr.st.free.fr/fabregasg.htm
A bientôt, au
plus le tard le samedi 24 à Bastian à 18 heures.
Amitiés.
Claudet
Q3.
Le texte est lisible entre
les différents signes cabalistiques mais la photo n'est pas
visible.
J'ai une kyrielle de signes sans
liens logiques et aucune image.
Tu devrais essayer à partir
d'un logiciel pour terrien de base !
Merci pour ta
célérité.
Avec le plaisir de te relire
très bientôt
L'ours des plages.
R3a.
Désolé,
Pif, ce n'est pas la première fois qu'il y a entre nous ce
problème de photo.
Je croyais avoir
justement un logiciel pour terrien de base. J'échange des tas de
photos de ce même format chaque semaine au sein de ma famille, et
je n'ai généralement pas de problème. Alors je ne
sais pas ce qui se passe entre nous, sinon un conflit entre le
paramétrage d'un des logiciels (pas forcément des
logiciels photos) qui sont sur nos ordinateurs respectifs.
Je vais
réessayer de t'envoyer d'abord le texte d'une part, puis la
photo, avec ou sans compression, dans des messages successifs. Dis-moi
avec lequel tu reçois la photo intacte.
Sinon, cette photo
se trouve aussi sur le forum de mon site, dans nos échanges de
mars 2005 sur les cales à bateaux, à l'adresse :
http://jcautran.free.fr/forum/peche.html
Tu peux
peut-être aussi la recopier de là.
A très
bientôt,
JC
R3b.
Salut Serge,
As-tu pu finalement
ouvrir l'une ou l'autres des photos de cales de Fabrégas que je
t'ai envoyées avant-hier ?
(...)
Amitiés. A+
Claudet
Q4.
Salut Fox,
J'ai pu ouvrir les photos sans
problème (...).
J'ai réussi à ouvrir
et à imprimer la photo sur les cales à bateaux. Merci
beaucoup !
Voici le texte sur le trajet le
long de la côte entre Mar vivo et Fabrégas, en
exclusivité. Je l'ai terminé il y a une heure !
Adessias.
Pif
28 décembre
2003 - 9 mars 2005 : Termes provençaux
relatifs à la pêche et aux poissons de
mer
C1a.
Salut Claudet,
Hier il ne faisait pas très
beau alors je me suis attelé à ton lexique. Je me suis
régalé pendant tout l'après-midi à
retrouver des termes qui s'enlisaient doucettement dans ma
mémoire et à en découvrir de nouveaux.
Je me permet toutefois de te
signaler quelques variantes dont tu feras l'usage que tu voudras !
Gobi de brailles : se disait
du "zizi", à la plage ou à la pêche. C'était
le seul poisson qui avait le droit de cracher de l'eau de temps
à autres et qui restait à l'abri dans le maillot ! (...).
Tintaine : Appareil
destiné à accrocher les calmars et le "supis" grâce
à leurs nombreux hameçons, à ses éclats
métalliques et à un mouvement de haut en bas
provoqué par le bras du pêcheur. Mais également,
quand une personne est particulièrement agitée ou se
retourne souvent dans son sommeil, on dit qu'elle fait tintaine.
(...) C'est tout pour aujourd'hui.
Amitiés.
SM
C1b.
Salut jeune homme,
En lisant ton lexique, j'y ai
découvert quelques erreurs ou omissions et je me permets de te
les communiquer.
(...) Le nom de bati lou bateù provenait du fait
qui fallait faire couler le bateau ! Je pense !
Cigale de mer : Ce n'est pas
la galathée qui est un décapode possédant des
pinces et qui vit dans les roches. La cigale est un décapode
sans pinces (comme la langouste) dont la paire d'antennes s'est
transformée en deux excroissances larges qui lui donnent la
physionomie d'une cigale. Il existe la grande Cigale de mer qui peut
atteindre les neuf cents grammes (j'en ai capturé une bonne
demi-douzaine sur le tombant des Deux Frères), et le Cigalon qui
atteint péniblement les dix centimètres et qui se
complaît dans les herbiers de posidonies. C'est lui qui est
très estimé pour décorer la bouillabaisse.
(...) Escargot de mer :
L'escargot de mer possède une coquille analogue à celle
de ses cousins terrestres. (J'en possède quelques exemplaires.)
La limace est le Nudibranche (Branchies nues).
Gabian : Exclusivement le
goéland. La mouette se nomme la gabianello. Elle a
tendance à remplacer petit à petit le gabian, depuis
qu'on a fermé leur cantine préférée :
L'émissaire.
Liche : Cette espèce
de poissons n'a rien à voir avec les requins ! C'est un
scombridé de la sous famille des carangues. Poisson plus proche
du thon et du maquereau. (j'ai eu l'occasion d'en harponner deux et je
peux te certifier que j'ai fait du ski nautique sous marin
derrière ces monstres) !
Voilà pour aujourd'hui, en
espérant une bonne réception.
Amicalement.
Serge
R1.
Salut Serge,
J'ai lu avec
attention tous tes commentaires sur les termes de mon lexique
provençal et des « mots d'ici » et je te remercie
pour tout cela et le temps que tu y a passé (...).
- cigale de mer
: il y avait bien confusion de ma part avec galathée (vieux
souvenir erroné d'un cours de zoologie d'Agro). J'adopte donc ta
définition. Mais le grand Larousse assimile aussi la cigale de
mer au genre Scyllare des crustacés décapodes.
- escargot de
mer : ce que je me représente bien pour en avoir en
collection c'est la Natica millepunctata, qu'on appelait dans
ma famille « limace de mer », mais elle a bien une coquille
(comme on désignait souvent limaces certains genres d'escargots
terrestres - les limaces vraies étant alors les « limaces
sans coquilles »). Il faudra qu'on en reparle car je ne sais plus
à quoi ressemble ce que tu appelles Nudibranche. En attendant,
j'ai retiré le terme trop ambigu d'escargot de mer pour ne
laisser que celui de limace de mer.
- liche :
évidemment, tu sais mieux que moi de quoi il s'agit puisque je
n'ai jamais plongé et que ma connaissance du sujet n'est que
livresque. Je m'étais référé d'une part
à un vieux fascicule de la faune de France qui, pour liche,
renvoyait au « genre Scymnus (Scymnus lichia), voisin du
requin ». D'autre part, à un site du Centre d'Etudes et de
Recherches Ethnologiques qui fournit les noms latin, commun et
vernaculaire des poissons pêchés sur les côtes
varoises. Au cas où tu ne connaîtrait pas ce site, voici
son adresse :
http://cerev.online.fr/tableaupoissons.htm
Pour eux, la liche,
c'est Trachynotus glaucus (je ne sais pas à quelle
classe de poissons ça correspond).
Je m'étais
donc permis de proposer pour liche : « Nom de divers poissons de
mer de grande taille, etc. ». Mais comme ces faunes ou ces listes
sont probablement faites par des généralistes ou des
théoriciens qui ne connaissent pas forcément les
côtes seynoises, je me fie donc entièrement à toi
si tu penses que ce que nos pêcheurs ou plongeurs appellent la
liche, c'est un « scombridé des la sous-famille des
carangues ».
Voilà pour
aujourd'hui. La
suite des commentaires d'ici 24 ou 48 heures.
Amitiés,
Jean-Claude
C2.
Salut Fox !
(...) Tu avais un peu raison avec ta liche (Scymnus lichia
ou requin liche) qu'on peut rencontrer en Méditerranée.
Squale à cinq fentes branchiales, dépourvu de nageoire
anale et sans aiguillon devant les nageoires dorsales. Je n'en ai
jamais rencontré !
Les véritables liches, de la
famille des Carangides, sont des proches parents des petits chinchards,
du poisson pilote (Naucrates ductor), du tassergal et des
carangues. la taille est de 1 m pour Lichia Amia et de 30 à 70
cm pour L. Vadigo et L. glauca.
La petite Cigale ou Cigalon est Scyllarus
arctus quand à la grande cigale c'est Scyllarides lactus
qui peut atteindre la taille de 45 cm.
Pour les escargots et les
nudibranches, j'attends ton prochain passage car il y a aussi le
lièvre de mer qui est une variété de limace de
taille conséquente (jusqu'à 30 cm). Je ne croit pas en
posséder de diapos.
(...) Voilà pour aujourd'hui.
Adessias !
Serge
R2.
(...)
Nouvelle suite à nos échanges de commentaires sur le
lexique des mots d'ici.
La liche :
merci pour tes nouvelles précisions et les noms latins des
principales espèces.
Gabian -
gabianello : J'ai suivi ta distinction. Mais je ne suis pas
entré dans les mots savants car le genre Larus, dans la
Faune de France semble couvrir 7 ou 8 espèces de mouettes ou
goélands, tandis que Lou Trésor dou Felibrige
utilise gabian à la fois pour les goélands (dont le grand
gabian, Procellaria puffinus, ou Puffinus cinereus ?
qui sont des pétrels) et les mouettes, tout en distinguant bien
cependant la gabianolo, ou mouette rieuse (Larus ridibundus).
Amitiés,
sans doute à bientôt. (...)
JCA
C3.
Je viens encore t'importuner
avec des mots qui me reviennent (avant qu'ils ne repartent dans les
oubliettes où ils pensaient goûter à une retraite
dorée.
Je me souviens avoir entendu dire "Machotte"
comme synonyme de grande cigale de mer. Mais ce terme était
employé par un camarade de plongée originaire de l'Aude.
Les escaveiniers magouillaient
dans les vases grasses du bout du Lazaret, ce qui troublait l'eau. Le
terme "magouille" pour désigner des pratiques louches où
la plupart des tenants et des aboutissants demeurent dans un flou qui
n'est pas forcément très artistique ne proviendrait-il
pas de la pratique des escaveiniers ?
Masque désigne bien
la Castagnole de notre côte, malheureusement dans mes livres je
ne trouve sous ce vocable que l'hirondelle de mer (Brama Rayi)
qui peut atteindre des dimensions allant jusqu'à 1 m. Nos
masques dépassent rarement les 10 cm et possèdent une
queue bifide très prononcée mais de longueur similaire.
Elles sont de teinte gris noirâtre et se tiennent constamment aux
environs des tombants rocheux en bancs diffus. Leurs alevins ont une
allure plus effilée et une livrée d'un magnifique bleu
phosphorescent ; ils fréquentent en groupe les
anfractuosités rocheuses et semblent compter sur leur couleur et
leur effet de groupe pour dissuader les prédateurs. Est-ce le
même poisson, à l'état juvénile, ou une
autre variété ?
Au sujet de Molinari, une
émission de radio locale où Léon Orlandi fait une
émission sur les mots et les expressions d'ici a
dernièrement parler de Molinari comme d'un renfloueur
habile qui avait fait sa notoriété de Nice à
Toulon et qui aurait pris sa retraite à La Ciotat. Il
était d'origine italienne, de Gênes il me semble. Les
marseillais auraient fait appel à lui pour désobstruer
l'entrée de port où un navire avait coulé. Il
semblerait que ce dernier soit la fameuse Sardine....
(...) As tu des renseignements sur un filet de pêche au thon
qui se nommerait "Tournaire" (Tournero en Provençal) et
qui aurait été usité aussi bien dans la
région du Lavandou que du côté de La Ciotat et
Marseille dans la première partie du XX° siècle. Il
consistait parait-il à un filet à grosses mailles avec
lequel les pêcheurs encerclaient le banc de poissons avant de
refermer le dessous et de remonter la nasse ainsi formée. Il ne
leur restait plus qu'à gaffer les poissons prisonniers. Cette
pèche me semble très possible mais je ne retrouve aucune
trace d'elle dans ma documentation et dans les méandres
électroniques de l'ordinateur.
Voilà pour aujourd'hui,
j'espère que je participe activement à ta
préretraite.
Amitiés à toute la
famille.
SM
R3.
- (...) Sur Molinari,
il s'est dit et écrit tellement de choses que je ne sais pas si
on peut se faire une opinion exacte car plusieurs villes ou ports se le
sont approprié. Je ne sais pas qui détient la
vérité.
- Concernant le
filet de pêche au thon qui se nommerait "Tournaire", je n'ai rien
trouvé pour l'instant. Mais d'après le principe que tu
décris (les pêcheurs encerclaient le banc de poissons
avant de refermer le dessous et de remonter la nasse ainsi
formée), y a-t-il un rapport avec le type de filet qu'on appelle
l'épervier ?
(...) J'ai
retrouvé par ailleurs un vieux manuscrit de mon père
"Engins de pêche de notre région" qu'il avait dû
écrire il y a 10 ou 20 ans (ou peut-être recopier de
quelque autre document qu'il avait eu en mains ?). Il renferme quelques
termes que je ne me souviens pas avoir entendus jusqu'ici (et qui ne
figurent pas dans mon lexique). Je t'envoie ce texte sous sa forme
brute avec des termes un peu en vrac [cf. engins_de_peche.html
]. Sans doute es-tu
plus expert que moi avec certains termes (embornier, garbelles,
riaï, issaugue, bouguière, mujolière,...) et les
définitions données t'intéresseront-elles. Mais il
y a probablement aussi des avis divergents sur la définition ou
la description de tel ou tel engin.
Salut, et à
bientôt.
Jean-Claude
C4a.
Bien le bonjour monsieur le
retraité en gestation !
Juste un mot pour te remercier du
lexique sur les engins de pêche que je vais détailler
très bientôt.
J'y ai déjà
retrouvé "Tounaille" qui a des chances de représenter une
variante de la tournero des pêcheurs du Lavandou. Les
dimensions et l'utilisation de ce filet de poste semblant très
proches (...).
Amitiés à toute ta
tribu.
Serge.
C4b.
Salut Claudet,
(...) J'ai donc
épluché ton glossaire sur les engins de pêche et je
t'en expédie le premier jet.
J'espère que je ne te
dérange pas trop ! C'est ça aussi qui est bien avec
internet, on peut s'occuper des E-mail quand on en a le temps.
Broumé : Moi j'ai
toujours écrit broumet.
Pour ma part, le musclau,
je n'ai jamais entendu. C'était mousclau qui signifiait
hameçon et mouscle pour moule.
Les lignes fixées sur la
ligne mère des palangres se nomment des brassoles
alors que les brassoù ou les brassoulets
étaient les lignes des zigou-zigous.
Je ne connaissait pas l'emborgnier,
bien que j'ai déja vu ce genre de panier.
La garbello est le nom
provençal de la nasse.
Le batardéou est le
batardeau. Là aussi, je vois bien ce genre de panier
grillagé, toujours en pratique, qui pour moi était une
garbelle métallique.
Le vocable de riai m'est
également inconnu, les seuls éperviers que je n'ai jamais
utilisé sont les fameuses balances avec les quelles on ramenait
souvent des fritures de mange-tout. Le nom ne proviendrait il pas de
réa (ria en provençal), poulie qui était
utilisée pour actionner la corde de serrage du filet ?
Le seau du marin, c'est le bouioù,
pas le bouilloou.
La foëne, c'est la fichouiro
ou la faguino. Fachouire, c'est une mauvaise femme
(là on pourrait encore comprendre une fouine !), ou des olives
trop mûres, ou l'éclisse des fromages.
Le fustier, pour moi c'est
le charpentier, et la fusta est un gros morceau de bois tout
juste équarri alors que la bûchette se dit busco
(ou broco).
Je sais qu'il existe un mode de
pêche encore pratiqué dans le pays niçois avec un
long filet tiré à terre à la force des bras par
une bonne vingtaine de personnes et que nos chères têtes
pensantes de Bruxelles ont voulu faire disparaître. On attrape
les bancs d'alevins qu'on nomme poutigne. Par contre l'issaugue
(moi j'ai toujours entendu l'eissaugo) est un long filet de
pêche traîné par un bateau, pour la pêche
à la sardine.
Le tartanon (ou tartanoun
?) est une sorte de tartane équipée pour traîner un
filet qui porte le même nom. Ce type d'embarcation de pêche
côtière a vu ses heures de gloire à la fin du
XIX° siècle, mais son maniement et sa rapidité n'ont
pas résisté à l'arrivée des moteurs.
La cenche (ou cencho)
consiste bien à ceindre un banc de poissons avec un filet
tournant. Cencho: Enceinte, ceindre, encercler.
Fourgoun, c'est battre l'eau
et la troubler avec de la boue (fourgouneja), pourquoi pas avec
de la chaux ?
L'entremaou, c'est notre
fameux tremail ou tramail (en provençal : Entremai, entre-maio).
Filet qui par sa construction (à trois mailles !) emprisonne
rapidement le poisson dès qu'il se débat.
Le batudon (probablement le
batudo) est un filet de fond proche di trémail mais un
peu plus résistant, réservé au maquereau.
La tounaille ou tounaio,
ou tounairo, est une série de filets mobiles pour
emprisonner les thons en les encerclant et en les remontant à la
gaffe après avoir refermé le fond. Ce type de pêche
se pratiquait encore dans la baie de La Ciotat avant la dernière
guerre, en concurrence avec la madrague.
Je connaissais la combrière
mais pas l'escombriere. Mais c'est un type de bateau !
Il en est de même pour la mujolière
qui pour moi est la mugelièro. Filet utilisé dans
les bouches du Rhône, du côté des étangs de
Vacares et de Fos, pour capturer les mulets.
Ce petit exercice qui m'a
occupé toute la journée m'a permis de faire un petit
complément à ton lexique, sur le rusquet.
Comme tu le dis, c'est un flotteur
sous lequel pend un hameçon pour les blades. Mais c'est aussi
une méthode pour attraper les gros muges pansus ou les mulets
dorés, par les calmasses d'automne, avant les grosses
mistralades. On préparait un sandwich d'hameçons de 4
à 6 dans un morceau de pain, on ligaturait celui-ci avec un
élastique et on mettait le tout au bout d'une canne à
moulinet. On envoyait ce casse-croûte à une trentaine de
mètres du rivage, dans une zone de mer étale (Du port du
Manteau aux Sablettes). Bientôt le bout de pain était
animé de trépidations et souvent il disparaissait sous
l'eau. Si le muge était bien accroché (Parfois avec
quatre ou cinq hameçons) on n'avait plus qu'à se battre
avec son fil et sa canne. J'en ai sorti trois ou quatre de plus de six
kilos, presque des sous-marins, de cette manière.
La pêche au rusquet
peut aussi se pratiquer avec une dizaine de flotteurs, quand le temps
est très calme, en les laissant dériver et en les
surveillant depuis un barquet, à la rame. Ils restent à
proximité les uns des autres et dès qu'il y a une pitée
le pêcheur n'a qu'à aller ramasser le rusquet
évadé.
Voilà pour aujourd'hui.
Bonne lecture et à bientôt de te lire.
Amicalement.
SM
R4.
Salut Serge,
(...) En tout cas
merci pour tout le travail que tu as accompli sur mon glossaire (...).
Je vais reprendre
chaque mot en détail et essayer de rédiger une version
améliorée qui intègre toutes les précisions
que tu apportes. (...).
Fox
Q5.
Salut Pif,
Je ne voudrais pas
abuser de ton temps si tu as en ce moment d'autres
préoccupations, mais à l'occasion (rien ne presse),
peux-tu te pencher sur ces derniers termes ou expressions :
Qu'est-ce que le
(ou la ?) cantre comme poisson ?
(...) Même
question pour encaper ?
Merci d'avance.
Après ça, je crois que j'aurai fait le tour d'absolument
tout ce que j'avais en instance comme termes ou "mots d'ici", extraits
du fond de ma mémoire et susceptibles d'enrichir mon lexique.
Amitiés,
Claudet
R5.
Salut à toi, jeune et
élégant bipède !
Ton mail m'a fait plaisir et tes
mots à définir me sortent un peu de mes écritures
et de mes recherches actuelles (les pastorales).
Le cantre est le nom
catalan de la Canthare (Cantharus cantharus, linné 1758)
ou (Cantharus lineatus Montagu 1815), qui s'appelle aussi Griset
ou Pironneau sur l'atlantique.
Ici, les poissonniers le nomment
Dorade grise (DO).
C'est un sparidé au profil
assez droit, dont le dos est d'un gris métallique et les flancs
sont argentés avec quelques bandes longitudinales
noirâtres diffuses.
On le rencontre en atlantique, de
la mer du Nord jusqu'aux îles Canaries. Il pénètre
parfois en Méditerranée le long des côtes d'Espagne
et très exceptionnellement dans le golfe du Lion. Sa dentition
est faible, formée de petites dents, car c'est une espèce
partiellement herbivore.
Avec la dorade rose et la
dorée (la saupe), c'est une espèce prisée des
poissonniers, et des restaurateurs, qui arrivaient à les
écouler auprès des estivants en lieu et place des vraies
daurades (DAU).
(...) Pour encaper,
plusieurs sens me viennent à l'esprit :
En terme de marine, c'est prendre
et tenir un cap grace à un amer visuel (on encape sur sainte
Elme). Je n'ai jamais entendu dire qu'on encapait sur le 270 par
exemple.
D'un autre côté, on encape
quand on se recouvre le dos avec une cape pour se protéger du
vent ou de la pluie mais on encape aussi lorsqu'on construit
une chape en ciment.
Mais on peut aussi encaper
quand on atteint son but, quand on conçoit un projet ou quand on
encaisse son dû.
D'aprés mon dico
provençal ça désigne également le fait de
rebattre la faux ou la meule.
Ne pas confondre avec encapeler
qui signifie se couvrir d'un chapeau et qui a donné capelan
ou capelage (noeud de tête de mature).
(...) Voilà pour aujourd'hui
!
J'espère que ta
dernière ligne droite n'est pas trop pénible et surtout
que tu "encapes" sans problèmes....
Amicalement.
Pif.
Q6.
Salut, Pif,
Désolé
pour le retard mis à te répondre et à te remercier
pour tes deux derniers envois de définitions de termes
inexpliqués. (...).
J'ai bien pris note
de toutes tes définitions, de cantre à encaper,
de bestiasse à faire les mains, de bacéler
à djèdjè, etc. etc. et je t'en remercie.
J'ai ainsi pu mettre à jour ces divers termes sur le site
internet (...).
Claudet
R6.
Salut Jean Claude,
(...) J'ai également relevé quelques termes à
peaufiner dans ton lexique des mots d'ici :
La palanquée est
aussi un terme employé en plongée pour définir un
groupe de plongeurs qui saute à l'eau ensemble et va donc
utiliser les mêmes paramètres pour calculer ses paliers
(Durée et profondeur). Personnellement, j'ai toujours eu en
horreur cette expression qui assimile le plongeur à une
quelconque marchandise... C'est pourtant ce que ça a tendance
à devenir avec la législation actuelle !
J'ai toujours entendu parler de pescadou
pour un pêcheur amateur et de pescaïre pour le
professionnel !
Le pagre n'est pas un nom
de famille mais un sparidé appelé encore dorade rose. Il
se différencie du pageot (Sparidé également) par
un profil moins droit et une dentition plus proche de celle de la
daurade. Sa chair est beaucoup plus quelconque et pourrait se comparer
à celle du cantre (dorade grise). C'est un des sparidés
qui est valorisé dans l'assiette par une cuisson au four avec
des pommes de terre et de l'huile. Un jus de citron ou une
rémoulade y sont les bienvenus.
A bientôt de te lire (ou de
te voir) !
Amicalement.
SM
Q7.
Avé,
Serge,
(...) Merci par ailleurs pour tes
précisions sur les termes de pescadous/pescaïres,
palanquée, pagre, etc. Je complète ou rectifie mon
lexique au fur et à mesure de tes envois (...).
Salut.
Claudet
16-31 mai 2003 :
A propos du gangui
Q1.
bonsoir, je
viens de découvrir le site avec plaisir, ancien habitant de
Mar-Vivo puis de Lagoubran, je découvre avec plaisir un site
très complet sur l'histoire et la vie Seynoise et sur les
activités de la petite mer.
Aujourd'hui je suis
venu précisément sur le site car un lien m'a
été indiqué par un moteur de recherche où
j'avais noté : "pêche gangui". Au chapitre sur les "petits
métiers" je vois que le gangui est apparemment un filet
tiré dans peu d'eau par un homme à pied. pourrai-je en
savoir plus ?
De même
avez-vous des récits concernant des pêches au gangui mais
tiré par deux bateaux ?
A présent
sur Sète et membre d'une association de voile latine, nous nous
proposons de reconstituer une pêche au gangui tiré par
deux catalanes de 11 mètres à la voile. Le filet est
actuellement en fabrication au lycée de la mer, et nous nous
entraînons aux manoeuvres d'ensemble sur les bateaux.
Néanmoins de
nombreux points, des tours de main nous manquent, auriez vous quelques
lumières sur ces sujets ? merci d'avance de votre
réponse,
YAL
R1.
Bonjour,
Merci de votre
message et de vous intéresser à notre site sur l'histoire
de La Seyne (Var) : http://jcautran.free.fr
Je m'appelle
Jean-Claude Autran, fils de Marius Autran et j'assure, à
distance (je ne réside pas à La Seyne, mais à
Montpellier), la correspondance du site internet de mon père,
qui est maintenant très âgé (92 ans).
Je n'ai
malheureusement guère d'éléments pour vous
répondre avec précision sur les techniques ou les tours
de main de la pêche au gangui, où le gangui tiré
par deux catalanes, que vous souhaitez connaître.
Tout ce que j'ai pu
retrouver, ce sont quelques descriptions du gangui et quelques
commentaires sur la pêche au gangui, dans différents
passages des ouvrages de mon père : "Images de la vie seynoise
d'antan", que je vous reproduis ci-dessous :
Marius Autran :
Tome 1, chapitre : « Métiers d'autrefois »
L'administration
maritime décida un jour, et c'est bien compréhensible,
d'interdire ce mode pêche dévastateur des fonds marins. Il
en fut de même pour la pêche au gangui qui consistait
à draguer les fonds d'herbiers non pas en poussant mais en
traînant un filet volumineux en forme de sac conique dont
l'embouchure était tenue béante par une armature de fer.
Les prises ramenaient sur le pont, du poisson de bouillabaisse, des
langoustes, des poulpes, des crabes,... et aussi... hélas ! les
herbiers dont la reconstitution serait laborieuse.
Marius Autran -
Tome 3 - Chapitre : « La baie du Lazaret »
Rappelez-vous,
les anciens qui avez vu dans la Baie du Lazaret chaque dimanche matin
ces personnages folkloriques poussant devant eux un engin de
pêche tout simple [le pousse-avant] formé d'une armature
de bois trapézoïdale, tenue par un manche où
s'accrochait un filet en forme de poche.
En poussant le
manche devant eux, l'engin draguait à faible profondeur, se
remplissait d'algues, de poissons, de crabes, de crevettes, de
bigorneaux.
Dans les fonds
importants, on utilisa aussi un moyen de pêche dévastateur
appelé gangui, sorte de drague métallique traînant
un filet volumineux au fond duquel s'entassaient poissons, langoustes,
poulpes, crabes, etc.
Pour tenter de
sauvegarder les richesses du Lazaret, les autorités maritimes en
viendront à interdire beaucoup d'activités : le
pousse-avant, le gangui, la pêche aux mouredus, la pêche au
lamparo (pêche de nuit à la lumière...).
Marius Autran :
Tome 6 (L'isthme des Sablettes), chapitre 1 :
Durant les
mois de l'été, les pêcheurs de Saint-Elme ne
voyaient pas arriver d'un bon oeil des tartanes ventrues en provenance
de Toulon, qui exerçaient une pêche spéciale qu'on
appelait le gangui ; cela sur les fonds des plus riches herbiers de
posidonies qui s'étendaient depuis le Marégau jusqu'au
Cap Sicié.
En quoi consistait
cette pêche ? Ce n'était pas un procédé
très original. On pouvait définir ainsi le gangui comme
une espèce de grand filet en forme de poche dont l'ouverture
métallique pouvait draguer des fonds de moyenne profondeur,
plats de préférence et recueillir pêle-mêle
des poissons, des crustacés, des mollusques.
Ce mode de
pêche était pratiqué depuis le Moyen Age sur les
côtes méditerranéennes, jusqu'au jour où les
anciens comprirent la nocivité du procédé qui
détruisait le milieu marin où les espèces
pouvaient le mieux frayer.
Aussi le gangui fut
prohibé par les gouverneurs de Provence par un
arrêté du 2 juin 1581. Les siècles passèrent
et ce mode de pêche fut de nouveau autorisé pour des
durées très limitées dans le cours d'une
année, au mois d'août seulement. Mais là encore les
autorités maritimes, comme elles le firent pour la pêche
au pousse-avant dont il sera question plus loin, prirent la
décision d'une interdiction définitive à la grande
satisfaction des petits professionnels de Saint-Elme et des
plaisanciers.
Il arriva
fréquemment que la rencontre sur les mêmes lieux de
pêche entre modestes « pescadous » et dragueurs de
tartanes dérivât en algarades dangereuses.
Marius Autran :
Tome 6 (L'isthme des Sablettes), chapitre 2 :
Les gens de
condition modeste pour qui la propriété d'un bateau eut
été un luxe pouvaient tout de même ramener au foyer
familial la valeur d'une soupe de poissons, d'une friture et même
d'une petite bouillabaisse.
Cette forme de
pêche comme celle des vers marins fut un jour interdite par les
autorités maritimes soucieuses de protéger la faune et la
flore du Lazaret, mises à mal par les dragues, les
râteaux, les grapettes par de braves gens peu soucieux de la
reproduction des espèces marines.
Nul doute que les
chercheurs du laboratoire de biologie de Tamaris avaient lancé
un cri d'alarme auprès des autorités maritimes qui
interdirent aussi ou limitèrent la pêche au gangui du
côté de la haute mer.
Marius Autran :
Lexique provençal
Gangui :
Pêche au gangui : ancien mode de pêche, dévastateur
des fonds marins : un filet volumineux. La pêche au gangui
consistait à draguer les fonds d'herbiers non pas en poussant
(comme le pousse-avant) mais en traînant un filet volumineux (le
gangui) en forme de sac conique dont l'embouchure était tenue
béante par une armature de fer et au fond duquel s'entassaient
poissons, langoustes, poulpes, crabes, etc. Etre dans le gangui, c'est
aussi être dans une situation inextricable, soit au sens propre
(embrouillamini, emmêlement de fils de pêche), soit au
figuré (être dans le pétrin).
Dans l'Histoire de
La Seyne de Louis Baudoin (1965), j'ai trouvé également
un paragraphe sur :
IMPORTANCE DE LA
PECHE DANS LE QUARTIER DE LA SEYNE AUTREFOIS
L'importance
de cette industrie et de son corollaire, le commerce du poisson, semble
avoir été conditionnée à La Seyne d'une
part par l'activité navale de ce port, le nombre d'inscrits
maritimes qui armaient ses navires et, d'autre part, par l'effectif des
gens du pays servant à bord des bâtiments de l'Etat et de
ceux de la Marine marchande dépendant d'autres ports. Ce que
nous disons là s'applique, bien entendu, à l'ensemble du
quartier maritime qui, ne l'oublions pas, comprenait en plus du port de
La Seyne, ceux de Saint-Mandrier, Saint-Nazaire, Le Brusc et Bandol.
Elle paraît
avoir été prospère jusque vers la seconde
moitié du xixe siècle. De fait, elle s'est amoindrie
aujourd'hui ; c'est une constatation qui découle de l'effectif
plus faible des bateaux de pêche et de l'effectif naviguant, de
la réduction des inscrits des divers lieux du quartier.
Cette diminution de
l'industrie de la pêche dans notre région a eu pour causes
également : la concurrence des poissons et des produits de
l'Océan qui arrivent par grandes quantités, par wagons et
bateaux frigorifiques, l'absorption par l'arsenal de Toulon, les
chantiers modernes, d'autres activités locales, de beaucoup des
habitants de la côte.
A ces raisons, il y
a lieu d'ajouter que les eaux sont devenues moins poissonneuses que
dans le passé.
Jadis on
pêchait sur notre littoral de multiples variétés de
poissons méditerranéens dont les principaux
représentants étaient : le rouget, le thon, la sardine,
le loup ou bar, le maquereau, le merlan, l'anguille, l'anchois, la
dorade, le congre, le mulet, le pageau, la raie, le sar, et encore la
dorée ou coq de Saint-Pierre, le chat de mer et la girelle.
On récoltait
aussi les mollusques : l'encornet ou calmar, la seiche, le poulpe, la
clovisse, etc. ; le fameux murex de l'Antiquité, dont il
existait plusieurs variétés, la mou le l'huître. On
pratiquait la pêche des crustacés : langouste, crabe,
homard, cigaloun, etc.
Dans un rapport
présenté en janvier 1881 à la Commission
sénatoriale d'enquête sur le repeuplement des eaux,
rapport préparé par M. Bouchon-Brandely, on estimait que
la rade de Toulon, les îles et la rade d'Hyères
étaient très fécondes en faune ichtyologique et
que toutes les espèces éparses sur le littoral
provençal y étaient représentées.
Quant aux engins
employés pour les divers genres de pêche, ils
étaient fort variés ; c'étaient le gangui,
l'eyssaugue, le palangre (le grand et le petit), la foëne, la
battude, la mugelière, l'épervier, l'escombrière,
etc. A La Seyne, on se servait, en outre, du sardinal, de la nasse, du
Breguin, du Trémaïl.
Nous ne parlons pas
de l'installation fixe et importante qu'était la madrague sur
laquelle nous nous sommes déjà étendu.
Enfin, il existe
plusieurs sites internet qui mentionnent la pêche au gangui et
donnent quelques photos ou dessins des engins utilisés. Se sont
les sites suivants :
http://www.ame-lr.org/publications/education/ecole_eole/pg18.html
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/etoile/sorties/sausset/pages/peche.htm
http://oceanic-dev.com/news.asp?langue=fr
Qui donnent
notamment les informations suivantes :
Pêche
au gangui : Le gangui est un petit chalut de fond. Il cause de nombreux
dégâts au fond des mers.
Pêche au
chalut pélagique : Contrairement au gangui, le chalut
pélagique ne ravage pas les fonds des mers.
Pêche au
gangui ou au râteau : Le râteau est un engin
traîné derrière un bateau sur les petits fonds
sableux comme ceux de la lagune du Brusc avec son herbier de
Cymodocées, ou ceux de l'herbier de posidonies.
Le râteau est
constitué d'un cadre métallique muni d'un filet formant
une poche de capture et d'une barre métallique ou d'une
chaîne traînant sur le fond afin de débusquer au
passage les poissons et autres invertébrés.
La pêche
souvent pratiquée de nuit permet la capture de poissons qui
entrent traditionnellement dans la confection de la "soupe de poissons
" (labres, crénilabres, serrans, rascasses...) ou la
récolte, en hiver, de crevettes du genre Palaemon.
Prochainement cette
pêche non sélective devrait disparaître
définitivement car elle est destructrice (saccage des pontes,
des nids de poissons et d'invertébrés); d'autre part elle
est responsable de la raréfaction de nombreuses espèces
(capture de nombreux juvéniles de sars, dorades...).
Il y a aussi le
site REGLEMENTATION RELATIVE À LA PECHE MARITIME ET AUX AIRES
PROTEGEES DANS LES PAYS PARTICIPANTS AU PROJET FAO COPEMED : Mars 2002
Filets de
pêche :
Les filets de
pêche sont répartis en trois catégories: les filets
fixes, les filets flottants et les filets traînants (article 11).
Le texte ne comprend aucune disposition particulière concernant
les caractéristiques et les modalités d'utilisation des
filets fixes. Il y est spécifié que les filets flottants
ne sont assujettis à aucune restriction de maillage (article
13). Les filets traînants sont subdivisés en deux groupes,
d'une part, les filets traînés à la remorque d'un
ou plusieurs bateaux (filets boeuf ou gangui), d'autre part, les filets
halés à bras sur le rivage ou à bord d'un navire
ainsi que les sennes et les filets éperviers (article 14). Les
filets traînants d'un maillage inférieur à 70 mm
(maille étirée alors que le filet est encore
mouillé) sont prohibés et le doublage des poches de ces
filets est interdit. L'emploi des filets traînants du premier
groupe est autorisé en tout temps à une distance d'au
moins trois milles marins mesurés à partir de la laisse
de basse mer (article 15).
Voilà ce que
j'ai pu trouver pour l'instant. Mais je vais à La Seyne à
la fin du mois et je poursuivrai la recherche avec mon père (qui
connaît peut-être encore quelques vieux pêcheurs
professionnels ?) et dans Ses archives. Si je retrouve quelques
nouvelles précisions, je ne manquerai pas de vous les faire
parvenir.
Dans cette attente,
recevez mes meilleurs sentiments.
JCA
Q2.
bonsoir,
merci pour la rapidité de votre réponse et les nombreux
renseignements que vous me donnez.
Nos sources
principales sont un pêcheur, aujourd'hui fort âgé,
de Sète et qui a pratiqué cette pêche étant
jeune. S'il se souvient de la plupart des gestes, sa mémoire
flanche parfois ! Une autre source provient de l'un de nos
adhérents qui écrit pour le Chasse-Marée et avait
fait un article sur cette pratique il y a quelques années (CM
n°89).
En collectant
d'autres sources, j'ai découvert la réédition du
livre de Paul Gourret Provence des pêcheurs (éditions
Serre, 1981) écrit à la fin du XIX ème
siècle. Déjà à l'époque il relevait
l'effet dévastateur de ce type de filet et la
nécessité d'une règlementation pour ne pas
épuiser la ressource.
De ces diverses
recherches je m'aperçois que notre terminologie n'est pas exacte
; nous devrions parler de pêche au boeuf, le gangui est une forme
particulière de filet, et il n'est pas toujours tiré par
deux bateaux.
Ce que nous voulons
remettre en pratique est cette pêche au boeuf, mais comme il
n'existe plus de bateaux boeufs, plus grands et plus puissants que les
catalanes, nous nous voyons donc obligés d'utiliser celles-ci.
La flotille et ce type de pêche a perduré plus longtemps
sur Sète qu'en Provence, et c'est pour retrouver les gestes, les
diverses opérations qui commandent ce type de pratique que nous
nous sommes engagés dans cette aventure ! Aventure car si nous
connaissons les grandes lignes de la théorie, la mise en
pratique nous montre que nous devons fortement affiner et notre
préparation, et redécouvrir les techniques et le "tempo"
des manoeuvres.
Si tout va bien
nous ferons quelques séries de trait les 12, 13 et 14 juillet.
En attendant nous nous entraînons tous les quinze jours devant
Sète.
Voici donc plus
explicitement l'une de nos activités qui complète nos
activités de restauration, entretien et sauvegarde du patrimoine
maritime de Sète et de l'étang de Thau (si vous
êtes déjà passé à Bouzigues vous avez
peut-être remarqué les nacelles et barquettes
amarées devant le musée de l'étang, ce petit bout
de quai est géré par notre association, les bateaux pour
moitié à des propriétaires et les autres à
l'association; généralement presque chaque dimanche
après-midi il y a du monde !).
Au plaisir de vous
lire à nouveau ou de vous rencontrer si vous vouliez venir vous
promener sur nos sites. Cordialement
YAL (association
Voile Latine de Sète et de l'étang de Thau, bar le grand
Large, 3 promenade JB Marty, 34200 Sète
et depuis une
semaine ! http://www.chez.com/voilelatine/
Q3.
hello
à vous tous, voici quelques images de la Cette sur
l'étang de Thau le 17 mai et à quai au Grau du Roi ce
week-end. En plus une jolie gravure de pêche au boeuf et le noeud
indispensable au nom savant et pourtant si simple à faire
(à condition d'avoir un cabillot et un oeil où le
passer). Ce noeud permet d'attacher la maille (ou fune, ou liban bref
la grande ficelle) qui remorque le gangui, son avantage énorme
est de pouvoir être larguée immédiatement.
à plus
YAL
Retour
à la page d'accueil du forum
Retour
à la page d'accueil du site
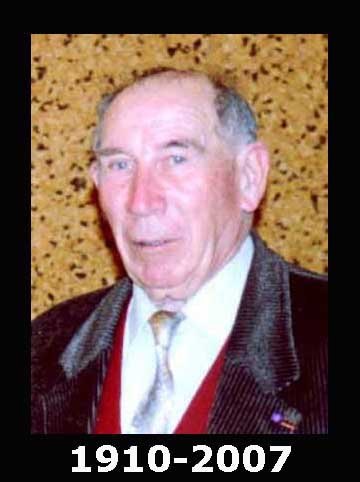 |
-
Marius
AUTRAN et
-
Jean-Claude
AUTRAN
jcautran.free.fr
|
 |
© Jean-Claude Autran
2016
 Après
15 ans d'existence (2001-2015), la section "Forum" de ce site internet
n'est plus désormais alimentée
Après
15 ans d'existence (2001-2015), la section "Forum" de ce site internet
n'est plus désormais alimentée 
 Les
informations précédemment rassemblées resteront en
ligne, mais il ne pourra être répondu à aucune
nouvelle question
Les
informations précédemment rassemblées resteront en
ligne, mais il ne pourra être répondu à aucune
nouvelle question