|
|
Petite Histoire de la Grande Construction Navale |
|
|
|
Petite Histoire de la Grande Construction Navale |
|
1966 : année d'une grande crise et de luttes victorieuses pour les travailleurs et la population
Devant l'importance du déficit de 1965, le Conseil d'Administration des F.C.M. se réunit le 3 février et enregistre la double démission de M. Chevalier, Président directeur général et M. Vayssières, Directeur général adjoint.
Un nouveau directeur est nommé provisoirement, M. Charron qui déclare : « La situation est grave... les pouvoirs publics ont promis une aide qui n'est pas venue. Le bilan de 1965 accuse un déficit important ».
Le comité d'établissement est réuni d'urgence en présence de M. Lauga, chef du personnel et de M. Curet, chef du personnel adjoint.
Une réunion commune est prévue avec tous les syndicats qui signent un appel avec : MM. Dimo, Rasoli et Rossi pour la CGT, MM. Assaïnte, Roche et Guzzo pour la CGC, MM. Panaroto et Vuillon pour la CFDT, M. Rembado pour le syndicat autonome des dessinateurs, M. Danielli pour la CGT-GO.
La décision fut prise d'intervenir auprès du Ministre des Affaires économiques et sociales ; également auprès du Ministre des Transports.
Un appel à la mobilisation générale des personnels des chantiers et de la population pour empêcher la fermeture des chantiers fut lancé et comme nous allons le voir, il fut entendu largement par la population seynoise et varoise.
Par contre, la disparition des ateliers Mazeline et Graville se fit presque dans la discrétion. Après avoir construit des centaines de navires de petits tonnages et des milliers de moteurs, ces structures qui produisirent des merveilles pendant près d'un siècle furent vendues, hélas !
Le Conseil Municipal fut réuni le 8 février 1966 en séance extraordinaire dans la salle des fêtes de l'Hôtel de ville. Rassemblés dans l'union la plus totale, on vit s'entasser des travailleurs des chantiers bien sûr mais aussi les dirigeants syndicaux, toutes tendances confondues, des artisans, des commerçants, des enseignants, autrement dit toutes les catégories sociales qui s'élevèrent avec force contre les mesures envisagées par le Patronat de l'époque et surtout contre les équivoques entretenues par l'État, les affairistes et des responsables politiques de haut niveau.
Ils s'engagèrent à mener toutes les actions nécessaires pour faire triompher leur droit à la vie.
Le comité de défense de la Construction navale multiplia pendant plusieurs semaines les protestations sous toutes les formes : motions et délégations auprès de la Préfecture et du Conseil général, campagnes de presses, tracts, réunions publiques, meetings presque quotidiens aux portes des entreprises. Toutes ces actions créèrent rapidement un climat de combat et dans cette ambiance fébrile il fut possible d'organiser des actions spectaculaires d'une envergure surprenante. Ce furent alors les marches sur Toulon, Draguignan, Marseille et Paris. La défense de la Navale prenait de jour en jour un caractère national et il n'est pas inutile, pensons-nous, de rappeler avec quelques détails le souvenir des manifestations exaltantes de cette année mémorable de 1966 qui vit se concrétiser la victoire des travailleurs seynois, desquels il ne faut pas séparer tous ceux des entreprises sous-traitantes des chantiers navals menacées elles aussi de disparition et il y en avait une quinzaine !
À la date du 11 février n'avait-on pas déjà licencié 500 ouvriers du personnel en régie ?
La marche sur Toulon fut une véritable démonstration de force. Un immense rassemblement évalué à près de 20 000 manifestants obstrua le port devant l'Hôtel de ville. Tous les magasins de la ville observèrent la consigne de fermeture.
Les élus municipaux, les conseillers généraux de l'aire toulonnaise, des députés, des sénateurs, la poitrine barrée de leur écharpe tricolore, prirent la tête d'un cortège impressionnant qui prit la direction de Toulon. Toutes les couches de la population : travailleurs des chantiers, bien sûr, artisans, commerçants, enseignants, manuels, intellectuels tous rangés derrière des drapeaux rouges et tricolores, ceux des partis politiques, des associations solidaires des travailleurs, anciens combattants, syndicats de toutes tendances.
Depuis longtemps la population seynoise n'avait pas connu des heures aussi exaltantes et d'une telle ampleur. Il fallait remonter aux époques glorieuses du Front populaire de 1936 qui apporta aux gens des avantages sociaux appréciables. Trente ans après le peuple était encore obligé de descendre dans la rue pour affirmer son unité et sa force, pour défendre son droit à la vie. Et les pancartes et les banderoles exprimaient fermement sa volonté. On pouvait lire : « Halte à la régression sociale », « Le droit au travail », « Les travailleurs varois ne veulent pas mourir ». Un mot d'ordre au caractère railleur disait : « Le Var est aussi un département francophone ».
Un fait nouveau plutôt inattendu défraya les conversations quand le cortège arriva à la hauteur de Bon Rencontre. Une délégation d'ecclésiastiques vint prendre place parmi les personnalités, et l'on reconnut Monseigneur Barthe, évêque de Toulon, accompagné de prêtres et même de religieuses vêtues de longues robes bleues et coiffées de leurs grandes cornettes blanches. À la vue des drapeaux rouges, l'une d'elles profondément choquée déclara à l'évêque :
- « Monseigneur ! que venons-nous faire ici et nous mêler à ces révolutionnaires qui chantent l'Internationale et portent fièrement leurs drapeaux rouges ? ».
Monseigneur Barthes sut les rassurer : « Soyez sans crainte, ma soeur, répondit-il, ce sont les drapeaux des syndicats ! ».
Sans doute n'avait-il pas voulu voir celui du Parti Communiste, qui portait la faucille et le marteau.
Quand la colonne des manifestants entra dans Toulon, le nombre des participants avoisinait les trente mille. Sur la place Louis Blanc, les voix de quelques orateurs enflammèrent la foule convaincue de poursuivre l'action jusqu'à la victoire : Raymond Dimo, secrétaire de la C.G.T., Pierre Jeanne de la Fédération C.F.D.T. de la métallurgie.
M. Moreni, Président du Comité de Sauvegarde de l'économie varoise rappela la phrase de M. Olivier Guichard, alors Ministre de l'Aménagement du territoire : « Le Var c'est le tourisme ! ». Sérieux avertissement qui ne présageait rien de bon pour l'avenir.
Les jours passaient et avec une détermination accrue, la classe ouvrière seynoise organisa les marches sur Draguignan, Marseille, avec la convergence de caravanes venues de La Ciotat, Port-de-Bouc.
Les pouvoirs publics, qui avaient envisagé effectivement la fermeture des chantiers, furent contraints de reculer devant la croissance des protestations qui allaient prendre une ampleur nationale quand se déroula la fameuse marche sur Paris. Partis le 3 mai de La Seyne, des centaines de travailleurs, leur Maire et tous les élus en tête, traversèrent les plus grandes villes pour y manifester partout avec la même ferveur, ameutant à Dijon, à Troyes, contre la politique catastrophique des gouvernants qui furent contraints de débloquer quelques milliards pour permettre aux chantiers navals de poursuivre leurs activités.
Mais la vigilance des syndicalistes ne devait pas se relâcher malgré les propos rassurants du Préfet de l'époque qui affirmait que les chantiers auraient bientôt une triple activité : construction navale, réparation navale, reconversion (incinérateurs, escalators, turbines, etc.). Cela ne devait pas suffire à calmer les inquiétudes. On laissa entendre à un certain moment que M. Onassis avait manifesté son intention de passer commande aux F.C.M. de 10 à 12 cargos. Il estimait que l'entreprise de La Seyne effectuait des travaux d'excellente qualité. Puis, quelque temps après, le seigneur de la mer ne parla plus que de réparation navale laquelle pouvait se passer des bureaux d'études et des techniciens. Alors ?
L'aide momentanée de l'État avait apporté un ballon d'oxygène à la trésorerie des F.C.M., mais l'avenir n'était pas assuré pour longtemps. Les polémiques se poursuivaient dans la presse politique et syndicale.
La municipalité protesta violemment quand fut prise la décision en haut lieu d'exonérer les chantiers navals de la taxe locale quand ils construiraient pour l'étranger. Les conséquences sur les budgets locaux furent catastrophiques.
Les problèmes de la concurrence étrangère avaient pris dans cette période des proportions dramatiques.
La France était passée au sixième rang dans l'industrie navale pendant que le Japon fabriquait 40 % de la production mondiale. Ses prix compétitifs étaient obtenus au détriment des conditions de vie des travailleurs japonais.
Un journaliste de « Var Informations » écrivait à ce propos avec juste raison : « Si les Nippons ont des prix de revient imbattables, c'est au mépris des lois humaines des pays civilisés. La journée de 10 heures, les bas salaires, l'absence de sécurité sociale ne sont pas des faits qui plaident en faveur du Japon. Et accepter sur le plan mondial un monopole de fait de l'industrie nippone serait une prime à l'immoralité ».
Et la bataille se poursuit. On ne compte plus les manifestations à La Seyne et ses environs, les prises de parole, les distributions de tracts. Avec plus de force encore, les syndicats exigent que les armateurs français soient mis dans l'obligation de construire leurs navires dans les chantiers français ; que des dispositions soient prises par l'État pour que le fret national transite dans la proportion de 50 % sous pavillon français.
Ces mesures ne seront jamais prises. À la date du 25 février, la situation des F.C.M. est devenue explosive et après avoir enregistré la démission de M. Chevalier (P.D.G.) et de M. Vayssières (Directeur général adjoint), un comité interministériel décide de « réanimer les chantiers » et d'autoriser la fusion de ceux de La Ciotat, du Trait (Seine Maritime) et de Port-de-Bouc. Pour La Seyne, un administrateur judiciaire a été désigné lequel aura des moyens d'action et de paiement.
Le Préfet M. Berthet affirme qu'il faudra ensuite trouver une formule d'exploitation pour aller vers la reconversion et créer un atelier de réparation de bateaux.
À une délégation municipale du 28 février, M. Morin, Secrétaire général de la Marine marchande, répond « un groupe d'experts présidé par M. Vicaire a été constitué pour examiner les possibilités de développement de la Société (constructions neuves, réparations, etc.) ». Peut-on espérer des délais ? L'équivoque subsiste.
Il y eut dans cette période une affaire qui accrut considérablement les difficultés financières des chantiers.
En juillet 1964, fut mis sur cale un transport de voyageurs appelé Sagafjord commandé pour des milliardaires retraités norvégiens et destiné surtout à recevoir de grands handicapés désireux de faire le tour du monde dans les conditions d'un confort exceptionnel.
On lira plus loin un texte descriptif de ce navire dont tout le monde s'accordait à dire dans les chantiers qu'on avait recherché par tous les moyens un luxe outrancier. Les ingénieurs eux-mêmes étaient stupéfaits du choix des matériaux.
Nous ne chercherons pas à savoir qui fut responsable, mais des erreurs irréparables furent commises dans le calcul des prix et les pertes se chiffrèrent par milliards, disait-on. À ces graves déceptions pour les dirigeants de l'entreprise allaient s'ajouter d'autres déboires : il fallut ralentir les travaux et le contrat de livraison ne fut pas respecté.
Ce fut seulement en septembre 1966 que le bateau fut achevé au lieu du mois d'avril comme prévu.
On sait qu'en pareil cas, les retards sont durement sanctionnés.
Tout cela ne pouvait qu'amplifier les inquiétudes persistantes sur la survie de la Construction navale seynoise.
Pendant que le Secrétaire général de la Marine marchande affirmait que le gouvernement prenait toutes les mesures pour permettre la poursuite de l'activité des chantiers navals, M. Pisani, Ministre de l'Équipement avait déclaré dans une émission télévisée qu'ils devraient disparaître de la carte. Qui croire ?
À la séance du comité d'établissement du 18 avril, force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée et M. Charron alors directeur des F.C.M. envisage une fermeture partielle mais n'exclut pas une fermeture totale. L'approvisionnement en matières premières ne se fait pas, pour la simple raison que les fournisseurs ne les débloquent pas. L'État fait attendre l'aide qu'il a promise, et la fameuse commission Vicaire ne fait plus parler d'elle.
Rappelons au passage les incidents graves qui s'étaient produits au moment du lancement du cargo Jiupang. Il avait fallu l'effectuer à la sauvette. Les personnalités mêmes avaient déserté la cérémonie. Il n'y eut pas de marraine, pas de baptême au champagne et au lieu de spectacle habituel, on vit apparaître des manifestants et leurs banderoles qui clamaient encore une fois « Non aux licenciements », « Les chantiers ne veulent pas mourir ».
Enfin le 4 juin 1966 : l'Assemblée nationale délibère pour apporter son concours financier permettant la poursuite de l'exploitation des chantiers de La Seyne.
Il est question du groupe Herlicq (engineering à Marle (Aisne) et Raismes (Nord) dont le directeur général est André Herlicq).
 |
|
|
|
|
|
|
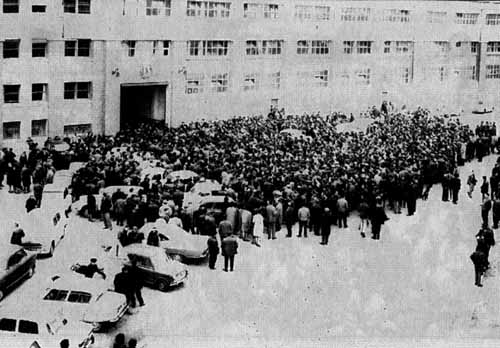 |
|
|
 |
|
|
1er juillet 1966 : naissance des C.N.I.M. (Constructions navales et industrielles de la Méditerranée)
Un administrateur provisoire des chantiers a été désigné, qui s'empresse de déclarer au Préfet du Var : « Je suis le médecin au chevet d'un grand malade ».
On apprend alors que les chantiers de la Seine-Maritime seront vendus séparément : c'est le commencement du démantèlement des F.C.M.
Après quelques semaines d'angoisse, on apprend que ces chantiers ont vécu. Ils seront remplacés par les C.N.I.M. :
La nouvelle société (Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée) sera dirigée par M. Berre, qui annonce une aide de l'État permettant la garantie de l'emploi pour deux ans.
Ce fut un résultat appréciable, et les syndicats s'empressèrent de demander la réintégration des premières victimes des licenciements.
Qui était Marcel Berre, fondé de pouvoir de la Société Herlicq ? Il fut employé comme dessinateur aux F.C.M. en 1934 et deviendra en 1966 Directeur général des C.N.I.M. et de la C.I.E.L. (Constructions Industrielles Électriques du Littoral). Il dirigea plusieurs autres sociétés industrielles et commerciales ; fut également Président de la Chambre patronale varoise.
Quant au groupe Herlicq, société franco-belge, elle avait des ramifications nombreuses en France (Dunkerque, Quimper, Longwy, en Afrique Noire, au Maroc, etc.
Dès sa prise de fondation, M. Berre déclara : « les activités de l'entreprise vont s'orienter vers la construction navale de transports spéciaux, la réparation navale et les activités de reconversion ».
Arrêtons là le film des événements douloureux de cette seule année 1966 qui se termina tout de même beaucoup mieux qu'elle n'avait commencé. Avec l'arrivée de M. Berre à la tête de l'entreprise, on peut dire qu'une ère nouvelle s'ouvrait sur laquelle nous reviendrons dans la période 1966-1976.
Des bateaux en tous genres et quels bateaux !
Nous avons écrit jusqu'ici bien des choses sur les origines de l'industrie navale, ses raisons d'exister, ses réalisations surprenantes et même spectaculaires, les conditions de vie et de travail des personnels au siècle dernier.
Nous avons esquissé le progrès des techniques, évoqué quelques conflits entre Patronat et travailleurs, montré les difficultés des dirigeants à faire vivre et progresser l'industrie nationale, soumise hélas ! à des périodes de récession.
Mais il faut bien comprendre qu'à plusieurs décennies d'intervalle, tous ces aspects ont évolué dans la mouvance des situations politiques, économiques, sociales. C'est pourquoi nous reviendrons plus loin sur des périodes prospères et aussi maussades et puis hélas ! ce sera la phase finale qui se terminera par la fermeture et la destruction des chantiers.
En attendant, nous allons consacrer plusieurs pages de notre ouvrage à parler de quelques types de bateaux, de lancements célèbres, du rôle éminent que ces navires ont joué dans la vie économique locale nationale et même mondiale, qu'il s'agisse de la Marine militaire ou civile, en ayant toujours une pensée émue pour les milliers de marins et d'officiers qui ont péri dans les belles coques envoyées par le fond par accident et surtout par les destructions de la guerre.
Au début de cet ouvrage nous avons rappelé l'existence des petits chantiers seynois, attestée d'ailleurs par le nom de la rue reliant la place des Esplageols au jardin Aristide Briand (rue des Chantiers), ce que d'ailleurs beaucoup de nos concitoyens ne savent pas.
Ces premières structures de la Navale construisirent des bateaux en bois quelquefois doublés par des plaques de cuivre (ce que savaient faire les Romains), des bateaux appelés gabarres, tartanes, bombardes, polacres, brigantins, goélettes, etc. d'un tonnage variant de 20 à 200 tonneaux.
Ils n'utilisaient que la force du vent pour se déplacer. La première grande révolution apportée à la navigation sera l'utilisation de la force de la vapeur (Denis Papin) qui propulsa les premières machines à aubes.
En 1832, Frédéric Sauvage eut l'idée d'utiliser l'hélice pour la propulsion des bateaux, idée qui fut concrétisée en 1842.
Et ces inventions s'appliquèrent aux premières constructions métalliques en fer (chantiers Mathieu).
Au passage, il n'est pas inintéressant de savoir que déjà au début du XVIIIe siècle la construction navale seynoise s'était taillée une solide réputation sur les bords de la Méditerranée.
Voici une statistique relevée dans la revue Provence historique de mars 1964 et qui place La Seyne en tête pour la construction des navires.
Nombre de navires construits entre 1785 et 1791 :
La Seyne : 40 unités &endash; Marseille : 29 unités - La Ciotat : 17 unités &endash; Martigues : 7 unités - Saint-Tropez : 7 unités.
Il faut ajouter que les chantiers seynois garderont cette avance pendant longtemps sur leurs concurrents.
On pourra lire et relire avec intérêt la liste des navires de petit tonnage parue dans l'Histoire de La Seyne écrite par M. Baudoin (avec leurs noms, leurs caractéristiques, les lieux de construction, les noms des armateurs...). Nous parlerons essentiellement des constructions métalliques réalisées à partir de la fondation des Forges et Chantiers de la Méditerranée. Rappelons au passage le texte du Tome I intitulé Du Bourriquet au S.I.T.C.A.T. qui retrace l'histoire des transports maritimes locaux assurant la liaison Toulon-La Seyne (n° 1, n° 2, n° 3). Ils datent respectivement de 1816 et de 1856. Quand la société des bateaux à vapeur Toulon-La Seyne fut fondée, elle mit en service de jolis petits navires à cheminée haute et qui pouvaient transporter jusqu'à 350 passagers. La plupart furent construits dans les Forges et Chantiers.
Nous avons toujours le souvenir de les voir suspendus à la grande grue Atlas toutes les fois que leur carénage était nécessaire.
La construction navale métallique prit un essor considérable dans la seconde moitié de l'empire napoléonien.
L'ère du colonialisme, commencée sous Charles X par la conquête de l'Algérie, allait se poursuivre sous Napoléon III qui avait cependant déclaré en arrivant à la tête des Français : « L'Empire c'est la paix ! ». Et il fit la guerre pendant toute la durée de son règne ! Naturellement, il fallut bon nombre de navires de transports de troupes et de marchandises pour assurer la suprématie de la France sur les continents africain, asiatique et même océanique.
Des appellations nouvelles de navires apparurent avec les paquebots, les frégates cuirassées, les croiseurs cuirassés, les garde-côtes, les canonnières.
La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée fit de bonnes affaires avec les constructions nécessaires à la Marine nationale mais aussi avec les pays étrangers désireux de perfectionner leur défense et leur développement économique. Citons par exemple l'Espagne (« Numancia », « Pelayo ») ; le Brésil (Floriano, Déodoro) ; le Chili (Capitan Prat) ; la Russie (Iaroslav, Bayan..., et plus tard Cesarevitch, Amiral Makarov...). Un immense répertoire serait nécessaire pour mémoriser tous les navires construits dans nos chantiers navals.
Entre le XVIIe siècle et le XXe, M. Baudouin nous a fait connaître avec leurs caractéristiques, le rôle éminent qu'ils jouèrent, les causes de leur disparition souvent dramatique. Nul doute que les publications du siècle qui s'achève nous apporteront une documentation précieuse sur les bilans prodigieux des constructions navales proprement dites et des travaux d'une étonnante diversification.
Comme il n'est pas possible de parler de tous les navires, le lecteur trouvera dans les pages qui suivent des récits réservés à quelques-uns d'entre eux seulement, une vingtaine environ, soit en raison de leurs qualités techniques remarquables, en progrès sensibles sur les générations de bateaux précédentes, soit parce qu'ils rendirent des services considérables au pays par leur rôle économique ou encore par leur participation à des combats meurtriers à la fin desquels on apprit souvent leur fin tragique. La carrière maritime de certains d'entre eux fut jalonnée par des aventures troublantes comme les récits qui suivent le montreront.
La « Gloire »
Cette frégate cuirassée de 6 000 tonneaux année en 1860, fut dotée des 32 canons dont 28 concentrés en une batterie et 4 sur les gaillards. On peut la considérer comme l'ancêtre des navires de ligne d'aujourd'hui.
Les plans de ce navire furent dressés par l'ingénieur Dupuy de Lôme qui lui donna une puissance de 3 200 cv et une vitesse de 13 noeuds, bien que la coque fût alourdie par un blindage de 12 cm pesant 800 tonnes, impénétrable aux projectiles de l'époque.
L'ingénieur Dupuy de Lôme, né dans le Morbihan en 1816, vécut presque toute sa vie à Toulon où d'ailleurs il fut conseiller municipal. Il mourut à Paris en 1885. Son nom a été donné à une allée du cimetière central de Toulon.
La Gloire fut le premier cuirassé de haute mer qui constitue le point de départ de toute l'évolution postérieure qui connut son apogée avec les super-cuirassés de la deuxième guerre mondiale (appelés Dreadnought par les Anglais).
Avec des navires comme la Gloire, la France du deuxième empire se tailla une solide réputation en matière de construction navale militaire. Elle renforça peu après sa Flotte par les Magenta, Solférino, Couronne, qui se révéla supérieure à la Royal Navy britannique.
Cette dernière réagit vigoureusement sous l'impulsion de la Reine Victoria qui tenait absolument à rétablir la supériorité de son pays.
Les frégates cuirassées anglaises Black Prince et Warrior dont la tenue à la mer s'avéra douteuse ne parvinrent pas à ternir le prestige de la Gloire.
Aussi le gouvernement français encouragé demanda à ses Chantiers navals 11 navires semblables.
De nombreux pays étrangers passèrent commande à nos chantiers des paquebots et des navires de guerre. Ce fut le cas de l'Italie, la Russie, l'Espagne, la Turquie, l'Égypte, le Brésil, la Hollande, la Prusse. Ce qui explique que dans cette période, les F.C.M. connurent un essor considérable.
Le « France »
Le premier navire important lancé à La Seyne par la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée s'appela le paquebot France, transatlantique considéré alors comme un modèle de technologie.
Sa mise à l'eau eut lieu le 21 mai 1854. Il fut destiné à la compagnie de navigation mixte pour une ligne Marseille - Rio de Janeiro.
Long de 66 mètres, large de 11 mètres, il pouvait transporter plusieurs centaines de passagers dont la vie à bord n'était pas des plus confortables. Il fut tout de même rendu célèbre par un mode de propulsion curieux imaginé par l'ingénieur Du Tremblay et qui consistait pour actionner la machine à utiliser un mélange d'éther et de chloroforme combustibles qui permettait de réduire considérablement la consommation de charbon et de récupérer une place appréciable au profit du fret.
Une douzaine de navires de même type que le France furent construits à La Seyne dans les années qui suivirent et rendit des services étonnants.
L'État utilisa le paquebot France entre 1854 et 1856 pour transporter du matériel et des troupes pendant la guerre de Crimée.
La guerre terminée, il fut de nouveau affecté à la ligne du Brésil.
Son dernier voyage, il l'effectua de Marseille à Bahia. Malheureusement, le 28 septembre 1856, un incendie ayant éclaté dans la machine, il fut détruit.
Fallait-il incriminer l'inflammabilité de l'éther ? On ne sut trop, mais l'expérience de l'ingénieur Du Tremblay ne fut pas renouvelée.
La « Seyne »
Ce navire date de janvier 1874. Les Forges et Chantiers construisirent plusieurs unités de transport qu'on baptisa « La Seyne » tout naturellement parce que les armateurs locaux (Guerry-Beaussier-Lombard) voulurent honorer la cité qui leur était chère.
Ces petits navires à roues, polacres ou clippers, furent affectés à la navigation intérieure La Seyne - Toulon. On les appela tout simplement La Seyne n° 1, n° 2 et n° 3. Toutefois, La Seyne n° 1 reçut du langage populaire de l'époque le sobriquet de Mouré Négré qui signifie en langue provençale face noire parce que l'extrémité supérieure de l'étrave avait été décorée d'une tête de couleur sombre.
Le dernier bateau portant le nom de La Seyne fut un paquebot à propulsion mixte (voile et vapeur).
Il servit au Chili, puis en Méditerranée puis en Extrême-Orient assurant la liaison Singapour - Batavia (aujourd'hui Djakarta). Nous faisons une mention spéciale pour ce navire en raison de sa fin tragique en 1909.
Les archives des F.C.M. racontent cette fin effroyable en ces termes : « Alors que le navire s'était engagé dans le détroit de Rhio à 80 miles de Singapour par une nuit noire, un choc d'une violence inouïe, un fracas épouvantable le secouèrent d'où il s'ensuivit une panique indescriptible. Une collision avec le steamer anglais « Onda » venait de déchirer les bordages de la « Seyne » si gravement que le bateau seynois coula en moins de vingt minutes. L'organisation du sauvetage par le commandant Couaillac devint quasiment impossible. Quelques témoins rescapés racontèrent des scènes déchirantes. Au petit jour, des naufragés qui nageaient furent happés par les requins et disparurent dans une mer de sang ».
Le maître d'hôtel rescapé de ce drame ne put informer la compagnie des Messageries Maritimes qu'avec beaucoup de retard, mais avec précisions.
Nous aurons hélas ! d'autres exemples de catastrophes à relater dans l'histoire de nos chantiers navals.
Le Pelayo
Vers la fin du XIXe siècle, plus précisément le 5 février 1887, s'effectua aux Chantiers de La Seyne l'un des lancements les plus fameux. D'après le Petit Var, quotidien de l'époque, cette journée revêtit un éclat exceptionnel avec la mise à l'eau d'un cuirassé de 9 900 tonneaux pour le gouvernement espagnol.
Il fallut 3 ans de travaux pour construire l'un des plus puissants navires du monde, protégé par une cuirasse de 0,45 m.
Le mot Pelayo est tiré de Pélage, roi des Asturies, mort en 737, qui fut le fondateur de la première monarchie ibérique et qui se défendit âprement contre les Arabes.
La cérémonie du lancement fut grandiose. Les chantiers avaient été abondamment décorés. Partout flottaient des oriflammes aux couleurs françaises et espagnoles. Partout des écus aux armes de la société (voir le dessin du blason des F.C.M. au début de l'ouvrage).
Le Président du Conseil d'administration des F.C.M. qui fut le Président fondateur, Armand Béhic, malgré son grand âge, était venu de Paris pour accueillir le Ministre de la Marine espagnole. Des reporters de la capitale s'étaient spécialement déplacés pour souligner la valeur de l'ouvrage réalisé par les chantiers, et l'excellence des relations franco-espagnoles.
De Paris, de Nice, de Marseille, 600 invités avaient envahi les tribunes officielles.
Sous un soleil magnifique, M. Lagane, Directeur des Chantiers en cette fin du XIXe siècle dirigea personnellement les opérations de lancement dont le succès fut complet. Après quoi, il reçut dans les locaux administratifs des chantiers 180 personnes invitées à un banquet dont le menu comportait 15 plats. Ne parlons pas des vins !
M. Gaignebet dans le récit qu'il écrivit en 1947 sur le lancement du Pelayo a ajouté que Jean Aicard avait lu un poème de 11 strophes de 6 vers, à la fin du repas.
Le Numancia
Le 17 novembre 1863 fut lancée aux F.C.M. la coque de la frégate cuirassée Numancia destinée à la Marine espagnole mais ce ne fut qu'au mois de décembre 1864 que le navire put être livré.
Il convient de lui consacrer quelques développements en raison de ses exploits qui firent déjà la preuve à cette époque de la haute qualité du travail effectué par le personnel de nos chantiers.
Voici les caractéristiques essentielles du navire : longueur 96 m ; largeur : 17 m ; tirant d'eau 8 m, machine de 2 000 cv actionnant une seule hélice ; déplacement 7 500 tonneaux ; vitesse légèrement supérieure à 12 noeuds.
La coque en fer était protégée par une cuirasse de 13 cm d'épaisseur. Et pourtant le bateau pouvait supporter une artillerie de 34 canons de 20 cm !
En possession de ce navire, le gouvernement espagnol donna l'ordre au Commandant de rejoindre l'escadre du Pacifique, sous les ordres de l'Amiral Pareja en vue d'une intervention militaire au Pérou. Le déplacement s'effectua par le détroit de Magellan seule voie praticable à l'époque, le canal de Panama n'ayant été commencé qu'en 1881.
Les représentants de la Marine n'étaient pas tous convaincus que la frégate cuirassée était en mesure d'affronter les grandes mers surtout sur des trajets aussi longs.
Le comportement du Numancia allait mettre un terme à leur perplexité.
Après des opérations militaires dont le bombardement d'El Callas (2 mai 1866) fut l'épisode principal, l'escadre espagnole prit le chemin du retour.
La division du Numancia se dirigea vers les Philippines, fit escale à Manille, toucha Batavia, puis le Cap (indiquons au passage que le canal de Suez ne fut utilisé qu'à partir de 1869) et puis le passage à Sainte-Hélène, à Rio de Janeiro où il fallut réparer quelques avaries.
Son périple s'acheva le 20 septembre 1867 avec son arrivée à Cadix. La frégate avait fait le tour du monde !
L'exploit du Numancia, construit à La Seyne, répétons-le avec quelque fierté, eut un grand retentissement dans le monde.
La preuve avait été apportée qu'on pouvait désormais naviguer en toute sécurité, bien loin des zones côtières, avec un navire à vapeur. Ce premier voyage autour du monde effectué par un bateau cuirassé fut commémoré par la confection d'une médaille frappée le 20 janvier 1868 et qui porte l'inscription suivante : « Incloricata navis quae prima terram circuivit ».
Le Jauréguiberry
Ce cuirassé porta le nom d'un Amiral né à Bayonne en 1815 et disparu en 1887. Jean Bernard Jauréguiberry se distingua particulièrement, pendant la guerre 1870-1871 dans les combats de Patay et du Mans. Il fut Ministre de la Marine.
Si nous faisons une mention spéciale de ce navire, c'est tout d'abord en raison de ses innovations techniques. Il fut le premier cuirassé français à recevoir des tourelles mues par le courant électrique dont il fit usage en 1915 en participant à la bataille des Dardanelles.
Ce que nous voulions surtout mettre en relief, ce sont les circonstances du lancement qui se fit le 13 octobre 1893, en présence d'une escadre russe commandée par l'Amiral Avellan et du Président de la République Sadi Carnot.
Pourquoi de telles personnalités ? Parce que la diplomatie visait à une alliance franco-russe dans la perspective d'un conflit mondial qui se préparait.
Le Président de la République fut reçu devant la Mairie par le maire Saturnin Fabre entouré de son conseil municipal et des personnalités locales civiles et maritimes (voir le chapitre Ils sont venus à La Seyne, dans le tome IV de notre série d'ouvrages Images de la vie seynoise d'antan).
Le cortège se dirigea vers la place de la Lune où attendait le président du Conseil d'administration des F.C.M. M. Jouet-Pastré entouré de ses collaborateurs.
Tous les invités d'honneur occupèrent les tribunes, la foule innombrable applaudissait le Président et sa suite tandis que nos musiques locales jouaient les plus beaux morceaux de leur répertoire.
L'évêque de Fréjus Monseigneur Mignot procéda au baptême du navire et ce fut alors le lancement admirablement réussi. La Marseillaise retentit, le vaisseau prit lentement possession de son élément sous les vivats de la foule enthousiaste. Ainsi s'acheva cette cérémonie grandiose qui revêtit un caractère véritablement historique pour La Seyne et pour la France.
Le « Gallia »
La compagnie de navigation atlantique ouvrit en 1912 une ligne reliant la France, le Brésil et l'Argentine en vue d'exploiter les services maritimes et postaux. Elle commanda aux F.C.M. deux paquebots le Gallia et le Massilia.
Dans cette relation, il sera surtout question du premier de ces navires, d'abord parce qu'il fut l'une des plus grandes réalisations navales de l'époque, parce que sa fin tragique bouleversa la vie de milliers de gens et en raison également de souvenirs personnels émouvants, comme la suite de ce récit va le montrer.
En quelques mots décrivons le navire, impressionnant pour l'époque. Mis sur cale en 1912 et lancé le 26 mars 1913, long de 182 mètres, jaugeant 15 000 t, il pouvait atteindre une vitesse de plus de 20 noeuds sous l'impulsion de deux machines d'une puissance de 26 000 cv.
Il effectua ses premiers voyages vers l'Amérique du Sud. Hélas ! Pour son malheur, la guerre de 1914 le changea d'affectation. Il devint croiseur auxiliaire et fut destiné au transport des troupes d'Afrique et du Moyen-Orient à travers la Méditerranée.
Tant pis si le lecteur m'accusera d'ostentation, mais je ne peux résister au désir de raconter comment je fis la connaissance du Gallia. Il me semble que ce témoignage de l'enfant que j'étais est appréciable et malgré le temps passé, conserve sa valeur.
Dès le début de la guerre, mon père avait été appelé à exercer ses fonctions à Ferryville (Tunisie), ma famille s'y fixa et entre 1914 et 1920, mes parents traversèrent la Méditerranée plusieurs fois et passèrent leurs permissions en France.
Vers la fin de l'été 1916, une traversée leur fut proposée, à bord du Gallia qui devait rejoindre Marseille avec 2 000 sénégalais à son bord, lesquels devaient s'orienter sur le front de Lorraine.
Moins d'une demi-heure après le départ de Bizerte, le navire dut rebrousser chemin, la présence d'un sous-marin allemand ayant été signalée par l'Amirauté française.
Le lendemain le Gallia repartit, accompagné d'un autre transport, escorté par trois contre-torpilleurs. Le convoi longea prudemment les côtes tunisiennes puis algériennes et marqua de longs arrêts dans les ports pour tromper l'ennemi. Puis ce fut la direction des Baléares et des côtes catalanes, puis les côtes françaises et enfin Marseille.
Par deux fois, des alertes troublèrent la traversée qui finalement dura 4 ou 5 jours.
Comment oublier l'affolement qui régnait à bord, les préparatifs de sauvetage, la canonnade, les embarcations prêtes à quitter le navire, les gilets de sauvetage... en attendant la torpille.
Elle ne vint pas ce jour-là, mais quelques semaines plus tard, le 4 octobre 1916 précisément, le beau Gallia quittait Marseille pour Salonique. Parvenu entre la Sardaigne et le nord de la Tunisie, le sous-marin allemand (U 35) qui avait déjà coulé le paquebot Provence au début de l'année, attaqua le Gallia. Quand la Vigie cria : « Une torpille par tribord », il était déjà trop tard. Une formidable explosion atteignit la cale à munitions. En un quart d'heure, le navire s'enfonça dans la mer entraînant dans la mort un millier de passagers.
Le Gallia devait acheminer sur le front du Moyen-Orient 1 650 soldats français et 350 serbes. L'équipage comportait 350 marins. Des croiseurs français recueillirent quelques centaines de naufragés le lendemain, mais le Commandant Kerboul préféra périr avec son navire.
Pour terminer ce récit, disons que l'infortuné Gallia ne dura même pas quatre ans. Son semblable, le Massilia, navigua plus longtemps, mais finit sa carrière lamentablement, les Allemands l'ayant sabordé à Marseille le 21 août 1944, après avoir détruit les chantiers navals de La Seyne et de La Ciotat.
Sous-marin pour la pêche aux éponges
Le contenu de cette relation a été emprunté à la revue Sillages, dans l'un des articles écrits par Patrick Martinenq.
En fait, ce sous-marin n'est pas un bateau. C'est un engin, conçu pour la pêche aux éponges, qui fut commandé aux F.C.M. en 1907 par un prêtre de Carthage, l'abbé Raoul.
L'année suivante, un magazine célèbre de l'époque appelé Illustration consacra un article à cette curieuse réalisation de nos chantiers. Pourquoi un prêtre de Carthage fut-il intéressé par la pêche aux éponges ? Tout simplement parce qu'elles étaient si nombreuses sur les côtes tunisiennes, que leur exploitation lucrative était devenue une véritable industrie, mais aussi pour éviter aux pêcheurs des accidents de plongée fréquents par une retenue excessive de leur souffle dans les profondeurs. L'ingénieur des chantiers chargé de cette construction, Monsieur Rousset, entra en contact avec l'abbé Raoul pour la mise au point d'un engin de plongée dont voici une description sommaire. Pour en avoir une idée plus précise sans doute faudrait-il consulter la fiche n° 1012 inscrite dans les registres de la Société.
Ce sous-marin de pêche ressemblait à une bouée cylindrique de 5 m de long par 1,60 m de diamètre, surmontée d'un kiosque donnant accès à l'intérieur où opéraient deux hommes vivant grâce à un réservoir d'air comprimé, disposant de ballasts de 300 litres permettant la descente sur les fonds habités par les éponges ou la remontée en surface. Celle-ci en cas de danger pouvait se faire rapidement en libérant de l'intérieur un lest de 680 kg. Pour les déplacements, deux rames spéciales avaient été imaginées pour être manoeuvrées de l'intérieur. À l'avant du sous-marin était fixée une sorte de corne renfermant des lampes électriques permettant d'éclairer le fond visible de l'intérieur par un grand hublot et munie d'une longue pince articulée pour arracher les éponges et les déposer dans un panier suspendu au bout de la corne.
L'article paru dans L'Illustration ne fit pas mention des avantages commerciaux que les Tunisiens tirèrent de ce curieux sous-marin. De toute manière, cette réalisation apporta une fois de plus la preuve du savoir-faire et de l'imagination créative de nos anciens des chantiers.
Le dock d'Ismaël Pacha
Il s'agit là d'une construction navale un peu spéciale. Dans les années 1860, le vice-roi d'Égypte se préoccupa de développer sa flotte marchande. On sait que les bateaux nécessitent un entretien constant et donc leur passage fréquent dans les bassins du radoub. C'est pourquoi les autorités maritimes égyptiennes pensèrent à la formule d'un dock flottant permettant de recevoir un navire, une fois rempli, puis de le mettre à sec après le pompage de l'eau, cette opération pouvant s'effectuer en 5 heures.
Nos chantiers de La Seyne reçurent commande d'un dock de 130 m de long, 30 m de large et pesant 4 100 tonnes. La construction dura plusieurs mois, après quoi la compagnie des Messageries Impériales eut la charge de convoyer ce dock flottant jusqu'à sa destination égyptienne.
Le remorquage s'effectua par deux paquebots en fer très solides. Pour faciliter les mouvements du dock, il avait fallu confectionner une fausse étrave et fixer à l'autre bout un gouvernail.
Le départ s'effectua le 3 juillet 1868. Ce fut une véritable odyssée pour ce convoi qui devait traverser la Méditerranée. À hauteur des îles d'Hyères, le dock perdit son gouvernail. Il fallut donc rebrousser chemin, réparer et reprendre un autre départ qui eut lieu le 9 juillet, à une vitesse qui ne dépassait guère 5 noeuds. Le cap Corse est dépassé le 11 juillet, mais à partir du 13 juillet la mer se déchaîne.
Le convoi doit s'arrêter à Syracuse et se ravitailler en charbon. Il reprend la mer de nouveau entre en furie et le dock menace de couler. Il faut encore réduire la vitesse pour éviter le pire.
Enfin le 31 juillet, on est en vue d'Alexandrie. La traversée avait duré 21 jours, sans parler du premier départ raté.
On imagine la joie immense qui régna dans les chantiers seynois à la réception de la dernière nouvelle.
Cette réussite contribua grandement à rehausser le prestige de la construction navale seynoise.
Le cuirassé Paris
Dans le Tome I de notre série « Images de la vie seynoise d'antan », quarante pages ont été consacrées au lancement du cuirassé Paris, dans nos Chantiers, le 22 septembre 1912. C'est pourquoi cette relation se borne à rappeler l'essentiel de ce que l'on doit savoir de cet événement qui revêtit un caractère historique national, dans un contexte de préparation à un conflit mondial.
Quelques mots sur les caractéristiques du navire aux qualités inégalées en ce début du XXe siècle : longueur 165 mètres, largeur 27 m. Puissance prévue pour les turbines : 26 200 cv. Vitesse prévue : 20 noeuds. Artillerie énorme comportant 12 pièces de 30 cm en 6 tourelles doubles et 22 pièces de 14 cm. Les chaudières peuvent marcher au charbon ou au mazout. Les turbines Parsons actionnent 4 hélices.
 |
|
|
Les tribunes officielles accueillirent des centaines de personnalités : Ministre de la Marine : M. Delcassé ; Président et membres du Conseil municipal de Paris, Président et membres du Conseil d'Administration, des F.C.M., députés, sénateurs, conseillers généraux, Maire et conseillers municipaux, Direction des chantiers navals, M. Rimbaud en tête, Grands Officiers des années de terre et de mer.
Face aux tribunes officielles, la grande masse des ouvriers et des techniciens, des milliers de Seynois enthousiastes. Nos formations musicales locales égayèrent admirablement la cérémonie.
Plus qu'à l'ordinaire, quand le signal du lancement fut donné et qu'on vit glisser vers son élément l'énorme masse de fer et d'acier, ce fut une joie indescriptible, des applaudissements frénétiques mêlés aux accents toujours poignants de notre hymne national.
Les opérations de lancement terminées, le bateau ramené à quai par de puissants remorqueurs, la grande foule se dispersa, mais les invités de marque se rassemblèrent dans le hall du casino de Michel Pacha à Tamaris admirablement décoré pour la circonstance.
Il y eut exactement 319 convives invités par le Conseil d'Administration des F.C.M.
Nous invitons les lecteurs à lire ou relire dans notre Tome I la composition des menus hors d'oeuvre, des six plats, des spécialités culinaires les plus fines, les noms des meilleurs vins servis au cours de ces agapes.
On trouvera également dans ce chapitre du Tome I, le texte des discours prononcés par le Président du Conseil d'Administration des F.C.M., le Président du Conseil municipal de Paris, par M. Delcassé, Ministre de la marine. L'un valorisant l'excellence des travaux réalisés aux Chantiers de La Seyne (rappelons que la coque du cuirassé Paris fut mise à l'eau après 9 mois de travail seulement), les autres exacerbant l'élan patriotique des Français dont certains ne cachaient pas leurs désirs revanchards après les désastres de la guerre de 1870. La relation du Tome I sur le lancement du cuirassé Paris se termine par la liste des distinctions honorifiques décernées à de nombreux Seynois des chantiers.
Ajoutons pour terminer cette notice volontairement écourtée que le beau cuirassé après avoir joué un rôle éminent dans l'histoire de la Marine nationale n'eut pas une fin glorieuse.
En 1940, saisi par les Anglais, utilisé comme base de D.C.A. pendant quelques temps, il disparaîtra dans les chantiers de démolition en 1956.
Les Napoléon
À travers sa longue histoire, la Marine nationale tant civile que militaire a toujours voulu vénérer des hommes illustres : écrivains, stratèges, hommes politiques plus particulièrement célèbres - comme elle a eu le souci de perpétuer l'image de notre beau pays de France avec ses provinces, de rappeler également les grands événements nationaux, les grands idéaux de nos anciens ardents défenseurs de la Démocratie.
Voilà pourquoi les noms de Napoléon, de Paris se sont inscrits souvent sur les navires.
Dans cette relation, nous évoquons les Napoléon qu'on retrouve quatre fois sur les historiques de la marine.
Le premier Napoléon fut lancé au Havre en 1842.
Actionné par la vapeur et la voile, ce navire de dimensions modestes (Longueur 45,30 m - largeur 8,52 m) fut utilisé comme paquebot-poste entre 1842 et 1850. Il avait cette particularité que son hélice n'avait pas encore un tracé définitif car l'invention du précurseur Frédéric Sauvage devait être modifiée.
Un autre Napoléon naquit en 1847 et dura jusqu'en 1884. Les plans de ce vaisseau furent conçus par Dupuy de Lôme, jeune ingénieur qui n'avait pas trente ans, un homme de génie qui fut l'artisan principal des transformations et des progrès de la marine pendant 40 ans. Rappelons qu'en 1856, il fut vice-président de la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée.
Ce second Napoléon destiné à la marine de guerre était beaucoup plus imposant que le précédent par ses dimensions d'abord (Longueur 79 m - largeur 16,15 m) et surtout par son armement (92 canons, dont 64 de 30 cm). Intégré à l'escadre de Toulon, il participa à la guerre de Crimée (1854-1856). Il avait été construit à l'arsenal de Toulon (cale du Mourillon). Il fut détruit en 1884.
En 1959, on vit réapparaître le nom de Napoléon sur les mers.
Nous parlerons avec précision de ce troisième, mieux connu des Seynois et surtout des Corses parce qu'il fut construit par les chantiers navals de La Seyne qui le lancèrent le 4 avril 1959. C'était un paquebot commandé par la Compagnie Générale Transatlantique, destiné à l'exploitation des lignes de la Corse.
Voici quelques caractéristiques : longueur 108,70 m, largeur 15,80 m ; sa coque était presque entièrement soudée.
En plus de son équipage, il pouvait embarquer 1200 personnes ; un entrepont pouvait recevoir une centaine de voitures légères et la plage avant quelques autocars de dimension moyenne.
Sur ce paquebot moderne, les passages trouveraient tout le confort de la modernité : bar, cafétéria, salle de jeux...
L'État major comprenait 10 officiers et l'équipage 66 hommes.
Ce Napoléon fut le premier paquebot appelé car-ferry. Il assura pendant 14 ans les liaisons avec la Corse.
|
|
|
|
En 1974, il fut vendu à l'Arabie Saoudite pour devenir Alpasha.
Un quatrième paquebot baptisé Napoléon, construit par les Chantiers Dubigeon Normandie est entré en ligne depuis le 21 juin 1976 pour assurer la liaison Corse-continent.
Il arrive parfois à cette belle unité d'effectuer des croisières sur le pourtour méditerranéen à la grande satisfaction des touristes qui apprécient tout le confort et les agréments du navire et toutes ses qualités idéales.
Le Sagafjord
Paquebot construit pour le compte d'une grande compagnie norvégienne : La Norske Amerikalinje.
Mis sur cale le 19 juin 1963, lancé le 13 juin 1964, livré le 18 septembre 1965.
On a écrit à l'époque que le Sagafjord était un véritable palace flottant car il offrait à ses huit cents passagers un luxe et un confort inégalés dans le monde de la construction navale.
Hormis les voyages entre Oslo et New York, la compagnie avait prévu des croisières de 80 à 90 jours autour du monde.
 |
|
|
Décrivons succinctement les caractéristiques du navire. Longueur 188,98 m ; largeur 24,38 m ; tirant d'eau 8,23 m ; vitesse en service 20 noeuds.
Le navire a été construit en acier avec superstructure du pont supérieur en alliage léger. Il est équipé d'un stabilisateur de roulis.
Les ponts supérieurs sont recouverts de bois (teck ou pin d'Oregon).
La navigation et la sécurité y sont assurées par les appareils les plus modernes dans le détail desquels il n'est pas possible d'entrer ici.
Ce magnifique bateau de tourisme comporte 270 cabines dont 88 de première classe.
Chacune est dotée d'un local sanitaire individuel (baignoire, lavabo, W.C.), l'insonorisation est assurée par des cloisons doubles, tous les agréments possibles s'y trouve : moquette, rideaux, téléphone, télévision... Un haut-parleur peut y apporter de la musique classique ou moderne. Tout a été conçu pour assurer aux voyageurs la détente, le repos complet, la joie de vivre.
À l'occasion du lancement du Sagafjord, la revue Méditerranée, publiée par les F.C.M. dans les années 1965 a consacré un numéro spécial, à la journée du 18 septembre date de la livraison à la compagnie norvégienne.
De ce document très riche, nous avons relevé quelques précisions significatives du luxe, du confort et du bon goût exigés par les promoteurs.
Il n'est pas possible de reproduire ici les textes et surtout les illustrations se rapportant au beau navire.
Le salon principal (30 m x 25 m) et son ameublement luxueux, le grand salon avant et son jardin d'hiver avec ses plantes vertes, offraient au regard des passagers des merveilles de décoration d'un goût raffiné.
La salle de spectacle d'une capacité d'accueil de 250 personnes peut distraire les touristes par des animations diverses, conférences, séances de cinéma, un escalier somptueux aux marches couvertes de moquette rouge donne accès à la grande salle à manger où peuvent prendre place 475 personnes servies dans la totalité en un seul service.
Nous n'en finirions pas de décrire toutes les commodités à la disposition des passagers : salons de coiffure, soins de beauté, soins médicaux (hôpital, dentisterie, radiographie) ; salles de jeux pour les enfants ; piscine, lingerie, buanderie, imprimerie, bulletins d'information, bibliothèque, hall-boutique.
Ajoutons pour terminer cette courte narration que le lancement du navire s'est effectué sans aucune cérémonie le 13 juin 1964. Par contre, le 18 septembre 1965 rassembla du beau monde, les autorités de la grande compagnie norvégienne Norske Amerikalinje sous la conduite de son président M. Henriksen, des autorités françaises nationales, départementales.
Instant émouvant que celui où l'on échangea les pavillons français et norvégien.
Des discours brillants furent prononcés par M. Henriksen, M. Chevalier, Directeur des F.C.M. et par M. Morin, Secrétaire d'état à la Marine.
Le Quirinal
Peu après la fondation de la Société des F.C.M., ce navire, qui porte le nom d'un des hauts-lieux de la Rome antique, fut lancé le 26 avril 1857.
Deux raisons expliquent cette relation succincte. Tout d'abord parce que le Quirinal fut l'un des premiers paquebots importants de cette époque, lancé à La Seyne et actionné par la vapeur et les roues à aubes, l'hélice n'étant pas tout à fait au point.
Long seulement de 58 mètres, il pouvait tout de même transporter plusieurs centaines de voyageurs dans des conditions relativement confortables pour le compte de la Compagnie de Commerce et de Navigation de Russie.
La seconde raison est justifiée par le fait que cette livraison à la Russie des Tsars marqua le point de départ d'un grand nombre de constructions navales seynoises pour les pays étrangers comme l'Espagne, l'Argentine, la Grèce, l'Italie, le Japon, l'Égypte, le Chili, le Portugal.
Ce lancement a revêtu un caractère historique par la présence du Grand Duc Constantin, très considéré en Russie parce qu'il avait cédé ses droits au trône au profit de son frère Nicolas Ier, avant de devenir vice-roi de Pologne.
Ce dernier arrivé à Toulon le 20 avril repartit le 27 pour Marseille où il assista au grand théâtre de cette ville, à une représentation de gala, Les Martyrs de Chateaubriand.
Les historiques des F.C.M. nous ont appris que la cérémonie du lancement fut contrariée par une pluie diluvienne et malgré le mauvais temps l'abbé Coquereau y ajouta l'eau du baptême.
Le Grand Duc Constantin sous la pluie battante voulut connaître l'ensemble des installations de notre construction navale. Sans aucun doute, sa visite fut bénéfique pour notre industrie navale, la Russie ayant passé de nombreuses commandes dans les années qui suivirent.
Plusieurs steamers nommés Péranade, puis Colchis, Elbrutz, Kertch, noms géographiques de la Russie, furent des bateaux en fer à roues, puis à hélice dont les dimensions et les améliorations techniques évoluèrent rapidement vers la fin du XIXe siècle.
Le Cesarevitch
À la fin du XIXe siècle, dans les années 1898-99, la Russie commanda aux Forges et Chantiers de la Méditerranée deux cuirassés : le Bayan de 7 800 t et le Césarevitch de 13 105 t. Ce dernier fut le plus grand navire de guerre construit par la France dans cette période et celui dont les qualités stratégiques remarquables portèrent au plus haut niveau le prestige de nos chantiers navals - ce qui explique, la nécessaire relation que nous lui avons consacrée.
Long de 118,50 m, d'une puissance de 13 500 cv., ce navire fut lancé en présence des plus hautes autorités de la Marine impériale russe et la cérémonie fastueuse prit le caractère d'un resserrement de l'alliance franco-russe, particulièrement affirmée depuis 1893 avec le lancement du cuirassé Jauréguiberry en présence de l'escadre commandée par l'Amiral Avellan.
Selon les conceptions de M. Lagane, Directeur des F.C.M. en cette fin du XIXe siècle, le Cesarevitch avait été pourvu d'une protection spéciale contre les explosions sous-marines.
Durant la guerre russo-japonaise de 1904-1905 les constructions navales seynoises firent la preuve éclatante de leur efficacité et de leur supériorité. La bataille navale de Port-Arthur, néfaste pour la Russie des Tsars, se termina par la destruction quasi-totale de son escadre. Deux cuirassés s'illustrèrent singulièrement par leur résistance aux assauts des Japonais : le Bayan et le Cesarevitch, tous deux construits aux F.C.M. de La Seyne.
Le Bayan, gravement endommagé, fut coulé par son équipage plutôt que de le voir tomber aux mains de l'ennemi. On apprit plus tard que les Japonais réussirent tout de même à le renflouer, à le réparer et à l'intégrer dans leur flotte sous le nom de Aso.
Le Cesarevitch réussit à sortir glorieusement de la rade de Port-Arthur malgré ses blessures.
La supériorité de sa construction et surtout l'épaisseur de son cuirassement lui permirent de résister aux tirs violents et prolongés de l'escadre japonaise.
Après leur défaite, les Russes, désireux de se doter d'une grande Marine militaire comprirent à quels chantiers ils devaient s'adresser. Ce qui explique les nombreuses commandes de la Russie des tsars à nos chantiers seynois. Ils passèrent commande dès 1905, de plusieurs contre-torpilleurs et du cuirassé Amiral Makarov à nos chantiers seynois.
Les historiens russes de la guerre russo-japonaise ont formulé ce jugement sur la capacité de résistance des navires de guerre engagés dans le conflit à la bataille de Port-Arthur : « Sur les douze contre-torpilleurs de 350 tonnes que comptait la flottille de Port-Arthur lors de l'agression japonaise, on en comptait seulement six dont on pût être pleinement satisfaits : ils étaient de construction française ».
Il y eut en effet entre 1880 et 1906, 21 navires de guerre destinés à la flotte russe : cuirassés, croiseurs, torpilleurs, contre-torpilleurs. Durant la visite qu'ils effectuèrent à Moscou, M. Lagane, Directeur des chantiers de La Seyne et M. Widmann, Directeur des Établissements de Marseille, surent parfaitement convaincre l'Amirauté russe de la haute technicité de l'industrie navale seynoise.
Le Tamaris
Au sud de Madagascar, aux confins du cercle polaire austral se trouve un archipel dénommé Iles Crozet, nom d'un explorateur qui les découvrit en 1772.
Combien de Seynois savent qu'il existe sur le pourtour de l'une d'elles la Baie du Tamaris ?
Il y a quelques années, le journaliste Jean Debout, se référant à l'écrivain Robert de Chateaubriant nous avait expliqué l'origine de cette appellation, pour le moins étonnante dans une région si redoutable pour les navigateurs.
Le nom d'un des plus beaux quartiers de La Seyne est venu là en raison d'un drame de la mer. Tamaris était le nom d'un bateau construit aux F.C.M., lancé en 1867. Il s'agissait d'un clipper de 500 tonneaux, affecté à Bordeaux et chargé du ravitaillement de la Nouvelle-Calédonie, française depuis 1853.
Disparu pendant une année, on ne sut que par le plus grand des hasards sa fin dramatique à proximité des îles Crozet. Qu'on en juge !
Un amiral anglais signale au quai d'Orsay en octobre 1887 qu'un albatros a été trouvé mort sur l'un des rivages des îles. Rien de surprenant à cela, mais l'oiseau porte au cou un morceau de fer blanc dont l'inscription suivante est parfaitement lisible en français. « Treize naufragés sont réfugiés aux îles Crozet - 4 août 1887 ». C'est alors que toutes les autorités portuaires de l'Europe sont prévenues. On sut peu après par les armateurs de Bordeaux, la disparition du Tamaris depuis Décembre 1886.
Plusieurs unités de la Marine entreprirent des recherches, en partant de la baie de Diego Suarez de Madagascar.
Les sirènes retentirent en vain. Une goélette la Meurthe explora tous les rivages jusqu'au jour où une lettre fut découverte dans une cabane abandonnée qui signalait pour les naufragés l'obligation de chercher refuge dans une autre île.
Des indigènes les avaient-ils menacés ? On ne retrouva jamais les marins naufragés, dont l'aventure se termina sans doute tragiquement. En souvenir de leur infortune, on appela la baie qui les accueillit : Baie du Tamaris.
La Navale, une industrie très complexe
Par souci de concision, il n'était pas possible dans cette sorte de synthèse de la construction navale seynoise d'en aborder tous les aspects de manière approfondie.
C'est pourquoi nous avons consacré peu de place aux problèmes des techniques posés par la conception, l'utilisation, la fabrication, les lancements de bateaux.
Il était tout de même indispensable d'ouvrir et d'intercaler une rubrique montrant la complexité et les difficultés énormes d'une industrie comme celle de la Navale.
Ceux qui en ont la charge sont confrontés à des facteurs économiques et politiques épineux, à des problèmes humains délicats (revendications incessantes, sécurité dans le travail, questions d'hygiène, etc.).
En décrivant ici, même succinctement, le processus de la construction d'un navire, le lecteur pourra se faire une idée des difficultés de tous ordres à vaincre, malgré toutes les prévisions des spécialistes.
Un armateur désireux de remplacer un navire trop ancien, c'est-à-dire après 25 ou 30 ans de services, charge ses services techniques d'établir un dossier où figureront des multitudes d'exigences. Quel type de navire : paquebot, pétrolier, cargo, méthanier, navire de plaisance ? Quelle ligne de navigation devra-t-il servir ? Quelles mers empruntées ? Quelles seront ses dimensions ? (Longueur, largeur, tirant d'eau,…). Port en lourd ? Effectifs, nombre de passagers éventuels ? Type des machines de propulsion (fuel, électricité,...) ? Vitesse moyenne à réaliser ? Poids du combustible, ventilation, réfrigération, matériaux employés ? Prévoir les assurances (Véritas), débattre des prix,…
Tous ces renseignements seront transmis à divers chantiers de construction navale dont les bureaux d'études établiront un avant-projet du navire conformément aux demandes de l'armateur.
Le dossier sera transmis à l'entreprise choisie qui, à son tour, examinera avec le plus grand soin l'avant-projet et si un accord est conclu, il faudra alors passer un marché de commande sur lequel quelque 200 personnes vont travailler, étudier toutes les installations, les appareils nécessaires, les quantités de matières premières à commander. Les plans préparatoires devront déterminer le tracé des lignes d'eau, de toutes les courbes, avec une extrême précision (plan des formes).
Des sections de spécialistes (coque, machines, électricité,...) mettront au point tous les travaux qui les concernent.
Pendant un siècle et demi, les Seynois assistèrent de près ou de loin au montage de l'ossature des navires sur les cales (en bois au début, en maçonnerie par la suite) jusqu'à l'aire des éléments préfabriqués.
Au début du siècle, il fallut jusqu'à 3 ans de travail pour construire un cuirassé. La coque faite de tôles et de profilés ne pouvait s'édifier qu'avec lenteur car la soudure n'avait pas encore remplacé le rivetage. Les instruments de levage étaient encore rudimentaires et l'électricité naissait à peine.
Et cependant, les navires avec leurs ponts robustes, leurs cloisons étanches, leurs quilles de roulis, résistaient à la pression extérieure de l'eau, à la poussée intérieure du poids de la cargaison, à la force des vagues de la mer déchaînée. Les récits qui précèdent l'ont prouvé abondamment.
Nouvelles années prospères (1976-1980)
Revenons maintenant à l'année 1966 avec M. Berre à la direction de l'Entreprise C.N.I.M.
Après la tempête de juillet et un cap très difficile franchi, les nouveaux dirigeants savaient bien que des efforts de redressement nécessaires devraient se poursuivre longtemps pour sortir la construction navale du marasme.
Au mois de septembre, la direction annonça que la nouvelle société avait obtenu pour 33 milliards de centimes de travaux répartis sur les secteurs de la construction, de la réparation, des activités terrestres et même nucléaires.
Faisons état succinctement pour l'année 1967 d'une diversification inespérée avec le lancement de 3 transports de gaz liquéfié, la fabrication de tubes lance-missiles, d'escaliers mécaniques destinés à la R.A.T.P., d'usines d'incinération.
On annonça dans cette même période : une commande d'un pétrolier de 25 000 t, de 4 cargos polythermes, de navires frigorifiques pour l'U.R.S.S.
Dans une interview accordée à la presse au mois d'août 1970, M. Berre annoncera que le carnet de commandes dans le seul domaine maritime atteignait 143 milliards de centimes. Ce fut dans cette période faste que les C.N.I.M. s'orientèrent vers la construction de navires transporteurs de gaz appelés méthaniers.
Les affirmations de M. Berre se concrétisèrent dans les quatre années qui suivirent par un bilan dont voici un résumé succinct des plus gros travaux : 6 containers, 7 méthaniers dont la capacité variait de 35 000 à 75 000 m3 dont l'Hassi R'Mel, méthanier de 40 000 m3, 2 transports de gaz propane ou ammoniac de 52 400 m3, 3 cargos frigorifiques, 5 usines d'incinération, 80 escalators pour la R.A.T.P., 11 chaudières, 30 turbines, armement lance-missiles pour les sous-marins Indomptable et Redoutable. Autre aspect de l'évolution et du progrès des techniques : les aires de fabrication. Les Américains les avaient imaginées après leur désastre naval de Pearl Harbor au cours duquel leur flotte du Pacifique fut détruite par les Japonais le 7 décembre 1941.
 |
|
|
Il leur fallait la reconstituer au plus vite et le système des ensembles préfabriqués, à proximité des cales, donna des résultats surprenants.
Leur exemple fut suivi à La Seyne et ailleurs. Ces aires de travail à proximité des cales étaient chacune desservies par ses appareils de levage propres, son réseau complet de distribution de courant pour les soudures. Cette nouvelle conception du travail se révéla d'une grande efficacité quand on pense qu'il fut possible d'assembler par les grues les plus puissantes des blocs de 70 tonnes et même 120 tonnes avec l'Atlas, et cela dans un temps record.
L'aménagement de ces aires de fabrication nécessita la disparition des cales 4 et 5 qui dataient de plus d'un siècle. Remarquons au passage qu'on assistait déjà à la disparition des plus vieilles structures des chantiers navals.
Devant l'importance de ces réalisations, la société des F.C.M. fut conduite à étudier la création d'un nouveau chantier capable de construire des méthaniers d'une contenance allant jusqu'à 260 000 m3, projet ambitieux qui n'aura pu voir le jour.
En 1971, la cadence des réalisations ne faiblit pas. Notons pour l'essentiel : 3 usines d'incinération, 5 porte-containeurs, 16 chaudières, 18 escalators et de nombreux travaux pour l'armement nucléaire.
En 1972 et 1973, les progrès furent satisfaisants dans les mêmes domaines et l'éventail de la diversification s'ouvrit plus largement.
Aux pétroliers Purha-Wintta, s'ajouta la construction des matériels offshore : plate-forme de forage, modules, constructions industrielles de mécanique générale, centrales thermiques, usines de dessalement, les polythermes (Pointe Allègre, Pointe des Colibris, Fort la reine, etc.), travaux divers pour le Commissariat de l'Énergie Atomique. Arrêtons ces énumérations sans doute fastidieuses.
Dans le même temps, prenait naissance une structure nouvelle le M.I.T. (Matériels Industriels et Terrestres), ce qui deviendra plus tard le secteur terrestre de Brégaillon dont nous parlerons plus loin.
Pour ce faire, les Chantiers seynois firent l'acquisition de la S.M.N.M. (Société de Matériel Naval du Midi).
M. Berre affirmait avec une fierté bien légitime que l'entreprise des C.N.I.M. à elle seule occupait 5 300 personnes. À cet effectif s'ajoutait celui de la sous-traitance qu'on pouvait estimer à 2 000 travailleurs.
Ce qui revient à dire que la Construction navale seynoise, c'était alors 7 300 emplois.
En 1973, les activités économiques avaient progressé de 28 %. L'année 1974, verra s'accentuer celles des C.N.I.M. de 42 % avec la commande de 14 navires assurant une pleine charge de travail jusqu'en fin 1978.
La confiance revenue, de nouveaux problèmes de croissance allaient maintenant se poser par l'extrême diversité des commandes. Aiguillonnés par le succès, les ingénieurs voyaient grand. Il leur fallait repenser les problèmes de la manutention, mécaniser et automatiser davantage.
Avec l'apparition de l'informatique, il fallait revoir aussi les moyens et les procédés de gestion.
À l'évidence le progrès, la rapidité et la modernité allaient nécessiter des investissements très coûteux.
Certes, depuis 1961, on avait bien pensé à installer la première génération d'ordinateurs, mais dix ans plus tard, les progrès de l'informatique avaient été si fulgurants qu'il avait fallu créer un centre de traitement spécialisé dans ce domaine avec des appareils de la troisième génération d'ordinateurs.
Il fallut multiplier les programmateurs, pupitreurs, ordinateurs. Les projets, les plans et les devis relatifs à des travaux d'une telle diversification qu'il fallut obligatoirement créer des emplois. On compte dans cette période jusqu'à 160 ingénieurs et 300 dessinateurs.
 |
|
|
De la multitude des travaux de l'année 1974, faisons une mention spéciale pour l'armement des méthaniers Genota (75 000 m3 et « Géométra ; le lancement et l'armement de cargos routiers ; 5 navires de 4 200 t pour la centrale d'achat soviétique Sudoimport. Ce fut la série des Akademic (Tupolev, Artsimovich,...) qui furent livrés en 1975 ainsi que les transports de containers tels que le Chevalier Paul », le « Chevalier Roze ».
Nous ne parlerons pas des activités de moindre importance et d'une extrême diversité, sans lesquelles cependant la situation de l'entreprise aurait déjà donné des signes troublants d'inquiétude.
Et nous en arrivons à l'année 1976 remarquable par la réalisation de la première jumboïdisation, technique nouvelle qui consistait à « sectionner un navire en son milieu, à écarter les deux moitiés pour intégrer des éléments préfabriqués permettant ainsi un allongement du navire et donc l'accroissement de sa capacité ».
Cette expérience obtint un franc succès. Pour ce faire, il fallut construire une forme de 210 m de long et 57 m de large.
À la fin de l'année 1976, le carnet de commandes comportait :
Et comme les années précédentes : usines d'incinération, chaudières, escalators, etc.
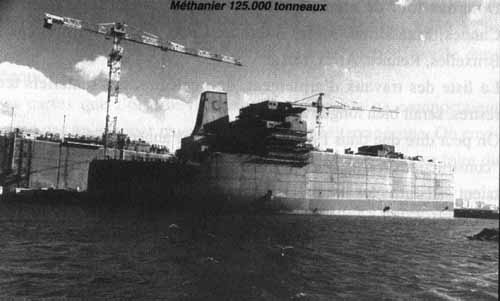 |
|
|
Ces nouvelles années prospères étaient bien significatives d'un nouvel essor pour nos chantiers navals. Et pourtant, les fruits n'allaient pas tenir la promesse des fleurs, comme nous le constaterons dans les pages qui suivent.
Il serait bien fastidieux d'énumérer les villes, syndicats intercommunaux, agglomérations qui furent dotés de ces structures modernes si nécessaires à la vie actuelle.
Donnons tout de même quelques exemples : Grasse, Antibes, Cannes, Mandelieu, Metz, Avignon, Caen, Nice, Monaco, Lille, Bruxelles, Rennes, Arles, etc.
La liste des travaux d'armement, du nucléaire, des matériels terrestres, serait bien longue à établir.
On peut dire que dans l'ensemble jusqu'à l'année 1976 les activités « constructions navales » et « matériels et installations terrestres » restaient satisfaisantes, mais les dirigeants de l'entreprise ne cachaient pas leur inquiétude sur le proche avenir.
Précisons toutefois que la construction navale représentait encore 63 % des activités et les commandes terrestres 27 %.
Malgré les résultats très positifs obtenus dans les années 1966-1976, il fallait voir plus loin.
Les autorités maritimes du plus haut niveau avaient-envisagé depuis plusieurs années la création d'un ensemble industriel et portuaire à Brégaillon, projet favorisé par la Municipalité qui apporta une contribution financière appréciable ; projet dont la réalisation serait un complément indispensable aux activités de la construction navale. Il fallait envisager l'extension des C.N.I.M. et prendre des mesures d'accompagnement pour la C.I.E.L. (Société de Constructions et d'Installations Électriques du Littoral) et le C.N.E.X.O. (Centre National d'Exploitation des Océans).
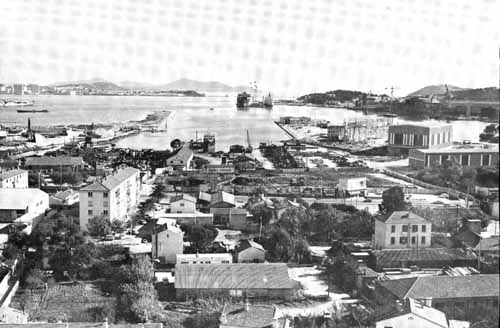 |
|
|
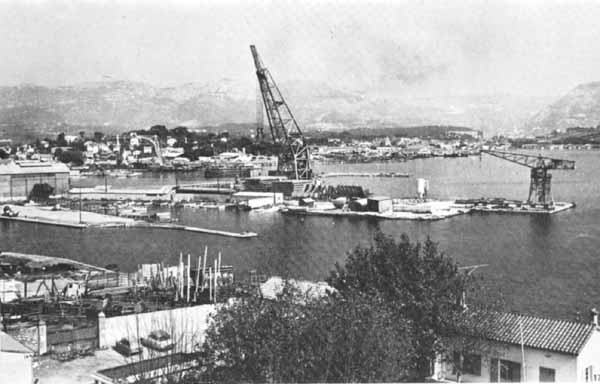 |
|
|
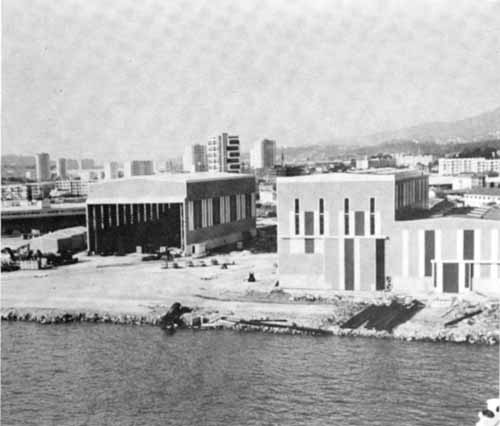 |
|
|
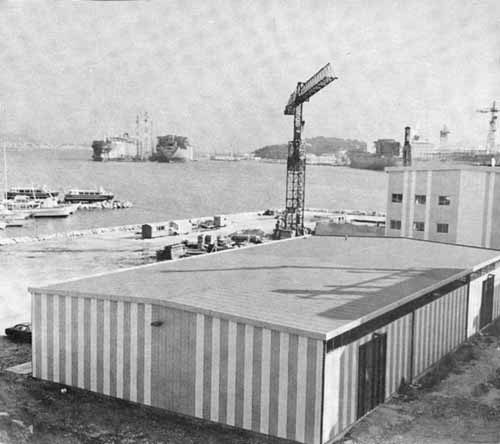 |
|
|
La longue digue du futur Port Marchand s'allongeait si bien qu'il y avait tout lieu d'espérer qu'en 1977 un premier bateau important serait à quai à Brégaillon. Hélas la crise s'aggrava dangereusement. Le nombre de demandeurs d'emplois atteignait déjà en 1974. 1 500 000 à l'échelle nationale et l'A.N.P.E. de La Seyne en comptait déjà 4 000 dans la même période.
Dans le domaine de la Construction navale, la production française chuta entre 1974 et 1978 de 1.040 000 tonneaux de jauge brute à 700 000.
Dans un appel diffusé par tracts et articles de presse, les syndicats dénonçaient les objectifs du livre blanc européen qui visait à « ne conserver qu'un seul grand chantier de construction navale dans chaque pays ».
Les cartes que l'on trouvait dans ce document ne comportaient même pas un chantier naval sur la façade méditerranéenne. On envisageait froidement la disparition des industries navales pour faire du Var la vitrine du tourisme international !
Malgré une conjoncture difficile, les commandes enregistrées en 1974 furent honorées jusqu'en 1981 mais à partir de 1976, il n'y eut pas de commandes nouvelles. Par contre, les techniciens des chantiers surent perfectionner les procédés de destruction et de transformation des ordures ménagères par les usines d'incinération (procédé Martin).
En 1975, pour faire face à la gravité de la situation, les dirigeants de la construction navale en collaboration avec les gouvernements crurent trouver une solution avec la fusion des chantiers. D'un côté, les Chantiers de l'Atlantique et de l'autre Dunkerque, La Ciotat, La Seyne.
M. Berre, interrogé sur le problème des fusions, s'exprimait ainsi : « Depuis la loi du 24 mai 1951, la construction navale recevait une aide de l'État, sous forme de subventions ».
« En 1975, cette aide représente 0,5 % du prix d'un navire alors qu'il y a 20 ans, elle représentait 40 % ».
« Je suis opposé à la solution proposée par les hautes instances. Le Président Directeur-général Herlicq également. Pourquoi ? Les C.N.I.M. de La Seyne ont ressuscité en 1966 et nos chantiers sont en pleine expansion aujourd'hui. Nos effectifs sont passés de 2 600 à 5 800. Le chiffre d'affaires de 150 millions d'A.F. est devenu un milliard ».
« Le carnet de commandes est supérieur aujourd'hui à 450 milliards d'A.F. Le dernier bateau en commande sera livré en 1981. Nous sommes très compétitifs dans la construction des méthaniers et des porte-containers ».
« Notre outil de travail est en parfaite condition pour lutter avec les chantiers les mieux outillés ».
« ... La fusion, si elle devait se faire, arrêterait dans son élan une société en pleine expansion, la seule grande entreprise du Var génératrice d'emplois ».
« ... Si la fusion se faisait, on pourrait craindre des licenciements de l'ordre de 2 000 environ et des troubles sociaux seraient possibles ; alors que l'État s'efforce de renflouer des industries défaillantes, il paraît aberrant que l'on « casse les reins » à une industrie en pleine expansion qui ne licencie pas mais au contraire embauche et réalise des bénéfices ».
Ainsi s'exprimait M. Berre sur les projets de fusion dans la Construction navale.
De son côté, la Municipalité très inquiète de la situation des chantiers lançait des appels à la vigilance.
Rares étaient les séances du conseil où il ne fût pas question des problèmes de l'emploi, où l'on ne dénonçât les promesses du pouvoir sur la relance et la croissance économique qui se traduisaient par un constat d'échec évident. Les délibérations dont le sens rejoignait celui des motions syndicales, souhaitaient une autre politique pour la construction navale qui ne devrait plus être soumise aux puissances d'argent internationales. Elles voulaient une véritable politique d'indépendance nationale et la rénovation de la flotte française.
Voici la teneur de l'appel lancé à la vigilance en juillet 1975 : « La municipalité, informée de la grave menace qui pèse sur les CNIM. après les déclarations du Directeur, Marcel Berre, constate tout d'abord que, contrairement aux récentes déclarations lénifiantes du chef de l'État, la situation de l'emploi risque de s'aggraver à La Seyne, comme partout ailleurs en France.
Comme elle l'a fait en 1966 avec la marche sur Toulon et aussi sur Paris, la Municipalité alerte dès à présent la population seynoise, l'appelle à s'unir et à se préparer à des actions de grande envergure, capables d'assurer une nouvelle victoire des travailleurs.
Toute menace n'étant pas écartée, il faut que la vigilance de tous se renforce ».
Dans les quatre années qui suivirent toutes les commandes enregistrées depuis les années prospères 1974-1975 furent livrées correctement, après quoi il fallut malheureusement constater un ralentissement des activités.
Voici un aperçu global des livraisons effectuées entre 1974 et 1978 :
Réparation navale : travaux réalisés sur 24 navires (dont l'Île de la Réunion, le Mermoz, le Mistral, le Pélican).
Pour la construction navale : 3 navires pour l'Algérie et le Mexique, 1 méthanier de 129 000 t, 1 transporteur de gaz de 53 400 m3, 4 transports de containeurs, 2 bâtiments de soutien logistiques pour les marines d'Algérie et de Libye avec ponts flottants et pontons de débarquement. En cours de construction en 1978 : le Fairsky.
 |
|
|
Matériels et installations terrestres (MIT) : 17 chantiers marines ou terrestres, 28 escalators pour la S.N.C.F., 40 escalators pour la R.A.T.P., des turbines par dizaines, des tubes de lancement pour la D.C.A.N., des usines d'incinération Monaco, Usines de dessalement (évaporateurs), Bruxelles, Metz, Avignon, Nice, Arles, Valenciennes, etc., etc.
Domaine de l'offshore : bouées, plate-formes de forage (type Epsilon).
Domaine du nucléaire : travaux pour la centrale E.D.F. d'Alsace, travaux pour les sous-marins nucléaires, pour Cadarache.
Domaine de l'informatique : pointage, gestion des heures.
Réalisation spectaculaire : en mars 1974, les C.N.I.M. entreprenaient la construction d'une grande forme de 215 mètres de longueur et de 57 mètres de largeur. Le 15 janvier 1976 on procédait à la mise en eau pour y décoller un méthanier de 130 000 m3 construit par blocs sur l'aire de fabrication. Ce procédé était un progrès considérable par rapport à la construction sur cale où il fallait se cantonner à des navires de 75 000 m3.
Il n'était pas trop ambitieux d'envisager par ces moyens nouveaux la fabrication de grands bateaux en deux éléments pouvant atteindre 250 000 m3 après jonction.
Mais hélas ! de 1976 à 1978, aucune grande commande ne fut enregistrée. La réduction des activités allait conduire la Direction à prendre les mesures suivantes :
Les conditions de travail au milieu du XXe siècle
Avant d'aborder les années sombres où se préparaient les mauvais coups contre la Construction navale, revenons quelques instants dans ces années prospères où l'ampleur et la qualité de ses travaux avaient redonné à l'industrie seynoise tout son éclat d'autrefois, où les problèmes humains connurent eux aussi des améliorations très sensibles.
Il était bien normal que les personnels des chantiers dont la compétence remarquable, le courage admirable dans les périodes dramatiques avaient permis à l'entreprise des affaires fructueuses, puissent bénéficier à leur tour de quelques avantages sous des formes diverses.
Avant de montrer avec précision l'amélioration considérable des nouvelles conditions de travail par rapport au passé lointain, il est juste, toutefois de remarquer des discriminations à caractère raciste même dans cette période de progrès.
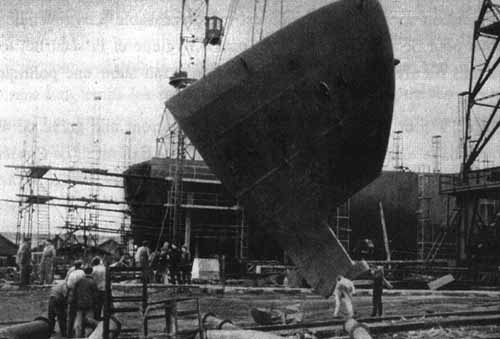 |
Dans nos précédents écrits, nous avons parlé longuement des problèmes de l'immigration avec ces nombreux Italiens venus en 1840 pour construire la voie ferrée entre Marseille et Avignon, en 1886 pour aménager la corniche de Tamaris, en 1876-1896, puis 1926 pour aider la Construction navale aux F.C.M. Nous avions rappelé aussi la venue de 350 chinois entassés dans des baraquements bordant la place de la Lune traités durement, emprisonnés parfois à la moindre incartade.
Nous voici dans les années 1974-1976, donc beaucoup plus tard, à une période où affluent dans la sous-traitance (S.A.M.I.C. en particulier) de nouveaux travailleurs immigrés (Algériens, Marocains, Sénégalais) affectés aux travaux les plus pénibles et les plus dangereux comme l'avaient été les Italiens du siècle dernier.
|
|
|
|
Fara, parmi d'autres, apporta son témoignage dans la lutte pour des conditions de vie plus humaines.
« Quand on sort des ballasts, on est méconnaissable. Les revendications pour de meilleurs salaires, pour l'hygiène et la sécurité, les patrons n'en veulent pas discuter. On nous fait subir une politique raciste ».
Entre 1975 et 1976, ces travailleurs effectuèrent une grève de 40 jours. Ils se tournèrent vers la municipalité et Ali disait : « Le Conseil Municipal et M. Philippe Giovannini (Maire de La Seyne) nous ont fait avoir le casse-croûte pour le midi et le soir ! ». Et son copain triomphant d'ajouter : « On nous a même donné du bois pour le brasero ! ».
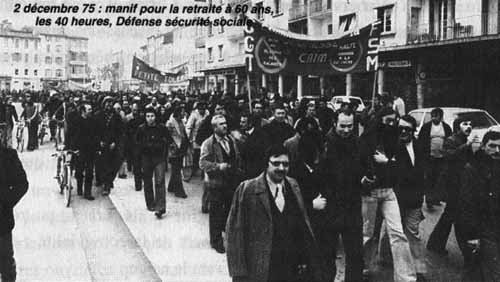 |
|
|
Ces faits sont relativement récents et signifient tout simplement que les problèmes du racisme sont loin d'être résolus.
Nous avons apporté jusqu'ici quelques témoignages sur la dureté des conditions de travail du siècle dernier et au début du XXe siècle. Nos anciens, dans leur grande majorité, passèrent leur vie dans les Chantiers navals ou à l'Arsenal de Toulon. Ils nous ont souvent conté leurs peines : durée de la journée de travail excessive, cadences infernales d'où les efforts physiques épuisants, alimentation insuffisante et de qualité inférieure, conditions d'hygiène et de sécurité défectueuses, risques fréquents d'accidents, déplacements à pieds, les instruments de locomotion ayant été rares et chers pendant longtemps. À ce propos, voici un témoignage personnellement vécu.
Au début de notre siècle, quelques ouvriers privilégiés disposaient de bicyclettes, utiles certes, mais avec un double inconvénient. La roue motrice ne pouvait tourner en roue libre et les pneus étaient pleins. La roue libre et les chambres à air apportèrent, on le comprend, un confort et une sécurité appréciables.
La moto apparut seulement dans les années 1930 et l'auto ne fut accessible au petit peuple des usines et des campagnes que quelques années seulement après la guerre de 1939-45.
De grands progrès techniques, il est vrai, vinrent adoucir les tâches ingrates de nos travailleurs, mais il y eut des générations de riveurs qui ne connurent pas la soudure électrique ; des titaniers qui escaladèrent longtemps les marches de fer avant de connaître les ascenseurs. Les tourneurs, les scieurs et tous les autres corps de métier souffrirent beaucoup avant de disposer des machines-outils actionnées à l'électricité.
Autrement dit les travaux pénibles usèrent les hommes et leur interdirent le plus souvent les agréments d'une longue et paisible retraite. Il est inutile de rappeler à travers cet historique qu'au début du siècle la journée de travail était de 12 heures, auxquelles les travailleurs en rajoutaient souvent deux ou trois pour arrondir leur fin de quinzaine. La législation exigeait 10 heures pour les enfants de 13 à 16 ans et 11 heures pour les jeunes gens de 16 à 18 ans et les femmes.
En 1906, une grève générale fut déclenchée pour obtenir la journée de 8 heures. Les travailleurs ne l'obtiendront qu'en 1919.
Rappelons succinctement que ce fut en 1936 que les plus grandes conquêtes sociales furent acquises de haute lutte, relatives à la durée du travail, aux congés, aux salaires.
Les travailleurs de nos chantiers navals furent tout de même obligés de passer à l'action pour exiger l'application des lois votées par le Parlement de l'époque. Trente ans s'étaient écoulés depuis ces victoires ouvrières qui furent de courte durée. Les désastres de la guerre, les privations, les conditions de vie et de travail nouvelles allaient obligatoirement vers des mutations sensibles et comme on va le constater ce fut dans la décennie 1966-1976 que le sort des classes laborieuses fut amélioré considérablement. Il avait fallu franchir quelques étapes au lendemain de la deuxième guerre mondiale pour abroger d'abord les lois du gouvernement de Vichy dont les dispositions étaient contraires à la semaine de 40 heures. Les congés payés furent portés à trois semaines en 1956. La quatrième semaine sera accordée en 1963. Puis ce fut la perspective des 39 heures.
Pour ce qui concerne particulièrement les Chantiers de La Seyne avec ses C.N.I.M. sous la direction de M. Berre, ce fut l'éclatement des acquis sociaux : augmentation des salaires et leur indexation sur l'échelle mobile, la diminution du temps de travail et l'aménagement d'un horaire continu, la grille des salaires hiérarchisée...
Bien évidemment, les conditions de travail de cette période prospère des années 1974 n'avaient plus rien de comparable avec les années d'avant la guerre de 1939 et encore moins avec celles du siècle dernier qualifiées parfois d'inhumaines.
En ce milieu du XXe siècle, l'ambiance dans les ateliers, les rapports entre chefs et ouvriers s'étaient améliorés. Certes, il y eut toujours des conflits latents ; mais il semble bien que les discussions ouvertes à tous les échelons aboutirent souvent à des solutions bénéfiques pour tous.
En marge des questions strictement professionnelles, les dirigeants de l'entreprise, les syndicats s'efforcèrent et réussirent à créer des structures de loisirs, à caractère culturel, artistique, sportif, qui ne pouvaient qu'améliorer les rapports entre individus.
Nos grands-pères n'auraient jamais imaginé qu'ils auraient pu trouver au sein de l'entreprise des animateurs de la convivialité ; des organisateurs d'excursions, de sorties vers la neige.
Ils avaient conquis de haute lutte le droit au savoir et, comme tous les citoyens, ne pouvaient-ils pas prétendre à des congés, à des voyages, à posséder des véhicules individuels pour gagner du temps et éviter bien des fatigues ?
Eux qui usèrent et raccommodèrent tant de chaussures pour se rendre à leur travail, eux qui se hâtaient sans cesse pour ne pas manquer la porte par crainte d'une sanction pécuniaire, eux qui subirent pendant toute une vie l'obsession de l'implacable sifflet, n'auraient pu croire à l'invention de véhicules à deux roues, puis à quatre roues, avec des moteurs qui allègeraient bien leurs peines. Ce qui nous amène à ironiser quelque peu sur les problèmes de stationnement dans cette période de prospérité des années 1975 où affluaient vers la même porte quelque 5 000 ouvriers des CNIM et 2 000 travailleurs venus des entreprises extérieures. Le nombre des véhicules à garer avoisinait les 2 000.
Rappelons-nous l'encombrement des rues de toute la ville et encore faut-il préciser que de nombreux ouvriers s'associaient pour n'utiliser qu'un seul véhicule en partageant les frais.
Des parkings furent aménagés à la Lune, aux Mouissèques, qui furent rapidement saturés. On envisageait un parking aérien au-dessus de la place Benoît Frachon. Ces problèmes auraient sans nul doute trouvé une solution. Hélas ! avec les vagues de licenciements, on n'entendit plus d'algarades pour trouver une place au parking... et aussi pour en sortir !
N'oublions pas avant de terminer cette rétrospective sur les conditions de travail des dernières décennies de faire l'éloge de ce magnifique restaurant avec libre-service qui fonctionna pendant plusieurs années à proximité de la clinique. Le confort, les tarifs, la qualité des menus, l'ordre et la propreté étaient reconnus de tous.
Les convives ne pouvaient concevoir que les aînés du siècle précédent avaient été obligés de protester pour obtenir dans un premier temps un hangar à peine couvert et fermé où ils pouvaient manger leur pain accompagné de quelques rogatons, mais pas toujours d'un verre de vin noir. Quand la cantine jouxtant la porte principale fut aménagée, on leur servit une soupe chaude.
Quel progrès sensible ! Les années passèrent et la soupe fut accompagnée d'un plat et le repas devint complet à prix modique.
Et maintenant c'était le grand restaurant qui au début pouvait servir 1 200 repas en libre service et satisfaire 2 500 personnes en plusieurs services dans les périodes où les chantiers accueillaient près de 7 000 travailleurs.
Autre aspect dans les changements intervenus : les problèmes de sécurité dans le travail qui se posèrent avec acuité de tout temps et auxquels des solutions efficaces ne furent apportées qu'avec lenteur.
Des centaines de travailleurs trouvèrent la mort dans les chantiers et des milliers d'autres y furent accidentés et gravement handicapés par la suite. Des statistiques fragmentaires indiquent 17 décès entre 1880 et 1892, 24 décès entre 1969 et 1979. Les causes, fort diverses, (chute d'un échafaudage, choc d'un engin mécanique, brûlure...).
Les rapports d'accidents indiquaient toujours dans les motifs imprudence, inattention, violence du vent... Pendant longtemps, il ne fut pas question d'une responsabilité de l'employeur. À qui fallait-il donc imputer la cause du malheur ?
Aux dirigeants, aux chefs des travaux ? Aux exécutants ? N'entrons pas ici dans le détail des procédures, mais il est certain que les responsabilités d'un Patronat qui lésinait sur le financement d'installations ou d'engins de protection contre des dangers éventuels ou permanents étaient engagées, mais d'autre part il arriva aussi que les exécutants pèchent par imprudence en n'acceptant qu'avec mépris les conseils qu'on leur donnait.
Les années passant avec la croissance des activités de l'entreprise, la complexité des constructions, l'extrême diversité des engins de travail et des moyens énergétiques, les causes d'accidents se multiplièrent, pas seulement à La Seyne, bien sûr. Les problèmes de mutualité, d'assurances bien simplifiés à la naissance des industries allaient prendre de plus grandes dimensions et le législateur dut s'en mêler sérieusement.
Des mesures contraignantes furent prises contre les chefs de l'entreprise tenus de respecter les normes de sécurité : ceintures de protection, balustrades...
Les ouvriers eux aussi devraient appliquer des consignes comme le port du casque, d'un masque, de lunettes, suivant la nature de leur tâche.
Des organismes spécialisés dans les problèmes de sécurité furent créés et chargés des préventions d'accidents. Tout cela fut bien nécessaire et contribua à limiter les malheurs mais hélas ! la part de l'imprévu et celle du hasard demeurent grandes et comme Jean de La Fontaine l'a écrit dans l'une de ses fables : « On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter ».
La dégradation progressive - La crise commence (1976-1980)
Nous avons constaté depuis le début de cet historique qu'à travers les décennies, il y eut des alternances de périodes fastes et de récessions économiques. Rien n'a été simple pour les dirigeants des industries navales.
Il leur fallut compter avec les crises générées par les guerres mondiales. Si les guerres coloniales furent souvent bénéfiques à l'industrie et au commerce, il n'en fut pas de même avec la guerre sous-marine de 1914 à 1918 qui envoya par le fond 972 000 tonnes de navires avec des dizaines de milliers de militaires (marins et soldats) et de passagers civils.
La concurrence internationale, les problèmes sociaux, ceux de l'indépendance des peuples, les conflits économiques aux multiples facettes, les problèmes idéologiques liés à ceux de la grande finance, tout cela explique les difficultés parfois énormes à vaincre, pour trouver des solutions aux questions qui nous ont préoccupé dans ce modeste ouvrage.
Nous entrons ici dans la dernière phase de la dégradation de l'économie seynoise et varoise qui se poursuivra jusqu'à la catastrophe, avec la disparition définitive de notre belle industrie seynoise créatrice d'immenses richesses pendant un siècle et demi.
Incertitudes - inquiétudes - promesses - mensonges (1980-1986)
Vers la fin de l'année 1978 arrivent dans les Conseils d'Administration de la Navale de douloureuses informations. Un plan élaboré par le Vicomte Davignon à Bruxelles, dans le cadre de la C.E.E., envisage le licenciement de 1 500 personnes dans les chantiers seynois pour 1979.
Dans l'espace d'une année, 500 ouvriers, techniciens et cadres ont été mis à la retraite. Beaucoup d'autres partis volontairement n'ont pas été remplacés, à la suite de quoi l'effectif fut ramené à 3 600 emplois.
Les autres chantiers de construction navale subissaient le même sort. On ne pouvait plus se bercer d'illusions après les déclarations du vicomte, commissaire de la C.E.E., à la commission économique de l'Assemblée européenne : « Il faut s'attendre à la suppression effective de 50 000 emplois ».
Cependant, pour limiter les dégâts un deuxième plan Davignon fut mis en discussion à l'Assemblée européenne et l'on parla du programme « Scrap and build » c'est-à-dire « Démolition, construction », un plan qui porterait sur les trois années à venir et dont le principe consistait à subventionner la démolition de deux navires pour la reconstruction d'un navire dans la perspective de donner à la Navale de nouvelles structures et de lancer un programme de constructions au niveau communautaire. Les Seynois... et les autres ne connurent pas les bienfaits de telles propositions !
Les autorités françaises de la Construction navale qui prétendaient il y a quelques années faire face aux difficultés par les activités de diversification, commençaient à déchanter.
Il leur fallait bien reconnaître les chiffres : entre 1974 et 1978 la production française était tombée de 1 040 000 tonneaux de jauge brute à 700 000.
Une propagande insidieuse laissait entendre que La Seyne était bien placée pour résister à la crise après l'inauguration du port de Brégaillon, le 15 octobre 1979, et dont on pouvait espérer qu'il apporterait dans le tissu économique local, des activités complémentaires.
Un port qui prendrait un caractère international par ses possibilités de relations commerciales avec tous les pays méditerranéens, l'Algérie en particulier. Un port avec prolifération d'activités complémentaires sans doute créatrices d'emplois. On pourrait donc espérer à la faveur d'un complexe économique Toulon-La Seyne que seraient aussi améliorées les relations du continent avec la Corse. Observons au passage l'attitude des élus toulonnais et du Maire particulièrement qui rêvaient dans cette période d'une grande communauté de l'aire toulonnaise et qui avaient baptisé d'entrée le nouveau port : Toulon - Brégaillon !
Il fallut quelques mois plus tard une délibération du Conseil municipal de La Seyne pour rendre officielle l'appellation du nouveau port La Seyne - Brégaillon, ce qui n'était que justice puisque géographiquement il était implanté en territoire seynois. En parlant de la construction navale seynoise, le Maire toulonnais ne disait-il pas : « Mes chantiers » ! Observons également que le jour de l'inauguration du port de La Seyne - Brégaillon l'absence du Ministre des Transports fut très remarquée et, autre constatation désagréable, ce fut l'absence du Directeur général de la Marine marchande qui avait la charge de représenter le Ministre. Sans commentaires !
Et nous voici dans les années 1980 où les effectifs vont sans cesse s'amenuisant, où les travaux du secteur terrestre prédominent : chaudières, turbines, incinération, armement terrestre, armement marine, adaptation de missiles, escalators, ponts flottants, etc.
En fait de commandes, notons tout de même un paquebot de croisière pour le compte de Monrovia Liberia, trois frégates pour l'Arabie Saoudite.
Signalons aussi une réalisation attendue depuis plusieurs années : l'usine d'incinération des ordures ménagères de l'agglomération Toulon - La Seyne.
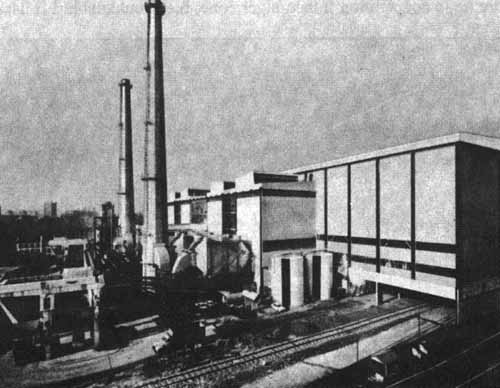 |
|
|
Un incident douloureux qui causa une vive émotion à La Seyne et dans les environs : la mort accidentelle de Marcel Berre à l'âge de 64 ans. Sa disparition fut d'autant plus regrettée qu'il avait su donner une impulsion nouvelle à l'Entreprise et nous avons dit que, sous sa Direction, les Chantiers navals avaient connu des années prospères. Le successeur de M. Berre fut le gendre de M. Herlicq. Il s'agissait de M. Mitrieff Vsevolod, ingénieur des mines qui sera aussi Directeur général de la C.I.E.L.
Cette nouvelle Direction ne donna pas l'impression de lutter efficacement contre le processus de dégradation des chantiers. Au mois de juin de cette année 1980, le Président de la Compagnie navale algérienne indiquait que son pays était prêt à commander 14 méthaniers et 14 transporteurs de gaz pétrole. Quelle chance d'avoir 28 bateaux à construire dans cette période et aussi quelle belle opération dans le cadre de la coopération franco-algérienne, bien souhaitable ! Hélas ! Cette possibilité ne fut pas concrétisée...
 |
La protestation des travailleurs contre la suppression des emplois se renforça. Une grande manifestation eut lieu le 10 avril où les dirigeants syndicalistes dénoncèrent les 1 600 emplois supprimés aux C.N.I.M. en deux ans ; ils s'élevaient contre cette propagande qui voulait justifier la réduction des effectifs en écartant les « bras cassés » : « ceux du personnel qui acceptent la prime de 40 000 F pour partir ne sont pas toujours des « bras cassés » disaient-ils, il y a souvent parmi eux des ouvriers hautement qualifiés et pour tous ces gens-là on a tout de même trouvé un milliard 200 millions pour les licencier ».
Ils ajoutaient à l'adresse du Patronat : « Votre système de départs en pré-retraite pour cause économique c'est une politique de licenciements déguisés encouragés par des primes ». Dans les autres chantiers, on pratiquait de même. Comme il n'était pas question de remplacer les départs bien évidemment les effectifs allaient s'amenuisant partout.
Alors le gouvernement parla un autre langage. En octobre 1982, le Ministre de la Mer parla d'un plan de consolidation par le regroupement de trois chantiers : Dunkerque, La Seyne et La Ciotat.
Ce groupe naval devait s'inscrire dans un plan de relance de la marine marchande française et l'on envisagea la création de 1 500 emplois.
Mais la réalité fut tout autre. À La Seyne, le groupe Herlicq lança l'idée de la séparation du secteur industriel du secteur naval, ce que l'immense majorité du personnel condamna avec force par un vote à bulletins secrets.
Sous cette appellation, les structures du groupe Normed comprenant les C.N.C. (Chantiers Navals de La Ciotat), les C.N.I.M. (Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée), la Société Industrielle et Financière des Chantiers de France (Dunkerque) prirent leurs activités à partir du 1er janvier 1982 ; les Constructions Industrielles et Installations Électriques du Littoral (C.I.E.L.) y furent intégrées.
M. Vselovod Mitrief ayant assuré l'intérim de la Direction après le départ de M. Herlicq à la retraite, prit tout de même sa place au Conseil d'Administration de la Normed dont la présidence fut confiée à M. Jacques Dollois.
Pour ce qui concerne les activités, disons que les commandes furent assez nombreuses sur l'ensemble des trois chantiers.
En 1982, il fallut armer le paquebot Fairsky. Il fallait achever sur cales deux frégates pour la C.O.M.E.X. et une troisième pour l'Arabie Saoudite et aussi un navire support de plongée Seacom. Pour ne dire que l'essentiel, on réalisa dans une période de dix années des navires superbes comme le Fred Scamaroni, l'Avenir, l'Atlantic, paquebot croisière de luxe de 1 200 passagers, le Sagafjord, auquel nous avons consacré une mention spéciale. Il faudrait aussi parler longuement des transporteurs de gaz pour l'Algérie, la Malaisie ; des transporteurs des navires routiers ou frigorifiques...
Et puis nos chantiers seynois se distinguèrent particulièrement par le label Made in C.N.I.M. qu'on pouvait retrouver sur les chaudières, les centrales thermiques, les usines d'incinération, les turbines, les tapis et escaliers roulants, dont le nombre avait atteint 500 en quelque 10 ans.
Par ailleurs, le secteur de l'offshore, démarré en 1978, prit des proportions considérables avec la construction des barges et des plate-formes de forage pour l'installation des forages pétroliers (type Jack-up).
|
|
|
|
Les activités de diversification s'étaient tellement étendues durant ces dernières années que la superficie des C.N.I.M. couvrait maintenant 60 hectares.
En effectuant des retours sur le passé, le lecteur aura constaté que les protagonistes de l'Europe future s'appliquaient depuis 40 ans au moins à faire disparaître la construction navale. S'ils étaient parvenus jusque-là à l'affaiblir seulement c'est que la résistance à leurs sinistres projets avait été puissamment animée par les travailleurs et leurs syndicats, les municipalités et organisations démocratiques, les élus partisans d'une indépendance nationale.
Ceux-là n'avaient-ils pas réussi en 1966, dans l'élan impétueux d'une union sans faille, à faire reculer les forces du mal, à sauver leur outil de travail et la vie économique de toute une région ?
À la pointe de leur combat, se trouvait toujours le Comité d'Entreprise, organisme qui n'a pas été évoqué jusqu'ici et qui mérite quelques développements élogieux. Après quoi il nous faudra revenir hélas ! sur les dernières années dramatiques de 1982 à 1988.
 |
C'est un organisme qui a tenu une place importante dans la vie des travailleurs seynois en activité dans les Chantiers navals. Il était élu démocratiquement à bulletins secrets. Tous les syndicats y étaient représentés en proportion de leurs influences respectives.
Il avait un droit de regard sur la marche de l'entreprise mais le pouvoir de décision appartenait au Patronat.
Il défendait les droits des travailleurs dans tous les domaines possibles : salaires, temps de travail, sécurité, etc.
Au niveau social, plusieurs commissions y animaient des réalisations à caractères très divers : les sports, les loisirs, la culture, l'apprentissage, la formation professionnelle, la situation des retraités...
Le budget du comité d'entreprise représentant 1 % de la masse salariale, permit pendant plusieurs années des activités fort bénéfiques.
Celui de l'année 1981 consacra près de 50 millions de centimes aux activités sportives. Les oeuvres pour l'enfance (colonies de vacances par exemple) reçurent près de 40 millions de centimes, celles pour les anciens 15 millions de centimes, la Bibliothèque et les loisirs culturels, environ 10 millions et l'apprentissage, 6 millions.
Soulignons particulièrement dans le domaine du sport le complexe remarquable au quartier de l'Évescat, nommé Jean Guimier (nom d'un pionnier de l'éducation physique et du sport) dont l'inauguration eut lieu le 18 juillet 1981.
Ce fut sans doute la réalisation la plus spectaculaire du Comité d'Entreprise des C.N.I.M. avec, ne l'oublions pas, l'aide de la municipalité de l'époque qui avait offert le terrain.
Grâce à ce complexe naquit le club omnisports composé de quatre sections et quatre vingt-sept adhérents au début pour devenir rapidement 21 sections et 1 500 adhérents, ce qui signifie que les besoins du sport pour les travailleurs des chantiers furent pleinement satisfaits.
Le complexe ouvrier sportif des C.N.I.M. qu'on appela plus simplement le C.O.S. a rendu également des services considérables aux enfants des écoles primaires Léo Lagrange, sises à proximité, et à ceux du collège L'Herminier du quartier de l'Évescat.
Sans vouloir entrer dans le domaine des luttes syndicales qui mériteraient un véritable historique, disons tout de même que ce fut la C.G.T. qui joua un rôle prépondérant, au sein du Comité surtout depuis 1966.
En 1982, elle obtint près de 80 % des suffrages aux élections professionnelles dans le collège ouvrier.
Dans le deuxième collège (techniciens, cadres, dessinateurs, agents de maîtrise) elle obtint autant de sièges que les trois autres syndicats réunis, soit 54,90 % des voix exprimées.
Des inquiétudes bien justifiées
Nous entrons maintenant dans une phase décisive des problèmes de la Navale. La Fédération des syndicats maritimes apportait les précisions suivantes à ce propos :
« Les transports maritimes ont un rôle considérable à jouer dans la défense de l'indépendance nationale tant du point de vue économique que stratégique. 60 % de notre commerce extérieur se fait par la voie maritime et il faut malheureusement constater que seulement 22 % des importations et 16,5 % des exportations sont acheminées sous pavillon national ».
La France avait besoin de 70 navires de moyen et de petit tonnage. Hélas ! ces dernières années, elle était passée au neuvième rang après les armements grecs et les pavillons de complaisance. Le gouvernement avait peu de prise sur les armateurs français qui commandaient à l'étranger tout en bénéficiant des aides françaises. Le Ministre de la Mer Louis Le Pensec parla de la restructuration en deux groupes : l'un sur l'Atlantique, l'autre sur la Méditerranée chargés de mieux répartir les commandes, d'améliorer la productivité, de favoriser la diversification.
Les promesses faites par les gouvernements de l'époque ne furent pas tenues pour empêcher la régression de notre flotte de commerce. C'est pourquoi le comité de soutien des chantiers navals lança une journée « Ville en lutte » pour le 7 décembre 1983. Des milliers de manifestants défilèrent dans les rues de la ville. Les orateurs dénoncèrent une fois de plus tous les aspects négatifs de la construction navale seynoise ; ils montraient chiffres à l'appui comment la France était devenue tributaire à 78 % de l'étranger, ils expliquaient les besoins urgents de notre pays pour ses approvisionnements propres (20 navires transporteurs de vrac, 40 pour les produits pétroliers, quatre pour les produits chimiques sans parler des passagers).
Et par surcroît le gouvernement de l'époque ne prévoyait-il pas la construction en cinq ans de 500 navires de pêche artisanale et 80 navires de pêche industrielle.
Malgré tous les arguments des défenseurs de la Navale, malgré leurs propositions concrètes, on assistait progressivement au démantèlement d'une industrie pourtant si nécessaire.
Les enquêtes sur les chantiers navals donnaient des chiffres significatifs. Entre 1966 et 1976, la Construction navale française passa de 34 000 emplois à 19 000. Il ne faisait plus de doute pour personne que cette régression était organisée.
La Caisse des armateurs recevait bien des injections de capitaux publics, mais ces derniers n'en continuaient pas moins à passer des commandes à des pays étrangers.
M. Guy Langagne, Secrétaire d'État à la mer dans cette période, envisageait de réduire encore la capacité de production en s'orientant vers un « dégraissage » progressif de chacun des sites encore existants, et l'on parla des pré-retraites à 55 ans.
En novembre 1983, il fut procédé dans le secteur C.N.M. (Chantiers Nord et de la Méditerranée) à une nouvelle organisation, le groupe Herlicq s'occupant de sites de Brégaillon - Les Mouissèques - Lagoubran avec 950 travailleurs, la partie navale comptant encore 3 600 personnes. Les activités n'allèrent pas mieux pour autant.
En décembre 1983, ce furent les ingénieurs et cadres qui s'engagèrent dans la lutte pour la défense de l'emploi. Ils s'adressèrent au Premier ministre en ces termes : « Nous refusons de voir détruire ce potentiel et ce tissu industriel qui environne notre entreprise ».
Ils demandèrent au gouvernement : « De tout faire pour que des mesures ponctuelles qui pourraient être prises ne se transforment pas en épreuves de force politiques ».
Le dépôt de bilan fut écarté, momentanément du moins, une aide du gouvernement, une subvention de 720 millions de francs, ayant été accordée à la Navale.
C'était une mesure réconfortante, mais cette nouvelle heureuse fut bien contrariée par les commandes de trois paquebots de 225 mètres passées en Suède et au Danemark.
Le regroupement des sites entraîna des changements dans les responsabilités de Direction. M. Michel Perreau devint Directeur de La Ciotat et M. Jean Favrelle, Directeur de La Seyne. Mais en attendant les commandes, les réductions d'horaires continuèrent.
L'année 1984 se présenta sous le signe d'une inquiétude bien justifiée. Les chantiers nationaux français ne recevraient, disait-on, aucune commande avant la fin de l'année.
Les dernières, entre septembre 1982 et septembre 1983, avaient été ainsi réparties : sur treize bâtiments neufs, quatre avaient été construits en France et neuf à l'étranger !
Les manifestations de mécontentement reprirent avec beaucoup de détermination.
Plus de dix mille personnes défilèrent dans les rues de La Seyne. Le curé fit même sonner le tocsin à l'Église Notre-Dame !
Pour calmer les inquiétudes, les dirigeants de la Navale enregistrèrent des promesses de plusieurs commandes (pétroliers, paquebots...). Les syndicats organisèrent encore une marche sur Toulon après quoi on leur promit du travail jusqu'à la fin 1986.
Le gouvernement et la Direction de la Normed envisageaient encore des suppressions d'emplois, on s'orientait vers ce qu'on a appelé le plan Dollois qui estimait à 1 200 le nombre de personnes excédentaires et prévoyait avec les départs de volontaires que les chantiers seynois ne compteraient plus que 1 000 à 1 500 personnes à la fin de 1986 - autrement dit, les moyens les plus divers furent envisagés pour que la disparition de l'entreprise se fasse en douceur.
Par exemple : les membres du personnel ayant atteint 53 ans, pourraient partir en pré-retraite ; on parlait de caser les travailleurs dans les zones industrielles comme celle de Six-Fours.
Enfin, à partir du 5 janvier 1985, les lettres pour les congés de conversion parviennent aux employés de la Navale : 480 pour commencer. D'autres reçoivent un badge (laissez passer) pour accéder à l'entreprise ; un organisme dit cellule de conversion met tout en oeuvre en relation avec les services publics de l'emploi pour faciliter leur réinsertion dans l'économie locale. La C.G.T. s'oppose à cette mesure, fait occuper le chantier, mais restera impuissante devant les décisions d'en haut : 730 nouvelles suppressions d'emplois.
Le Ministre du Redéploiement Industriel, Madame Edith Cresson, oublie, ou a peut-être ignoré, les engagements de ses prédécesseurs Le Pensec et Langagne : elle ne garantit plus le maintien du site à La Seyne.
Dans le même temps, on apprend qu'à la C.I.E.L. un plan de redressement prévoit 380 licenciements. La survie de cette entreprise, étroitement liée à celle des chantiers, n'est plus qu'une question de jours.
Et cependant, les travailleurs, toutes catégories confondues, en ce début de l'année 1985 vont poursuivre la lutte âprement. Les chantiers sont occupés momentanément, mais on ressent qu'une lassitude certaine gagne du terrain. Comment poursuivre l'action ? Les syndicats en viennent à une consultation du personnel à bulletins secrets pour savoir si l'occupation des chantiers doit être reconduite, ou alors s'il faut rechercher d'autres formes d'action.
Un vote est organisé, qui donne les résultats suivants : sur 2 474 votants, 747 voix se prononcent pour l'occupation de l'entreprise, mais 1 720 voix (69 %) préfèrent d'autres formes d'action.
L'immense majorité souhaite que le combat se poursuive. Et, comme nous allons le montrer, les derniers défenseurs de la Navale firent preuve de la plus grande détermination durant les deux dernières années avant la catastrophe de la fermeture.
Dernières années funestes (1986-1988)
Durant toute l'année 1985, les départs en pré-retraite s'étaient multipliés par centaines, ainsi que les départs en congés de conversion, auxquels s'ajoutaient près d'une centaine de volontaires. Au total, on put estimer à 1 600 le nombre des emplois disparus vers la fin de l'année.
Le monde ouvrier se sentait accablé, lui qui luttait depuis plusieurs décennies pour sauver son outil de travail, la vie de sa famille, la vie économique locale.
Que de promesses non tenues ! Quel riche vocabulaire trompeur avec de savantes solutions proposées ! Les restructurations, pool de reconversion, la séparation puis le regroupement des sites navals, pour aboutir finalement à la liquidation en douceur de l'industrie navale... sans parler des autres, dont il n'a pas été question dans cet ouvrage.
L'agence centrale de presse révéla début 1986, l'existence de rapports confidentiels déposés sur le bureau du Premier ministre Laurent Fabius et qui faisaient état de la fermeture de deux des groupes de la Normed. Il s'agissait de La Seyne et La Ciotat.
Les Ministres consultés, ceux de l'Économie et des Finances, celui de l'Industrie, celui de la Mer, tous évoquaient la crise mondiale, les difficultés de l'Europe en gestation ; ils affirmaient que tous les pays européens liquidaient leurs chantiers.
Il était vrai que le marché mondial était stagnant. En quelques années, les effectifs de la Normed étaient passés de 10 743 en 1984 à 4 698 fin 1986. Mais, pendant ce temps, la R.F.A., la Grande-Bretagne, l'Italie, la Yougoslavie, augmentaient leurs productions, autrement dit la crise de la construction navale n'existait pas pour tout le monde et l'Allemagne se taillait la part du lion.
Et il était bien démontré que la France avait besoin de navires, puisque notre flotte ne transitait que 28 % du fret national.
Durant l'été 1986, un nouveau personnage apparut à qui certains affairistes firent confiance ; un ancien officier mécanicien de la Marine marchande, Laurent Genoyer, qui s'était lancé dans les affaires financières en 1964, à la tête d'un groupe appelé « Société phocéenne de métallurgie ».
L'Olympique de Marseille en pleine crise l'appela à son secours en 1974. Deux ans plus tard, il devint un héros, l'O.M. ayant emporté la Coupe de France. Il tenta une carrière politique, fut conseiller municipal de Marseille sur la liste de Gaston Defferre de 1971 à 1977. Candidat aux législatives comme indépendant en 1986, il fut battu.
Alors, il s'offrit à la Navale avec des projets magnifiques dont voici l'essentiel : construction de petites unités pour la Marine nationale, diversification très poussée, création d'une division de transmission des fluides, spécialisation dans la robinetterie, etc., pour proposer en définitive mille emplois pour 1990.
Tout cela fit beaucoup de bruit pour rien car on apprit bien vite que l'administration judiciaire n'acceptait pas le plan Génoyer, ce qui permit à un humoriste de titrer un article : « Génoyer la Navale ». Encore un espoir déçu !
Et les pétitions, les délégations, les manifestations reprirent de plus belle. Le 24 juin dans « La Seyne ville morte », un défilé évalué à cinq mille personnes clame son indignation. À cette date, il ne reste plus qu'un navire dans les chantiers et deux mille salariés.
- Pour combien de temps encore !
- Le lendemain, le P.D.G. de la Normed annonce à Paris que l'entreprise est en cessation de paiement.
Naturellement, les économistes prédisaient de grands malheurs pour La Seyne et sa population : Que deviendra la ville avec 11 milliards de salaires injectés en moins dans l'économie locale ? Des centaines de chômeurs de plus pour la ville, sans parler des augmentations d'impôts qui pourraient atteindre 30 %.
Le Ministre de l'Industrie persiste dans ses affirmations : « L'avenir des Chantiers de La Seyne n'est plus assuré ». Et pour édulcorer la gravité de la fermeture, il parle des primes de départ, des exonérations d'impôts, de la création de zones d'entreprises.
Tous ces palliatifs ne pouvaient suffire à calmer les inquiétudes et la colère des travailleurs qui se manifestèrent même avec violence le jour du 14 juillet 1986. La cérémonie fut perturbée par les manifestants de la Normed qui firent irruption dans le défilé patriotique en clamant que ce jour-là c'était la fête du peuple et non celle des militaires, interruption du défilé, intervention des C.R.S. et retour au calme ; les incidents auraient pu prendre une tournure beaucoup plus dramatique.
Nouvelle lueur d'espoir ! Nouvelle manifestation annoncée pour le 30 septembre, car on vient d'apprendre que la Corse a besoin d'un car-ferry pour 1988.
Tout le monde est d'accord : conseillers généraux, conseillers municipaux, élus provençaux et corses, tous estiment que ce car-ferry est la dernière chance pour les Chantiers de La Seyne qui s'étaient déjà distingués quelques années auparavant en lançant le superbe Napoléon.
Un vent d'union sacrée souffle sur La Seyne et toute la région toulonnaise pour la construction du car-ferry dans nos chantiers.
On voit encore le 1er octobre un défilé de 10 000 personnes. Mais le 1er novembre, le gouvernement met le groupe Normed en liquidation judiciaire.
Quelques jours auparavant, 1 126 personnes avaient reçu une lettre de licenciement.
Quelques mois plus tard, on apprenait que le fameux car-ferry destiné à assurer la liaison continent-Corse avait été commandé aux Chantiers de l'Atlantique. Comme disaient certains plaisantins : « le bateau s'était trompé de port ! ».
Le Ministre de l'Industrie annonça au Sénat la fermeture de la Normed par nécessité de respecter les décisions européennes.
Mais il y avait encore au tout début de 1988, 830 personnes au chantier, des gens que l'on bernait depuis des mois avec d'hypothétiques projets de reprise.
Ne disait-on pas au Conseil Général que le gouvernement allait passer au privé des bateaux militaires.
À l'horizon 1995-2000, la France devait renouveler l'essentiel de sa Flotte militaire, c'est-à-dire au moins dix navires.
Les défenseurs de la Navale, saturés de toutes les magouilles, les tromperies, les spectacles, ne pouvaient que réagir avec violence. Comment pouvaient-ils encore croire le Ministre de la Coopération qui venait parler de l'entrée de la Défense nationale dans les Chantiers, ou des projets de l'armateur italien Léone, ou de l'importante flotte d'accompagnement générée par la mise en chantier du porte-avions Charles De Gaulle... ou encore du projet Renaval paru dans le bulletin officiel du conseil économique européen ? Comment les travailleurs des chantiers pouvaient-ils admettre que la France se plie aux exigences d'un déclin mûrement réfléchi imposé par le marché unique européen. Ils en étaient profondément ulcérés, d'autant que des statistiques sérieuses annonçaient la nécessité de 48 navires en France dans l'horizon 1992, 564 en Europe et 3 665 dans le monde !
Le 3 octobre 1987, la Direction des Chantiers procéda au lancement de la dernière coque, la Somme, un P.R.E. (lisez pétrolier-ravitailleur d'escadre) en présence de trois mille personnes - des élus, des militaires, des écoliers. À dire vrai, la joie n'y était pas malgré les éclats de la Marseillaise et de la Coupo Santo. L'inquiétude se lisait sur les visages. On se posait encore et toujours des questions sur l'avenir du chantier.
Serait-il encore possible d'assister à des spectacles aussi grandioses que ces lancements de navires que des générations de Seynois venaient applaudir depuis 150 ans ?
Enfin, un long beuglement de la sirène retentit, annonçant le départ du navire. Mais rien ne bougeait. Problèmes techniques ? Erreurs de calcul ? La grande masse métallique ne glissait pas. Certains voyaient un symbole dans cet incident : la Navale ne veut pas, ne peut pas mourir.
Après des moments terriblement angoissants pour les dirigeants responsables, il fallut se résoudre à utiliser des vérins, appareils destinés à donner des coups de poussoirs et l'on put alors percevoir un déplacement minime qui s'accrut à souhait pour permettre au P.R.E. de prendre possession de son élément et de laisser derrière lui une cale vide dont nous pressentions la triste destinée. Il était la 1 444e unité construite dans nos chantiers navals.
Le Comité d'Entreprise (devenu le Comité d'Établissement) s'était réuni quelques jours auparavant pour discuter de l'avenir du site.
Fallait-il envisager une réindustrialisation ? Les hectares libérés allaient-ils intéresser les grands professionnels de l'immobilier ou les partisans du tout tourisme ?
Toutes les supputations se donnaient libre cours. C'étaient les soubresauts de l'agonie, on offrit même un dernier ballon d'oxygène pour trois cent cinquante personnes qu'on pourrait utiliser à l'Arsenal pour l'entretien des bateaux de guerre et, pour ce faire, il fut question de l'acquisition du site Normed par le ministère de la Défense. Le dossier de ce projet, élaboré paraît-il à la fin juin, ne fut jamais déposé devant le tribunal de commerce de Paris - il avait disparu avant, mystérieusement...
Dans cette période, on apprit la mort de Jean Favrelle, Directeur de l'établissement seynois Normed. Curieux concours de circonstances néfastes qui s'abattaient à la fois contre l'entreprise et son estimé directeur.
Ingénieur de l'École Navale, M. Favrelle avait quitté la Marine nationale en 1970 alors qu'il était capitaine de corvette pour s'occuper de la construction navale française qu'il défendit âprement à La Ciotat (1971-1979), puis à Dunkerque (1979-1982), puis à La Seyne...
Dramatique coïncidence ! Selon sa volonté, il n'y eut aucun discours, ses cendres furent dispersées dans le bassin de radoub au cours d'une cérémonie poignante, dont le silence fut rompu seulement par le hurlement lugubre de la sirène.
Dans les semaines qui suivirent, les défenseurs de la Navale livrèrent encore quelques combats, ils manifestèrent à Toulon le 14 septembre, bloquèrent la circulation pour exiger la conversion du site en secteur militaire et sauver les 468 personnes qui composaient l'effectif du chantier à la fin août 1988.
La fermeture définitive est annoncée pour le 28 février 1989, et l'on sait alors que le taux de chômage atteindra 25 % dans notre pauvre cité sinistrée une nouvelle fois. On sait aussi que de la disparition de la taxe professionnelle payée à la ville s'en suivra une amputation de 15 millions de francs sur le budget communal.
Tout le monde s'accorde bien pour dire la nécessité impérieuse de trouver d'autres activités sur les dizaines d'hectares occupés par les structures disparues.
Qui va s'en occuper ? Quels sont les organismes impliqués dans ces problèmes dramatiques ?
Le Conseil général, la ville de La Seyne, la Chambre de Commerce, l'Administration maritime, la Marine nationale, la ville de Toulon, les industriels, les promoteurs mobiliers éventuels, les chercheurs et technologues de la mer, les spécialistes du tourisme, etc.
Dans ce contexte d'une complexité inouïe, de bonnes volontés se manifestèrent certes, et l'on parla du projet Marépolis.
Notre historique s'arrêtera à la date du 28 février 1989, cessation officielle de la Construction navale seynoise.
Volontairement, nous n'avons pas voulu nous livrer au jeu des polémiques qui opposent depuis des années les élus, les municipalités, les partis politiques, les citoyens, les personnalités, toutes tendances confondues.
Qu'il nous soit permis tout de même de déplorer que six années aient passé, depuis la catastrophe de la fermeture. Les magouilles politiques ne cessent d'alimenter la presse chaque jour. Un climat malsain a gagné l'opinion des citoyens seynois qui ressentent du dégoût, du mépris et naturellement de la colère en constatant avec beaucoup d'amertume la dégradation de toutes les valeurs que leur ville méritait de conserver.
Des mises au point nécessaires
Les lignes qui suivent s'adressent à des citoyens d'importation qui n'ont pas connu l'histoire glorieuse de la Navale ou simplement à de braves gens, ignorant ce qui se passe autour d'eux et incapables d'un effort de compréhension.
Elles s'adressent à ceux qui ont voulu justifier les mesures prises par les dirigeants de l'État dont les conséquences ont été catastrophiques pour la vie économique locale et même régionale, à ceux qui s'en allaient répétant que nos chantiers étaient bien incapables de faire face à la concurrence étrangère, que le développement des transports ferroviaires et aériens condamnait les constructeurs de navires à réduire leurs productions, que la flotte de guerre dépassée par les terribles engins de la modernité devait réduire son tonnage... autant d'explications et d'arguments qui pouvaient se discuter. Mais ce qui était inadmissible c'étaient les raisonnements des bavards stupides qui déclaraient :
« La construction navale d'aujourd'hui manquait plutôt de technicité ». Comme ils avaient besoin de savoir, ces pauvres diables, avant de répandre de telles inepties !
C'est pourquoi il nous a paru indispensable d'apporter des précisions nécessaires et de montrer que, dès son origine, notre construction navale seynoise avec tout son personnel : Directeurs, ingénieurs, techniciens, ouvriers, a su mettre à profit les découvertes, les inventions, le progrès des sciences et des techniques, pour devenir une industrie de pointe, longtemps inégalée dans le monde.
Certes, il y eut tout au long de la longue histoire de l'industrie navale des alternances de progrès et de récession de son activité, mais en aucune façon, dans les périodes de recul, on ne put incriminer le manque d'initiative et de technicité.
Il est indispensable de revenir quelque peu sur le début de notre historique pour rappeler les grandes étapes de l'industrie navale qui ne prit son véritable essor qu'au milieu du XIXe siècle après les grandes découvertes de Denis Papin et de Frédéric Sauvage, personnalités sur lesquelles nous revenons nécessairement.
Pendant des siècles, la construction navale en bois a prévalu et les moyens de propulsion n'ont pas varié beaucoup avec la voile et les avirons.
Nos anciens ont néanmoins recherché des perfections dans les formes et les dimensions. Les charpentiers de l'époque ont réalisé des oeuvres magnifiques et nos chantiers seynois du Moyen Age, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ont été à l'avant-garde tout en travaillant avec les outils les plus simples : scie, rabot, tarière, ciseau à bois, etc. Répétons des chiffres donnés par les archives de la Marine : entre 1785 et 1791, les Chantiers de La Seyne avaient construit 40 navires, ceux de Marseille 29 et ceux de La Ciotat 17.
Le premier de ces chantiers fut établi au début du XVIIIe siècle du côté Est du port de La Seyne, par Pierre Tortel, famille illustre dont un quartier de La Seyne porte le nom. On y construisait de modestes embarcations actionnées par les rames et la voile.
Suivirent de nombreux petits chantiers en bois en bordure du port, vers la place de la Lune à l'Est, et des Esplageols à l'Ouest. Nous avons donné leurs noms au début de l'ouvrage. On y construisait des goélettes, des brigantins, des bombardes et on les faisait si bien que l'un des meilleurs flibustiers de cette époque, Jean Gaspard de Vence, devenu un jour Amiral et Préfet de Toulon, commandera dans ces chantiers, les bateaux corsaires pour faire la chasse à l'Anglais.
Puis vers le milieu du XVIIIe siècle, l'ère industrielle démarra timidement.
Ne revenons pas sur les industriels déjà cités : Mathieu - Lombard - Taylor qui à partir de 1835 se lancèrent audacieusement dans les constructions en fer et à vapeur et ne furent donc pas les derniers à appliquer les découvertes de Denis Papin et Frédéric Sauvage, mal récompensés de leur génie. On sait que le premier reconnut la force élastique de la vapeur et qu'au tout début du XVIIIe siècle il l'utilisa pour actionner des machines à aubes sur des cours d'eau en Allemagne où la Révocation de l'Édit de Nantes l'avait exilé. Les Anglais, déjà les plus grands rivaux de la flotte française, surent exploiter et vulgariser ces engins et prirent une avance importante sur notre industrie navale tandis que Denis Papin finit sa vie dans la misère, après avoir rendu de grands services à la perfide Albion.
Sauvage, lui, apporta à la construction navale française sans doute la plus belle découverte du XIXe siècle. Il lui fallut des années de travail pour faire évoluer l'idée du pas de vis vers le tracé de l'hélice moderne. Comme Papin, il se ruina et fut emprisonné pour dettes.
Ces exemples tragiques font penser à cette belle phrase d'Honoré de Balzac : « les grands hommes sont comme les bons fruits ; ils mûrissent souvent sur la paille ».
Ajoutons pour en revenir un instant à Frédéric Sauvage que la fin de sa vie tourna au désastre quand on lui montra un jour un bateau américain actionné par une hélice, son invention ! dont il avait été contraint de vendre le premier brevet de 1832 pour payer ses dettes ; et il en perdit la raison.
Les étrangers avaient su tirer le meilleur parti des découvertes françaises, mais fort heureusement nos industriels, nos ingénieurs remontèrent la pente. La relation écrite sur la Gloire le montre de façon péremptoire.
Vers la fin du XIXe siècle et jusqu'à la guerre de 14-18, les Chantiers de La Seyne réalisèrent des prodiges de créations, d'ingéniosité, de performances qui les portèrent indiscutablement au faite de la construction navale mondiale. Le lecteur en sera certainement convaincu en relisant la biographie d'Amable Lagane, Directeur des chantiers pendant vingt ans (Tome II, pp. 108-148) sous l'impulsion duquel 215 bâtiments (Marine militaire et Marine de commerce) furent lancés.
Nous nous bornerons à citer quelques exemples retentissants : la frégate cuirassée La Gloire avait suscité la jalousie des Anglais, en 1860.
Mais deux ans plus tard, la frégate cuirassée Numancia, construite pour la marine espagnole, fit merveille en effectuant le tour du monde par tous les temps, après avoir participé à un combat naval en Argentine. Jamais aucun navire surtout alourdi par sa cuirasse, n'avait réussi un tel exploit.
Quelques années plus tard, le Vicomte Ferdinand de Lesseps fait percer le Canal de Suez grâce aux trente-deux grandes dragues construites aux Forges et Chantiers de La Seyne.
Dans les années 1880, ce fut la naissance du premier sous-marin Le Gymnote mis au point par l'ingénieur du Génie maritime Gustave Zédé en collaboration avec un autre ingénieur éminent Dupuy de Lôme, qui furent tous deux des administrateurs de la Société des F.C.M. (voir leur biographie au début de l'ouvrage).
Ce fut seulement vers la fin du XIXe siècle que la force motrice de l'électricité apparut dans la construction navale et là encore nos chantiers navals se distinguèrent. Le cuirassé Jauréguiberry fut le premier navire de guerre français dont les tourelles étaient mues à l'électricité. C'était en 1893.
En 1898, sont lancés les cuirassés Cesarevitch et Bayan commandés par la Russie, le premier fut la seule unité qui résista aux assauts de l'ennemi pendant la guerre russo-japonaise de 1904, à la fameuse bataille de Port Arthur. S'il ne fut pas coulé c'est que M. Lagane avait su le protéger par une épaisse cuirasse au niveau de la ligne de flottaison.
Le second, le Bayan, endommagé gravement, ne sombra pas non plus sous les coups de l'ennemi mais, courant le risque d'être pris, ce fut l'équipage qui l'envoya par le fond.
L'Amirauté russe avait apprécié la qualité des constructions seynoises et passa d'autres commandes en 1913 aux F.C.M.
En 1906, autre performance avec la mise sur cale du cuirassé Voltaire. Il faut savoir de celui-ci qu'il fut le premier cuirassé à turbines de la Marine française et qu'il fut également le plus rapide, avec une vitesse de 25 noeuds.
Rappelons que le lancement du cuirassé Paris le 22 septembre 1912 fut considéré comme un événement historique puisque nous lui avons consacré un texte spécial dans les pages précédentes. Mais hélas ! La guerre de 1914 éclata et cette expansion considérable de nos industries navales fut condamnée à un ralentissement brutal.
Le Parlement avait adopté le programme naval Delcassé, Ministre de la Marine, qui devait se concrétiser par un supplément de 174 000 tonnes, s'ajoutant aux 964 000 à flot. Les Chantiers de La Seyne mettent sur cale le superdreadnought Béarn de la même série que les cuirassés Bretagne, Lorraine, Provence, etc.
En raison des faits de guerre, cette unité ne sera lancée qu'en 1920 et mise en service comme porte-avions en 1927. Les F.C.M. pouvaient tout de même s'enorgueillir d'avoir réalisé les premiers, ce type de navire pour la défense nationale.
Comme cela s'était produit en 1870, nos Chantiers navals s'adaptèrent à de nouvelles activités. La construction navale fut sacrifiée au profit du matériel militaire : canons et obus de 75 mm, artillerie lourde de marine de 305 sur voie ferrée, chars d'assaut, etc.
Il faut faire ici une mention spéciale au Général Estienne, surnommé le père des chars d'assaut, lequel demanda aux ingénieurs seynois d'étudier un prototype cuirassé terrestre de 38 tonnes. Ce fut dans le plus grand secret que ces terribles engins furent mis à l'essai dans les terrains des Mouissèques et sur la route de Tamaris, la nuit. Ils donnèrent entière satisfaction mais au moment de leur arrivée sur le front, l'armistice du 11 novembre intervint. Nul doute que les cinq cents chars d'assaut commandés auraient eu vite raison des divisions allemandes chancelantes.
La Société des Forges et Chantiers pouvait tout de même dire avec quelque fierté que l'on appela les chars : chars lourds du type La Seyne.
La période de l'entre-deux guerres 1919-1939 ne fut pas des meilleures pour nos chantiers. La conjoncture économique, les difficultés financières, la lourdeur des impôts, le coût excessif des constructions modernes, autant de facteurs qui freinèrent la reprise de l'expansion d'autrefois. Mais en aucune façon, on ne pouvait incriminer la haute technicité des travaux effectués. N'avait-on pas modifié tous les moyens de propulsion avec les nouveaux combustibles tirés du pétrole ? Le mazout s'était substitué au charbon et l'on ne vit plus les mahonnes ravitailler les navires en briquettes provenant des réserves du Bois sacré. Et l'on ne vit plus les corvées de charbon imposées aux marins par un dur travail à la chaîne, si épuisant que la musique des équipages de la flotte venait alléger leur peine en jouant sur les ponts des marches endiablées !
L'administration maritime fit construire les réservoirs du Lazaret dont la contenance pouvait alimenter une flotte en quelques heures.
Chaque jour voyait naître des progrès nouveaux. Le soudage électrique remplaçait peu à peu le rivetage, ce qui eut le grand avantage de diminuer la peine des hommes et aussi des gains de temps pour la construction. S'il nous fallait énumérer toutes les innovations, les créations, les perfectionnements recherchés et apportés dans tous les ateliers et s'il fallait comparer le travail des hommes de la Navale du XIXe siècle et ceux du XXe on pourrait parler d'une véritable révolution permanente.
Dans les années qui précédèrent le deuxième conflit mondial, sous l'impulsion d'autres personnalités, les chantiers reprirent une activité considérable et se lancèrent dans la construction de petites unités de combat : torpilleurs, contre-torpilleurs, sous-marins ; des dizaines de bateaux rapides et fort élégants destinés à la liaison métropole - colonies africaines...
(Les noms et les caractéristiques de ces magnifiques unités civiles et militaires figurent dans l'ouvrage Les pionniers publié par l'association Sillages, que préside l'ingénieur Marc Ferrier.
Les chantiers produisirent peu de grandes unités dans cette période, exception faite pour le Béarn, achevé comme porte-avions avec 40 appareils et pour le remarquable croiseur Montcalm. La prolifération de navires moyens, rapides, efficaces, redonna aux Chantiers seynois une place de premier plan. Leurs ateliers toujours en phase avec les progrès de la modernité se dotèrent des engins mécaniques les plus divers et les plus performants. Hélas ! Encore une période faste brisée brutalement par la guerre, l'occupation ennemie, la destruction sur lesquelles nous ne reviendrons pas, sinon pour dire aux détracteurs dont nous parlions tantôt qu'ils fassent un petit effort de compréhension pour imaginer la volonté, le dévouement, la détermination des personnels qui se mobilisèrent pour reconstruire, repenser et moderniser les installations, les ateliers, les quais, l'outillage... les moyens de levage, les bureaux d'études, etc.
On se demande encore comment, trois ans après le désastre du 17 août 1944, il fut possible de redonner vie à l'entreprise, considérant que dans la France pillée, ruinée, on manquait de tout. Et cependant dans une telle situation le plein emploi fut assuré à près de 3 000 personnes.
Quelques années passèrent et des progrès incessants réalisés on pouvait augurer des bilans prodigieux et une prospérité sans faille. Dans les années 60, nous faisions état des déclarations lénifiantes de MM. Lamouche et Chevalier affirmant avec hauteur les qualités techniques de l'entreprise qu'ils dirigeaient pendant que se préparaient les mauvais coups contre elle.
Des preuves de la capacité des productions de la qualité des travaux, on en découvrait tous les jours dans tous les ateliers : chaudronnerie, turbines, menuiserie... Tout changeait, les créations se succédaient.
On recherchait des formes, des dimensions nouvelles pour obtenir une meilleure efficacité des machines-outils : planeuses, perceuses, cisailles, presses, cintreuses, tours, machines à découper au chalumeau (oxy-découpage), machines à bois, grenailleuse, etc.
À l'appui de ces affirmations, nous aurions pu multiplier les témoignages d'ingénieurs, de techniciens qui ont vécu l'évolution des progrès dans le domaine de la construction navale, l'utilisation des moyens les plus perfectionnés avec pour objectif une plus grande rapidité, d'exécution, un accroissement de la productivité, l'économie des forces humaines, la recherche des meilleures conditions de travail et de sécurité.
Toutes les personnes consultées auraient sans nul doute étoffé notre historique de précieux renseignements et d'arguments péremptoires pour confondre les détracteurs de la Navale seynoise.
Faisons parler seulement, M. Michelis, ingénieur dans les Chantiers navals de 1932 à 1969, donc pendant 37 ans, qui possédait d'abondantes archives très bien classées, ce qui explique la raison de notre choix.
Pendant ses longues années au service de la construction navale, M. Michelis avait acquis une grande expérience ayant travaillé d'abord dans le bureau d'études Machines en 1939 puis au bureau d'études Coque en 1945. La plus grande partie de sa carrière, il la passa sur les travaux.
Sa riche documentation, nous l'avons consultée en écoutant ses commentaires dont nous ne pouvons donner ici que des passages fragmentaires.
Par exemple : on sait que le berceau d'un navire en construction est enduit d'une couche de suif pour faciliter le lancement de la coque vers la mer. Mais le suif doit être réchauffé, ce qui est parfois malaisé par des temps froids et dans le passé de fâcheux contre-temps obligèrent les lanceurs à utiliser des vérins jusqu'au jour où l'on apprit que la qualité du suif dépendait de la nourriture des animaux.
Alors on découvrit le Base Kol, matière grasse plus facile à ramollir par le chauffage, ce qui fut une amélioration importante dans les techniques du lancement. Il y en eut d'autres. Les tins, pièces de bois qui soutenaient la coque du navire en construction, furent remplacés par des pièces métalliques soudées conjointement à la coque et à la cale et coupées au chalumeau avant le lancement.
Puis ce fut l'aire de la préfabrication qui débuta en 1949 et le gros démarrage en 1958 avec des éléments de 60 à 80 tonnes assemblés dans le bassin. On s'acheminait vers la disparition des cales.
On n'en finirait pas d'énumérer des progrès techniques dans tous les ateliers. M. Michelis citait la création de cette fameuse chaudière F.C.M. (de M. Buffet) qui assurait le passage de la vapeur ordinaire à la vapeur surchauffée. Il vit triompher aussi le moteur Diesel. Il suivit de près le passage du rivetage à la soudure électrique pratiquée en 1945 pour les petits travaux et généralisée en 1947 sur tous les bateaux.
Ce fut aussi dans cette période que nos ingénieurs des chantiers imaginèrent des cheminées spéciales appelées Strombos dont la forme et l'orifice créaient un tourbillon marginal entraînant les fumées en spirales qui ne pouvaient se rabattre sur le pont des navires.
Une autre étape importante à ne pas omettre : à partir de 1958, toutes les commandes du navire partirent du tableau de bord établi dans la partie la plus haute des superstructures.
N'avait-on pas créé dans cette période un service contrôle chargé de toutes les fabrications de l'entreprise en vérifiant la qualité des productions, en détectant les moindres défauts, en informant la Direction qui voulait des produits compétitifs à souhait. Ce service disposait des appareils les plus performants de radiométallographie, de gammagraphie (rayons gamma), d'appareils ultra-sons. Et l'on parla de la C.A.O. (Conception Assistée par Ordinateur). Avec les techniques nouvelles, c'était maintenant l'ordinateur qui remplaçait la planche à dessin et la machine à calculer. Il fixait les formes du navire, déterminait les poids, les surfaces, les volumes, la résistance des matériaux. Il s'en suivit bien évidemment des progrès énormes dans la rapidité des études.
Nous pourrions allonger la liste des performances remarquables et de réalisations qu'on pouvait qualifier de première mondiale. Il n'est pas possible de passer en revue tous les problèmes techniques, tous les moyens de perfectionnement recherchés dans toutes les phases de la construction navale.
Au cours de leurs longues années d'activités, les bureaux d'études, les personnels (toutes catégories confondues) ont apporté des preuves indiscutables de leurs capacités d'adaptation à passer d'un type de construction à un autre.
Nous l'avons montré tout au long de cet historique en précisant l'extrême diversité des travaux réalisés et leur dynamisme grâce auxquels dans aucun domaine nos chantiers ne prirent du retard.
Nous passerons sur les perspectives d'évolution de la Construction navale avec de nouveaux concepts comme l'aéroglisseur amphibie, l'hydroptère, les bâtiments propulsés sur coussins d'air (les naviplanes),...
Nul doute, si les événements n'avaient pas pris la tournure catastrophique que les Seynois ont douloureusement vécue, que le savoir-faire, l'esprit créatif, la volonté des personnels de chantiers auraient probablement amplifié leur image de marque.
Que faudrait-il dire encore pour amener à un peu plus de bon sens les détracteurs de nos chantiers seynois ?
Espérons que cette rubrique intitulée : « Des mises au point nécessaires » aura suffi à rectifier leur opinion et les convaincre de rendre équitable le jugement de la postérité.
Nous aurions préféré qu'ils nous apportent des lumières sur la politique européenne et l'affaiblissement économique qui ont gangrené nos chantiers... et les autres.
Nous souhaitons les persuader que nous, Seynois de vieille souche, avons eu à coeur à travers ces lignes, de perpétuer des souvenirs attachants, toujours si présents à notre mémoire où tant de nos ancêtres furent impliqués.
Sans doute des censeurs impitoyables ne manqueront pas de nous accuser d'un certain orgueil teinté de chauvinisme.
Tant pis ! Nous n'en serons nullement fâchés.
En terminant cet ouvrage, nous avons le sentiment d'avoir ajouté une nouvelle pierre à ce modeste édifice d'histoire locale intitulé « Images de la vie seynoise d'antan ».
Notre désir peut se résumer ainsi : rappeler et mémoriser ce que fut le dur labeur de nos ancêtres fondateurs de la communauté seynoise en des lieux d'accès difficile par leur nature hostile qu'il fallut améliorer au cours des décennies des XVIIe et XVIIIe siècles.
Ancêtres au courage indomptable qui luttèrent âprement contre la piraterie venue d'Afrique et du Moyen-Orient, mais aussi contre les exploiteurs de l'intérieur les abbés-seigneurs retranchés dans leur Castellum de Six-Fours.
Ancêtres créateurs d'une petite industrie navale tout juste nécessaire à ses débuts à l'exploitation des richesses de la mer, une activité artisanale dont l'évolution fulgurante allait doter la France, à partir du XIXe siècle de l'un des plus grands chantiers de constructions navales de réputation internationale par l'importance et la qualité de ses travaux. Il fallait donc vénérer ces générations de travailleurs hommes, femmes et enfants qui travaillèrent longtemps dans des conditions misérables et contribuèrent efficacement à l'enrichissement des patrimoines local, régional, national, sans oublier la défense du pays.
Au fil de nos recherches documentaires, des témoignages nombreux de vieux travailleurs, des récits vivants, de nos souvenirs personnels, il est apparu que le sujet de la Navale était vaste et que toutes les facettes présentaient un intérêt certain.
Il a été dit dans l'avant-propos qu'il fallait éviter de donner à l'ouvrage un caractère de « fourre-tout » sans quoi l'accumulation de sujets infiniment variés aurait pu donner un fatras incohérent.
Il est certain que quelques lecteurs trouveront ce défaut à la lecture de l'ouvrage. Il y aura sans doute des censeurs impitoyables qui estimeront que tout n'était pas à dire.
Pour être plus complète, l'histoire de la Construction navale aurait pu se faire en plusieurs volumes : l'un traitant des origines, l'autre des plus belles réalisations, d'autres des conditions de travail, des problèmes de syndicalisme et de la mutualité, des périodes prospères en alternance avec les récessions économiques, etc.
À la vérité, tous ces sujets ont été liés, mais leur imbrication a été un exercice délicat en observant toutefois qu'un ordre chronologique rigoureux a été respecté.
Naturellement, il fallait mettre en valeur les constructions magnifiques mises au service des compagnies de navigation et de la Marine militaire. Nous l'avons fait en parlant de quelques navires plus célèbres que d'autres par leurs qualités et leurs exploits.
Il était bien normal de parler de ceux qui les avaient conçus et construits, de leurs problèmes personnels, des problèmes sociaux.
Fallait-il ignorer le rôle du pont basculant ? Celui de la Bourse du travail ? La conduite de certains responsables des chantiers pendant l'occupation allemande ? Les batailles revendicatives ? Le problème des immigrés, toujours d'actualité... on voit bien que l'histoire de la Construction navale à La Seyne, comme ailleurs, passe par tous ces aspects.
Dans la dernière partie de l'ouvrage, nous avons insisté beaucoup sur toutes les luttes menées par les travailleurs (toutes catégories confondues) et les populations seynoise et varoise pour la sauvegarde de l'industrie navale.
Il aurait été inadmissible que ce passé de combativité soit vite gommé de la tradition des luttes seynoises, que les réalisations spectaculaires de nos ouvriers, techniciens, ingénieurs tombent dans l'océan de l'oubli ou ne s'estompent rapidement dans l'histoire de notre communauté.
La Seyne entière a le devoir de cultiver le souvenir de ses enfants qui apportèrent à leur ville, à leur pays et même à l'humanité des richesses incalculables malgré les pires souffrances physiques et morales.
Au rappel de ce passé glorieux, les Seynois vibreront longtemps dans leurs fibres les plus intimes. C'est bien pour cela qu'ils sont devenus irréconciliables avec les politiciens de tous bords restés sans solutions pour l'industrie navale et bien d'autres.
Et pourtant, les conditions n'étaient-elles pas réalisées pour accomplir des projets grandioses sur les bords de la Méditerranée ?
Quand le port de Brégaillon fut inauguré, des économistes compétents lui donnèrent un avenir international.
La France pourrait être dotée, disaient-ils, avec Marseille et La Seyne à l'Est, et Sète à l'Ouest d'un ensemble d'équipements portuaires efficace permettant d'ouvrir des débouchés sur tout le pourtour méditerranéen, desservis admirablement par une situation géographique exceptionnelle, une desserte complète à la fois routière auto-routière et ferroviaire.
Et toute l'activité portuaire serait forcément complémentaire de l'industrie navale.
N'était-il pas souhaitable que ce port de Brégaillon entretienne des relations régulières avec la Compagnie algérienne de navigation ?
Et La Seyne n'avait-elle pas eu la chance d'avoir vu s'installer précisément dans cette base de Brégaillon le Centre National d'Exploitation des Océans (C.N.E.X.O.), structure existant depuis quelque trente ans et dont les activités s'articulent autour de cinq thèmes principaux : ressources vivantes, ressources minérales et fossiles, pénétration de l'homme en milieu marin, protection de l'environnement et aménagement du littoral, interaction océan-atmosphère.
Hélas ! Ces espérances de toute une population sont bien déçues. Le port de Brégaillon végète, et des rares bateaux qui s'y amarrent, à l'opposé, le regard découvre depuis déjà sept ans le spectacle abominable du désert industriel, du « No man's land » comme disent certains.
Comment voulez-vous que les Seynois, si fiers de leur passé, n'en souffrent pas, surtout après avoir entendu l'un des plus hauts dignitaires de la République déclarer il y a quelques mois, que « l'on s'était peut-être trop pressé de démanteler la construction navale française ».
Dans cette conclusion, nous voulons exprimer notre reconnaissance à deux organisations nées après le véritable cataclysme social dont notre ville a été victime.
La première appelée « Sillages », dont le nom à lui seul évoque la mer et les navires, s'est proposé, sous la Direction de l'ingénieur Marc Ferrier, de rassembler des archives, des maquettes, des photos, des témoignages... en vue de pérenniser le passé glorieux des chantiers navals seynois.
Déjà un travail remarquable a été fait avec des expositions, des conférences, des publications, l'édition d'un ouvrage superbe intitulé Les Pionniers que toutes les bibliothèques scolaires et familiales devraient posséder.
La seconde association revêt un caractère tout différent avec son désir ardent d'apporter un soutien aux victimes de la catastrophe. Il s'agit de l'A.M.I.A.N.S. (Association de Maintien des Intérêts des Anciens de la Navale Seynoise) groupement fondé en 1989 et présidé par Baptistin Colonna. Cette structure est venue assurer la continuité du service social de la Normed disparue.
Tous les anciens salariés des Chantiers y ont leur place. L'A.M.I.A.N.S., comme l'a énoncé Colonna, apportera son concours pour résoudre des problèmes d'ordre collectif ou des situations personnelles : recherche d'un emploi, liquidation de fin de carrière, demande de retraite, pension de réversion pour les veuves, aide au logement. Le rôle de l'A.M.I.A.N.S. se concrétise donc par l'information, l'orientation vers les services compétents, afin de constituer des dossiers bien ficelés.
Il est tout de même lamentable de constater dans notre République dite démocratique, que la politique de ses dirigeants est peu soucieuse du sort des travailleurs. L'État ordonne, le Patronat décide, les licenciements suivent sans consultation aucune des intéressés. Serait-ce le retour à l'esclavagisme, un mal que Diderot définissait en ces termes au XVIIIe siècle : « Avoir des esclaves n'est rien ; ce qui est intolérable c'est d'avoir des esclaves et de les appeler citoyens ».
Volontairement, tout au long de cet historique, nous n'avons pas voulu nous livrer au jeu des querelles politiques au travers des multiples interventions des élus ou personnalités diverses, exception faite pour quelques édiles municipaux particulièrement impliqués dans les problèmes économiques locaux.
Nous avons évité de parler des projets de réindustrialisation qui ont sombré dans les confusions et les magouilles. Les années ont passé et rien de tangible n'apparaît à l'horizon. Malgré tout, les Seynois se prennent toujours à espérer que, parmi leurs enfants, il se trouvera bien une équipe de gens sérieux, compétents, dévoués et honnêtes pour sortir notre communauté du marasme, une crise qui hélas gagne le pays tout entier au moment où ces lignes sont écrites. Certes, La Seyne a besoin d'équipes novatrices. Et la Nation française ?
Nous conseillons aux politiciens de l'heure présente de relire le texte de la déclaration qui suit, prononcée à l'Assemblée consultative d'Alger en Novembre 1943.
« La France veut que cesse un régime économique dans lequel les grandes sources de la richesse nationale échappaient à la Nation, où les activités principales de la production et de la répartition se dérobaient à son contrôle, où la conduite des entreprises excluait la participation des organisations de travailleurs et de techniciens, dont cependant elle dépendait. Il ne faut plus qu'on puisse trouver un homme, ni une femme qui ne soient assurés de vivre et de travailler dans des conditions honorables de salaire, d'alimentation, de loisirs, d'hygiène et d'avoir accès au savoir et à la culture ».
Ces paroles admirables devaient se concrétiser par la suite dans l'application du programme du Conseil National de la Résistance..., programme dont la réalisation fragmentaire avait tout de même permis des acquis économiques et sociaux.
Cinquante ans se sont écoulés depuis et nous assistons hélas ! à leur remise en cause, à tel point qu'on peut qualifier de véritable recul historique les mesures prises par les gouvernants de ces dernières décennies.
... N'oublions pas de dire que cette déclaration de l'Assemblée consultative d'Alger fut prononcée par le Général de Gaulle.
Annexe 1 : Liste des directeurs des Chantiers Navals Seynois
F.C.M.
|
|
Total |
|
Total |
|
|
150-200 salariés |
|
2200 |
|
|
4000 |
|
2600 |
|
|
2630 |
|
2500 |
|
|
1940 |
|
2300 |
|
|
2340 |
|
2250 |
|
|
2920 |
|
1940 |
|
|
2900 |
|
1614 |
|
|
3440 |
|
1919 |
|
|
4040 |
|
2266 |
|
|
3250 |
|
2234 |
|
|
2660 |
|
2950 |
|
|
2220 |
|
|
|
Années |
Maîtrise |
Dessinateurs |
Techniciens |
Employés |
Ouvriers |
Total |
|
1949 |
205 |
200 |
47 |
398 |
2592 |
3442 |
|
1950 |
219 |
202 |
48 |
400 |
2504 |
3373 |
|
1951 |
221 |
199 |
49 |
403 |
2644 |
3522 |
|
1952 |
229 |
199 |
54 |
409 |
2752 |
3641 |
|
1953 |
233 |
197 |
60 |
414 |
2891 |
3800 |
|
1954 |
242 |
191 |
69 |
397 |
2740 |
3633 |
|
1955 |
252 |
136 |
73 |
416 |
1914 |
3841 |
|
1956 |
243 |
200 |
74 |
428 |
2653 |
3623 |
Annexe 4 : Effectifs détaillés des Chantiers au 12 juin 1973
|
Ingénieurs et cadres |
|
|
Employés, techniciens, dessinateurs, maîtrise |
|
|
Ouvriers |
|
|
Apprentis |
|
|
TOTAL |
|
Retour à la page d'accueil du site
 |
|
 |
© Jean-Claude Autran 2023