
Lettre T
|
Ta, tap |
Bouchon, tampon. |
|
Tabernacle |
Qualifie un individu insupportable par sa lourdeur, son apathie : « Un tabernacle pareil ! ». |
|
Tâcher moyen |
Renforcement pléonastique du verbe tâcher, c'est-à-dire essayer de, faire en sorte que, faire des efforts pour venir à bout de. Exemple : « Tâchez moyen de terminer ce travail ! ». « Et tachez moyen d'écouter un peu ce que je dis - que vous en ayez pour votre argent ! ». |
|
Tafanàri |
Désigne un fessier, surtout quand il est d'importance (de l'argot français tafanard). Un tafanàri comme l'Arc de Triomphe, ou comme la Porte d'Aix. |
|
Tail (n.m.) |
Entaille, incision dans un terrain, à partir de laquelle on entame un bêchage, une récavade (du prov. tai, tranchant, fil d'une lame). |
|
Taille-cèbe (n.m.) |
Appellation familière de la courtilière ou taupe-grillon, insecte orthoptère ensifère qui creuse des galeries et se nourrit de vers, insectes ou racines (prov. taio-cebo, c'est-à-dire : qui coupe les oignons) (cf. terraioun). |
|
Taillole |
En Provence, ceinture de laine avec laquelle les hommes retiennent leur pantalon (prov. talholo, taiolo). |
|
Tambour |
Nom familier d'un poisson de mer (Umbrina cirrosa), ainsi nommé en raison des claquements qu'il produit avec sa queue lorsqu'il est capturé. |
|
Tanos |
Plume naissante d'un oiseau (prov. tano) et, par extension, poil en formation, bulbe durci qui dépasse de la peau d'un visage, grain de beauté sur lequel quelques poils ont poussé. |
|
Tanquer |
Planter, enfoncer, planter (un objet pointu dans le sol, dans un support). Pétanque vient de pèd, pied, et tanca, fixé au sol. (cf. claver). Autre sens : attendre, faire le pied de grue. « Elle est venue, mais elle m'a fait tanquer plus d'un heure ! ». |
|
Tant |
Conjonction de coordination qui introduit une supposition, comme dans : « il est bien possible que... », ou « si ça se trouve,... ». « Tant, il arrive que demain ! » (sens du prov. tant). Tant peut avoir également le sens de si, ou de aussi : « Marche pas tant droit, jeune, tu vas te casser ! », ou encore : « Fai te vèire ! » « Pas tant couioun ! » (Pas si bête !). |
|
Tante Rose |
Euphémisme pour dire qu'une femme a ses règles. On disait aussi, en imitant le cri du coq, comme un cocorico prolongé : « Tante Rose ! La poule a fa l'uou ». |
|
Tapé, tapet |
Escargot, limaçon (Helix aperta) dont la coquille est fermée par un mucus blanchâtre épais pendant l'hibernation, (du prov. tap, bouchon ; du moyen fr. taper, boucher) et qui donnait d'excellents plats pour l'aïoli. |
|
Tapenié |
Câprier (Capparis spinosa), arbuste de la famille des capparidacées, qui produit la tapène (câpre), bouton à fleur du tapenié qui se confit dans du vinaigre et sert de condiment. |
|
Taper des mains |
Expression parfois préférée à applaudir, que d'aucuns jugent trop savante... |
|
Taquet |
Violent coup de poing, gifle, ou coup de pied. Il lui a balancé un de ces taquets ! (cf. prendre à la châtaigne). |
|
Taradèu, aladèr |
Filaire ou philaria, arbrisseau très commun de la garrigue. L'espèce philaria à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia) est l'aladèr mascle ; l'espèce à larges feuilles est le gros aladèr. |
|
Tarente (n.f.) |
Gecko, sorte de lézard aux yeux gloguleux et aux pattes munies de ventouses, qui peut se déplacer sur les surfaces verticales et lisses, d'une espèce commune dans le sud de la France (genre Tarentola). |
|
Targue |
(Du prov. targo, bouclier échancré à droite pour laisser passer la lance, plastron de jouteur). Joute sur l'eau, divertissement usité en Provence. A gagna la targo - Lou patron Vincent - Emé sa lancette - N'a fa toumba cent... |
|
Tartifle (n.m. ou n.f.) |
Topinambour. Dans d'autres régions, c'est la pomme de terre. |
|
Tassèu |
Emplâtre, topique ; soufflet sur la joue ; tasseau, morceau de bois qui sert à soutenir une étagère ; importun, personne lourde et indolente qui n'est bonne à rien. |
|
Tasta |
Goûter, déguster ; tâter, toucher, palper. Les élèves de Martini assaillaient autrefois Pierre la Chique, le marchand de sucreries, en lui criant : « Pierré ! Fai tasta ! ». Alors notre personnage se déchaînait et se répandait en invectives amères et s'écriait en provençal : « Garça mi lou camp, capoun de bouan diou ! ». |
|
Tavan |
Taon, grosse mouche et parfois bourdon, grosse abeille, hanneton, etc. Ainsi, le tavan merdassier désigne, soit le bousier (Ateuchus sacer), soit la mouche à merde (Lucilia Caesar) (et au figuré, un emmerdeur). |
|
Tchiapacan, chapacan |
Employé de la fourrière ou la fourrière elle-même. Ce terme (du prov. achapa, attraper, et can, chien ; ou du piémontais ciapa can) désignait autrefois un individu un peu marginal qui vivait du commerce des chiens qu'il attrapait dans les rues et revendait pour leur peau. Par extension, clochard, bon à rien : Etre habillé comme un tchiapacan. |
|
Tchoi |
Appellation familière impersonnelle (cf. bicou). A pétanque, au tireur : « Vas-y ! Tchoi, lève-la de bon coeur ! ». |
|
Tè ! |
Tiens ! Regarde ! Prends ! (Impératif du verbe teni, et exclamation de surprise). Ah ! tè peut aussi avoir le sens de adieu ! (ah ! tè espargno : adieu mes économies) ou signifier à un enfant que quelque chose d'intéressant à regarder (train, auto, etc.) vient de passer, que c'est fini : Ah ! tè. |
|
Tencho |
Teinte, teinture : Faire la tencho : tremper les filets de pêche dans une dissolution d'écorce de pin broyée (rusco) pour les préserver de l'action corrosive de la mer. Moulin à tencho, cf. moulin à rusco. |
|
Tenir |
Pour un commerçant, ne pas le tenir correspond à se vendre bien. « Vous vouliez de ce rosé de Provence ? Je ne le tiens pas ! ». Au contraire, je n'en tiens pas, signifie : je ne fais pas cet article. |
|
Terrailles |
Poteries, objets en terre, vases de terre, vaisselle de terre (mot francisé du prov. terràio). |
|
Terraioun |
Terrassier. Le terme désigne également la courtilière, ou taupe-grillon, gros insecte orthoptère fouisseur et nuisible aux cultures (cf. taille-cèbe). |
|
Testard, testo d'aï, testoun |
Têtu, entêté opiniâtre, tête d'âne (du prov. testo, tête). Un parent d'élève avait francisé le mot en disant au maître : « Eh ! Oui ! Mon petit, il est têtard ! ». Le substantif correspondant (entêtement) est la testardise. |
|
Tèste-negro |
Fauvette à tête noire, oiseau passereau du genre Sylvia. |
|
Thonaille, tounaio |
Filet dérivant dédié au thon (cf. madrague). |
|
Tian |
Grand plat de terre large et peu profond, terrine, écuelle sans oreilles. Terme autrefois utilisé pour la bassine où l'on faisait manuellement la vaisselle. « Le tian est sur la pile ». |
|
Tible |
Truelle, outil de maçon (prov. tiblo) ; son contenu : une tible de mortier. |
|
Tina, tinèu, tino |
Cuve, cuvier, cuveau, notamment cuve à faire le vin. |
|
Tintaine |
Tintoin, tapage, tracas, débauche, veille (du prov. tintèino, tintaino, de l'espagnol titiritaina, bruit de flûtes, et du bas latin tintinnum, sonnettes). Faire tintaine, c'est faire la débauche, faire du bruit ou être sur pied toute la nuit. Faire tintaine s'applique aussi à une personne agitée ou qui se retourne souvent pendant son sommeil, ainsi qu'à un nourrisson qui passe une nuit agitée, qui pleure, qui cluisse. |
|
Tintaine |
Petite échelle qui sort de l'arrière du bateau des jouteurs sur laquelle ils se tiennent debout pour combattre ; joute sur l'eau (du prov. tintèino ou tintèno, de l'italien tintenna, "en vacillant". |
|
Tiragasso |
Salsepareille d'Europe, salsepareille rude (Smilax aspera) : liane-arbrisseau épineuse à fleurs odorantes et à fruits rouges en grappes, qui bloque souvent toute progression dans les sous-bois (cf. aglariat, rin vierge). |
|
Tirasse-pute |
Moto (du prov. tirassa, traîner, tirer après soi). (Les premières motos étaient ainsi appelées par les honnêtes gens que ces engins dérangeaient - et qui considéraient que les filles s'y laissant emmener étaient nécessairement de mœurs suspectes). |
|
Tiro-puou (à) |
Faire quelque chose à tiro-puou (ou à tiro-péu), « à tire-poil » : faire quelque chose en vitesse, à temps perdu, sans prendre le temps de fignoler, bâcler son travail. Pourrait provenir (?) de l'expression jeter quelque chose a tiro-péu, c'est-à-dire jeter quelque chose à la gribouillette (à condition qu'on puisse tirer les cheveux de celui qui s'en empare), ce qui se fait dans les baptêmes lorsque le parrain jette de l'argent ou des dragées. Es a tiro-péu, on se l'arrache. |
|
Titè (n.f.) |
Poupée, petite fille fort parée, cocotte, fille de mœurs suspectes. |
Titou |
Petit objet et, en particulier, petite partie d'un dispositif mécanique (bouton, vis, petite boule, etc.). Petit bouton permettant d'actionner un mécanisme, petite protubérance d'un objet. Cf. bitoniau. Titou désigne aussi un individu de petite taille (p'titou), un bouchon. Au quartier Beaussier autrefois, Scipion Magliotto était surnommé « Titou », car il était très petit. Au contraire, son fils aîné, Baptistin, qui était d'unetaille hors du commun, était surnommé « le Grand Titou ». |
|
Toc, tock |
Gros morceau. « T'as pas un tock de bois ? ». Pourrait provenir du provençal toc, to, toco, toqui, qui signifie notamment masse, gros morceau : un to de ferre. |
|
Tomber |
En Provence, tomber connaît un emploi transitif direct au sens de laisser tomber ou faire tomber. Cette "faute de français" demeure encore fréquente : « Si tu tombes ta tirelire, tu la casses ! ». |
|
Torpilleur |
Véhicule, tonneau de vidange (cf. bouto) monté sur deux roues, destiné à la collecte du contenu des toupines. Véhicule hippomobile au XIXe siècle, il devint un engin motorisé dans les quelques années qui précédèrent la mise en service de l'Émissaire commun. Pourquoi le torpilleur ? Probablement parce qu'on le fuyait comme un navire aurait fui face à la menace d'une torpille. La puanteur que répandait ce véhicule constituait une telle agression qu'on le considérait comme un danger redoutable, surtout quand il venait à la rencontre d'un piéton. Ce dernier n'avait d'autre recours que de tourner les talons, en pressant son mouchoir sur ses narines. On disait alors : « Attention, ça torpille ! ». |
|
Tòti |
Butor, gros imbécile, niais, gauche, emprunté (du prov. tòti, souche, et, par extension, pantin immobile) (cf. babalu, caffalo, darnagas, estordi, fada, etc.). |
|
Tóulisso, téulisso (n.f.) |
Toiture, toit, couverture de tuiles. |
|
Tóulissié, téulissié |
Moineau, pierrot, ou toiturier commun, oiseau passereau du genre Passer (cf. gnotti). |
|
Toupin |
Récipient, généralement pot de terre cuite muni d'un couvercle, utilisé notamment pour le lait ou pour préparer et tenir au chaud les aliments, les tisanes, etc. Les plats et les toupins étaient curés jusqu'à la dernière miette. Le toupin désignait aussi le pot de chambre individuel que l'on transvasait dans la toupine familiale. Être sourd comme un toupin qualifie la surdité profonde. |
|
Toupine |
Pot de terre à deux anses (prov. toupino), usité à l'origine pour mettre de l'huile, du miel, des olives ou de la graisse, petite jarre. Pour les Provençaux de vieille souche : récipient en terre cuite, de quelque trente à quarante centimètres de haut, en forme d'urne fortement ventrue dans sa partie centrale, reposant sur une embase circulaire d'environ quinze centimètres de diamètre, et ouvert largement vers le haut. Cette ouverture étant bordée et renforcée par un bourrelet dont la forme rappelle les contours d'une bouche lippue, l'expression avoir des lèvres comme un rebord de toupine était d'un usage courant chez nos anciens. Son usage se répandit un jour en Provence comme seau hygiénique, surtout chez les citadins (qui n'avaient ni tas de fumier, ni pàti dans un jardin). |
|
Toupinier |
C'est ainsi qu'on nommait le préposé à la vidange des toupines, celui qui conduisait le torpilleur. C'est moi le toupinier... Qui dans tous les quartiers... Fais mon petit métier... Et sans faire péter le bédélé... Je vide tous les jours des toupines... J'en ramasse des tas... J'en trouve à chaque pas... (chanté autrefois à l'Eden-Théâtre). |
|
Tourdereau |
Variété de rouquier, poisson qui fréquente uniquement les côtes rocheuses, comme le labre paon ou le crénilabre. |
|
Tourdre (n.m.) |
Oiseau passereau du genre Turdus : la grive et ses différentes espèces : draine, tourd, mauvis, litorne. Les vieux provençaux avaient surnommés les Corses Li Tourdre (du latin turdus, grive) par comparaison aux oiseaux migrateurs. |
|
Tourner |
Mélanger (par exemple, le sucre dans le café). « Tè, le café ! J'ai mis deux grains de sucre, t'as plus qu'à le tourner ». |
|
Tousque |
Touffe isolée d'arbres, d'arbustes ou de buissons ; cépée, fourré (prov. tousco). Les tousques des Terres Gastes. |
|
Toussihoun (n.m.) |
Petite toux, toux sèche, toux chronique. |
Tout |
Employé pour exprimer la ressemblance : C'est tout son père (c'est tout le portrait de son père). Avoir tout l'air de. Ça en a tout l'air. |
|
Tout ! |
Tout ! (à la fin d'une énumération) signifie, en mauvaise part : tout ce qu'il est possible de faire, la totale, quoi ! « Il l'embête en classe, il lui envoie de l'encre, il lui casse ses crayons, il lui coupe ses gommes, tout ! ». Egalement, en fin de phrase, signifie tout ce qu'on peut imaginer : « J'avais un cor superbe... Sensible et tout... Je savais le temps trois jours à l'avance » (Marcel Pagnol, César). |
Tout à l'heure |
Peut signifier : « Encore un peu », ou « il s'en est fallu de peu ». Par exemple : « Il m'examine le fond de la gorge avec le manche de la cuillère que tout à l'heure, il me fait vomir... ». |
|
Tóutenière |
Calamarette, ustensile pour la pêche aux calmars (prov. tóuteno), ou autres céphalopodes : Faisceau de gros hameçons réunis par leur partie droite (cf. roumagnole). |
|
Tóuteno |
Calmar, encornet, espèce de mollusque que l'on mange farci d'herbes. Tóuteno est également un qualificatif injurieux. |
Tracassin |
En français : humeur inquiète et agitée. En provençal : semblerait désigner une marotte (sceptre surmonté d'une tête grotesque) (?) |
|
Train coquin |
Grand tracas, remue-ménage, tapage d'enfer (prov. trin couquin, trin dóu diable) (cf. l'expression française le diable et son train ?). |
|
Traviole |
Rue transversale, généralement étroite ; chemin de traverse. De traviole : locution adverbiale signifiant de travers (cf. de biscànti). |
|
Treize |
Treize reste raide ! Expression utilisée notamment à la pétanque, dérivant du fait que le chiffre 13 porte malheur : lorsque la mène est en 15 points, on considère que celui qui atteint le score de 13 (qui est donc tout près de la victoire) n'ira pas au delà et sera battu. |
|
Tremblant |
Chez nous, être tremblant, ce n'est pas être un trembleur, c'est au contraire être intrépide, vaillant, courageux, dur à la tâche. « Nautres, lei Beaussetans, sian tremblant ! ». |
|
Trente et un, trente deux |
Trente et un, trente deux, le dernier ferme la porte. Expression dont l'origine est discutée mais qui tend à signifier : rien n'a d'importance, qui vivra verra. |
|
Tressusa, trassusa, tressuda |
Suer à grosses gouttes, transpirer, transsuder. On trouve d'ailleurs ce verbe dans le roman transsusar, l'espagnol trasudar, l'italien trasudare. La francisation de ce verbe a donné lieu à l'expression « il me prend les trois sueurs ». |
|
Tressusour |
Sueur abondante, sueur froide, sueur de la mort. D'où les expressions la tressusour me pren (l'angoisse me prend), faire veni la tressusour (mettre dans des transes mortelles). |
|
Trimard |
Vagabond, chemineau, ouvrier qui va de ville en ville pour chercher du travail. [N.B. en argot français, le trimard c'est la route, alors que le vagabond c'est le trimardeur]. |
|
Trinque (n.f.) |
Outil du jardinier ou de l'escavenier : sorte de houe à lame courbe (prov. trinco, trenco). « Une large trinque, son outil de travail, permettait à l'escavenier de remuer d'énormes masses de vase ». Voir aussi béchard, ou magaou. |
|
Trissoun |
Pilon. On tassait les grappes de raisin dans les cornues, sans les écraser tout à fait, au moyen d'un gourdin très épais à une extrémité appelé trissoun (de l'occitan trissa : triturer, piler, broyer, fouler) |
|
Trois |
Terme associé à quelque chose d'excessif, énormité. « Elle dit de ces trois de choses devant ses enfants ! ». Vient probablement de la déformation du prov. tros, morceau, fragment, tranche, qui exprime certains superlatifs, comme dans tros d'omo (gros homme), tros de couquin (fieffé coquin), tout d'un tros (sans façon). |
|
Trois-pieds |
Trépied (du prov. trespèd, de tres, trois, et pèd, pied). |
|
Trois sueurs |
Les expressions « il me prend les trois sueurs » ou « j'en ai les trois sueurs », n'ont rien à voir avec le chiffre trois mais proviennent de la déformation du verbe provençal tressusa (ou trassusa, tressuda, etc.) qui signifie : suer à grosses gouttes, transpirer, transsuder. |
|
Trompe-couillon |
Equivalent du français attrape-nigaud. |
|
Tron |
Coup de tonnerre, foudre, détonation (prov. troun). A l'origine de nombreux jurons provençaux très usités : tron de Dièu, tron de pas Dièu, tron de l'air, tron de sort, etc. Un tron de l'air, c'est aussi un enfant particulièrement insupportable, un vrai démon (cf. couquin de Dièu ). |
|
Tronche d'àpi |
En provençal, àpi signifie le céleri, mais tronche d'àpi ! est une insulte. |
Troucho |
Omelette, plus particulièrement aux fines herbes. Troucho de tapène : Omelette ou œufs brouillés aux câpres. Troucho à la meissouniero : Omelettes aux oignons. |
|
Trouner |
Tonner, faire des tonnerres (prov. trouna). |
|
Trueio (n.f.) |
Truie, laie, coche ; femme trop grasse, paresseuse, salope. La trueio a fa un porquet... n'a fa un, n'a fa dous, n'a fa tres ! |
|
Trufer |
Railler, se moquer (prov. trufa) ; tromper, tricher. Il a trufé son père au jeu de cartes ! |
|
Tuber |
Fumer (prov. tuba). |
|
Tueis, tueï |
If [et non thuya], arbre de la famille des taxacées (Taxus baccata). |
|
Tutane |
Nom d'un certain arbre (?), probablement employé naïvement pour platane. |
Accès aux autres lettres du lexique :
Retour à la page d'accueil du site
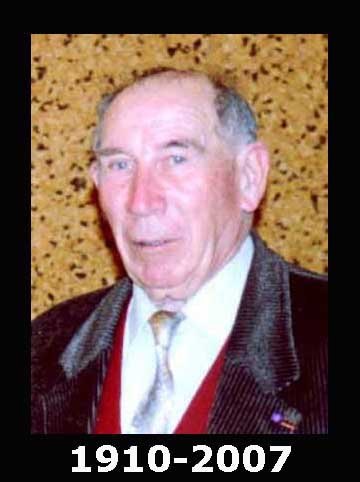 |
jcautran.free.fr
|
 |
Jean-Claude Autran 2021